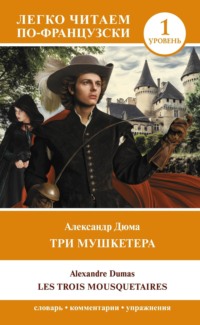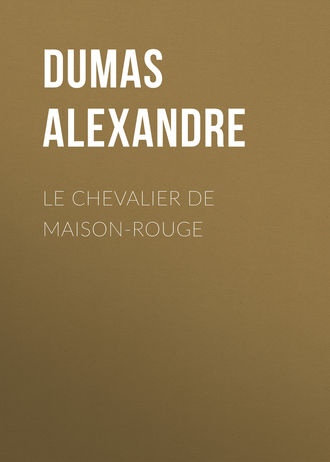
Полная версия
Le Chevalier de Maison-Rouge
Il recueillit donc toute sa présence d'esprit et attendit.
– Qui es-tu? demanda une voix encore animée par la lutte.
– Je suis un homme que l'on assassine, répondit Maurice.
– Il y a plus, tu es un homme mort, si tu parles haut, que tu appelles ou que tu cries.
– Si j'eusse dû crier, je n'eusse point attendu jusqu'à présent.
– Es-tu prêt à répondre à mes questions?
– Questionnez d'abord, je verrai après si je dois répondre.
– Qui t'envoie ici?
– Personne.
– Tu y viens donc de ton propre mouvement?
– Oui.
– Tu mens.
Maurice fit un mouvement terrible pour dégager ses mains; la chose était impossible.
– Je ne mens jamais! dit-il.
– En tout cas, que tu viennes de ton propre mouvement, ou que tu sois envoyé, tu es un espion.
– Et vous des lâches!
– Des lâches, nous?
– Oui, vous êtes sept ou huit contre un homme garrotté, et vous insultez cet homme. Lâches! lâches! lâches!
Cette violence de Maurice, au lieu d'aigrir ses adversaires, parut les calmer: cette violence même était la preuve que le jeune homme n'était pas ce dont on l'accusait; un véritable espion eût tremblé et demandé grâce.
– Il n'y a pas d'insulte là, dit une voix plus douce, mais en même temps plus impérieuse qu'aucune de celles qui avaient parlé. Dans le temps où nous vivons, on peut être espion sans être malhonnête homme: seulement, on risque sa vie.
– Soyez le bienvenu, vous qui avez prononcé cette parole; j'y répondrai loyalement.
– Qu'êtes-vous venu faire dans ce quartier?
– Y chercher une femme.
Un murmure d'incrédulité accueillit cette excuse. Ce murmure grossit et devint un orage.
– Tu mens! reprit la même voix. Il n'y a point de femme, et nous savons ce que nous entendons par femme, il n'y a point de femme à poursuivre dans ce quartier; avoue ton projet, ou tu mourras.
– Allons donc, dit Maurice. Vous ne me tueriez pas pour le plaisir de me tuer, à moins que vous ne soyez de véritables brigands.
Et Maurice fit un second effort plus violent et plus inattendu encore que le premier pour dégager ses mains de la corde qui les liait; mais soudain un froid douloureux et aigu lui déchira la poitrine.
Maurice fit malgré lui un mouvement en arrière.
– Ah! tu sens cela, dit un des hommes. Eh bien, il y a encore huit pouces pareils au pouce avec lequel tu viens de faire connaissance.
– Alors, achevez, dit Maurice avec résignation. Ce sera fini tout de suite, au moins.
– Qui es-tu? Voyons! dit la voix douce et impérieuse à la fois.
– C'est mon nom que vous voulez savoir?
– Oui, ton nom?
– Je suis Maurice Lindey.
– Quoi! s'écria une voix, Maurice Lindey, le revoluti… le patriote? Maurice Lindey, secrétaire de la section Lepelletier?
Ces paroles furent prononcées avec tant de chaleur, que Maurice vit bien qu'elles étaient décisives. Y répondre, c'était, d'une façon ou de l'autre, fixer invariablement son sort.
Maurice était incapable d'une lâcheté. Il se redressa en vrai Spartiate, et dit d'une voix ferme:
– Oui, Maurice Lindey; oui, Maurice Lindey, le secrétaire de la section Lepelletier; oui, Maurice Lindey, le patriote, le révolutionnaire, le jacobin; Maurice Lindey enfin, dont le plus beau jour sera celui où il mourra pour la liberté.
Un silence de mort accueillit cette réponse.
Maurice Lindey présentait sa poitrine, attendant d'un moment à l'autre que la lame, dont il avait senti la pointe seulement, se plongeât tout entière dans son cœur.
– Est-ce bien vrai? dit après quelques secondes une voix qui trahissait quelque émotion. Voyons, jeune homme, ne mens pas.
– Fouillez dans ma poche, dit Maurice, et vous trouverez ma commission. Regardez sur ma poitrine, et si mon sang ne les a pas effacées, vous trouverez mes initiales, un M et un L brodés sur ma chemise.
Aussitôt Maurice se sentit enlever par des bras vigoureux. Il fut porté pendant un espace assez court. Il entendit, ouvrir une première porte, puis une seconde. Seulement, la seconde était plus étroite que la première, car à peine si les hommes qui le portaient y purent passer avec lui.
Les murmures et les chuchotements continuaient.
– Je suis perdu, se dit à lui-même Maurice; ils vont me mettre une pierre au cou et me jeter dans quelque trou de la Bièvre.
Mais, au bout d'un instant, il sentit que ceux qui le portaient montaient quelques marches. Un air plus tiède frappa son visage, et on le déposa sur un siège. Il entendit fermer une porte à double tour, des pas s'éloignèrent. Il crut sentir qu'on le laissait seul. Il prêta l'oreille avec autant d'attention que peut le faire un homme dont la vie dépend d'un mot, et il crut entendre que cette même voix, qui avait déjà frappé son oreille par un mélange de fermeté et de douceur, disait aux autres:
– Délibérons.
VIII
Geneviève
Un quart d'heure s'écoula qui parut un siècle à Maurice. Rien de plus naturel: jeune, beau, vigoureux, soutenu dans sa force par cent amis dévoués, avec lesquels il rêvait parfois l'accomplissement de grandes choses, il se sentait tout à coup, sans préparation aucune, exposé à perdre la vie dans un guet-apens ignoble.
Il comprenait qu'on l'avait renfermé dans une chambre quelconque; mais était-il surveillé?
Il essaya un nouvel effort pour rompre ses liens. Ses muscles d'acier se gonflèrent et se roidirent, la corde lui entra dans les chairs, mais ne se rompit pas.
Le plus terrible, c'est qu'il avait les mains liées derrière le dos et qu'il ne pouvait arracher son bandeau. S'il avait pu voir, peut-être eût-il pu fuir.
Cependant, ces diverses tentatives s'étaient accomplies sans que personne s'y opposât, sans que rien bougeât autour de lui; il en augura qu'il était seul.
Ses pieds foulaient quelque chose de moelleux et de sourd, du sable, de la terre grasse, peut-être. Une odeur âcre et pénétrante frappait son odorat et dénonçait la présence de substances végétales, Maurice pensa qu'il était dans une serre ou dans quelque chose de pareil. Il fit quelques pas, heurta un mur, se retourna pour tâter avec ses mains, sentit des instruments aratoires, et poussa une exclamation de joie.
Avec des efforts inouïs, il parvint à explorer tous ces instruments les uns après les autres. Sa fuite devenait alors une question de temps: si le hasard ou la Providence lui donnait cinq minutes, et si parmi ces ustensiles il trouvait un instrument tranchant, il était sauvé.
Il trouva une bêche.
Ce fut, par la manière dont Maurice était lié, toute une lutte pour retourner cette bêche, de façon à ce que le fer fût en haut. Sur ce fer, qu'il maintenait contre le mur avec ses reins, il coupa ou plutôt il usa la corde qui lui liait les poignets. L'opération était longue, le fer de la bêche tranchait lentement. La sueur lui coulait sur le front; il entendit comme un bruit de pas qui se rapprochait. Il fit un dernier effort, violent, inouï, suprême; la corde, à moitié usée, se rompit.
Cette fois, ce fut un cri de joie qu'il poussa; il était sûr du moins de mourir en se défendant.
Maurice arracha le bandeau de dessus ses yeux.
Il ne s'était pas trompé; il était dans une espèce, non pas de serre, mais de pavillon où l'on avait serré quelques-unes de ces plantes grasses qui ne peuvent passer la mauvaise saison en plein air. Dans un coin, étaient ces instruments de jardinage dont l'un lui avait rendu un si grand service. En face de lui était une fenêtre; il s'élança vers la fenêtre; elle était grillée, et un homme armé d'une carabine était placé en sentinelle devant.
De l'autre côté du jardin, à trente pas de distance à peu près, s'élevait un petit kiosque qui faisait pendant à celui où était Maurice. Une jalousie était baissée, mais à travers cette jalousie brillait une lumière.
Il s'approcha de la porte et écouta: une autre sentinelle passait et repassait devant la porte. C'étaient ses pas qu'il avait entendus.
Mais au fond du corridor retentissaient des voix confuses; la délibération avait visiblement dégénéré en discussion. Maurice ne pouvait entendre avec suite ce qui se disait. Cependant quelques mots pénétraient jusqu'à lui, et parmi ces mots, comme si pour ceux-là seuls la distance était moins grande, il entendait les mots espion, poignard, mort.
Maurice redoubla d'attention. Une porte s'ouvrit, et il entendit plus distinctement.
– Oui, disait une voix, oui, c'est un espion, il a découvert quelque chose, et il est certainement envoyé pour surprendre nos secrets. En le délivrant, nous courons risque qu'il nous dénonce.
– Mais sa parole? dit une voix.
– Sa parole, il la donnera, puis il la trahira. Est-ce qu'il est gentilhomme pour qu'on se fie à sa parole?
Maurice grinça des dents à cette idée que quelques gens avaient encore la prétention qu'il fallût être gentilhomme pour garder la foi jurée.
– Mais nous connaît-il pour nous dénoncer?
– Non, certes, il ne nous connaît pas, il ne sait pas ce que nous faisons; mais il sait l'adresse, il reviendra bien accompagné.
L'argument parut péremptoire.
– Eh bien, dit la voix qui déjà plusieurs fois avait frappé Maurice comme devant être celle du chef, c'est donc décidé?
– Mais oui, cent fois oui; je ne vous comprends pas avec votre magnanimité, mon cher; si le comité de salut public nous tenait, vous verriez s'il ferait toutes ces façons.
– Ainsi donc vous persistez dans votre décision, messieurs?
– Sans doute, et vous n'allez pas, j'espère, vous y opposer.
– Je n'ai qu'une voix, messieurs, elle a été pour qu'on lui rendît la liberté. Vous en avez six, elles ont été toutes six pour la mort. Va donc pour la mort.
La sueur qui coulait sur le front de Maurice se glaça tout à coup.
– Il va crier, hurler, dit la voix. Avez-vous au moins éloigné madame Dixmer?
– Elle ne sait rien; elle est dans le pavillon en face.
– Madame Dixmer, murmura Maurice; je commence à comprendre. Je suis chez ce maître tanneur qui m'a parlé dans la vieille rue Saint-Jacques, et qui s'est éloigné en se riant de moi, quand je n'ai pas pu lui dire le nom de mon ami. Mais quel diable d'intérêt un maître tanneur peut-il avoir à m'assassiner?
– En tout cas, dit-il, avant qu'on m'assassine, j'en tuerai plus d'un. Et il bondit vers l'instrument inoffensif qui, dans sa main, allait devenir une arme terrible.
Puis il revint derrière la porte et se plaça de façon à ce qu'en se déployant elle le couvrît.
Son cœur palpitait à briser sa poitrine, et dans le silence on entendait le bruit de ses palpitations.
Tout à coup Maurice frissonna de la tête aux pieds; une voix avait dit:
– Si vous m'en croyez, vous casserez tout bonnement une vitre, et à travers les barreaux vous le tuerez d'un coup de carabine.
– Oh! non, non, pas d'explosion, dit une autre voix; une explosion peut nous trahir. Ah! vous voilà, Dixmer; et votre femme?
– Je viens de regarder à travers la jalousie; elle ne se doute de rien, elle lit.
– Dixmer, vous allez nous fixer. Êtes-vous pour un coup de carabine? êtes-vous pour un coup de poignard?
– Soit, pour le poignard. Allons!
– Allons! répétèrent ensemble les cinq ou six voix. Maurice était un enfant de la Révolution, un cœur de bronze, une âme athée, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. Mais à ce mot allons! prononcé derrière cette porte qui, seule, le séparait de la mort, il se rappela le signe de la croix que sa mère lui avait appris lorsque, tout enfant, elle lui faisait dire ses prières à genoux. Les pas se rapprochèrent, mais ils s'arrêtèrent, puis la clef grinça dans la serrure, et la porte s'ouvrit lentement. Pendant cette minute qui venait de s'écouler, Maurice s'était dit: «Si je perds mon temps à frapper, je serai tué. En me précipitant sur les assassins, je les surprends; je gagne le jardin, la ruelle, je me sauve peut-être.»
Aussitôt, prenant un élan de lion, en jetant un cri sauvage où il y avait encore plus de menace que d'effroi, il renversa les deux premiers hommes, qui le croyant lié et les yeux bandés, étaient loin de s'attendre à une pareille agression, écarta les autres, franchit, grâce à ses jarrets d'acier, dix toises en une seconde, vit au bout du corridor une porte donnant sur le jardin toute grande ouverte, s'élança, sauta dix marches, se trouva dans le jardin, et, s'orientant du mieux qu'il lui était possible, courut vers la porte.
La porte était fermée à deux verrous et à la serrure. Maurice tira les deux verrous, voulut ouvrir la serrure; il n'y avait pas de clef.
Pendant ce temps, ceux qui le poursuivaient étaient arrivés au perron: ils l'aperçurent.
– Le voilà, crièrent-ils, tirez dessus, Dixmer, tirez dessus; tuez! tuez!
Maurice poussa un rugissement: il était enfermé dans le jardin; il mesura de l'œil les murailles; elles avaient dix pieds de haut.
Tout cela fut rapide comme une seconde.
Les assassins s'élancèrent à sa poursuite.
Maurice avait trente pas d'avance à peu près sur eux; il regarda tout autour de lui avec ce regard du condamné qui demande l'ombre d'une chance de salut pour en faire une réalité.
Il aperçut le kiosque, la jalousie, derrière la jalousie la lumière. Il ne fit qu'un bond, un bond de dix pieds, saisit la jalousie, l'arracha, passa au travers de la fenêtre en la brisant et tomba dans une chambre éclairée où lisait une femme assise près du feu.
Cette femme se leva épouvantée en criant au secours.
– Range-toi, Geneviève, range-toi, cria la voix de Dixmer; range-toi, que je le tue! Et Maurice vit s'abaisser à dix pas de lui le canon de la carabine.
Mais à peine la femme l'eût-elle regardé qu'elle jeta un cri terrible, et qu'au lieu de se ranger comme le lui ordonnait son mari, elle se jeta entre lui et le canon du fusil.
Ce mouvement concentra toute l'attention de Maurice sur la généreuse créature dont le premier mouvement était de le protéger.
À son tour, il jeta un cri. C'était son inconnue tant cherchée.
– Vous!.. Vous!.. s'écria-t-il.
– Silence! dit-elle.
Puis, se retournant vers les assassins, qui, différentes armes à la main, s'étaient rapprochés de la fenêtre:
– Oh! vous ne le tuerez pas! s'écria-t-elle.
– C'est un espion, s'écria Dixmer, dont la figure douce et placide avait pris une expression de résolution implacable; c'est un espion, et il doit mourir.
– Un espion! lui? dit Geneviève; lui, un espion? Venez ici, Dixmer. Je n'ai qu'un mot à vous dire pour vous prouver que vous vous trompez étrangement.
Dixmer s'approcha de la fenêtre: Geneviève s'approcha de lui, et, se penchant à son oreille, elle lui dit quelques mots tout bas.
Le maître tanneur releva la tête.
– Lui? dit-il.
– Lui-même, répondit Geneviève.
– Vous en êtes sûre? La jeune femme ne répondit point cette fois: mais elle se retourna vers Maurice et lui tendit la main en souriant. Les traits de Dixmer reprirent alors une expression singulière de mansuétude et de froideur. Il posa la crosse de sa carabine à terre.
– Alors, c'est autre chose, dit-il. Puis, faisant signe à ses compagnons de le suivre, il s'écarta avec eux et leur dit quelques mots, après lesquels ils s'éloignèrent.
– Cachez cette bague, murmura Geneviève pendant ce temps; tout le monde la connaît ici. Maurice ôta vivement la bague de son doigt et la glissa dans la poche de son gilet.
Un instant après, la porte du pavillon s'ouvrit, et Dixmer, sans arme, s'avança vers Maurice.
– Pardon, citoyen, lui dit-il; que n'ai-je su plus tôt les obligations que je vous avais! Ma femme, tout en se souvenant du service que vous lui aviez rendu dans la soirée du 10 mars, avait oublié votre nom. Nous ignorions donc complètement à qui nous avions à faire; sans cela, croyez-le bien, nous n'eussions pas un instant suspecté votre honneur ni soupçonné vos intentions. Ainsi donc, pardon, encore une fois!
Maurice était stupéfait; il se tenait debout par un miracle d'équilibre; il sentait que la tête lui tournait, il était près de tomber.
Il s'appuya à la cheminée.
– Mais enfin, dit-il, pourquoi vouliez-vous donc me tuer?
– Voilà le secret, citoyen, dit Dixmer, et je le confie à votre loyauté. Je suis, comme vous le savez déjà, maître tanneur et chef de cette tannerie. La plupart des acides que j'emploie pour la préparation de mes peaux sont des marchandises prohibées. Or, les contrebandiers que j'emploie avaient avis d'une délation faite au conseil général. Vous voyant prendre des informations, j'ai eu peur. Mes contrebandiers ont eu encore plus peur que moi de votre bonnet rouge et de votre air décidé, et je ne vous cache pas que votre mort était résolue.
– Je le sais pardieu bien, s'écria Maurice, et vous ne m'apprenez là rien de nouveau. J'ai entendu votre délibération et j'ai vu votre carabine.
– Je vous ai déjà demandé pardon, reprit Dixmer d'un air de bonhomie attendrissante. Comprenez donc ceci, que, grâce aux désordres du temps, nous sommes, moi et mon associé, M. Morand, en train de faire une immense fortune. Nous avons la fourniture des sacs militaires; tous les jours nous en faisons confectionner quinze cents, ou deux mille. Grâce au bienheureux état de choses dans lequel nous vivons, la municipalité, qui a fort à faire, n'a pas le temps de vérifier bien exactement nos comptes, de sorte, il faut bien l'avouer, que nous pêchons un peu en eau trouble; d'autant plus, comme je vous le disais, que les matières préparatoires que nous nous procurons par contrebande nous permettent de gagner deux cents pour cent.
– Diable! fit Maurice, cela me paraît un bénéfice assez honnête, et je comprends maintenant votre crainte qu'une dénonciation de ma part ne le fît cesser; mais maintenant que vous me connaissez, vous êtes rassuré, n'est-ce pas?
– Maintenant, dit Dixmer, je ne vous demande même plus votre parole.
Puis, lui posant la main sur l'épaule et le regardant avec un sourire:
– Voyons, lui dit-il, à présent que nous sommes en petit comité et entre amis, je puis le dire, que veniez-vous faire par ici, jeune homme? Bien entendu, ajouta le maître tanneur, que si vous voulez vous taire, vous êtes parfaitement libre.
– Mais je vous l'ai dit, je crois, balbutia Maurice.
– Oui, une femme, dit le bourgeois, je sais qu'il était question d'une femme.
– Mon Dieu! pardonnez-moi, citoyen, dit Maurice; mais je comprends à merveille que je vous dois une explication. Eh bien, je cherchais une femme qui, l'autre soir, sous le masque, m'a dit demeurer dans ce quartier. Je ne sais ni son nom, ni sa position, ni sa demeure. Seulement, je sais que je suis amoureux fou, qu'elle est petite…
Geneviève était grande.
– Qu'elle est blonde et qu'elle a l'air éveillé… Geneviève était brune avec de grands yeux pensifs.
– Une grisette enfin… continua Maurice; aussi, pour lui plaire, ai-je pris cet habit populaire.
– Voilà qui explique tout, dit Dixmer avec une foi angélique que ne démentait point le moindre regard sournois.
Geneviève avait rougi, et, se sentant rougir, s'était détournée.
– Pauvre citoyen Lindey, dit Dixmer en riant, quelle mauvaise heure nous vous avons fait passer, et vous êtes bien le dernier à qui j'eusse voulu faire du mal; un si bon patriote, un frère!.. Mais, en vérité, j'ai cru que quelque malintentionné usurpait votre nom.
– Ne parlons plus de cela, dit Maurice, qui comprit qu'il était temps de se retirer; remettez-moi dans mon chemin et oublions…
– Vous remettre dans votre chemin? s'écria Dixmer; vous quitter? Ah! non pas, non pas! je donne ou plutôt, mon associé et moi, nous donnons ce soir à souper aux braves garçons qui voulaient vous égorger tout à l'heure. Je compte bien vous faire souper avec eux pour que vous voyiez qu'ils ne sont point si diables qu'ils en ont l'air.
– Mais, dit Maurice au comble de la joie de rester quelques heures près de Geneviève, je ne sais vraiment si je dois accepter.
– Comment! si vous devez accepter, dit Dixmer; je le crois bien: ce sont de bons et francs patriotes comme vous; d'ailleurs, je ne croirai que vous m'avez pardonné que lorsque nous aurons rompu le pain ensemble.
Geneviève ne disait pas un mot. Maurice était au supplice.
– C'est qu'en vérité, balbutia le jeune homme, je crains de vous gêner, citoyen… Ce costume… ma mauvaise mine… Geneviève le regarda timidement.
– Nous offrons de bon cœur, dit-elle.
– J'accepte, citoyenne, répondit Maurice en s'inclinant.
– Eh bien, je vais rassurer nos compagnons, dit le maître tanneur; chauffez-vous en attendant, cher ami. Il sortit. Maurice et Geneviève restèrent seuls.
– Ah! monsieur, dit la jeune femme avec un accent auquel elle essayait inutilement de donner le ton du reproche, vous avez manqué à votre parole, vous avez été indiscret.
– Quoi! madame, s'écria Maurice, vous aurais-je compromise? Ah! dans ce cas, pardonnez-moi; je me retire, et jamais…
– Dieu! s'écria-t-elle en se levant, vous êtes blessé à la poitrine! votre chemise est toute teinte de sang!
En effet, sur la chemise si fine et si blanche de Maurice, chemise qui faisait un étrange contraste avec ses habits grossiers, une large plaque de rouge s'était étendue et avait séché.
– Oh! n'ayez aucune inquiétude, madame, dit le jeune homme; un des contrebandiers m'a piqué avec son poignard. Geneviève pâlit, et lui prenant la main:
– Pardonnez-moi, murmura-t-elle, le mal qu'on vous a fait; vous m'avez sauvé la vie, et j'ai failli être cause de votre mort.
– Ne suis-je pas bien récompensé en vous retrouvant? car, n'est-ce pas, vous n'avez pas cru un instant que ce fût une autre que vous que je cherchais?
– Venez avec moi, interrompit Geneviève, je vous donnerai du linge… Il ne faut pas que nos convives vous voient en cet état: ce serait pour eux un reproche trop terrible.
– Je vous gêne bien, n'est-ce pas? répliqua Maurice en soupirant.
– Pas du tout, j'accomplis un devoir. Et elle ajouta:
– Je l'accomplis même avec grand plaisir. Geneviève conduisit alors Maurice vers un grand cabinet de toilette d'une élégance et d'une distinction qu'il ne s'attendait pas à trouver dans la maison d'un maître tanneur.
Il est vrai que ce maître tanneur paraissait millionnaire. Puis elle ouvrit toutes les armoires.
– Prenez, dit-elle, vous êtes chez vous. Et elle se retira. Quand Maurice sortit, il trouva Dixmer, qui était revenu.
– Allons, allons, dit-il, à table! on n'attend plus que vous.
IX
Le souper
Lorsque Maurice entra avec Dixmer et Geneviève dans la salle à manger, située dans le corps de bâtiment où on l'avait conduit d'abord, le souper était tout dressé, mais la salle était encore vide.
Il vit entrer successivement tous les convives au nombre de six.
C'étaient tous des hommes d'un extérieur agréable, jeunes pour la plupart, vêtus à la mode du jour; deux ou trois même avaient la carmagnole et le bonnet rouge.
Dixmer leur présenta Maurice en énonçant ses titres et qualités.
Puis, se retournant vers Maurice:
– Vous voyez, dit-il, citoyen Lindey, toutes les personnes qui m'aident dans mon commerce. Grâce au temps où nous vivons, grâce aux principes révolutionnaires qui ont effacé la distance, nous vivons tous sur le pied de la plus sainte égalité. Tous les jours la même table nous réunit deux fois, et je suis heureux que vous ayez bien voulu partager notre repas de famille. Allons, à table, citoyens, à table!
– Et… M. Morand, dit timidement Geneviève, ne l'attendons-nous pas?
– Ah! c'est vrai, répondit Dixmer. Le citoyen Morand, dont je vous ai déjà parlé, citoyen Lindey, est mon associé. C'est lui qui est chargé, si je puis le dire, de la partie morale de la maison; il fait les écritures, tient la caisse, règle les factures, donne et reçoit l'argent, ce qui fait que c'est celui de nous tous qui a le plus de besogne. Il en résulte qu'il est quelquefois en retard. Je vais le faire prévenir.
En ce moment la porte s'ouvrit et le citoyen Morand entra.
C'était un homme de petite taille, brun, aux sourcils épais; des lunettes vertes, comme en portent les hommes dont la vue est fatiguée par le travail, cachaient ses yeux noirs, mais n'empêchaient pas l'étincelle d'en jaillir. Aux premiers mots qu'il dit, Maurice reconnut cette voix douce et impérieuse à la fois qui avait été constamment, dans cette terrible discussion dont il avait été victime, pour les voies de douceur; il était vêtu d'un habit brun à larges boutons, d'une veste de soie blanche, et son jabot assez fin fut souvent, pendant le souper, tourmenté par une main dont Maurice, sans doute parce que c'était celle d'un marchand tanneur, admira la blancheur et la délicatesse.