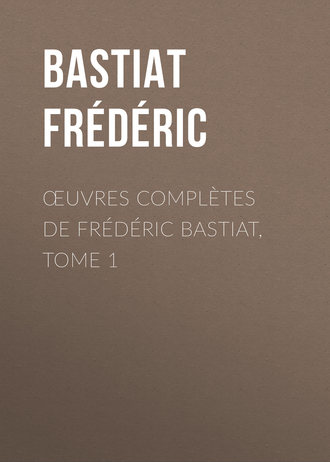
Полная версия
Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat, tome 1
Mon cher Félix, voilà bien longtemps que je ne t'ai écrit. C'est que nous sommes si éloignés et qu'il faut si longtemps pour avoir une réponse de Mugron, que je ne suis jamais sûr de la recevoir ici. Enfin me voilà à peu près décidé, et sauf circonstances imprévues, à dire adieu à la Péninsule de lundi en huit. Mon intention est d'aller à Londres; je ne puis, selon le conseil que tu me transmets, de la part de ma tante, aller d'abord à Plymouth. Le steamboat va directement à Londres. J'avais d'abord pensé à m'embarquer pour Liverpool. Je satisferais ainsi à l'économie et à mon goût pour la marine, parce que la navigation à voiles est moins chère et plus fertile en émotions que la monotone vapeur. Mais la saison est si avancée que ce serait imprudence, et je courrais le risque de passer un mois en mer.
Je me suis un peu ennuyé à Lisbonne les premiers jours. Maintenant, à part le désir bien naturel de revenir chez moi, je me plais ici, quoique j'y mène une vie uniforme. Mais ce climat est si doux, si beau, cette nature si riche, et je me sens un bien-être, une plénitude de santé si inaccoutumée, que j'attribue à cela l'absence d'ennui.
Voici un pays qui, je crois, te conviendrait bien: ni chaud, ni froid, ni brouillards, ni humidité; s'il pleut, ce sont des torrents pendant un jour ou deux, puis le ciel reprend sa sérénité, et l'atmosphère sa douce tiédeur. Partout on peut disposer d'un peu d'eau; ce sont des bosquets de myrtes, d'orangers, des treilles touffues, des héliotropes qui rampent le long des murs, comme chez nous les convolvulus. Maintenant je comprends la vie des Maures. Malheureusement les hommes ici ne valent pas la nature, ils ne veulent pas se donner la peine par laquelle les Arabes se donnaient tant de jouissances. Peut-être penses-tu que ces fervents catholiques dédaignent la fraîcheur et les parfums de l'oranger, et qu'ils se renferment dans les sévères plaisirs de la pensée et de la contemplation. Hélas! je reviendrai bien désabusé de la bonne opinion de Custine; il a cru voir ce qu'il désirait voir.
Ce sera pour moi une étude fort curieuse que celle de l'Angleterre succédant à celle de la Péninsule. La comparaison serait plus intéressante encore, si le catholicisme était aussi vivace ici qu'on se le représente. Mais enfin je verrai un peuple dont la religion réside dans l'intelligence, après en avoir vu un pour qui elle est toute dans les sens. Ici les pompes du culte: des flambeaux, des parfums, des habits magnifiques, des statues; mais la démoralisation la plus complète. Là, au contraire, des liens de famille, l'homme et la femme chacun aux devoirs de son sexe, le travail ennobli par un but patriotique, la fidélité aux traditions des ancêtres, l'étude constante de la morale biblique et évangélique; mais un culte simple, grave, se rapprochant du pur déisme. Quel contraste! que d'oppositions! quelle source de réflexions!
Ce voyage aura aussi produit un effet auquel je ne me serais pas attendu. Il n'a pu effacer cette habitude que nous avons contractée de nous observer nous-mêmes, de nous écouter penser et sentir, de suivre toutes les modifications de nos opinions. Cette étude de soi a bien des charmes, et l'amour-propre lui communique un intérêt qui ne saurait s'affaiblir. Mais à Mugron, toujours dans un milieu uniforme, nous ne pouvions que tourner dans un même cercle; en voyage, des situations excentriques donnent lieu à de nouvelles observations. Par exemple, il est probable que les événements actuels m'affectent bien différemment que si j'étais à Mugron; un patriotisme plus ardent donne plus d'activité à ma pensée. En même temps, le champ où elle s'exerce est plus étendu, comme un homme placé sur une hauteur embrasse un plus vaste horizon. Mais la puissance du regard est pour chacun de nous une quantité donnée, et il n'en est pas de même de la faculté de penser et de sentir.
Ma tante, à l'occasion de la guerre, me recommande la prudence; je n'ai absolument aucun danger à courir. Si je voyageais dans un bâtiment français et que la guerre fût déclarée, je pourrais craindre les corsaires; mais dans un navire anglais je ne cours pas ce danger, à moins de tomber sous la serre d'un croiseur français, ce qui ne serait pas bien dangereux d'ailleurs. D'après les nouvelles reçues aujourd'hui, je vois que la France a pris le parti d'une résignation sentimentale, qui devient grotesque. D'ici elle me paraît toute décontenancée; elle met son honneur à prouver sa modération, et, à chaque insulte, elle répond par des arguments en forme pour démontrer qu'elle a été insultée. Elle a l'air de croire que le remords va s'emparer des Anglais, et que, les larmes aux yeux, ils vont cesser de poursuivre leur but et nous demander pardon. Cela me rappelle ce mot: Il m'a souffleté, mais je lui ai bien dit son fait.
Adressez-moi vos lettres à Londres, sous couvert de MM. A. A. Gower neveux et compagnie.
Lisbonne, le 7 novembre 1840.Mon cher Félix, malgré le vif désir de me rapprocher de la France, j'ai été forcé de prolonger mon séjour à Lisbonne. Un rhume m'a décidé à remettre mon départ de huit jours, et, dans cet intervalle, on a trouvé des papiers qu'il faut dépouiller, ce qui me force à rester encore; mais il faudra de bien puissants motifs pour me retenir au delà du 17 de ce mois. Enfin ce retard a servi à me guérir, ce qui eût été plus difficile en mer ou à Londres.
J'ai joué de malheur de me trouver loin de la France dans un moment aussi intéressant; tu ne peux te faire l'idée du patriotisme qui nous brûle quand nous sommes en pays étranger. À distance, ce n'est plus le bonheur, ni même la liberté de notre pays qui nous occupe le plus, c'est sa grandeur, sa gloire, son influence. Malheureusement, je crains bien que la France ne jouisse guère des premiers de ces biens ni des derniers.
Je me désole d'être sans nouvelles et de ne pouvoir préciser l'époque où j'en recevrai; au moins, à Londres, j'espère trouver une rame de lettres.
Adieu, l'heure du courrier va sonner.
Paris, 2 janvier 1841.Mon cher Félix, je m'occupais d'un plan d'association pour la défense des intérêts vinicoles. Mais, selon mon habitude, j'hésitais à en faire part à quelques amis, parce que je ne voyais guère de milieu entre le succès et le ridicule, quand M. Humann est venu présenter aux chambres le budget des dépenses et recettes pour 1842. Ainsi que tu l'auras vu, le ministre ne trouve rien de mieux, pour combler le déficit qu'a occasionné notre politique, que de frapper les boissons de quatre nouvelles contributions. Cela m'a donné de l'audace, et j'ai couru chez plusieurs députés pour leur communiquer mon projet. Ils ne peuvent pas s'en mêler directement, parce que ce serait aliéner d'avance l'indépendance de leur vote. C'est une raison pour les uns, un prétexte pour les autres; mais ce n'est pas un motif pour que les propriétaires de vignes se croisent les bras, en présence du danger qui les menace.
Il n'y a qu'un moyen non-seulement de résister à cette nouvelle levée de boucliers, mais encore d'obtenir justice des griefs antérieurs, c'est de s'organiser. L'organisation pour un but utile est un moyen assuré de succès. Il faut que chaque département vinicole ait un comité central, et chaque comité un délégué.
Je ne sais pas encore dans quelle mesure je vais prendre part à cette organisation. Cela dépendra de mes conférences avec mes amis. Peut-être faudra-t-il que je m'arrête en passant à Orléans, Angoulême, Bordeaux, pour travailler à y fonder l'association. Peut-être devrai-je me borner à notre département; en tout cas, comme le temps presse, tu ferais bien de voir Domenger, Despouys, Labeyrie, Batistant, et de les engager à parcourir le canton, pour y préparer les esprits à la résistance légale, mais forte et organisée. (V. ci-après: Le fisc et la vigne.—Note de l'édit.)
Je n'ai pas besoin, mon cher Félix, de te dérouler la puissance de l'association! Fais passer tes convictions dans tous les esprits. J'espère être à Mugron dans une quinzaine, et nous agirons de concert.
Adieu, ton dévoué.
Paris, 11 janvier 1841.Que n'es-tu auprès de moi, mon cher Félix! cela ferait cesser bien des incertitudes. Je t'ai entretenu du nouveau projet que j'ai conçu; mais seul, abandonné à moi-même, les difficultés de l'exécution m'effrayent. Je sens que le succès est à peu près infaillible; mais il exige une force morale que ta présence me donnerait, et des ressources matérielles que je ne sais pas prendre sur moi de demander. J'ai tâté le pouls à plusieurs députés, et je les ai trouvés froids. Ils ont presque tous des ménagements à garder; tu sais que nos hommes du Midi sont presque tous quêteurs de places. – Quant à l'opposition, il serait dangereux de lui donner la haute main dans l'association, elle s'en ferait un instrument, ce qu'il faut éviter. Ainsi, tout bien pesé, il faut renoncer à fonder l'association par le haut, ce qui eût été plus prompt et plus facile. C'est la base qu'il faut fonder. – Si elle se constitue fortement, elle entraînera tout. Que les vignerons ne se fassent pas illusion, s'ils demeurent dans l'inertie, ils seront ici faiblement défendus. Je tâcherai de partir d'ici dimanche prochain; j'aurai dans une poche le projet des statuts de l'association, dans l'autre le prospectus d'un petit journal destiné à être d'abord le propagateur et plus tard l'organe de l'association. Avec cela je m'assurerai si ce projet rencontre de la sympathie dans Orléans, la Charente et le bassin de la Garonne. La suite dépendra de mes observations. Une brusque initiative eût été plus de mon goût. Il y a quelques années que je l'aurais peut-être tentée; maintenant une avance de six à huit mille francs me fait reculer, et j'en ai vraiment honte, car quelques centaines d'abonnés m'eussent relevé de tous risques. Le courage m'a manqué, n'en parlons plus.
Je suis obligé, mon cher Félix, d'invoquer sans cesse mon impartialité et ma philosophie pour ne pas tomber dans le découragement, à la vue de toutes les misères dont je suis témoin. Pauvre France! – Je vois tous les jours des députés qui, dans le tête-à-tête, sont opposés aux fortifications de Paris et qui cependant vont les appuyer à la chambre, l'un pour soutenir Guizot, l'autre pour ne pas abandonner Thiers, un troisième de peur qu'on ne le traite de Russe ou d'Autrichien; l'opinion, la presse, la mode les entraîne, et beaucoup cèdent à des motifs plus honteux encore. Le maréchal Soult lui-même est personnellement opposé à cette mesure, et tout ce qu'il ose faire, c'est de proposer une exécution lente, dans l'espoir qu'un revirement d'opinion lui viendra en aide, quand il n'y aura encore qu'une centaine de millions engloutis. C'est bien pis dans les questions extérieures. Il semble qu'un bandeau couvre tous les yeux, et on court risque d'être maltraité si l'on énonce seulement un fait qui contrarie le préjugé dominant.
Adieu, mon cher Félix, il me tarde bien de causer avec toi; les sujets ne nous manqueront pas.
Adieu, ton ami.
Bagnères, le 10 juillet 1844.Mon cher Félix, j'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre de M. Laffitte, d'Aire, membre du conseil général, qui m'embarrasse beaucoup. Il m'annonce que le général Durrieu va être élevé à la pairie; que le gouvernement veut le faire remplacer, à la chambre, par un secrétaire des commandements de M. le duc de Nemours. Il ajoute que les électeurs d'Aire ne sont pas disposés à subir cette candidature; et enfin il me demande si je me présenterai, auquel cas il pense que j'aurai beaucoup de voix dans ce canton, où je n'eus que la sienne aux élections dernières.
Comme la législature n'a plus que trois sessions à faire, et qu'ainsi je serai libre de me retirer au bout de ce terme sans occasionner une réunion extraordinaire du collége de Saint-Sever, je serais assez disposé à entrer encore une fois en lice, si je pouvais compter sur quelques chances; mais je ne dois pas m'aveugler sur le tort que me fera la scission qui s'est introduite dans le parti libéral. Si en outre je dois avoir encore contre moi l'aristocratie de l'argent et le barreau, j'aime mieux rester tranquille dans mon coin. Je le regretterais un peu, parce qu'il me semble que j'aurais pu me rendre utile à la cause de la liberté du commerce, qui intéresse à un si haut degré la France et surtout notre pays.
Mais cela n'est pas un motif pour que je me mette en avant en étourdi: je suis donc résolu à attendre qu'il me soit fait, par les électeurs influents, des ouvertures sérieuses; il me semble que l'affaire les touche d'assez près pour qu'ils ne laissent pas aux candidats le soin de s'en occuper seuls.
Je voulais envoyer mon article au Journal des Économistes, mais je n'ai pas d'occasion; je profiterai de la première qui se présentera. Il a le défaut, comme toute œuvre de commençant, de vouloir trop dire; tel qu'il est, il me paraît offrir quelque intérêt. Je profiterai de l'occasion pour essayer d'engager une correspondance avec Dunoyer.
Eaux-Bonnes, le 26 juillet 1844.Ta lettre m'a fait une pénible impression, mon cher Félix, non point par les nouvelles que tu me donnes des perspectives électorales, mais à cause de ce que tu me dis de toi, de ta santé, et de la lutte terrible que se livrent ton âme et ton corps. J'espère pourtant que tu as voulu parler de l'état habituel de ta santé, et non pas d'une recrudescence qui se serait manifestée depuis mon départ. Je comprends bien tes peines, d'autant plus qu'à un moindre degré je les éprouve aussi. Ces misérables obstacles, que la santé, la fortune, la timidité élèvent comme un mur d'airain entre nos désirs et le théâtre où ils pourraient se satisfaire, est un tourment inexprimable. Quelquefois je regrette d'avoir bu à la coupe de la science, ou du moins de ne pas m'en être tenu à la philosophie synthétique et mieux encore à la philosophie religieuse. On y puise au moins des consolations pour toutes les situations de la vie, et nous pourrions encore arranger tolérablement ce qui nous reste de temps à passer ici-bas. Mais l'existence retirée, solitaire, est incompatible avec nos doctrines (qui pourtant agissent sur nous avec toute la force de vérités mathématiques); car nous savons que la vérité n'a de puissance que par sa diffusion. De là l'irrésistible besoin de la communiquer, de la répandre, de la proclamer. De plus, tout est tellement lié, dans notre système, que l'occasion et la facilité d'en montrer un chaînon ne peuvent nous contenter; et pour en exposer l'ensemble il faut des conditions de talent, de santé et de position qui nous feront toujours défaut. Que faire, mon ami? attendre que quelques années encore aient passé sur nos têtes. Je les compte souvent, et je prends une sorte de plaisir à remarquer que plus elles s'accumulent, plus leur marche paraît rapide:
..... Vires acquirit eundo.Quoique nous ayons la conscience de connaître la vérité, en ce qui concerne le mécanisme de la société et au point de vue purement humain, nous savons aussi qu'elle nous échappe quant aux rapports de cette vie avec la vie future; et, ce qu'il y a de pire, nous croyons qu'à cet égard on ne peut rien savoir avec certitude.
Nous avons ici plusieurs prêtres très-distingués. Ils font, de deux jours l'un, des instructions de l'ordre le plus relevé; je les suis régulièrement. C'est à peu près la répétition du fameux ouvrage de Dabadie. Hier le prédicateur disait qu'il y a dans l'homme deux ordres de penchants qui se rattachent, les uns à la chute, les autres à la réhabilitation. Selon les seconds, l'homme se fait à l'image de Dieu; les premiers le conduisent à faire Dieu à son image. Il expliquait ainsi l'idolâtrie, le paganisme, il montrait leur effrayante convenance avec la nature corrompue. Ensuite il disait que la déchéance avait enfoncé si avant la corruption dans le cœur de l'homme, qu'il conservait toujours une pente vers l'idolâtrie, qui s'était ainsi insinuée jusque dans le catholicisme. Il me semble qu'il faisait allusion à une foule de pratiques et de dévotions qui sont un si grand obstacle à l'adhésion de l'intelligence. – Mais s'ils comprennent les choses ainsi, pourquoi n'attaquent-ils pas ouvertement ces doctrines idolâtres? pourquoi ne les réforment-ils pas? Pourquoi, au contraire, les voit-on s'empresser de les multiplier? Je regrette de n'avoir pas de relations avec cet ecclésiastique qui, je crois, professe la théologie à la faculté de Bordeaux, pour m'en expliquer avec lui.
Nous voilà bien loin des élections. D'après ce que tu m'apprends, je ne doute pas de la nomination de l'homme du château. Je suis surpris que notre roi, qui a la vue longue, ne comprenne pas qu'en peuplant la chambre de créatures, il sacrifie à quelques avantages immédiats le principe même de la constitution. Il s'assure un vote, mais il place tout un arrondissement en dehors de nos institutions; et cette manœuvre, s'étendant à toute la France, doit aboutir à corrompre nos mœurs politiques déjà si peu avancées. D'un autre côté, les abus se multiplieront, puisqu'ils ne rencontreront pas de résistance; et quand la mesure sera pleine, quel est le remède que cherchera une nation qui n'a pas appris à faire de ses droits un usage éclairé?
Pour moi, mon cher Félix, je ne me sens pas de force à disputer quelques suffrages. S'ils ne viennent pas d'eux-mêmes, laissons-les suivre leur cours. Il me faudrait aller de canton en canton organiser les moyens de soutenir la lutte. C'est plus que je ne puis faire. Après tout, M. Durrieu n'est pas encore pair.
J'ai profité d'une occasion pour envoyer au Journal des Économistes mon article sur les tarifs anglais et français. Il me paraît renfermer des points de vue d'autant plus importants qu'ils ne paraissent préoccuper personne. J'ai rencontré ici des hommes politiques qui ne savent pas le premier mot de ce qui se passe en Angleterre; et, quand je leur parle de la réforme douanière qui s'accomplit dans ce pays, ils n'y veulent pas croire. – J'ai du temps devant moi pour faire la lettre à Dunoyer. Quant à mon travail sur la répartition de l'impôt, je n'ai pas les matériaux pour y mettre la dernière main. La session du conseil général sera une bonne occasion pour cette publication.
Adieu, mon cher Félix, si tu apprends quelque chose de nouveau, fais-m'en part; mais de toutes les nouvelles la plus agréable que tu puisses me donner, c'est que le découragement dont ta lettre est empreinte n'était dû qu'à une souffrance passagère. Après tout, mon ami, et au milieu des épaisses ténèbres qui nous environnent, attachons-nous à cette idée qu'une cause première, intelligente et miséricordieuse, nous a soumis, par des raisons que nous ne pouvons comprendre, aux dures épreuves de la vie: que ce soit là notre foi. Attendons le jour où elle jugera à propos de nous en délivrer, et de nous admettre à une vie meilleure: que ce soit là notre espérance. Avec ces sentiments au cœur, nous supporterons nos afflictions et nos douleurs…
Paris, mai 1845.Mon cher Félix, je suis persuadé qu'il te tarde de recevoir de mes nouvelles. J'aurais aussi bien des choses à te dire, mais je serai forcé d'être court. Quoique à la fin de chaque jour il se rencontre que je n'ai rien fait, je suis toujours affairé. Dans ce Paris, jusqu'à ce qu'on soit au courant, il faut perdre un demi-jour pour utiliser un quart d'heure.
J'ai été très-bien accueilli par M. Guillaumin, qui est le premier économiste que j'ai vu. Il m'annonça qu'il donnerait un dîner, suivi d'une soirée, pour me mettre en rapport avec les hommes de notre école; en conséquence je ne suis allé voir aucun de ces messieurs. – Hier a eu lieu ce dîner. J'étais à la droite de l'amphitryon, ce qui prouve bien que le dîner était à mon occasion; à la gauche était Dunoyer. À côté de madame Guillaumin, MM. Passy et Say. Il y avait en outre MM. Dussard et Reybaud. Béranger avait été invité, mais il avait d'autres engagements. Le soir, arrivèrent une foule d'autres économistes: MM. Renouard, Daire, Monjean, Garnier, etc., etc. Mon ami, entre toi et moi, je puis te dire que j'ai éprouvé une satisfaction bien vive. Il n'y a aucun de ces messieurs qui n'ait lu, relu et parfaitement compris mes trois articles. Je pourrais écrire mille ans dans la Chalosse, la Sentinelle, le Mémorial, sans trouver, toi excepté, un vrai lecteur. Ici on est lu, étudié, et compris. Je n'en puis pas douter, parce que tous ou presque tous sont entrés dans des détails minutieux, qui attestent que la politesse ne faisait pas seule les frais de cet accueil; je n'ai trouvé un peu froid que M. X… Te dire les caresses dont j'ai été comblé, l'espoir qu'on a paru fonder sur ma coopération, c'est te faire comprendre que j'étais honteux de mon rôle. Mon ami, j'en suis aujourd'hui bien convaincu, si notre isolement nous a empêchés de meubler beaucoup notre esprit, il lui a donné, du moins sur une question spéciale, une force et une justesse, que des hommes plus instruits et mieux doués ne possèdent peut-être pas.
Ce qui m'a fait le plus de plaisir, parce que cela prouve qu'on m'a réellement lu avec soin, c'est que le dernier article, intitulé Sophismes, a été mis au-dessus des autres. C'est en effet celui où les principes sont scrutés avec le plus de profondeur; et je m'attendais à ce qu'il ne serait pas goûté. Dunoyer m'a prié de faire un article sur son ouvrage pour être inséré aux Débats. Il a bien voulu dire qu'il me croyait éminemment propre à faire apprécier son travail. Hélas! je sens déjà que je ne me tiendrai pas à la hauteur exagérée où ces hommes bienveillants me placent.
Après dîner, on a parlé du duel. J'ai rendu un compte succinct de ta brochure. Demain nous avons encore un dîner de corps chez Véfour; je l'y porterai, et comme elle n'est pas longue, j'espère qu'on la lira. Si tu pouvais la refondre ou du moins la retoucher, je crois qu'on la mettrait dans le journal; mais le règlement s'oppose à ce qu'on la transcrive textuellement. – Du reste le Journal des Économistes n'est pas aussi délaissé que je le craignais. Il a cinq à six cents abonnés; il gagne tous les jours en autorité.
Te rapporter la conversation m'entraînerait trop loin. Quel monde, mon ami, et qu'on peut bien dire: On ne vit qu'à Paris et l'on végète ailleurs!.. Malgré cela je soupire déjà après nos promenades et nos entretiens intimes. Le papier me manque; adieu, cher Félix, ton ami.
P. S. Je m'étais trompé; un dîner, même d'économistes, n'est pas une occasion favorable pour la lecture d'une brochure. J'ai remis la tienne à M. Dunoyer, je ne connaîtrai son sentiment que dans quelques jours. Tu trouveras dans le Moniteur du 27 mars, qui doit être dans la bibliothèque de ma chambre, le réquisitoire de Dupin sur le duel. Peut-être cela te fournira-t-il l'occasion d'étendre ta brochure. Ce soir je passe la soirée chez Y… Il m'a fait le plus cordial accueil, et nous avons parlé de tout, même de religion. Il m'a paru faible sur ce chapitre, parce qu'il la respecte sans y croire.
Ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis présenté chez Lamartine. Je n'ai pas été admis, il partait pour Argenteuil; mais avec sa grâce ordinaire, il m'a fait dire qu'il veut que nous causions à l'aise et m'a donné rendez-vous pour demain. Comment m'en tirerai-je?
Dans notre dîner, ou pour mieux dire après, on a agité une grande question: de la propriété intellectuelle. Un Belge, M. Jobard, a émis des idées neuves et qui t'étonneront. Il me tarde que nous puissions causer de toutes ces choses; car malgré ces succès éphémères je sens que je ne suis plus amusable de ce côté. À peine si cela touche l'épiderme; et, tout bien balancé, la vie de province pourrait être rendue plus douce que celle-ci pour peu que l'on y eût le goût de l'étude et des arts.
Adieu, mon cher Félix, à une autre fois. Écris-moi de temps en temps et occupe-toi de ton écrit sur le duel. Puisque la cour est revenue à sa singulière jurisprudence, la chose en vaut la peine.
Paris, le 23 mai 1845.Tu t'attends à beaucoup de détails, mon cher Félix, mais tu vas être bien désappointé; depuis ma dernière lettre que j'envoyai par Bordeaux et dont je n'ai pas encore l'accusé de réception, nous avons un temps qui me dégoûte des visites. Je passe les matinées à perdre mon temps à quelques bagatelles, commissions, affaires obligées, et le soir à le regretter. Ma lettre sera donc bien aride; cependant j'espère qu'elle te sera agréable à cause de celle de Dunoyer que j'y joins. Tu verras qu'il a apprécié ton écrit sur le duel. Je le quitte à l'instant; il m'a répété de vive voix ce qu'il a consigné dans sa lettre; il a vanté le fond et le style de ta brochure, et a dit qu'elle supposait des études faites dans la bonne voie; il m'a exprimé le regret de ne pouvoir en causer plus longtemps, et le désir de venir chez moi pour traiter plus à fond le sujet. Demain je la communiquerai à M. Say, qui est un homme vraiment séduisant par sa douceur, sa grâce, jointe à une grande fermeté de principes. C'est l'ancre du parti économiste. Sans lui, sans son esprit conciliant, le troupeau serait bientôt dispersé. Beaucoup de mes collaborateurs sont engagés dans des journaux qui les rétribuent beaucoup mieux que l'économiste. D'autres ont des ménagements politiques à garder; en un mot, il y a une réunion accidentelle d'hommes bienveillants, qui s'aiment quoique différant d'opinions à beaucoup d'égards; il n'y a pas de parti ferme, organisé et homogène. Pour moi, si j'avais le temps de rester ici et une fortune à recevoir chez moi, je tenterais de fonder une sorte de Ligue. Mais quand on ne fait que passer, il est inutile d'essayer une aussi grande entreprise.






