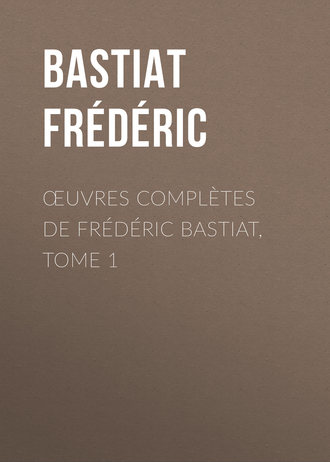
Полная версия
Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat, tome 1
Aussitôt je délibérai avec Soustra, qui malheureusement est absorbé par d'autres soins, dépêches télégraphiques, poste, garde nationale, etc., etc. Nous fûmes trouver les officiers du 9me, qui sont d'un esprit excellent, nous leur proposâmes de faire un coup de main sur la citadelle, nous nous engageâmes à mener six cents jeunes gens bien résolus; ils nous promirent le concours de tout leur régiment, après avoir cependant déposé leur colonel.
Ne dis pas, mon cher Félix, que notre conduite fut imprudente ou légère. Après ce qui s'est passé à Paris, ce qu'il y a de plus important c'est que le drapeau national flotte sur la citadelle de Bayonne. Sans cela, je vois d'ici dix ans de guerre civile; et quoique je ne doute pas du succès de la cause, je sacrifierais volontiers jusqu'à la vie, et tous les amis sont dans les mêmes sentiments, pour épargner ce funeste fléau à nos misérables provinces.
Hier soir, je rédigeai la proclamation ci-jointe au 7me léger, qui garde la citadelle; nous avions l'intention de l'y faire parvenir avant l'action.
Ce matin, en me levant, j'ai cru que tout était fini, tous les officiers du 9me avaient la cocarde tricolore, les soldats ne se contenaient pas de joie, on disait même qu'on avait vu des officiers du 7me parés de ces belles couleurs. Un adjudant m'a montré à moi-même l'ordre positif, donné à toute la 11me division, d'arborer notre drapeau. Cependant les heures s'écoulent et la bannière de la liberté ne s'aperçoit pas encore sur la citadelle. On dit, que le traître J… s'avance de Bordeaux avec le 55me de ligne; quatre régiments espagnols sont à la frontière, il n'y a pas un moment à perdre. Il faut que la citadelle soit à nous ce soir, ou la guerre civile s'allume. Nous agirons avec vigueur, s'il le faut; mais moi que l'enthousiasme entraîne sans m'aveugler, je vois l'impossibilité de réussir, si la garnison, qu'on dit être animée d'un bon esprit, n'abandonne pas le gouvernement. Nous aurons peut-être des coups et point de succès. Mais il ne faudra pas pour cela se décourager, car il faut tout tenter pour écarter la guerre civile. Je suis résolu à partir de suite, après l'action, si elle échoue, pour essayer de soulever la Chalosse. Je proposerai à d'autres d'en faire autant dans la Lande, dans le Béarn, dans le pays Basque; et par famine, par ruse, ou par force, nous aurons la garnison.
Je réserve le papier qui me reste pour t'apprendre la fin.
Le 5, à minuit.Je m'attendais à du sang, c'est du vin seul qui a été répandu. La citadelle a arboré le drapeau tricolore. La bonne contenance du Midi et de Toulouse a décidé celle de Bayonne, les régiments y ont arboré le drapeau. Le traître J… a vu alors le plan manqué, d'autant mieux que partout les troupes faisaient défection; il s'est alors décidé à remettre les ordres qu'il avait depuis trois jours dans sa poche. Ainsi tout est terminé. Je me propose de repartir sur-le-champ. Je t'embrasserai demain.
Ce soir nous avons fraternisé avec les officiers de la garnison. Punch, vins, liqueurs et surtout Béranger, ont fait les frais de la fête. La cordialité la plus parfaite régnait dans cette réunion vraiment patriotique. Les officiers étaient plus chauds que nous, comme des chevaux échappés sont plus gais que des chevaux libres.
Adieu, tout est fini. La proclamation est inutile, elle ne vaut pas les deux sous qu'elle te coûterait.
Bordeaux, le 2 mars 1834.… Je me suis un peu occupé de faire quelques connaissances, j'y réussirai, j'espère. Mais ici vous voyez écrit sur chaque visage auquel vous faites politesse: Qu'y a-t-il à gagner avec toi? Cela décourage. – On fonde, il est vrai, un nouveau journal. Le prospectus n'apprend pas grand' chose, et le rédacteur encore moins; car l'un est rédigé avec le pathos à la mode, et l'autre, me supposant un homme de parti, s'est borné à me faire sentir combien le Mémorial et l'Indicateur étaient insuffisants pour les patriotes. Tout ce que j'ai pu en obtenir, c'est beaucoup d'insistance pour que je prenne un abonnement.
Fonfrède est tout à fait dans les principes de Say. Il fait de longs articles qui seraient très-bons dans un ouvrage de longue haleine. À tout risque, je lui pousserai ma visite.
Je crois qu'un cours réussirait ici, et je me sens tenté. Il me semble que j'aurais la force de le faire, surtout si l'on pouvait commencer par la seconde séance; car j'avoue que je ne répondrais pas, à la première, même de pouvoir lire couramment: mais je ne puis quitter ainsi toutes mes affaires. Nous verrons pourtant cet hiver.
Il s'est établi déjà un professeur de chimie. J'ai dîné avec lui sans savoir qu'il faisait un cours. Si je l'avais su, j'aurais pris des renseignements sur le nombre d'élèves, la cotisation, etc. J'aurais su si, avec un professeur d'histoire, un professeur de mécanique, un professeur d'économie politique, on pourrait former une sorte d'Athénée. Si j'habitais Bordeaux, il y aurait bien du malheur si je ne parvenais à l'instituer, dussé-je en faire tous les frais; car j'ai la conviction qu'en y adjoignant une bibliothèque, cet établissement réussirait. Apprends donc l'histoire, et nous essayerons peut-être un jour.
Je te quitte; trente tambours s'exercent sous mes fenêtres, je ne sais plus ce que je dis.
Adieu.
Bayonne, le 16 juin 1840.Mon cher Félix, je suis toujours à la veille de mon départ, voilà trois fois que nous commandons nos places; enfin elles sont prises et payées pour vendredi. Nous avons joué de malheur, car quand nous étions prêts, le général carliste Balmaceda a intercepté les routes; il est à craindre que nous n'ayons de la peine à passer. Mais il ne faut rien dire de cela pour ne pas effrayer ma tante, qui est déjà trop disposée à redouter les Espagnols. Pour moi, je trouve que l'affaire qui nous pousse vers Madrid vaut la peine de courir quelques chances. Jusqu'à présent elle se présente sous un point de vue très-favorable. Nous trouverions ici les capitaux nécessaires, si nous ne tenions par-dessus tout à ne fonder qu'une compagnie espagnole13. Serons-nous arrêtés par l'inertie de cette nation? En ce cas j'en serai pour mes frais de route, et je trouverai une compensation dans le plaisir d'avoir vu de près un peuple qui a des qualités et des défauts qui le distinguent de tous les autres.
Si je fais quelques observations intéressantes, j'aurai soin de les consigner dans mon portefeuille pour te les communiquer.
Adieu, mon cher Félix.
Madrid, le 6 juillet 1840.Mon cher Félix, je reçois ta lettre du 6. D'après ce que tu me dis de ma chère tante, je vois que pour le moment sa santé est bonne, mais qu'elle avait été un peu souffrante; c'est là pour moi le revers de la médaille. Madrid est aujourd'hui un théâtre peut-être unique au monde, que la paresse et le désintéressement espagnols livrent aux étrangers qui, comme moi, connaissent un peu les mœurs et la langue du pays. J'ai la certitude que je pourrais y faire d'excellentes affaires; mais l'idée de l'isolement de ma tante, à un âge où la santé commence à devenir précaire, m'empêche de songer à proclamer mon exil.
Depuis que j'ai mis le pied dans ce singulier pays, j'ai formé cent fois le projet de t'écrire. Mais tu m'excuseras de n'avoir pas eu le courage de l'accomplir, quand tu sauras que nous consacrons le matin à nos affaires, le soir à une promenade indispensable, et le jour à dormir et haleter sous le poids d'une chaleur plus pénible par sa continuité que par son intensité. Je ne sais plus ce que c'est que les nuages, toujours un ciel pur et un soleil dévorant. Tu peux compter, mon cher Félix, que ce n'est pas par négligence que j'ai tant tardé à t'écrire; mais réellement je ne suis pas fait à ce climat, et je commence à regretter que nous n'ayons pas retardé de deux mois notre départ…
Je suis surpris que le but de mon voyage soit encore un secret à Mugron. Ce n'en est plus un à Bayonne, et j'en ai écrit, avant mon départ, à Domenger pour l'engager à prendre un intérêt dans notre entreprise. Elle est réellement excellente, mais réussirons-nous à la fonder? C'est ce que je ne puis dire encore; les banquiers de Madrid sont à mille lieues de l'esprit d'association, toute idée importée de l'étranger est accueillie par eux avec méfiance, ils sont aussi très-difficiles sur les questions de personnes, chacun vous disant: Je n'entre pas dans l'affaire si telle maison y entre; enfin ils gagnent tant d'argent avec les fournitures, emprunts, monopoles, etc., qu'ils ne se soucient guère d'autre chose. Voilà bien des obstacles à vaincre, et cela est d'autant plus difficile qu'ils ne vous donnent pas occasion de les voir un peu familièrement. Leurs maisons sont barricadées comme des châteaux forts. Nous avons trouvé ici deux classes de banquiers, les uns, Espagnols de vieille roche, sont les plus difficiles à amener, mais aussi ceux qui peuvent donner plus de consistance à l'entreprise; les autres, plus hardis, plus européens, sont plus abordables mais moins accrédités: c'est la vieille et la jeune Espagne. Nous avions à opter, nous avons frappé à la porte de l'Espagne pure, et il est à craindre qu'elle ne refuse et que de plus nous ne nous soyons fermé, par ce seul fait, la porte de l'Espagne moderne. Nous ne quitterons la partie qu'après avoir épuisé tous les moyens de succès, nous avons quelque raison de penser que la solution ne se fera pas attendre.
Cette affaire et la chaleur m'absorbent tellement, que je n'ai vraiment pas le courage d'appliquer à autre chose mon esprit d'observation. Je ne prends aucune note, et cependant les sujets ne me manqueraient pas. Je me trouve placé de manière à voir bien des rouages, et si j'avais la force et le talent d'écrire, je crois que je serais en mesure de faire des lettres tout aussi intéressantes que celles de Custine, et peut-être plus vraies.
Pour te donner une idée de la facilité que je trouverais à vivre ici, indépendamment des affaires qui s'y traitent et auxquelles je pourrais prendre part, on m'a offert d'y suivre des procès de maisons italiennes contre des grands d'Espagne, ce qui me donnerait suffisamment de quoi vivre sans aucun travail suivi; mais l'idée de ma tante m'a fait repousser cette proposition. Elle me souriait comme un moyen de prolonger mon séjour et d'étudier ce théâtre, mais mon devoir m'oblige à y renoncer.
Mon ami, je crains bien que le catholicisme ne subisse ici le même sort qu'en France. Rien de plus beau, de plus digne, de plus solennel et de plus imposant, que les cérémonies religieuses en Espagne; mais hors de là je ne puis voir en quoi ce peuple est plus spiritualiste que les autres. C'est, du reste, une matière que nous traiterons au long à mon retour et quand j'aurai pu mieux observer.
Adieu, mon cher Félix, fais une visite à ma tante, donne-lui de mes nouvelles, et reçois l'assurance de ma tendre amitié.
Madrid, le 16 juillet 1840.Mon cher Félix, je te remercie de tes bonnes lettres des 1er et 6 juillet; ma tante aussi a eu soin de m'écrire, en sorte que jusqu'à présent j'ai souvent des nouvelles, et elles me sont bien nécessaires. Je ne puis pas dire que je m'ennuie, mais j'ai si peu l'habitude de vivre loin de chez moi que je ne suis heureux que les jours où je reçois des lettres.
Tu es sans doute curieux de savoir où nous en sommes avec notre compagnie d'assurance. J'ai maintenant comme la certitude que nous réussirons. Il faut beaucoup de temps pour attirer à nous les Espagnols dont le nom nous est nécessaire; il en faudra beaucoup ensuite pour faire fonctionner une aussi vaste machine avec des gens inexpérimentés. Mais je suis convaincu que nous y parviendrons. La part que Soustra et moi devons avoir dans les bénéfices, comme créateurs, n'est pas réglée; c'est une matière délicate que nous n'abordons pas, n'ayant ni l'un ni l'autre beaucoup d'audace sur ce chapitre. Aussi, nous nous eu remettons à la décision du conseil d'administration. Ce sera pour moi un sujet d'expérience et d'observations. Voyons si ces Espagnols si méfiants, si réservés, si inabordables, sont justes et grands quand ils connaissent les gens. À cet article près, nos affaires marchent lentement, mais bien. Nous avons aujourd'hui ce qui est la clef de tout, neuf noms pour former un conseil, et des noms tellement connus et honorables qu'il ne paraît pas possible que l'on puisse songer à nous faire concurrence. Ce soir, il y a une junte pour étudier les statuts et conditions; j'espère qu'au premier jour l'acte de société sera signé. Cela fait, peut-être rentrerai-je en France pour voir ma tante et assister à la session du conseil général. Si je le puis en quelque manière, je n'y manquerai pas. Mais j'aurai à revenir ensuite en Espagne, parce que la compagnie me fournira une occasion de faire un voyage complet et gratis. Jusqu'à présent, je ne puis pas dire que j'aie voyagé. Toujours avec mes deux compagnons, je ne suis entré, sauf les comptoirs, dans aucune maison espagnole. La chaleur a suspendu toutes les réunions publiques, bals, théâtres, courses. – Notre chambre et quelques bureaux, le restaurant français et la promenade au Prado, voilà le cercle dont nous ne sortons pas. Je voudrais prendre ma revanche plus tôt. Soustra part le 26; sa présence est nécessaire à Bayonne. Lis tout ceci à ma tante que j'embrasse bien tendrement.
Le trait le plus saillant du caractère espagnol, c'est sa haine et sa méfiance envers les étrangers. Je pense que c'est un véritable vice, mais il faut avouer qu'il est alimenté par la fatuité et la rouerie de beaucoup d'étrangers. Ceux-ci blâment et tournent tout en ridicule; ils critiquent la cuisine, les meubles, les chambres et tous les usages du pays, parce qu'en effet les Espagnols tiennent très-peu au confortable de la vie; mais nous qui savons, mon cher Félix, combien les individus, les familles, les nations peuvent être heureuses sans connaître ces sortes de jouissances matérielles, nous ne nous presserions pas de condamner l'Espagne. Ceux-là arriveront avec leurs poches pleines de plans et de projets absurdes, et parce qu'on ne s'arrache pas leurs actions, ils se dépitent et crient à l'ignorance, à la stupidité. Cette affluence de floueurs nous a fait d'abord beaucoup de tort, et en fera à toute bonne entreprise. Pour moi, je pense avec plaisir que la méfiance espagnole l'empêchera de tomber dans l'abîme; car les étrangers, après avoir apporté leurs plans, seront forcés, pour les faire réussir, de faire venir des capitaux et souvent des ouvriers français.
Donne-moi de temps en temps des nouvelles de Mugron, mon cher Félix, tu sais combien le patriotisme du clocher nous gagne quand nous en sommes éloignés.
Adieu, mon cher Félix, mes souvenirs à ta sœur.
Madrid, le 17 août 1840.… Tu me fais une question à laquelle je ne puis répondre: Comment le peuple espagnol a-t-il pu laisser chasser et tuer les moines? Moi-même je me le demande souvent; mais je ne connais pas assez le pays pour m'expliquer ce phénomène. Ce qu'il y a de probable, c'est que le temps des moines est fini partout. Leur inutilité, à tort ou à raison, est une croyance généralement établie. À supposer qu'il y eût en Espagne 40,000 moines, intéressant autant de familles composées de 5 personnes, cela ne ferait que 200,000 habitants contre 10 millions. Leurs immenses richesses ont pu tenter beaucoup de gens de la classe aisée; l'affranchissement d'une foule de redevances a pu tenter beaucoup de gens de la classe du peuple. Le fait est qu'on en a fini avec cette puissance; mais, à coup sûr, jamais mesure, à la supposer nécessaire, n'a été conduite avec autant de barbarie, d'imprévoyance et d'impolitique.
Le gouvernement était aux mains des modérés, qui désiraient l'abolition des couvents, mais n'osaient y procéder. Financièrement, on espérait avec le produit des biens nationaux payer les dettes de l'Espagne, éteindre la guerre civile et rétablir les finances. Politiquement, on voulait, par la division des terres, rattacher une partie considérable du peuple à la révolution. Je crois que ce but a été manqué.
N'osant agir légalement, on s'entendit avec les exaltés. Une nuit, ceux-ci firent irruption dans les couvents. À Barcelone, Malaga, Séville, Madrid, Valladolid, ils égorgèrent et chassèrent les moines. Le gouvernement et la force publique restèrent trois jours témoins impassibles de ces atrocités. Quand l'aliment manqua au désordre, le gouvernement intervint, et le ministère Mendizabal décréta la confiscation des couvents et des propriétés monacales. Maintenant on les vend; mais tu vas juger de cette administration. Un individu quelconque déclare vouloir soumissionner un bien national, l'État le fait estimer, et cette estimation est toujours très-modique, parce que l'acquéreur s'entend avec l'expert. Cela fait, la vente se fait publiquement; on s'est entendu aussi avec le notaire pour écarter la publicité, et le bien vous reste à bas prix. Il faut payer un cinquième comptant, et les quatre autres cinquièmes en huit ans, par huitièmes. L'État reçoit en payement des rentes de différentes origines, qui s'achètent à la Bourse depuis 75 jusqu'à 95 de perte; c'est-à-dire qu'avec 25 fr. et même avec 5 on paye 100 fr.
Il résulte de là trois choses: 1° l'État ne reçoit presque rien, on peut même dire rien; 2° ce n'est pas le peuple des provinces qui achète, puisqu'il n'est pas à la Bourse pour brocanter le papier; 3° cette masse de terres vendues à la fois et à vil prix, a déprécié toutes les autres propriétés. Ainsi le gouvernement, qui s'est procuré à peine de quoi payer l'armée, ne remboursera pas la dette.
La propriété ne se divisera que lorsque les spéculateurs revendront en seconde main.
Les fermiers n'ont fait que changer de maîtres; et au lieu de payer le fermage aux moines, qui, dit-on, étaient des propriétaires fort accommodants, peu rigoureux sur les termes, prêtant des semences, renonçant même au revenu dans les années malheureuses, ils payeront très-rigoureusement aux compagnies belges et anglaises qui, incertaines de l'avenir, aspirent à rembourser l'État avec le produit des terres.
Le simple paysan, dans les années calamiteuses, n'aura plus la soupe à la porte des couvents.
Enfin les simples propriétaires ne peuvent plus vendre leurs terres qu'à vil prix. – Voilà, ce me semble, les conséquences de cette désastreuse opération.
Des hommes plus capables avaient proposé de profiter d'un usage qui existe ici: ce sont des baux de 50 et même 100 ans. Ils voulaient qu'on affermât aux paysans, à des taux modérés, pour 50 ans. Avec le produit, on aurait payé l'intérêt annuel de la dette et relevé le crédit de l'Espagne; et au bout de 50 ans, on aurait un capital déjà immense, plus que doublé probablement par la sécurité et le travail. Tu vois d'un coup d'œil la supériorité politique et financière de ce système.
Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de moines. Que sont-ils devenus? Probablement les uns sont morts dans les montagnes, au service de don Carlos; les autres auront succombé d'inanition dans les rues et greniers des villes; quelques-uns auront pu se réfugier dans leurs familles.
Quant aux couvents, ils sont convertis en cafés, en maisons publiques, en théâtres et surtout en casernes, pour une autre espèce de dévorants plus prosaïque que l'autre. Plusieurs ont été démolis pour élargir les rues, faire des places; sur l'emplacement du plus beau de tous, et qui passait pour un chef-d'œuvre d'architecture, on a construit un passage et une halle qui se font tort mutuellement.
Les religieuses ne sont guère moins à plaindre. Après avoir donné la volée à toutes celles qui ont voulu rentrer dans le monde, on a enfermé les autres dans deux ou trois couvents, et comme on s'est emparé de leurs propriétés, qui représentaient les dots qu'elles apportaient à leur ordre, on est censé leur faire une pension; mais, comme on ne la paye pas, on voit souvent sur la porte des couvents cette simple inscription: Pan para las pobres monjas.
Je commence à croire, mon cher Félix, que notre M. Custine avait bien mal vu l'Espagne. La haine d'une autre civilisation lui avait fait chercher ici des vertus qui n'y sont pas. Peut-être a-t-il, en sens inverse, commis la même faute que les Espagnols qui ne voient rien à blâmer dans la civilisation anglaise. Il est bien difficile que nos préjugés nous laissent, je ne dis pas bien juger, mais bien voir les faits.
Je rentre, mon cher Félix, et j'ai appris que demain on proclame la loi des ayuntamientos. Je ne sais pas si je t'ai parlé de cette affaire, en tout cas en voici le résumé.
Le ministère modéré, qui vient de tomber, avait senti que, pour administrer l'Espagne, il fallait donner au pouvoir central une certaine autorité sur les provinces; ici, de temps immémorial, chaque province, chaque ville, chaque bourgade s'administre elle-même. Tant que le principe monarchique et l'influence du clergé ont compensé cette extrême diffusion de l'autorité, les choses ont marché tant bien que mal; mais aujourd'hui cet état de choses ne peut durer. En Espagne, chaque localité nomme son ayuntamiento (conseil municipal), alcades, régidors, etc. Ces ayuntamientos, outre leurs fonctions municipales, sont chargés du recouvrement de l'impôt et de la levée des troupes. Il résulte de là que, lorsqu'une ville a quelque sujet de mécontentement, fondé ou non, elle se borne à ne pas recouvrer l'impôt ou à refuser le contingent. En outre, il paraît que ces ayuntamientos sont le foyer de grands abus, et qu'ils ne rendent pas à l'État la moitié des contributions qu'ils prélèvent. Le parti modéré a donc voulu saper cette puissance. Une loi a été présentée par le ministère, adoptée par les chambres, et sanctionnée par la reine, qui dispose que la reine choisira les alcades parmi trois candidats nommés par le peuple. Les exaltés ont jeté de hauts cris; de là la révolution de Barcelone et l'intervention du sabre d'Espartero. Mais, chose qui ne se voit qu'ici, la reine, quoique contrainte à changer de ministère, en a nommé un autre qui maintient la loi déjà, votée et sanctionnée. Sans doute que, parvenu au pouvoir par une violation de la constitution, il a cru devoir manifester qu'il la respectait en laissant promulguer une loi qui avait reçu la sanction des trois pouvoirs. C'est donc demain qu'on proclame cette loi: cela se passera-t-il sans trouble? je ne l'espère guère. En outre, comme on attribue à la France et à notre nouvel ambassadeur une mystification aussi peu attendue, après les événements de Barcelone, il est à craindre que la rage des exaltés ne se dirige contre nos compatriotes; aussi j'aurai soin d'écrire à ma tante après-demain, parce que les journaux ne manqueront pas de faire bruit de l'insurrection qui se prépare. Elle ne laisse pas que d'être effrayante, quand on songe qu'il n'y a ici, pour maintenir l'ordre, que quelques soldats dévoués à Espartero, qui doit être mortellement blessé de la manière dont son coup d'État a été déjoué.
Mais quel sujet de réflexions que cette Espagne qui, pour arriver à la liberté, perd la monarchie et la religion qui lui étaient si chères; et, pour arriver à l'unité, est menacée dans ses franchises locales qui faisaient le fond même de son existence!
Adieu! ton ami dévoué. Je n'ai pas le temps de relire ce fatras, tire-t'en comme tu pourras.
P. S. Mon cher Félix, la tranquillité de Madrid n'a pas été un moment troublée. Ce matin, les membres de l'ayuntamiento se sont réunis en séance publique pour promulguer la nouvelle loi qui ruine leur institution. Ils ont fait suivre cette cérémonie d'une énergique protestation, où ils disent qu'ils se feront tous tuer plutôt que d'obéir à la loi nouvelle. On dit aussi qu'ils ont payé quelques hommes pour crier les vivas et les mueras d'usage, mais le peuple ne s'est pas plus ému que ne s'en émouvraient les paysans de Mugron; et l'ayuntamiento n'a réussi qu'à démontrer de plus en plus la nécessité de la loi. Car enfin, ne serait-ce point un bien triste spectacle que de voir une ville troublée et la sûreté des citoyens compromise par ceux-là mêmes qui sont chargés de maintenir l'ordre?
On m'a assuré que les exaltés n'étaient pas d'accord entre eux; les plus avancés (je ne sais pas pourquoi on a donné du crédit à cette expression en s'accordant à l'adopter) disaient:
«Il est absurde de faire un mouvement qui n'ait pas de résultat. Un mouvement ne peut être décisif qu'autant que le peuple s'en mêle; or le peuple ne veut pas intervenir pour des idées; il faut donc lui montrer le pillage en perspective.»
Et malgré cette terrible logique, l'ayuntamiento n'a pas reculé devant la première provocation! Du reste, je te parle là de bruits publics, car, quant à moi, j'étais à la Bibliothèque royale, et je ne me suis aperçu de rien.






