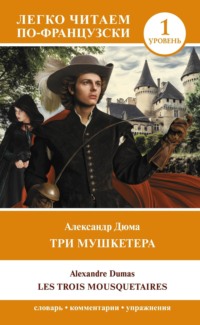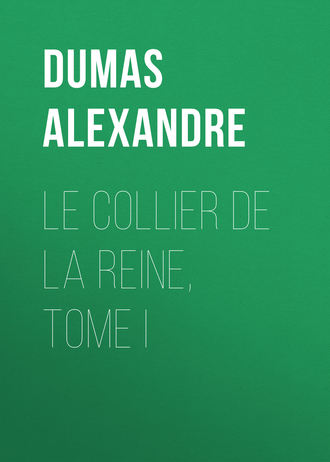 полная версия
полная версияLe Collier de la Reine, Tome I
– C'est vous qui avez raison, monsieur, répliqua Charny.
Alors, se retournant vers le cocher:
– Dauphin, dit-il, arrêtez, vous attendrez ici.
Dauphin s'était douté qu'on le rappellerait; il n'avait pas pressé ses chevaux, et, par conséquent, n'avait point dépassé la portée de la voix.
Dauphin s'arrêta donc; et comme, ainsi que l'avait prévu Philippe, il se doutait de ce qui allait se passer, il s'accommoda sur son siège de façon à voir, à travers les arbres encore dégarnis de feuilles, la scène dont son maître lui paraissait devoir être un des acteurs.
Cependant, peu à peu, Philippe et Charny gagnèrent dans le bois; au bout de cinq minutes, ils étaient perdus, ou à peu près, dans la demi-teinte bleuâtre qui en estompait les horizons.
Philippe, qui marchait le premier, rencontra une place sèche, dure sous le pied; elle présentait un carré long merveilleusement approprié à l'objet qui amenait les deux jeunes gens.
– Sauf votre avis, monsieur de Charny, dit Philippe, il me semble que voilà un bon endroit.
– Excellent, monsieur, répliqua Charny, en ôtant son habit.
Philippe ôta son habit à son tour, jeta son chapeau à terre, et dégaina.
– Monsieur, dit Charny dont l'épée était encore au fourreau, à tout autre qu'à vous, je dirais: «Chevalier, un mot, sinon d'excuse, du moins de douceur, et nous voilà bons amis…» mais, à vous, mais à un brave qui vient d'Amérique, c'est-à-dire d'un pays où l'on se bat si bien, je ne puis…
– Et moi, à tout autre répliqua Philippe, je dirais: «Monsieur, j'ai peut-être eu vis-à-vis de vous l'apparence d'un tort»; mais à vous, mais à ce brave matin qui l'autre soir encore faisait l'admiration de toute la cour par un fait d'armes si glorieux; à vous, monsieur de Charny, je ne puis rien dire, sinon: «Monsieur le comte, faites-moi l'honneur de vous mettre en garde.»
Le comte salua et tira l'épée à son tour.
– Monsieur, dit Charny, je crois que nous ne touchons ni l'un ni l'autre à la véritable cause de la querelle.
– Je ne vous comprends pas, comte, répliqua Philippe.
– Oh! vous me comprenez, au contraire, monsieur, et parfaitement même; et, comme vous venez d'un pays où l'on ne sait pas mentir, vous avez rougi en me disant que vous ne me compreniez pas.
– En garde! répéta Philippe.
Les fers se croisèrent.
Aux premières passes, Philippe s'aperçut qu'il avait sur son adversaire une supériorité marquée. Seulement, cette assurance, au lieu de lui donner une ardeur nouvelle, sembla le refroidir complètement.
Cette supériorité, laissant à Philippe tout son sang-froid, il en résulta que son jeu devint bientôt aussi calme que s'il eût été dans une salle d'armes, et, au lieu d'une épée, eût tenu un fleuret à la main.
Mais Philippe se contentait de parer, et le combat durait depuis plus d'une minute qu'il n'avait pas encore porté un seul coup.
– Vous me ménagez, monsieur, dit Charny; puis-je vous demander à quel propos?
Et masquant une feinte rapide, il se fendit à fond sur Philippe.
Mais Philippe enveloppa l'épée de son adversaire dans un contre encore plus rapide que la feinte, et le coup se trouva paré.
Quoique la parade de Taverney eût écarté l'épée de Charny de la ligne, Taverney ne riposta point.
Charny fit une reprise que Philippe écarta encore une fois, mais par une simple parade; Charny fut forcé de se relever rapidement.
Charny était plus jeune, plus ardent surtout; il avait honte, en sentant bouillir son sang, du calme de son adversaire; il voulut le forcer à sortir de ce calme.
– Je vous disais, monsieur, que nous n'avions touché ni l'un ni l'autre à la véritable cause du duel.
Philippe ne répondit pas.
– La véritable cause, je vais vous la dire: vous m'avez cherché querelle, car la querelle vient de vous; vous m'avez cherché querelle par jalousie.
Philippe resta muet.
– Voyons, dit Charny, s'animant en raison inverse du sang-froid de Philippe, quel jeu jouez-vous, monsieur de Taverney? Votre intention est-elle de me fatiguer la main? Ce serait un calcul indigne de vous. Morbleu! tuez-moi, si vous pouvez, mais au moins tuez-moi en pleine défense.
Philippe secoua la tête.
– Oui, monsieur, dit-il, le reproche que vous me faites est mérité; je vous ai cherché querelle, et j'ai eu tort.
– Il ne s'agit plus de cela, maintenant, monsieur; vous avez l'épée à la main, servez-vous de votre épée pour autre chose que pour parer, ou, si vous ne m'attaquez pas mieux, défendez-vous moins.
– Monsieur, reprit Philippe, j'ai l'honneur de vous dire une seconde fois que j'ai eu tort et que je me repens.
Mais Charny avait le sang trop enflammé pour comprendre la générosité de son adversaire; il la prit à offense.
– Ah! dit-il, je comprends; vous voulez faire de la magnanimité vis-à-vis de moi. C'est cela, n'est-ce pas, chevalier? Ce soir ou demain vous comptez dire à quelques belles dames que vous m'avez amené sur le terrain, et que là vous m'avez donné la vie.
– Monsieur le comte, dit Philippe, en vérité je crains que vous ne deveniez fou.
– Vous vouliez tuer M. de Cagliostro pour plaire à la reine, n'est-ce pas, et, pour plaire plus sûrement encore à la reine, moi aussi vous voulez me tuer, mais par le ridicule?
– Ah! voilà un mot de trop, s'écria Philippe en fronçant le sourcil; et ce mot me prouve que votre cœur n'est pas si généreux que je le croyais.
– Eh bien! percez donc ce cœur! dit Charny en se découvrant juste au moment où Philippe passait un dégagement rapide et se fendait.
L'épée glissa le long des côtes et ouvrit un sillon sanglant sous la chemise de toile fine.
– Enfin, dit Charny, joyeux, je suis donc blessé! Maintenant, si je vous tue, j'aurai le beau rôle.
– Allons, décidément, dit Philippe, vous êtes tout à fait fou, monsieur; vous ne me tuerez pas, et vous aurez un rôle tout vulgaire; car vous serez blessé sans cause et sans profit, nul ne sachant pourquoi nous nous sommes battus.
Charny poussa un coup droit si rapide que cette fois ce fut à grand-peine que Philippe arriva à temps à la parade; mais, en arrivant à la parade, il lia l'épée, et d'un vigoureux coup de fouet la fit sauter à dix pas de son adversaire.
Aussitôt il s'élança sur l'épée qu'il brisa d'un coup de talon.
– Monsieur de Charny, dit-il, vous n'aviez pas à me prouver que vous êtes brave: vous me détestez donc bien que vous avez mis cet acharnement à vous battre contre moi?
Charny ne répondit pas; il pâlissait visiblement.
Philippe le regarda pendant quelques secondes pour provoquer de sa part un aveu ou une dénégation.
– Allons, monsieur le comte, dit-il, le sort en est jeté, nous sommes ennemis.
Charny chancela. Philippe s'élança pour le soutenir; mais le comte repoussa sa main.
– Merci, dit-il, j'espère aller jusqu'à ma voiture.
– Prenez au moins ce mouchoir pour étancher le sang.
– Volontiers.
Et il prit le mouchoir.
– Et mon bras, monsieur; au moindre obstacle que vous rencontrerez, chancelant comme vous êtes, vous tomberez et votre chute vous sera une douleur inutile.
– L'épée n'a traversé que les chairs, dit Charny. Je ne sens rien dans la poitrine.
– Tant mieux, monsieur.
– Et j'espère être bientôt guéri.
– Tant mieux encore, monsieur. Mais si vous hâtez de vos veux cette guérison pour recommencer ce combat, je vous préviens que vous retrouverez difficilement en moi un adversaire.
Charny essaya de répondre, mais les paroles moururent sur ses lèvres; il chancela, et Philippe n'eut que le temps de le retenir entre ses bras.
Alors il le souleva comme il eût fait d'un enfant, et le porta à moitié évanoui jusqu'à sa voiture.
Il est vrai que Dauphin, ayant à travers les arbres vu ce qui se passait, abrégea le chemin en venant au-devant de son maître.
On déposa Charny dans la voiture; il remercia Philippe d'un signe de tête.
– Allez au pas, cocher, dit Philippe.
– Mais vous, monsieur? murmura le blessé.
– Oh! ne vous inquiétez pas de moi.
Et saluant à son tour, il referma la portière.
Philippe regarda le carrosse s'éloigner lentement; puis le carrosse ayant disparu au détour d'une allée, il prit lui-même la route qui devait le ramener à Paris par le chemin le plus court.
Puis, se retournant une dernière fois, et apercevant le carrosse qui, au lieu de revenir comme lui vers Paris, tournait du côté de Versailles et se perdait dans les arbres, il prononça ces trois mots, mots profondément arrachés de son cœur après une profonde méditation:
– Elle le plaindra!
Chapitre XXXIII
La maison de la rue Neuve-Saint-Gilles
À la porte du garde, Philippe trouva un carrosse de louage et sauta dedans.
– Rue Neuve-Saint-Gilles, dit-il au cocher, et vivement.
Un homme qui vient de se battre et qui a conservé un air vainqueur, un homme vigoureux dont la taille annonce la noblesse, un homme vêtu en bourgeois et dont la tournure dénonce un militaire, c'était plus qu'il n'en fallait pour stimuler le brave homme, dont le fouet, s'il n'était pas comme le trident de Neptune le sceptre du monde, n'en était pas moins pour Philippe un sceptre très important.
L'automédon à vingt-quatre sous dévora donc l'espace et apporta Philippe tout frémissant rue Saint-Gilles, à l'hôtel du comte de Cagliostro.
L'hôtel était d'une grande simplicité extérieure, d'une grande majesté de lignes, comme la plupart des bâtiments élevés sous Louis XIV, après les concetti de marbre ou de brique entassés par le règne de Louis XIII sur la Renaissance.
Un vaste carrosse, attelé de deux bons chevaux, se balançait sur ses moelleux ressorts, dans une vaste cour d'honneur.
Le cocher, sur son siège, dormait dans sa vaste houppelande fourrée de renard; deux valets, dont l'un portait un couteau de chasse, arpentaient silencieusement le perron.
À part ces personnages agissants, nul symptôme d'existence n'apparaissait dans l'hôtel.
Le fiacre de Philippe ayant reçu l'ordre d'entrer, tout fiacre qu'il était, héla le suisse, qui fit aussitôt crier les gonds de la porte massive.
Philippe sauta à terre, s'élança vers le perron, et s'adressant aux deux valets à la fois:
– M. le comte de Cagliostro? dit-il.
– M. le comte va sortir, répondit un des valets.
– Alors, raison de plus pour que je me hâte, dit Philippe, car j'ai besoin de lui parler avant qu'il sorte. Annoncez le chevalier Philippe de Taverney.
Et il suivit le laquais d'un pas si pressé qu'il arriva en même temps que lui au salon.
– Le chevalier Philippe de Taverney! répéta après le valet une voix mâle et douce à la fois. Faites entrer.
Philippe entra sous l'influence d'une certaine émotion que cette voix si calme avait fait naître en lui.
– Excusez-moi, monsieur, dit le chevalier en saluant un homme de grande taille, d'une vigueur et d'une fraîcheur peu communes, et qui n'était autre que le personnage qui nous est déjà successivement apparu à la table du maréchal de Richelieu, au baquet de Mesmer, dans la chambre de Mlle Oliva et au bal de l'Opéra.
– Vous excuser, monsieur! Et de quoi? répondit-il.
– Mais de ce que je vais vous empêcher de sortir.
– Il eût fallu vous excuser si vous étiez venu plus tard, chevalier.
– Pourquoi cela?
– Parce que je vous attendais.
Philippe fronça le sourcil.
– Comment, vous m'attendiez?
– Oui, j'avais été prévenu de votre visite.
– De ma visite, à moi, vous étiez prévenu?
– Mais oui, depuis deux heures. Il doit y avoir une heure ou deux, n'est-ce pas, que vous vouliez venir ici, lorsqu'un accident indépendant de votre volonté vous a forcé de retarder l'exécution de ce projet?
Philippe serra les poings; il sentait que cet homme prenait une étrange influence sur lui.
Mais lui, sans s'apercevoir le moins du monde des mouvements nerveux qui agitaient Philippe:
– Asseyez-vous donc, monsieur de Taverney, dit-il, je vous en prie.
Et il avança à Philippe un fauteuil placé devant la cheminée.
– Ce fauteuil avait été mis là pour vous, ajouta-t-il.
– Trêve de plaisanteries, monsieur le comte, répliqua Philippe d'une voix qu'il essayait de rendre aussi calme que celle de son hôte, mais de laquelle cependant il ne pouvait faire disparaître un léger tremblement.
– Je ne plaisante pas, monsieur; je vous attendais, vous dis-je.
– Allons, trêve de charlatanisme, monsieur; si vous êtes devin, je ne suis pas venu pour mettre à l'épreuve votre science divinatoire; si vous êtes devin, tant mieux pour vous, car vous savez déjà ce que je viens vous dire, et vous pouvez à l'avance vous mettre à l'abri.
– À l'abri… reprit le comte avec un singulier sourire, et à l'abri de quoi, s'il vous plaît?
– Devinez, puisque vous êtes devin.
– Soit. Pour vous faire plaisir, je vais vous épargner la peine de m'exposer le motif de votre visite: vous venez me chercher une querelle.
– Vous savez cela?
– Sans doute.
– Alors vous savez à quel propos? s'écria Philippe.
– À propos de la reine. À présent, monsieur, à votre tour. Continuez, je vous écoute.
Et ces derniers mots furent prononcés, non plus avec l'accent courtois de l'hôte, mais avec le ton sec et froid de l'adversaire.
– Vous avez raison, monsieur, dit Philippe, et j'aime mieux cela.
– La chose tombe à merveille, alors.
– Monsieur, il existe un certain pamphlet…
– Il y a beaucoup de pamphlets, monsieur.
– Publié par un certain gazetier…
– Il y a beaucoup de gazetiers.
– Attendez; ce pamphlet… nous nous occuperons du gazetier plus tard.
– Permettez-moi de vous dire, monsieur, interrompit Cagliostro avec un sourire, que vous vous en êtes déjà occupé.
– C'est bien; je disais donc qu'il y avait un certain pamphlet dirigé contre la reine.
Cagliostro fit un signe de tête.
– Vous le connaissez, ce pamphlet?
– Oui, monsieur.
– Vous en avez même acheté mille exemplaires.
– Je ne le nie pas.
– Ces mille exemplaires, fort heureusement, ne sont pas parvenus entre vos mains?
– Qui vous fait penser cela, monsieur? dit Cagliostro.
– C'est que j'ai rencontré le commissionnaire qui emportait le ballot, c'est que je l'ai payé, c'est que je l'ai dirigé chez moi, où mon domestique, prévenu d'avance, a dû le recevoir.
– Pourquoi ne faites-vous pas vous-même vos affaires jusqu'au bout?
– Que voulez-vous dire?
– Je veux dire qu'elles seraient mieux faites.
– Je n'ai point fait mes affaires jusqu'au bout, parce que, tandis que mon domestique était occupé de soustraire à votre singulière bibliomanie ces mille exemplaires, moi je détruisais le reste de l'édition.
– Ainsi, vous êtes sûr que les mille exemplaires qui m'étaient destinés sont chez vous.
– J'en suis sûr.
– Vous vous trompez, monsieur.
– Comment cela, dit Taverney, avec un serrement de cœur, et pourquoi n'y seraient-ils pas?
– Mais, parce qu'ils sont ici, dit tranquillement le comte en s'adossant à la cheminée.
Philippe fit un geste menaçant.
– Ah! vous croyez, dit le comte, aussi flegmatique que Nestor, vous croyez que moi, un devin, comme vous dites, je me laisserai jouer ainsi? Vous avez cru avoir une idée en soudoyant le commissionnaire, n'est-ce pas? Eh bien! j'ai un intendant, moi; mon intendant a eu aussi une idée. Je le paie pour cela, il a deviné; c'est tout naturel que l'intendant d'un devin devine, il a deviné que vous viendriez chez le gazetier, que vous rencontreriez le commissionnaire, que vous soudoieriez le commissionnaire; il l'a donc suivi, il l'a menacé de lui faire rendre l'or que vous lui aviez donné: l'homme a eu peur, et au lieu de continuer son chemin vers votre hôtel, il a suivi mon intendant ici. Vous en doutez?
– J'en doute.
– Vide pedes, vide manus6! a dit Jésus à saint Thomas. Je vous dirai, à vous, monsieur de Taverney: voyez l'armoire, et palpez les brochures.
Et, en disant ces mots, il ouvrit un meuble de chêne admirablement sculpté; et, dans le casier principal, il montra au chevalier pâlissant les mille exemplaires de la brochure encore imprégnés de cette odeur moisie du papier humide.
Philippe s'approcha du comte. Celui-ci ne bougea point, quoique l'attitude du chevalier fût des plus menaçantes.
– Monsieur, dit Philippe, vous me paraissez être un homme courageux; je vous somme de me rendre raison l'épée à la main.
– Raison de quoi? demanda Cagliostro.
– De l'insulte faite à la reine, insulte dont vous vous rendez complice en détenant ne fût-ce qu'un exemplaire de cette feuille.
– Monsieur, dit Cagliostro sans changer de posture, vous êtes, en vérité, dans une erreur qui me fait peine. J'aime les nouveautés, les bruits scandaleux, les choses éphémères. Je collectionne, afin de me souvenir plus tard de mille choses que j'oublierais sans cette précaution. J'ai acheté cette gazette; en quoi voyez-vous que j'aie insulté quelqu'un en l'achetant?
– Vous m'avez insulté, moi!
– Vous?
– Oui, moi! moi, monsieur! comprenez-vous?
– Non, je ne comprends pas, sur l'honneur.
– Mais, comment mettez-vous, je vous le demande, une pareille insistance à acheter une si hideuse brochure?
– Je vous l'ai dit, la manie des collections.
– Quand on est homme d'honneur, monsieur, on ne collectionne pas des infamies.
– Vous m'excuserez, monsieur; mais je ne suis pas de votre avis sur la qualification de cette brochure: c'est un pamphlet peut-être, mais ce n'est pas une infamie.
– Vous avouerez, au moins, que c'est un mensonge?
– Vous vous trompez encore, monsieur, car Sa Majesté la reine a été au baquet de Mesmer.
– C'est faux, monsieur.
– Vous voulez dire que j'en ai menti?
– Je ne veux pas le dire, je le dis.
– Eh bien! puisqu'il en est ainsi, je vous répondrai par un seul mot: je l'ai vue.
– Vous l'avez vue?
– Comme je vous vois, monsieur.
Philippe regarda son interlocuteur en face. Il voulut lutter avec son regard si franc, si noble, si beau, contre le regard lumineux de Cagliostro; mais cette lutte finit par le fatiguer, il détourna la vue en s'écriant:
– Eh bien! je n'en persiste pas moins à dire que vous mentez.
Cagliostro haussa les épaules, comme il eût fait à l'insulte d'un fou.
– Ne m'entendez-vous pas? dit sourdement Philippe.
– Au contraire, monsieur, je n'ai pas perdu une parole de ce que vous dites.
– Eh bien! ne savez-vous pas ce que vaut un démenti?
– Si, monsieur, répondit Cagliostro; il y a même un proverbe en France qui dit qu'un démenti vaut un soufflet.
– Eh bien! je m'étonne d'une chose.
– De laquelle?
– C'est de n'avoir pas encore vu votre main se lever sur mon visage, puisque vous êtes gentilhomme, puisque vous connaissez le proverbe français.
– Avant de me faire gentilhomme et de m'apprendre le proverbe français, Dieu m'a fait homme et m'a dit d'aimer mon semblable.
– Ainsi, monsieur, vous me refusez satisfaction l'épée à la main?
– Je ne paie que ce que je dois.
– Alors, vous me donnerez satisfaction d'une autre manière!
– Comment cela?
– Je ne vous traiterai pas plus mal qu'un homme de noblesse n'en doit traiter un autre; seulement, j'exigerai que vous brûliez en ma présence tous les exemplaires qui sont dans l'armoire.
– Et moi, je vous refuserai.
– Réfléchissez.
– C'est réfléchi.
– Vous allez m'exposer à prendre avec vous le parti que j'ai pris avec le gazetier.
– Ah! des coups de canne, dit Cagliostro en riant et sans remuer plus que n'eût fait une statue.
– Ni plus ni moins, monsieur; oh! vous n'appellerez pas vos gens.
– Moi? allons donc; et pourquoi appellerais-je mes gens? Cela ne les regarde pas; je ferai bien mes affaires moi-même. Je suis plus fort que vous. Vous doutez? Je vous le jure. Ainsi, réfléchissez à votre tour. Vous allez vous approcher de moi avec votre canne? Je vous prendrai par le cou et par l'échine, et je vous jetterai à dix pas de moi, et cela, entendez-vous bien, autant de fois que vous essaierez de revenir sur moi.
– Jeu de lord anglais, c'est-à-dire jeu de crocheteur. Eh bien! soit, monsieur l'Hercule, j'accepte.
Et Philippe, ivre de fureur, se jeta sur Cagliostro, qui tout à coup raidit ses bras comme deux crampons d'acier, saisit le chevalier à la gorge et à la ceinture, et le lança tout étourdi sur une pile de coussins épais qui garnissait un sofa dans l'angle du salon.
Puis, après ce tour de force prodigieux, il se remit devant la cheminée, dans la même posture, et comme si rien ne s'était passé.
Philippe s'était relevé, pâle et écumant, mais la réaction d'un froid raisonnement vint soudain lui rendre ses facultés morales.
Il se redressa, ajusta son habit et ses manchettes, puis d'une voix sinistre:
– Vous êtes en effet fort comme quatre hommes, monsieur, dit le chevalier; mais vous avez la logique moins nerveuse que le poignet. En me traitant comme vous venez de le faire, vous avez oublié que vaincu, humilié, à jamais votre ennemi, je venais d'acquérir le droit de vous dire: «L'épée à la main, comte, ou je vous tue.»
Cagliostro ne bougea point.
– L'épée à la main, vous dis-je, ou vous êtes mort, continua Philippe.
– Vous n'êtes pas encore assez près de moi, monsieur, pour que je vous traite comme la première fois, répliqua le comte, et je ne m'exposerai pas à être blessé par vous, tué même, comme ce pauvre Gilbert.
– Gilbert? s'écria Philippe chancelant, quel nom avez-vous prononcé là?..
– Heureusement que vous n'avez pas un fusil, cette fois, mais une épée.
– Monsieur, s'écria Philippe, vous avez prononcé un nom…
– Oui, n'est-ce pas? qui a éveillé un terrible écho dans vos souvenirs.
– Monsieur!
– Un nom que vous croyiez n'entendre jamais; car vous étiez seul avec le pauvre enfant dans cette grotte des Açores, n'est-ce pas, quand vous l'avez assassiné?
– Oh! reprit Philippe, défendez-vous! défendez-vous!
– Si vous saviez, dit Cagliostro en regardant Philippe, si vous saviez comme il serait facile de vous faire tomber l'épée des mains.
– Avec votre épée?
– Oui, d'abord avec mon épée, si je voulais.
– Mais voyons… voyons donc!..
– Oh! je ne m'y hasarderai pas; j'ai un moyen plus sûr.
– L'épée à la main! pour la dernière fois, ou vous êtes mort, s'écria Philippe en bondissant vers le comte.
– Mais celui-ci, menacé cette fois par la pointe de l'épée distante de trois pouces à peine de sa poitrine, prit dans sa poche un petit flacon qu'il déboucha, et en jeta le contenu au visage de Philippe.
À peine la liqueur eut-elle touché le chevalier, que celui-ci chancela, laissa échapper son épée, tourna sur lui-même et, tombant sur les genoux, comme si ses jambes eussent perdu la force de le soutenir, pendant quelques secondes perdit absolument l'usage de ses sens.
Cagliostro l'empêcha de tomber à terre tout à fait, le soutint, lui remit son épée au fourreau, l'assit sur un fauteuil, attendit que sa raison fût parfaitement revenue, et alors:
– Ce n'est plus à votre âge, chevalier, qu'on fait des folies, dit-il; cessez donc d'être fou comme un enfant, et écoutez-moi.
Philippe se secoua, se raidit, chassa la terreur qui envahissait son cerveau, et murmura:
– Oh! monsieur, monsieur; est-ce donc là ce que vous appelez des armes de gentilhomme?
Cagliostro haussa les épaules.
– Vous répétez toujours la même phrase, dit-il. Quand nous autres, gens de noblesse, nous avons ouvert largement notre bouche pour laisser passer le mot: gentilhomme, tout est dit. Qu'appelez-vous une arme de gentilhomme, voyons? Est-ce votre épée, qui vous a si mal servi contre moi? Est-ce votre fusil, qui vous a si bien servi contre Gilbert? Qui fait les hommes supérieurs, chevalier? Croyez-vous que ce soit ce mot sonore: gentilhomme? Non. C'est la raison d'abord, la force ensuite, la science enfin. Eh bien! j'ai usé de tout cela vis-à-vis de vous; avec ma raison, j'ai bravé vos injures, croyant vous amener à m'écouter; avec ma force, j'ai bravé votre force; avec ma science, j'ai éteint à la fois vos forces physiques et morales; il me reste maintenant à vous prouver que vous avez commis deux fautes en venant ici la menace à la bouche. Voulez-vous me faire l'honneur de m'écouter?
– Vous m'avez anéanti, dit Philippe, je ne puis faire un mouvement; vous vous êtes rendu maître de mes muscles, de ma pensée, et puis vous venez me demander de vous écouter quand je ne puis faire autrement?