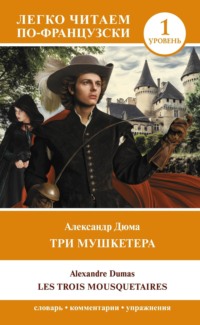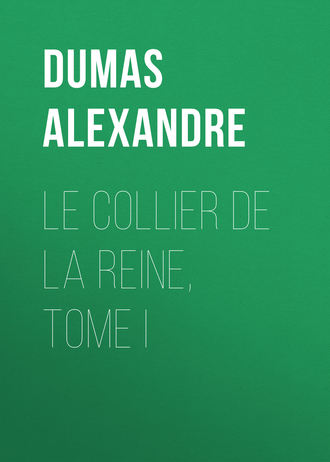 полная версия
полная версияLe Collier de la Reine, Tome I
– Faut-il que je fasse une démarche?
– Monsieur Corno!
– Diplomatique, monseigneur, très diplomatique.
– Ce serait bon si vous connaissiez ces gens là.
– Bossange est mon petit-cousin à la mode de Bretagne.
Don Manoël et Beausire se regardèrent.
Il se fit un silence. Les deux Portugais aiguisaient leurs réflexions.
Tout à coup un des valets ouvrit la porte et annonça:
– MM. Bœhmer et Bossange!
Don Manoël se leva soudain et, d'une voix irritée:
– Renvoyez ces gens-là! s'écria-t-il.
Le valet fit un pas pour obéir.
– Non, chassez-les vous-même, monsieur le secrétaire, reprit l'ambassadeur.
– Au nom du Ciel! fit Ducorneau suppliant, laissez-moi exécuter l'ordre de monseigneur; je l'adoucirai, puisque je ne puis l'éluder.
– Faites, si vous voulez, dit négligemment don Manoël.
Beausire se rapprocha de lui au moment où Ducorneau sortait avec précipitation.
– Ah çà! mais cette affaire est destinée à manquer? dit don Manoël.
– Non pas, Ducorneau va la raccommoder.
– Il l'embrouillera, malheureux! Nous avons parlé portugais seulement chez les joailliers; vous avez dit que je n'entendais pas un mot de français. Ducorneau va tout gâter.
– J'y cours.
– Vous montrer, c'est peut-être dangereux, Beausire.
– Vous allez voir que non; laissez-moi plein pouvoir.
– Pardieu!
Beausire partit.
Ducorneau avait trouvé en bas Bœhmer et Bossange, dont la contenance, depuis leur entrée à l'ambassade, était toute modifiée dans le sens de la politesse, sinon dans celui de la confiance.
Ils comptaient peu sur la vue d'un visage de connaissance, et se faufilaient avec raideur dans les premiers cabinets.
En apercevant Ducorneau, Bossange poussa un cri de joyeuse surprise.
– Vous ici! dit-il.
Et il s'approcha pour l'embrasser.
– Ah! ah! vous êtes bien aimable, dit Ducorneau, vous me reconnaissez ici, mon cousin le richard. Est-ce parce que je suis à une ambassade?
– Ma foi! oui, dit Bossange, si nous avons été séparés un peu, pardonnez-le-moi, et rendez-moi un service.
– Je venais pour cela.
– Oh! merci. Vous êtes donc attaché à l'ambassade?
– Mais oui.
– Un renseignement.
– Lequel, et sur quoi?
– Sur l'ambassade même.
– J'en suis le chancelier.
– Oh! à merveille. Nous voulons parler à l'ambassadeur.
– Je viens de sa part.
– De sa part! pour nous dire?..
– Qu'il vous prie de sortir bien vite de son hôtel, et bien vite, messieurs.
Les deux joailliers se regardèrent penauds.
– Parce que, dit Ducorneau avec importance, vous avez été maladroits et malhonnêtes, à ce qu'il paraît.
– Écoutez-nous donc.
– C'est inutile, dit tout à coup la voix de Beausire, qui apparut fier et froid au seuil de la chambre. Monsieur Ducorneau, Son Excellence vous a dit de congédier ces messieurs. Congédiez-les.
– Monsieur le secrétaire…
– Obéissez, dit Beausire avec dédain. Faites!
Et il passa.
Le chancelier prit son parent par l'épaule droite, l'associé du parent par l'épaule gauche, et les poussa doucement dehors.
– Voilà, dit-il, c'est une affaire manquée.
– Que ces étrangers sont donc susceptibles, mon Dieu! murmura Bœhmer, qui était un Allemand.
– Quand on s'appelle Souza et qu'on a neuf cent mille livres de revenu, mon cher cousin, dit le chancelier, on a le droit d'être ce qu'on veut.
– Ah! soupira Bossange, je vous ai bien dit, Bœhmer, que vous êtes trop raide en affaires.
– Eh! répliqua l'entêté Allemand, si nous n'avons pas son argent, il n'aura pas notre collier.
On approchait de la porte de la rue.
Ducorneau se mit à rire.
– Savez-vous bien ce que c'est qu'un Portugais? dit-il dédaigneusement; savez-vous ce que c'est qu'un ambassadeur, bourgeois que vous êtes? Non. Eh bien! je vais vous le dire. Un ambassadeur favori d'une reine, M. Potemkine, achetait tous les ans, au 1er janvier, pour la reine, un panier de cerises qui coûtait cent mille écus, mille livres la cerise; c'est joli, n'est-ce pas? Eh bien! M. de Souza achètera les mines du Brésil pour trouver dans les filons un diamant gros comme tous les vôtres. Cela lui coûtera vingt années de son revenu, vingt millions; mais que lui importe, il n'a pas d'enfants. Voilà.
Et il leur fermait la porte, quand Bossange, se ravisant:
– Raccommodez cela, dit-il, et vous aurez…
– Ici, l'on est incorruptible, répliqua Ducorneau.
Et il ferma la porte.
Le soir même, l'ambassadeur reçut la lettre suivante:
«Monseigneur,
«Un homme qui attend vos ordres et désire vous présenter les respectueuses excuses de vos humbles serviteurs est à la porte de votre hôtel; sur un signe de Votre Excellence, il déposera dans les mains d'un de vos gens le collier qui avait eu le bonheur d'attirer votre attention.
«Daignez recevoir, monseigneur, l'assurance du profond respect, etc., etc.
«Bœhmer et Bossange.»
– Eh bien! mais, dit don Manoël en lisant cette épître, le collier est à nous.
– Non pas, non pas, dit Beausire; il ne sera à nous que quand nous l'aurons acheté; achetons-le!
– Comment?
– Votre Excellence ne sait pas le français, c'est convenu; et, tout d'abord, débarrassons-nous de M. le chancelier.
– Comment?
– De la façon la plus simple: il s'agit de lui donner une mission diplomatique importante; je m'en charge.
– Vous avez tort, dit Manoël, il sera ici notre caution.
– Il dira que vous parlez français comme M. Bossange et moi.
– Il ne le dira pas; je l'en prierai.
– Soit, qu'il reste. Faites entrer l'homme aux diamants.
L'homme fut introduit; c'était Bœhmer en personne, Bœhmer, qui fit les plus profondes gentillesses et les excuses les plus soumises.
Après quoi il offrit ses diamants, et fit mine de les laisser pour être examinés.
Don Manoël le retint.
– Assez d'épreuves comme cela, dit Beausire; vous êtes un marchand défiant; vous devez être honnête. Asseyons-nous ici et causons, puisque M. l'ambassadeur vous pardonne.
– Ouf! que l'on a du mal à vendre! soupira Bœhmer.
«Que de mal on se donne pour voler!» pensa Beausire.
Chapitre XXX
Le marché
Alors, M. l'ambassadeur consentit à examiner le collier en détail.
M. Bœhmer en montra curieusement chaque pièce, et en fit ressortir chaque beauté.
– Sur l'ensemble de ces pierres, dit Beausire, à qui don Manoël venait de parler en portugais, M. l'ambassadeur ne voit rien à dire; l'ensemble est satisfaisant.
«Quant aux diamants en eux-mêmes, ce n'est pas la même chose; Son Excellence en a compté dix un peu piqués, un peu tachés.
– Oh! fit Bœhmer.
– Son Excellence, interrompit Beausire, se connaît mieux que vous en diamants; les nobles portugais jouent avec les diamants, au Brésil, comme ici les enfants avec du verre.
Don Manoël, en effet, posa le doigt sur plusieurs diamants l'un après l'autre, et fit remarquer avec une admirable perspicacité les défauts imperceptibles que peut-être un connaisseur n'eût pas relevés dans les diamants.
– Tel qu'il est cependant, ce collier, dit Bœhmer un peu surpris de voir un si grand seigneur aussi fin joaillier, tel qu'il est, ce collier est la plus belle réunion de diamants qu'il y ait en ce moment dans toute l'Europe.
– C'est vrai, répliqua don Manoël.
Et sur un signe Beausire ajouta:
– Eh bien! monsieur Bœhmer, voici le fait: Sa Majesté la reine de Portugal a entendu parler du collier; elle a chargé Son Excellence de négocier l'affaire après avoir vu les diamants. Les diamants conviennent à Son Excellence; combien voulez vous vendre ce collier?
– Seize cent mille livres, dit Bœhmer.
Beausire répéta le chiffre à son ambassadeur.
– C'est cent mille livres trop cher, répliqua don Manoël.
– Monseigneur, dit le joaillier, on ne peut évaluer les bénéfices au juste sur un objet de cette importance; il a fallu, pour composer une parure de ce mérite, des recherches et des voyages qui effraieraient si on les connaissait comme moi.
– Cent mille livres trop cher, repartit le tenace Portugais.
– Et pour que monseigneur vous dise cela, dit Beausire, il faut que ce soit chez lui une conviction, car Son Excellence ne marchande jamais.
Bœhmer parut un peu ébranlé. Rien ne rassure les marchands soupçonneux comme un acheteur qui marchande.
– Je ne saurais, dit-il après un moment d'hésitation, souscrire une diminution qui fait la différence du gain ou de la perte entre mon associé et moi.
Don Manoël écouta la traduction de Beausire et se leva.
Beausire ferma l'écrin et le remit à Bœhmer.
– J'en parlerai toujours à M. Bossange, dit ce dernier. Votre Excellence y consent-elle?
– Qu'est-ce à dire? demanda Beausire.
– Je veux dire que M. l'ambassadeur semble avoir offert quinze cent mille livres du collier.
– Oui.
– Son Excellence maintient-elle son prix?
– Son Excellence ne recule jamais devant ce qu'elle a dit, répliqua portugaisement Beausire; mais Son Excellence ne recule pas toujours devant l'ennui de marchander ou d'être marchandé.
– Monsieur le secrétaire, ne concevez-vous pas que je doive causer avec mon associé?
– Oh! parfaitement, monsieur Bœhmer.
– Parfaitement, répondit en portugais don Manoël, à qui la phrase de Bœhmer était parvenue, mais à moi aussi une solution prompte est nécessaire.
– Eh bien! monseigneur, si mon associé accepte la diminution, moi j'accepte d'avance.
– Bien.
– Le prix est donc dès à présent de quinze cent mille livres.
– Soit.
– Il ne reste plus, dit Bœhmer, sauf toutefois la ratification de M. Bossange…
– Toujours, oui.
– Il ne reste plus que le mode du paiement.
– Vous n'aurez pas à cet égard la moindre difficulté, dit Beausire. Comment voulez-vous être payé?
– Mais, dit Bœhmer en riant, si le comptant est possible…
– Qu'appelez-vous le comptant? dit Beausire froidement.
– Oh! je sais bien que nul n'a un million et demi en espèces à donner! s'écria Bœhmer en soupirant.
– Et d'ailleurs, vous en seriez embarrassé vous-même, monsieur Bœhmer.
– Cependant, monsieur le secrétaire, je ne consentirai jamais à me passer d'argent comptant.
– C'est trop juste.
Et il se tourna vers don Manoël.
– Combien Votre Excellence donnerait-elle comptant à M. Bœhmer?
– Cent mille livres, dit le Portugais.
– Cent mille livres, dit Beausire à Bœhmer, en signant le marché.
– Mais le reste? dit Bœhmer.
– Le temps qu'il faut à une traite de monseigneur pour aller de Paris à Lisbonne, à moins que vous ne préfériez attendre l'avertissement envoyé de Lisbonne à Paris.
– Oh! fit Bœhmer, nous avons un correspondant à Lisbonne; en lui écrivant…
– C'est cela, dit Beausire en riant ironiquement, écrivez-lui; demandez-lui si M. de Souza est solvable, et si Sa Majesté la reine est bonne pour quatorze cent mille livres.
– Monsieur… dit Bœhmer confus.
– Acceptez-vous, ou bien préférez-vous d'autres conditions?
– Celles que Monsieur le secrétaire a bien voulu me poser en premier lieu me paraissent acceptables. Y aurait-il des termes aux paiements?
– Il y aurait trois termes, monsieur Bœhmer, chacun de cinq cent mille livres, et ce serait pour vous l'affaire d'un voyage intéressant.
– D'un voyage à Lisbonne?
– Pourquoi pas?.. Toucher un million et demi en trois mois, cela vaut-il qu'on se dérange?
– Oh! sans doute, mais…
– D'ailleurs, vous voyagerez aux frais de l'ambassade, et moi ou M. le chancelier, nous vous accompagnerons.
– Je porterai les diamants?
– Sans nul doute, à moins que vous ne préfériez envoyer d'ici les traites, et laisser les diamants aller seuls en Portugal.
– Je ne sais… je… crois… que… le voyage serait utile, et que…
– C'est aussi mon avis, dit Beausire. On signerait ici. Vous recevriez vos cent mille livres comptant, vous signeriez la vente, et vous porteriez vos diamants à Sa Majesté.
– Quel est votre correspondant?
– MM. Nunez Balboa frères.
Don Manoël leva la tête.
– Ce sont mes banquiers, dit-il en souriant.
– Ce sont les banquiers de Son Excellence, dit Beausire en souriant aussi.
Bœhmer parut radieux; son aspect n'avait pas conservé un nuage; il s'inclina comme pour remercier et prendre congé.
Soudain une réflexion le ramena.
– Qu'y a-t-il? demanda Beausire inquiet.
– C'est parole donnée? fit Bœhmer.
– Oui, donnée.
– Sauf…
– Sauf la ratification de M. Bossange, nous l'avons dit.
– Sauf un autre cas, ajouta Bœhmer.
– Ah! ah!
– Monsieur, cela est tout délicat, et l'honneur du nom portugais est un sentiment trop puissant pour que Son Excellence ne comprenne pas ma pensée.
– Que de détours! Au fait!
– Voici le fait. Le collier a été offert à Sa Majesté la reine de France.
– Qui l'a refusé. Après?
– Nous ne pouvons, monsieur, laisser sortir de France à tout jamais ce collier sans en prévenir la reine, et le respect, la loyauté même exigent que nous donnions la préférence à Sa Majesté la reine.
– C'est juste, dit don Manoël avec dignité. Je voudrais qu'un marchand portugais tînt le même langage que M. Bœhmer.
– Je suis bien heureux et bien fier de l'assentiment que Son Excellence a daigné m'accorder. Voilà donc les deux cas prévus: ratification des conditions par Bossange, deuxième et définitif refus de Sa Majesté la reine de France. Je vous demande pour cela trois jours.
– De notre côté, dit Beausire, cent mille livres comptant, trois traites de cinq cent mille livres mises dans vos mains. La boîte de diamants remise à M. le chancelier de l'ambassade ou à moi disposé à vous accompagner à Lisbonne, chez MM. Nunez Balboa frères. Paiement intégral en trois mois. Frais de voyage nuls.
– Oui, monseigneur, oui, monsieur, dit Bœhmer en faisant la révérence.
– Ah! dit don Manoël en portugais.
– Quoi donc? fit Bœhmer inquiet à son tour et revenant.
– Pour épingles, dit l'ambassadeur, une bague de mille pistoles pour mon secrétaire, ou pour mon chancelier, pour votre compagnon, enfin, monsieur le joaillier.
– C'est trop juste, monseigneur, murmura Bœhmer, et j'avais déjà fait cette dépense dans mon esprit.
Don Manoël congédia le joaillier avec un geste de grand seigneur.
Les deux associés demeurèrent seuls.
– Veuillez m'expliquer, dit don Manoël avec une certaine animation à Beausire, quelle diable d'idée vous avez eue de ne pas faire remettre ici les diamants? Un voyage en Portugal! Êtes-vous fou? Ne pouvait-on donner à ces bijoutiers leur argent et prendre leurs diamants en échange?
– Vous prenez trop au sérieux votre rôle d'ambassadeur, répliqua Beausire. Vous n'êtes pas encore tout à fait M. de Souza pour M. Bœhmer.
– Allons donc! Eût-il traité s'il eût eu des soupçons?
– Tant qu'il vous plaira. Il n'eût pas traité, c'est possible; mais tout homme qui possède quinze cent mille livres se croit au-dessus de tous les rois et de tous les ambassadeurs du monde. Tout homme qui troque quinze cent mille livres contre des morceaux de papier veut savoir si ces papiers valent quelque chose.
– Allons, vous allez en Portugal! Vous qui ne savez pas le portugais… Je vous dis que vous êtes fou.
– Point du tout. Vous irez vous-même.
– Oh! non pas, s'écria don Manoël; retourner en Portugal, moi, j'ai de trop fameuses raisons. Non! non!
– Je vous déclare que Bœhmer n'eût jamais donné ses diamants contre papiers.
– Papiers signés Souza!
– Quand je dis qu'il se prend pour un Souza! s'écria Beausire en frappant dans ses mains.
– J'aime mieux entendre dire que l'affaire est manquée, répéta don Manoël.
– Pas le moins du monde. Venez ici, monsieur le commandeur, dit Beausire au valet de chambre, qui apparaissait sur le seuil. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas?
– Oui.
– Vous m'écoutiez?
– Certes.
– Très bien. Êtes-vous d'avis que j'ai fait une sottise?
– Je suis d'avis que vous avez cent mille fois raison.
– Dites pourquoi?
– Le voici. M. Bœhmer n'aurait jamais cessé de faire surveiller l'hôtel de l'ambassade et l'ambassadeur.
– Eh bien? dit don Manoël.
– Eh bien! ayant son argent à la main, son argent à ses côtés, M. Bœhmer ne conservera aucun soupçon, il partira tranquillement pour le Portugal.
– Nous n'irons pas jusque-là, monsieur l'ambassadeur, dit le valet de chambre; n'est-ce pas, monsieur le chevalier de Beausire?
– Allons donc! voilà un garçon d'esprit, dit l'amant d'Oliva.
– Dites, dites votre plan, répondit don Manoël assez froid.
– À cinquante lieues de Paris, dit Beausire, ce garçon d'esprit, avec un masque sur le visage, viendra montrer un ou deux pistolets à notre postillon; il vous volera nos traites, nos diamants, rouera de coups M. Bœhmer, et le tour sera fait.
– Je ne comprenais pas cela, dit le valet de chambre. Je voyais M. Beausire et M. Bœhmer s'embarquant à Bayonne pour le Portugal.
– Très bien!
– M. Bœhmer, comme tous les Allemands, aime la mer et se promène sur le pont. Un jour de roulis, il se penche et tombe. L'écrin est censé tomber avec lui, voilà. Pourquoi la mer ne garderait-elle pas quinze cent mille livres de diamants, elle qui a bien gardé les galions des Indes?
– Ah! oui, je comprends, dit le Portugais.
– C'est heureux, grommela Beausire.
– Seulement, reprit don Manoël, pour avoir subtilisé les diamants on est mis à la Bastille, pour avoir fait regarder la mer à M. le joaillier on est pendu.
– Pour avoir volé les diamants, on est pris, dit le commandeur; pour avoir noyé cet homme, on ne peut être soupçonné une minute.
– Nous verrons d'ailleurs quand nous en serons là, répliqua Beausire. Maintenant à nos rôles. Faisons aller l'ambassade comme des Portugais modèles, afin qu'on dise de nous: «S'ils n'étaient pas de vrais ambassadeurs, ils en avaient la mine.» C'est toujours flatteur. Attendons les trois jours.
Chapitre XXXI
La maison du gazetier
C'était le lendemain du jour où les Portugais avaient fait affaire avec Bœhmer, et trois jours après le bal de l'Opéra, auquel nous avons vu assister quelques-uns des principaux personnages de cette histoire.
Dans la rue Montorgueil, au fond d'une cour fermée par une grille, s'élevait une petite maison longue et mince, défendue du bruit de la rue par des contrevents qui rappelaient la vie de province.
Au fond de cette cour, le rez-de-chaussée, qu'il fallait aller chercher en sondant les différents gués de deux ou trois trous punais, offrait une espèce de boutique à demi ouverte à ceux qui avaient franchi l'obstacle de la grille et l'espace de la cour.
C'était la maison d'un journaliste assez renommé, d'un gazetier, comme on disait alors. Le rédacteur habitait le premier étage. Le rez-de-chaussée servait à empiler les livraisons de la gazette, étiquetées par numéros. Les deux autres étages appartenaient à des gens tranquilles, qui payaient bon marché le désagrément d'assister plusieurs fois l'an à des scènes bruyantes faites au gazetier par des agents de police, des particuliers offensés, ou des acteurs traités comme des ilotes.
Ces jours-là, les locataires de la maison de la Grille, on l'appelait ainsi dans le quartier, fermaient leurs croisées sur le devant, afin de mieux entendre les abois du gazetier, qui, poursuivi, se réfugiait ordinairement dans la rue des Vieux-Augustins, par une sortie de plain-pied avec sa chambre.
Une porte dérobée s'ouvrait, se refermait; le bruit cessait, l'homme menacé avait disparu; les assaillants se trouvaient seuls en face de quatre fusiliers des gardes-françaises, qu'une vieille servante était allée vite requérir au poste de la Halle.
Il arrivait bien de çà et de là que les assaillants, ne trouvant personne sur qui décharger leur colère, s'en prenaient aux paperasses mouillées du rez-de-chaussée, et lacéraient, trépignaient ou brûlaient, si par malheur il y avait du feu dans les environs, une certaine quantité des papiers coupables.
Mais qu'est-ce qu'un morceau de gazette pour une vengeance qui demandait des morceaux de peau du gazetier?
À ces scènes près, la tranquillité de la maison de la Grille était proverbiale.
M. Réteau sortait le matin, faisait sa ronde sur les quais, les places et les boulevards. Il trouvait les ridicules, les vices, les annotait, les crayonnait au vif, et les couchait tout portraiturés dans son plus prochain numéro.
Le journal était hebdomadaire.
C'est-à-dire que, pendant quatre jours, le sieur Réteau chassait l'article, le faisait imprimer pendant les trois autres jours, et menait du bon temps le jour de la publication du numéro.
La feuille venait de paraître le jour dont nous parlons, soixante-douze heures après le bal de l'Opéra, où Mlle Oliva avait pris tant de plaisir au bras du domino bleu.
M. Réteau, en se levant à huit heures, reçut de sa vieille servante le numéro du jour, encore humide et puant sous sa robe gris-rouge.
Il s'empressa de lire ce numéro avec le soin qu'un tendre père met à passer en revue les qualités ou les défauts de son fils chéri.
Puis quand il eut fini:
– Aldegonde, dit-il à la vieille, voilà un joli numéro; l'as-tu lu?
– Pas encore; ma soupe n'est pas finie, dit la vieille.
– Je suis content de ce numéro, dit le gazetier en élevant sur son maigre lit ses bras encore plus maigres.
– Oui, répliqua Aldegonde; mais savez-vous ce qu'on en dit à l'imprimerie?
– Que dit-on?
– On dit que certainement vous n'échapperez pas cette fois à la Bastille.
Réteau se mit sur son séant, et d'une voix calme:
– Aldegonde, Aldegonde, dit-il, fais-moi une bonne soupe et ne te mêle pas de littérature.
– Oh! toujours le même, répliqua la vieille; téméraire comme un moineau franc.
– Je t'achèterai des boucles avec le numéro d'aujourd'hui, fit le gazetier, roulé dans son drap d'une blancheur équivoque. Est-on venu déjà acheter beaucoup d'exemplaires?
– Pas encore, et mes boucles ne seront pas bien reluisantes, si cela continue. Vous rappelez-vous le bon numéro contre M. de Broglie? Il n'était pas dix heures qu'on avait déjà vendu cent numéros.
– Et j'avais passé trois fois rue des Vieux-Augustins, dit Réteau; chaque bruit me donnait la fièvre; ces militaires sont brutaux.
– J'en conclus, poursuivit Aldegonde tenace, que ce numéro d'aujourd'hui ne vaudra pas celui de M. de Broglie.
– Soit, dit Réteau; mais je n'aurai pas tant à courir, et je mangerai tranquillement ma soupe. Sais-tu pourquoi, Aldegonde?
– Ma foi non, monsieur.
– C'est qu'au lieu d'attaquer un homme, j'attaque un corps; au lieu d'attaquer un militaire, j'attaque une reine.
– La reine! Dieu soit loué, murmura la vieille; alors ne craignez rien; si vous attaquez la reine, vous serez porté en triomphe, et nous allons vendre des numéros, et j'aurai mes boucles.
– On sonne, dit Réteau, rentré dans son lit.
La vieille courut vite à la boutique pour recevoir la visite.
Un moment après, elle remontait enluminée, triomphante.
– Mille exemplaires, disait-elle, mille d'un coup; voilà une commande.
– À quel nom? dit vivement Réteau.
– Je ne sais.
– Il faut le savoir; cours vite.
– Oh! nous avons le temps; ce n'est pas peu de chose que de compter, de ficeler et de charger mille numéros.
– Cours vite, te dis-je, et demande au valet… Est-ce un valet?
– C'est un commissionnaire, un Auvergnat avec ses crochets.
– Bon! questionne, demande-lui où il va porter ces numéros.
Aldegonde fit diligence; ses grosses jambes firent gémir l'escalier de bois criard, et sa voix, qui interrogeait, ne cessa de résonner à travers les planches. Le commissionnaire répliqua qu'il portait ces numéros rue Neuve Saint-Gilles, au Marais, chez le comte de Cagliostro.
Le gazetier fit un bond de joie qui faillit défoncer sa couchette. Il se leva, vint lui-même activer la livraison confiée aux soins d'un seul commis, sorte d'ombre famélique plus diaphane que les feuilles imprimées. Les mille exemplaires furent chargés sur les crochets de l'Auvergnat, lequel disparut par la grille, courbé sous le poids.
Le sieur Réteau se disposait à noter pour le prochain numéro le succès de celui-ci, et à consacrer quelques lignes au généreux seigneur qui voulait bien prendre mille numéros d'un pamphlet prétendu politique. M. Réteau, disons-nous, se félicitait d'avoir fait une si heureuse connaissance, lorsqu'un nouveau coup de sonnette retentit dans la cour.