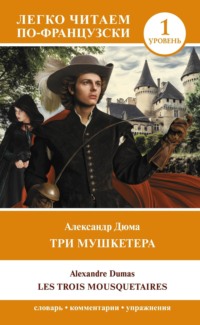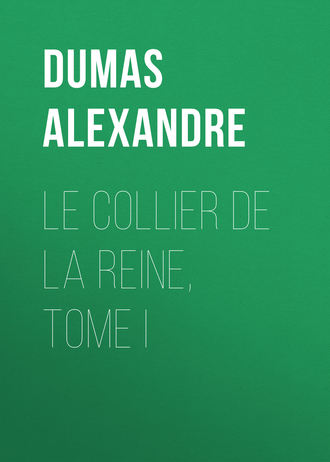 полная версия
полная версияLe Collier de la Reine, Tome I
Les quatre chevaux qui la menaient brûlaient le pavé; les postillons, comme on dit, allaient un train de prince.
La chaise s'arrêta devant un hôtel d'assez belle apparence, dans la rue de la Jussienne.
Sur la porte même de cet hôtel, deux hommes attendaient; l'un, d'une mise assez recherchée pour annoncer la cérémonie; l'autre, dans une sorte de livrée banale comme en ont eu de tout temps les officiers publics des différentes administrations parisiennes.
Autrement dit, ce dernier ressemblait à un suisse en costume d'apparat.
La chaise pénétra dans l'hôtel, dont les portes furent aussitôt fermées au nez de plusieurs curieux.
L'homme aux habits de cérémonie s'approcha très respectueusement de la portière et, d'une voix un peu chevrotante, il entama une harangue en langue portugaise.
– Qui êtes-vous? répondit de l'intérieur une voix brusque, en portugais également, seulement cette voix parlait un excellent portugais.
– Le chancelier indigne de l'ambassade, Excellence.
– Fort bien. Comme vous parlez mal notre langue, mon cher chancelier. Voyons, où descend-on?
– Par ici, monseigneur, par ici.
– Triste réception, dit le seigneur don Manoël, qui faisait le gros dos en s'appuyant sur son valet de chambre et sur son secrétaire.
– Votre Excellence daignera me pardonner, dit le chancelier dans son mauvais langage; ce n'est qu'à deux heures aujourd'hui qu'est descendu à l'ambassade le courrier de Son Excellence pour annoncer votre arrivée. J'étais absent, monseigneur, absent pour les affaires de la légation. Aussitôt mon retour, j'ai trouvé la lettre de Votre Excellence. Je n'ai eu que le temps de faire ouvrir les appartements; on les éclaire.
– Bon, bon.
– Ah! ce m'est une vive joie de voir l'illustre personne de notre nouvel ambassadeur.
– Chut! ne divulguons rien jusqu'à ce que des ordres nouveaux soient venus de Lisbonne. Veuillez seulement, monsieur, me faire conduire à ma chambre à coucher, je tombe de fatigue. Vous vous entendrez avec mon secrétaire, il vous transmettra mes ordres.
Le chancelier s'inclina respectueusement devant Beausire, qui rendit un salut affectueux et dit d'un air courtoisement ironique:
– Parlez français, cher monsieur, cela vous mettra plus à l'aise, et moi aussi.
– Oui, oui, murmura le chancelier, je serai plus à l'aise, car je vous avouerai, monsieur le secrétaire, que ma prononciation…
– Je le vois bien, répliqua Beausire avec aplomb.
– Je profiterai de cette occasion, monsieur le secrétaire, puisque je trouve en vous un homme si aimable, se hâta de dire le chancelier avec effusion, je profiterai, dis-je, de l'occasion, pour vous demander si vous croyez que M. de Souza ne m'en voudra pas d'écorcher ainsi le portugais?
– Pas du tout, pas du tout, si vous parlez le français purement.
– Moi! dit le chancelier joyeusement, moi! un Parisien de la rue Saint Honoré!
– Eh bien! c'est à ravir, dit Beausire. Comment vous nomme-t-on? Ducorneau, je crois?
– Ducorneau, oui, monsieur le secrétaire; nom assez heureux, car il a une terminaison espagnole, si l'on veut. Monsieur le secrétaire savait mon nom; c'est bien flatteur pour moi.
– Oui, vous êtes bien noté là-bas; si bien noté, que cette bonne réputation nous a empêchés d'amener un chancelier de Lisbonne.
– Oh! que de reconnaissance, monsieur le secrétaire, et quelle heureuse chance pour moi que la nomination de M. de Souza.
– Mais M. l'ambassadeur sonne, je crois.
– Courons.
On courut en effet. M. l'ambassadeur, grâce au zèle de son valet de chambre, venait de se déshabiller. Il avait revêtu une magnifique robe de chambre. Un barbier, appelé à la hâte, l'accommodait. Quelques boites et nécessaires de voyage, assez riches en apparence, garnissaient les tables et les consoles.
Un grand feu flambait dans la cheminée.
– Entrez, entrez, monsieur le chancelier, dit l'ambassadeur qui venait de s'ensevelir dans un immense fauteuil à coussins, tout en travers du feu.
– Monsieur l'ambassadeur se fâchera-t-il si je lui réponds en français? dit le chancelier tout bas à Beausire.
– Non, non, allez toujours.
Ducorneau fit son compliment en français.
– Eh! mais c'est fort commode; vous parlez admirablement le français, monsieur du Corno.
«Il me prend pour un Portugais», pensa le chancelier ivre de joie.
Et il serra la main de Beausire.
– Çà! dit Manoël, pourra-t-on souper?
– Certes, oui, Votre Excellence. Oui, le Palais-Royal est à deux pas d'ici, et je connais un traiteur excellent qui apportera un bon souper pour Votre Excellence.
– Comme si c'était pour vous, monsieur du Corno.
– Oui, monseigneur… et moi, si Son Excellence le permettait, je prendrais la permission d'offrir quelques bouteilles d'un vin du pays, comme Votre Excellence n'en aura trouvé qu'à Porto même.
– Eh! notre chancelier a donc bonne cave? dit Beausire gaillardement.
– C'est mon seul luxe, répliqua humblement le brave homme, dont, pour la première fois, aux bougies, Beausire et don Manoël purent remarquer les yeux vifs, les grosses joues rondes et le nez fleuri.
– Faites comme il vous plaira, monsieur du Corno, dit l'ambassadeur; apportez-nous de votre vin, et venez souper avec nous.
– Un pareil honneur…
– Sans étiquette, aujourd'hui je suis encore un voyageur, je ne serai l'ambassadeur que demain. Et puis nous parlerons affaires.
– Oh! mais monseigneur permettra que je donne un coup d'œil à ma toilette.
– Vous êtes superbe, dit Beausire.
– Toilette de réception, non de gala, dit Ducorneau.
– Demeurez comme vous êtes, monsieur le chancelier, et donnez à nos préparatifs le temps que vous donneriez à prendre l'habit de gala.
Ducorneau ravi quitta l'ambassadeur et se mit à courir pour gagner dix minutes à l'appétit de Son Excellence.
Pendant ce temps, les trois coquins, enfermés dans la chambre à coucher, passaient en revue le mobilier et les actes de leur nouveau pouvoir.
– Couche-t-il à l'hôtel, ce chancelier? dit don Manoël.
– Non pas: le drôle a une bonne cave et doit avoir quelque part une jolie femme ou une grisette. C'est un vieux garçon.
– Le suisse?
– Il faudra bien s'en débarrasser.
– Je m'en charge.
– Les autres valets de l'hôtel?
– Valets de louage que nos associés remplaceront demain.
– Que dit la cuisine? que dit l'office?
– Morts! morts! L'ancien ambassadeur ne paraissait jamais à l'hôtel. Il avait sa maison en ville.
– Que dit la caisse?
– Pour la caisse, il faut consulter le chancelier: c'est délicat.
– Je m'en charge, dit Beausire: nous sommes déjà les meilleurs amis du monde.
– Chut! le voici.
En effet, Ducorneau revenait essoufflé. Il avait prévenu le traiteur de la rue des Bons-Enfants, pris dans son cabinet six bouteilles d'une mine respectable, et sa figure réjouie annonçait toutes les bonnes dispositions que ces soleils, la nature et la diplomatie, savent combiner pour dorer ce que les cyniques appellent la façade humaine.
– Votre Excellence, dit-il, ne descendra pas dans la salle à manger?
– Non pas, non pas, nous mangerons dans la chambre, entre nous, près du feu.
– Monseigneur me ravit de joie. Voici le vin.
– Des topazes! dit Beausire en élevant un des flacons à la hauteur d'une bougie.
– Asseyez-vous, monsieur le chancelier, pendant que mon valet de chambre dressera le couvert.
Ducorneau s'assit.
– Quel jour sont arrivées les dernières dépêches? dit l'ambassadeur.
– La veille du départ de votre… du prédécesseur de Votre Excellence.
– Bien. La légation est en bon état?
– Oh! oui, monseigneur.
– Pas de mauvaises affaires d'argent?
– Pas que je sache.
– Pas de dettes… Oh! dites… S'il y en avait, nous commencerions par payer. Mon prédécesseur est un galant gentilhomme pour qui je me porte garant solidaire.
– Dieu merci! monseigneur n'en aura pas besoin; les crédits ont été ordonnancés il y a trois semaines, et le lendemain même du départ de l'ex-ambassadeur, cent mille livres arrivaient ici.
– Cent mille livres! s'écrièrent à la fois Beausire et don Manoël, effarés de joie.
– En or, dit le chancelier.
– En or, répétèrent l'ambassadeur, le secrétaire, et jusqu'au valet de chambre.
– De sorte, dit Beausire, en avalant son émotion, que la caisse renferme…
– Cent mille trois cent vingt-huit livres, monsieur le secrétaire.
– C'est peu, dit froidement don Manoël; mais Sa Majesté heureusement a mis des fonds à notre disposition. Je vous l'avais bien dit, mon cher, ajouta t-il en s'adressant à Beausire, que nous manquerions à Paris.
– Hormis ce point que Votre Excellence avait pris ses précautions, répliqua respectueusement Beausire.
À partir de cette communication importante du chancelier, l'hilarité de l'ambassade ne fit que s'accroître.
Un bon souper, composé d'un saumon, d'écrevisses énormes, de viandes noires et de crèmes, n'augmenta pas médiocrement cette verve des seigneurs portugais.
Ducorneau, mis à l'aise, mangea comme dix grands d'Espagne, et montra à ses supérieurs comme quoi un Parisien de la rue Saint-Honoré traitait les vins de Porto et de Xérès en vins de Brie et de Tonnerre.
M. Ducorneau bénissait encore le Ciel de lui avoir envoyé un ambassadeur qui préférait la langue française à la langue portugaise, et les vins portugais aux vins de France; il nageait dans cette délicieuse béatitude que fait au cerveau l'estomac satisfait et reconnaissant, lorsque M. de Souza l'interpellant lui demanda de s'aller coucher.
Ducorneau se leva, et dans une révérence épineuse qui accrocha autant de meubles qu'une branche d'églantier accroche de feuilles dans un taillis, le chancelier gagna la porte de la rue.
Beausire et don Manoël n'avaient pas assez fêté le vin de l'ambassade pour succomber sur-le-champ au sommeil.
D'ailleurs, il fallait que le valet de chambre soupât à son tour après ses maîtres, opération que le commandeur accomplit minutieusement, d'après les précédents tracés par M. l'ambassadeur et son secrétaire.
Tout le plan du lendemain se trouva dressé. Les trois associés poussèrent une reconnaissance dans l'hôtel, après s'être assurés que le suisse dormait.
Chapitre XXVIII
MM. Bœhmer et Bossange
Le lendemain, grâce à l'activité de Ducorneau à jeun, l'ambassade était sortie de sa léthargie. Bureaux, cartons, écritoire, air d'apparat, chevaux piaffant dans la cour, indiquaient la vie là où la veille encore on sentait l'atonie et la mort.
Le bruit se répandit vite, dans le quartier, qu'un grand personnage, chargé d'affaires, était arrivé de Portugal pendant la nuit.
Ce bruit, qui devait donner du crédit à nos trois fripons, était pour eux une source de frayeurs toujours renaissantes.
En effet, la police de M. de Crosne et celle de M. de Breteuil avaient de larges oreilles qu'elles se garderaient bien de clore en pareille occurrence; elles avaient des yeux d'Argus que certainement elles ne fermeraient pas lorsqu'il s'agirait de MM. les diplomates du Portugal.
Mais don Manoël fit observer à Beausire qu'avec de l'audace on empêcherait les recherches de la police d'être soupçons avant huit jours; les soupçons d'être certitudes avant quinze jours; que, par conséquent, avant dix jours, moyen terme, rien ne gênerait les allures de l'association, laquelle association, pour bien agir, devait avoir terminé ses opérations avant six jours.
L'aurore venait de poindre quand deux chaises de louage amenèrent dans l'hôtel la cargaison des neuf drôles destinés à composer le personnel de l'ambassade.
Ils furent installés bien vite, ou, pour mieux dire, couchés par Beausire. On en mit un à la caisse, l'autre aux archives, un troisième remplaça le suisse, auquel Ducorneau lui-même donna son congé, sous prétexte qu'il ne savait pas le portugais. L'hôtel se trouva donc peuplé par cette garnison, qui devait en défendre les abords à tout profane.
La police est profane au plus haut degré pour ceux qui ont des secrets politiques ou autres.
Vers midi, don Manoël dit Souza, s'étant habillé galamment, monta dans un carrosse fort propre que Beausire avait loué cinq cents livres par mois, en payant quinze jours d'avance.
Il partit pour la maison de MM. Bœhmer et Bossange, en compagnie de son secrétaire et de son valet de chambre.
Le chancelier reçut l'ordre d'expédier sous son couvert, et comme d'habitude, en l'absence des ambassadeurs, toutes les affaires relatives aux passeports, indemnités et secours, avec attention toutefois de ne donner des espèces ou de solder des comptes qu'avec l'agrément de M. le secrétaire.
Ces messieurs voulaient garder intacte la somme de cent mille livres, pivot fondamental de toute l'opération.
On apprit à M. l'ambassadeur que les joailliers de la couronne demeuraient sur le quai de l'École, où ils firent leur entrée vers une heure de relevée.
Le valet de chambre frappa modestement à la porte du joaillier, qui était fermée par de fortes serrures et garnie de gros clous à large tête, comme une porte de prison.
L'art avait disposé ces clous de manière à former des dessins plus ou moins agréables. Il était constaté seulement que jamais vrille, scie ou lime n'eut pu mordre un morceau du bois sans se rompre une dent sur un morceau de fer.
Un guichet treillissé s'ouvrit, et une voix demanda au valet de chambre ce qu'il désirait savoir.
– M. l'ambassadeur de Portugal veut parler à MM. Bœhmer et Bossange, répondit le valet.
Une figure apparut bien vite au premier étage, puis un pas précipité se fit entendre dans l'escalier. La porte s'ouvrit.
Don Manoël descendit de voiture avec une noble lenteur.
M. Beausire était descendu le premier pour offrir son bras à Son Excellence.
L'homme qui s'avançait avec tant d'empressement au-devant des deux Portugais était M. Bœhmer lui-même qui, en entendant s'arrêter la voiture, avait regardé par ses vitres, entendu le mot ambassadeur, et s'était élancé pour ne pas faire attendre Son Excellence.
Le joaillier se confondit en excuses pendant que don Manoël montait l'escalier.
M. Beausire remarqua que, derrière eux, une vieille servante, vigoureuse et bien découplée, fermait verrous, serrures, dont il y avait un grand luxe à la porte de la rue.
M. Beausire ayant paru faire ces observations avec une certaine recherche, M. Bœhmer lui dit:
– Monsieur, pardonnez; nous sommes si fort exposés dans notre malheureuse profession, que nos habitudes renferment toutes une précaution quelconque.
Don Manoël était demeuré impassible; Bœhmer le vit et lui réitéra à lui-même la phrase qui avait obtenu de Beausire un sourire agréable. Mais l'ambassadeur n'ayant pas plus sourcillé à la seconde fois qu'à la première:
– Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, dit encore Bœhmer décontenancé.
– Son Excellence ne parle pas français, dit Beausire, et ne peut vous entendre, monsieur; mais je vais lui transmettre vos excuses, à moins, se hâta-t-il de dire, que vous-même, monsieur, ne parliez le portugais.
– Non, monsieur, non.
– Je parlerai donc pour vous.
Et Beausire baragouina quelques mots portugais à don Manoël, qui répondit dans la même langue.
– Son Excellence M. le comte de Souza, ambassadeur de Sa Majesté Très Fidèle, accepte gracieusement vos excuses, monsieur, et me charge de vous demander s'il est vrai que vous avez encore en votre possession un beau collier de diamants?
Bœhmer leva la tête et regarda Beausire en homme qui sait toiser son monde.
Beausire soutint le choc en habile diplomate.
– Un collier de diamants, dit lentement Bœhmer, un fort beau collier?
– Celui que vous avez offert à la reine de France, ajouta Beausire, et dont Sa Majesté Très Fidèle a entendu parler.
– Monsieur, dit Bœhmer, est un officier de M. l'ambassadeur?
– Son secrétaire particulier, monsieur.
Don Manoël s'était assis en grand seigneur; il regardait les peintures des panneaux d'une assez belle pièce qui donnait sur le quai.
Un beau soleil éclairait alors la Seine, et les premiers peupliers montraient leurs pousses d'un vert tendre au-dessus des eaux, grosses encore et jaunies par le dégel.
Don Manoël passa de l'examen des peintures à celui du paysage.
– Monsieur, dit Beausire, il me semble que vous n'avez pas entendu un mot de ce que je vous ai dit.
– Comment cela, monsieur? répondit Bœhmer, un peu étourdi du ton vif du personnage.
– C'est que je vois Son Excellence qui s'impatiente, monsieur le joaillier.
– Monsieur, pardon, dit Bœhmer tout rouge, je ne dois pas montrer le collier sans être assisté de mon associé, monsieur Bossange.
– Eh bien! monsieur, faites venir votre associé.
Don Manoël se rapprocha et, de son air glacial qui comportait une certaine majesté, il commença en portugais une allocution qui fit plusieurs fois courber sous le respect la tête de Beausire. Après quoi il tourna le dos et reprit sa contemplation aux vitres.
– Son Excellence me dit, monsieur, qu'il y a déjà dix minutes qu'elle attend, et qu'elle n'a pas l'habitude d'attendre nulle part, pas même chez les rois.
Bœhmer s'inclina, prit un cordon de sonnette et l'agita.
Une minute après, une autre figure entra dans la chambre. C'était M. Bossange, l'associé.
Bœhmer le mit au fait avec deux mots. Bossange donna son coup d'œil aux deux Portugais, et finit par demander à Bœhmer sa clef pour ouvrir le coffre-fort.
«Il me paraît que les honnêtes gens, pensa Beausire, prennent autant de précautions les uns contre les autres que les voleurs.»
Dix minutes après, M. Bossange revint, portant un écrin dans sa main gauche; sa main droite était cachée sous son habit. Beausire y vit distinctement le relief de deux pistolets.
– Nous pouvons avoir bonne mine, dit don Manoël gravement en portugais; mais ces marchands nous prennent plutôt pour des filous que pour des ambassadeurs.
Et, en prononçant ces mots, il regarda bien les joailliers pour saisir sur leurs visages la moindre émotion dans le cas où ils comprendraient le portugais.
Rien ne parut, rien qu'un collier de diamants si merveilleusement beau que l'éclat éblouissait.
On mit avec confiance cet écrin dans les mains de don Manoël, qui soudain avec colère:
– Monsieur, dit-il à son secrétaire, dites à ces drôles qu'ils abusent de la permission qu'a un marchand d'être stupide. Ils me montrent du strass quand je leur demande des diamants. Dites-leur que je me plaindrai au ministre de France, et qu'au nom de ma reine, je ferai jeter à la Bastille les impertinents qui mystifient un ambassadeur de Portugal.
Disant ces mots, il fit voler, d'un revers de main, l'écrin sur le comptoir. Beausire n'eut pas besoin de traduire toutes les paroles, la pantomime avait suffi.
Bœhmer et Bossange se confondirent en excuses et dirent qu'en France on montrait des modèles de diamants, des semblants de parure, le tout pour satisfaire les honnêtes gens, mais pour ne pas allécher ou tenter les voleurs.
M. de Souza fit un geste énergique et marcha vers la porte aux yeux des marchands inquiets.
– Son Excellence me charge de vous dire, poursuivit Beausire, qu'il est fâcheux que des gens qui portent le titre de joailliers de la couronne de France en soient à distinguer un ambassadeur d'avec un gredin, et Son Excellence se retire à son hôtel.
MM. Bœhmer et Bossange se firent un signe, et s'inclinèrent en protestant de nouveau de tout leur respect.
M. de Souza leur faillit marcher sur les pieds et sortit.
Les marchands se regardèrent, décidément inquiets et courbés jusqu'à terre.
Beausire suivit fièrement son maître.
La vieille ouvrit les serrures de la porte.
– À l'hôtel de l'ambassade, rue de la Jussienne! cria Beausire au valet de chambre.
– À l'hôtel de l'ambassade, rue de la Jussienne! cria le valet au cocher.
Bœhmer entendit au travers du guichet.
– Affaire manquée! grommela le valet.
– Affaire faite, dit Beausire; dans une heure, ces croquants seront chez nous.
Le carrosse roula comme s'il eût été enlevé par huit chevaux.
Chapitre XXIX
À l'ambassade
En rentrant à l'hôtel de l'ambassade, ces messieurs trouvèrent Ducorneau qui dînait tranquillement dans son bureau.
Beausire le pria de monter chez l'ambassadeur, et lui tint ce langage:
– Vous comprenez, cher chancelier, qu'un homme tel que M. de Souza n'est pas un ambassadeur ordinaire.
– Je m'en suis aperçu, dit le chancelier.
– Son Excellence, poursuivit Beausire, veut occuper une place distinguée à Paris, parmi les riches et les gens de goût, c'est vous dire que le séjour de ce vilain hôtel, rue de la Jussienne, n'est pas supportable pour lui; en conséquence, il s'agirait de trouver une autre résidence particulière pour M. de Souza.
– Cela compliquera les relations diplomatiques, dit le chancelier; nous aurons à courir beaucoup pour les signatures.
– Eh! Son Excellence vous donnera un carrosse, cher monsieur Ducorneau, répondit Beausire.
Ducorneau faillit s'évanouir de joie.
– Un carrosse à moi! s'écria-t-il.
– Il est fâcheux que vous n'en ayez pas l'habitude, continua Beausire; un chancelier d'ambassade un peu digne doit avoir son carrosse; mais nous parlerons de ce détail en temps et lieu. Pour le moment, rendons compte à M. l'ambassadeur de l'état des affaires étrangères. La caisse, où est-elle?
– Là-haut, monsieur, dans l'appartement même de M. l'ambassadeur.
– Si loin de vous?
– Mesure de sûreté, monsieur; les voleurs ont plus de mal à pénétrer au premier qu'au rez-de-chaussée.
– Des voleurs, fit dédaigneusement Beausire, pour une si petite somme.
– Cent mille livres! fit Ducorneau. Peste! on voit bien que M. de Souza est riche. Il n'y a pas cent mille livres dans toutes les caisses d'ambassade.
– Voulez-vous que nous vérifiions? dit Beausire; j'ai hâte de me rendre à mes affaires.
– À l'instant, monsieur, à l'instant, dit Ducorneau en quittant le rez-de-chaussée.
Vérification faite, les cent mille livres apparurent en belles espèces, moitié or et moitié argent.
Ducorneau offrit sa clef, que Beausire regarda quelque temps, pour en admirer les ingénieuses guillochures et les trèfles compliqués.
Il en avait habilement pris l'empreinte avec de la cire.
Puis il la rendit au chancelier en lui disant:
– Monsieur Ducorneau, elle est mieux dans vos mains que dans les miennes; passons chez M. l'ambassadeur.
On trouva don Manoël en tête à tête avec le chocolat national. Il semblait fort occupé d'un papier couvert de chiffres. À la vue de son chancelier:
– Connaissez-vous le chiffre de l'ancienne correspondance? demanda-t-il.
– Non, Votre Excellence.
– Eh bien! je veux que désormais vous soyez initié, monsieur, vous me débarrasserez, de cette façon, d'une foule de détails ennuyeux. À propos, la caisse? demanda-t-il à Beausire.
– En parfait état, comme tout ce qui est du ressort de M. Ducorneau, répliqua Beausire.
– Les cent mille livres?
– Liquides, monsieur.
– Bien; asseyez-vous, monsieur Ducorneau, vous allez me donner un renseignement.
– Aux ordres de Votre Excellence, dit le chancelier radieux.
– Voilà le fait: affaire d'État, monsieur Ducorneau.
– Oh! j'écoute, monseigneur.
Et le digne chancelier approcha son siège.
– Affaire grave, dans laquelle j'ai besoin de vos lumières. Connaissez-vous des joailliers un peu honnêtes, à Paris?
– Il y a MM. Bœhmer et Bossange, joailliers de la couronne, dit le chancelier.
– Précisément, ce sont eux que je ne veux point employer, dit don Manoël; je les quitte pour ne jamais les revoir.
– Ils ont eu le malheur de mécontenter Votre Excellence?
– Gravement, monsieur Corno, gravement.
– Oh! si je pouvais être un peu moins réservé, si j'osais…
– Osez.
– Je demanderais en quoi ces gens, qui ont de la réputation dans leur métier…
– Ce sont de véritables juifs, monsieur Corno, et leurs mauvais procédés leur font perdre comme un million ou deux.
– Oh! s'écria Ducorneau avidement.
– J'étais envoyé par Sa Majesté Très Fidèle pour négocier l'achat d'un collier de diamants.
– Oui, oui, le fameux collier, qui avait été commandé par le feu roi pour Mme Du Barry; je sais, je sais.
– Vous êtes un homme précieux; vous savez tout. Eh bien! j'allais acheter ce collier; mais, puisque les choses vont ainsi, je ne l'achèterai pas.