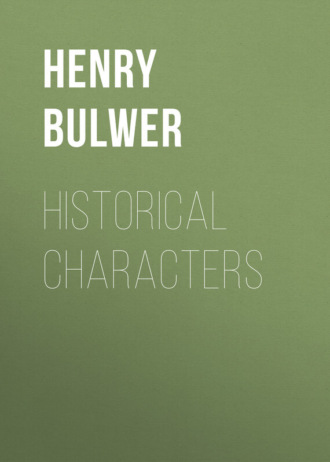 полная версия
полная версияHistorical Characters
“C’est ainsi que le prince fut, s’il est permis de le dire, porté jusqu’à Notre-Dame sur les cœurs des Français; et à son entrée dans le sanctuaire, lorsqu’il se prosterna aux pieds de l’autel, qui avait, durant tant de siècles, reçu les prières de ses pères, un rayon de lumière très-vive vint frapper sur sa figure et lui imprima je ne sais quoi de céleste. Il priait avec ardeur; tous priaient avec lui. Des larmes mouillaient nos yeux; il en échappait aux étrangers eux-mêmes. Oh! avec quelle vérité, avec quelle ardeur, chaque strophe de l’hymne de la reconnaissance était poussée vers les cieux! A la fin de la cérémonie, de vieux serviteurs du prince qui avaient pleuré trente ans son absence embrassaient ses genoux, et il les relevait avec cette grâce du cœur si touchante et qui lui est si naturelle. Le retour, de Notre-Dame aux Tuileries ne fut pas moins animé, moins heureux, et, parvenu dans la cour du palais, le prince descendit le cheval et adressa à la garde nationale une allocution parfaitement appliquée à la situation. Il prit la main à plusieurs officiers et soldats, les pria de se souvenir de ce beau jour, et leur protesta que lui-même ne l’oublierait jamais. Je fis ouvrir devant le prince les portes du palais et j’eus l’honneur de l’introduire dans l’aile qu’il devait habiter.
“Je lui demandai ses ordres pour le reste de la journée, et l’heure à laquelle je devais me présenter le lendemain pour le travail. Le prince paraissait hésiter s’il me laisserait partir ou me retiendrait. Je crus m’apercevoir que c’était indulgence de sa part, et je lui dis que je craindrais de l’occuper une minute de plus, parce que je le supposais fatigué, et c’est à moi qu’il répondit: – ‘Comment voulez-vous que je sois fatigué? C’est le seul jour de bonheur que j’ai goûté depuis trente ans. Ah! monsieur, quelle belle journée! Dites que je suis heureux et satisfait de tout le monde. Voilà mes ordres pour aujourd’hui – à demain, à neuf heures du matin.’
“En quittant le prince, je repris mon travail ordinaire et je le quittai sur les onze heures du soir pour aller chez M. de Talleyrand. Je le trouvai s’entretenant de la journée avec MM. Pasquier, Dupont de Némours, et Anglès. On s’accordait à la trouver parfaite. M. de Talleyrand rappela qu’il fallait un article au Moniteur. Dupont s’offrit de le faire. ‘Non pas,’ reprit M. de Talleyrand, ‘vous y mettriez de la poésie; je vous connais. Beugnot suffit pour cela; qu’il passe dans la bibliothèque et qu’il broche bien vite un article pour que nous l’envoyions à Sauvo.’
“Je me mets à la besogne qui n’était pas fort épineuse, mais parvenu à la mention de la réponse du prince à M. de Talleyrand, j’y suis embarrassé. Quelques mots échappés à un sentiment profond produisent de l’effet par le ton dont ils sont prononcés, par la présence des objets qui les ont provoqués, mais quand il s’agit de les traduire sur le papier, dépouillés de ces entours, ils ne sont plus que froids, et trop heureux s’ils ne sont pas ridicules. Je reviens à M. de Talleyrand, et je lui fais part de la difficulté. – ‘Voyons,’ me répondit-il, ‘qu’a dit Monsieur? Je n’ai pas entendu grand’chose; il me paraissait ému et fort curieux de continuer sa route; mais si ce qu’il a dit ne vous convient pas, faites-lui une réponse.’ ‘Mais comment faire un discours que Monsieur n’a pas tenu?’ ‘La difficulté n’est pas là: faites-le bon, convenable à la personne et au moment, et je vous promets que Monsieur l’acceptera, et si bien, qu’au bout de deux jours il croira l’avoir fait, et il l’aura fait; vous n’y serez plus pour rien.’ A la bonne heure! Je rentre, j’essaye une première version, et je l’apporte à la censure. ‘Ce n’est pas cela,’ dit M. de Talleyrand, ‘Monsieur ne fait pas d’antithèses et pas la plus petite fleur de rhétorique. Soyez court, soyez simple, et dites ce qui convient davantage à celui qui parle et à ceux qui écoutent; voilà tout.’ ‘Il me semble,’ reprit M. Pasquier, ‘que ce qui agite bon nombre d’esprits est la crainte des changements que doit occasionner le retour des princes de la maison de Bourbon; il faudrait peut-être toucher ce point, mais avec délicatesse.’ ‘Bien! et je le recommande,’ dit M. de Talleyrand. ‘J’essaye une nouvelle version et je suis renvoyé une seconde fois, parce que j’ai été trop long et que le style est apprêté. Enfin j’accouche de celle qui est au Moniteur, et où je fais dire au prince: ‘Plus de divisions: la paix et la France; je la revois enfin; et rien n’y est changé, si ce n’est qu’il s’y trouve un Français de plus.’ ‘Pour cette fois je me rends!’ reprit enfin le grand censeur, ‘c’est bien là le discours de Monsieur, et je vous réponds que c’est lui qui l’a fait; vous pouvez être tranquille à présent.’ Et en effet le mot fit fortune: les journaux s’en emparèrent comme d’un à propos heureux; on le reproduisit aussi comme un engagement pris par le prince, et le mot, ‘un Français de plus!’ devint le passeport obligé des harangues qui vinrent pleuvoir de toutes parts. Le prince ne dédaigna pas de le commenter dans ses réponses, et la prophétie de M. de Talleyrand fut complètement réalisée.”
63
Page 41, du Consulat. – “A huit heures du soir le Sénat se présenta aux Tuileries, ayant en tête son président, M. de Talleyrand. Ce personnage si bien fait pour les représentations où il fallait tempérer le fermeté par une exquise politesse, s’approcha du Prince, et selon sa coutume s’appuyant sur une canne, la tête penchée sur l’épaule, lut un discours à la fois fier et adroit, dans lequel il expliquait la conduite du Sénat sans l’excuser, car elle n’avait pas besoin d’excuse.
“‘Le Sénat,’ disait-il, ‘a provoqué le retour de votre auguste maison au trône de France. Trop instruit par le présent et le passé, il désire avec la nation affermir pour jamais l’autorité royale sur une juste division des pouvoirs, et sur la liberté publique, seules garanties du bonheur et des intérêts de tous.
“‘Le Sénat, persuadé que les principes de la constitution nouvelle sont dans votre cœur, vous défère, par le décret que j’ai l’honneur de vous présenter le titre de lieutenant-général du royaume jusqu’à l’arrivée du Roi, votre auguste frère. Notre respectueuse confiance ne peut mieux honorer l’antique loyauté qui vous fut transmise par vos ancêtres.
“‘Monseigneur, le Sénat, en ces moments d’allégresse publique, obligé de rester en apparence plus calme sur la limite de ses devoirs, n’en est pas moins pénétré des sentiments universels. Votre Altesse Royale lira dans nos cœurs à travers la retenue même de notre langage.’”
M. de Talleyrand joignit à ces paroles fermes et respectueuses les protestations de dévouement qui étaient alors dans toutes les bouches; il y mit de moins la banalité et la bassesse qui se rencontraient dans presque toutes.
“Le Prince répondit par le texte de la déclaration convenue. ‘Messieurs,’ dit-il, ‘j’ai pris connaissance de l’acte constitutionnel qui rappelle au trône de France le Roi, mon auguste frère. Je n’ai point reçu de lui le pouvoir d’accepter la Constitution, mais je connais ses sentiments et ses principes, et je ne crains pas d’être désavoué en assurant en son nom qu’il en admettra les bases.’
“Après cet engagement explicite, la déclaration énumérait les bases elles-mêmes, c’est-à-dire la division des pouvoirs, le partage du gouvernement entre le Roi et les Chambres, la responsabilité des ministres, le vote de l’impôt par la nation, la liberté de la presse, la liberté individuelle, la liberté des cultes, l’inamovibilité des juges, le maintien de la dette publique, des ventes, dites nationales, de la Légion d’Honneur, des grades et dotations de l’armée, l’oubli des votes et actes antérieurs, etc. ‘J’espère ajouta le Prince, que l’énumération de ces conditions vous suffit, et comprend toutes les garanties qui peuvent assurer la liberté et le repos de la France.’”
64
Page 121. – “‘Je sais tout cela mieux que vous,’ répondit M. de Talleyrand, ‘mais il ne faut pas qu’il en reste de trace dans l’esprit du roi, et c’est pour que l’oubli soit patent que j’ai choisi le duc de Liancourt; c’est l’homme du pays; il y fait du bien à tout le monde, il est placé pour en faire au roi, et je vous proteste qu’il sera bien reçu. Ce qui est passé est passé: la nature n’a pas donné aux hommes d’yeux par derrière, c’est de ce qui est devant qu’il faut s’occuper, et il nous restera encore assez à faire. Mais cependant, si M. de Liancourt trouvait de la difficulté à approcher du Roi? Car on s’accorde à dire qu’il est sous le joug d’un M. de Blacas qui ne laisse aborder que ceux qui lui conviennent. Qu’est-ce que ce Blacas? Je ne sais pas d’où il vient et me soucie assez peu de la savoir. Nous allons entrer dans un régime constitutionnel où le crédit se mesurera sur la capacité. C’est par la tribune et par les affaires que les hommes prendront désormais leur place, et se chargera qui voudra d’épier le moment du lever et de vider les poches du roi à son coucher.’
“M. de Liancourt était en effet parti, et partageant l’illusion de M. de Talleyrand il croyait aller reprendre sans difficulté auprès du roi l’exercice de son ancienne charge de maître de la garderobe. Tous deux avaient notablement compté sans leur hôte. M. de Liancourt ne vit point le roi, mais seulement M. de Blacas, qui le congédia avec la politesse froide qui ne lui manque jamais. Le hasard me fit rencontrer M. de Liancourt au retour, et avant qu’il eût pu voir M. de Talleyrand, je lui demandai comment il avait été reçu. Il me répondit: ‘Mal, très-mal, ou, pour mieux dire, pas du tout. Il y a là un certain M. de Blacas qui garde les avenues et vous croyez bien que je ne me suis pas abaissé à lutter contre; au reste, je crains fort que M. de Talleyrand n’ait donné dans un piège: les princes vont nous revenir les mêmes que lorsqu’ils nous ont quittés.’
“Le roi nous fut bientôt annoncé; les affaires se pressaient les unes sur les autres de telle sorte qu’à peine l’insuccès de M. de Liancourt put effleurer l’attention. Il fallait, toutefois, qu’il eût donné beaucoup à penser à M. de Talleyrand, car il n’en parlait à personne.”
65
“Mon Dieu, sire, je n’ai rien fait pour cela. C’est quelque chose d’inexplicable que j’ai en moi et qui porte malheur aux gouvernements qui me négligent.”
66
“But then, my dear M. de Talleyrand, I should be standing, and you seated.”
67
M. Thiers is of this opinion.
68
“Madame de Simiane reprit: ‘Il ne s’agit pas de cela; c’était bon du temps de Bonaparte; aujourd’hui il faut mettre dans les ministères des gens de qualité et qui ont à leurs ordres des bons travailleurs qui font les affaires, ce qu’on appele des bouleux.’” —Mémoires de Beugnot, p. 142.
69
So many and such different accounts are given of the time and manner in which this news arrived, that I merely give the popular, without answering for its being the accurate one.
70
“Le Conseil s’assemble: il se composait de MM. de Talleyrand, Dambray, de Feltre, de Fancourt, Beurnonville, et moi.
“Après deux mots de M. de Talleyrand sur ce dont le Roi a permis que le Conseil s’occupât, je commence la lecture du projet de la proclamation tel que les corrections l’avaient ajusté. Le Roi me laisse aller jusqu’au bout; puis, et non sans quelque émotion que trahit sa figure, m’ordonne de relire. Quand j’ai fini cette seconde lecture, Monsieur prend la parole; il se plaint avec vivacité des termes dans lesquels cette proclamation est rédigée. On y fait demander pardon au Roi des fautes qu’il a commises; on lui fait dire qu’il s’est laissé entraîner à ses affections, et promettre qu’il aura dans l’avenir une conduite toute différente. De pareilles expressions n’ont qu’un tort, celui d’avilir la royauté; car du reste elles disent trop ou ne disent rien du tout. M. de Talleyrand répond:
“‘Monsieur, pardonnera si je diffère de sentiments avec lui. Je trouve ces expressions nécessaires, et pourtant bien placées; le Roi a fait des fautes; ses affections l’ont égaré; il n’y a rien là de trop.’
“‘Est-ce moi,’ reprend Monsieur, ‘qu’on veut indirectement désigner?’
“‘Oui, puisque Monsieur a placé la discussion sur ce terrain, Monsieur a fait beaucoup de mal.’
“‘Le prince de Talleyrand s’oublie!..’
“‘Je le crains, mais la vérité m’emporte…’
“M. le Duc de Berry, avec l’accent d’une colère péniblement contrainte: ‘Il ne faut rien moins que la présence du Roi pour que je permette à qui que ce soit de traiter ainsi mon père devant moi, et je voudrais bien savoir…’
“A ces mots, prononcés d’un ton encore plus élevé que le reste, le Roi fait signe à M. le Duc de Berry, et dit: ‘Assez, mon neveu: c’est à moi seul à faire justice de ce qui se dit en ma présence et dans mon Conseil. Messieurs, je ne peux approuver ni les termes de la proclamation, ni la discussion dont elle a été le sujet. Le rédacteur retouchera son œuvre et ne perdra pas de vue les hautes convenances qu’il faut savoir garder quand on me fait parler.’
“M. le Duc de Berry, en me désignant: ‘Mais ce n’est pas lui qui a enfilé toutes ces sottises là.’
“Le Roi: ‘Mon neveu, cessez d’interrompre, s’il vous plaît. Messieurs, je répète que j’ai entendu cette discussion avec beaucoup de regrets. Passons à un autre sujet…’” —Mémoires du Comte Beugnot, tom. ii. p. 274.
71
“Mais, reprend vivement M. de Talleyrand, partez donc! Tandis que nous perdons le temps en allées et venues, et à disputer sur la compétence, le pont sautera! Annoncez-vous de la part du Roi de France et comme son ministre, dites les choses les plus fortes sur le chagrin qu’il éprouve.
“Voulez-vous que je dise que le Roi va se faire porter de sa personne sur le pont, pour sauter de compagnie si le maréchal ne se rend pas?
“Non pas précisément: on ne nous croit pas faits pour un tel héroïsme; mais quelque chose de bon et de fort: vous entendez bien, quelque chose de fort.
“Je cours à l’hôtel dû maréchal. Il était absent, mais j’y trouve les officiers de son état-major réunis. Je me fais annoncer de la part du Roi de France, et je suis reçu avec une politesse respectueuse; j’explique le sujet de ma mission à celui des officiers que je devais supposer le chef de l’état-major. Il me répond par des regrets sur l’absence de M. le maréchal, et s’excuse sur l’impuissance où il est de donner des ordres sans avoir pris les siens. J’insiste, on prend le parti d’aller chercher le maréchal qu’on était sur de trouver dans le lieu confident de ses plus chers plaisirs, au Palais-Royal, No. 113. Il arrive avec sa mauvaise humeur naturelle à laquelle se joignit le chagrin d’avoir été dérangé de sa partie de trente-et-un. Il m’écoute impatiemment, et comme il m’avait fort mal compris, il me répond de telle sorte qu’à mon tour je n’y comprends rien du tout. Le chef d’état-major reprend avec lui la conversation en allemand. Elle dure quelque temps, et j’entendais assez la langue pour m’apercevoir que le maréchal rejetait avec violence les observations fort raisonnables que faisait l’officier. Enfin, ce dernier me dit que M. le maréchal n’avait pas donné l’ordre pour la destruction du pont, que je concevais sans peine comment le nom qu’il avait reçu importunait des soldats prussiens; mais que du moment que le Roi de France avait fait justice de ce nom, il ne doutait pas que les entreprises commencées contre ce pont ne cessassent à l’instant même, et que l’ordre allait en être donné. Je lui demandai la permission d’attendre que l’ordre fût parti pour que j’eusse le droit de rassurer complètement Sa Majesté. Il le trouva bon. Le maréchal était retourné bien vite à son cher No. 113; l’ordre partit en effet. Je suivis l’officier jusque sur la place, et quand je vis que les ouvriers avaient cessé et se retiraient avec leurs outils, je vins rendre compte à M. de Talleyrand de cette triste victoire. Cela lui rendit un peu de bonne humeur. ‘Puisque les choses se sont passées de la sorte, dit le prince, on pourrait tirer parti de votre idée de ce matin, que le Roi avait menacé de se faire porter sur le pont pour sauter de compagnie: il y a là matière d’un bon article de journal. Arrangez cela.’
“Je l’arrangeai en effet; l’article parut dans les feuilles du surlendemain. Louis XVIII. dût être bien effrayé d’un pareil coup de tête de sa part; mais ensuite il en accepta de bonne grâce la renommée. Je l’ai entendu complimenter de cet admirable trait de courage, et il répendait avec une assurance parfaite…”
72
“Vous voyez à quoi les circonstances me forcent: j’ai à vous remercier de votre zèle, vous êtes sans reproche, et rien ne vous empêche de rester tranquillement à Paris.”
73
“J’ai eu le bonheur de rendre au Roi assez de services pour croire qu’ils n’ont pas été oubliés; je ne comprendrais pas ce qui pourrait me forcer de quitter Paris. J’y resterai, et je serai trop heureux d’apprendre qu’on ne fera pas suivre au Roi une ligne capable de compromettre sa dynastie et la France.”
74
Of whom nineteen to be tried by military law, the rest banished. A list of sixty, who were to be warned to quit France, was in the same spirit reduced to twenty.
75
“Gentlemen, – It is to-day sixteen years ago, that, called by him who then governed the world to give him my opinion as to a conflict which we were about to engage in with the Spanish people, I had the misfortune to displease him by unveiling the future, and revealing all the dangers likely to spring from an aggression not less unjust than rash. Disgrace was the price of my sincerity. Strange destiny! that which brings me back after this long space of time to renew to my legitimate sovereign the same efforts, the same counsels. The speech of the crown has dispelled the last hopes of the friends of peace, and, menacing Spain, is, I ought to say it, alarming for France… Yes, I will have the courage to tell all the truth. The chivalrous sentiments, which in 1789 carried away the generous hearts of that epoch, could not save the legitimate monarchy: they may lose it in 1823.”
76
“Sans la liberté de la presse il n’y a point de gouvernement représentatif: elle est un de ses instruments essentiels, elle en est l’instrument principal: chaque gouvernement a les siens, et nous ne nous souvenons pas assez que souvent ceux qui sont bons pour tel gouvernement sont détestables pour tel autre. Il a été démontré jusqu’à l’évidence, par plusieurs membres de cette Chambre, qui, dans cette session et dans le précédentes, ont parlé sur cette matière, que sans la liberté de la presse il n’y a point de gouvernement représentatif. Je ne vous redirai donc point ce que vous avez tous ou entendu, ou lu, et ce qui a dû souvent être l’objet de vos méditations.
“Mais il est deux points de vue sous lesquels la question ne me paraît pas avoir été suffisamment examinée et que je réduis à ces deux propositions:
“1°. La liberté de la presse est une nécessité du temps.
“2°. Un gouvernement s’expose quand il se refuse obstinément et trop longtemps à ce que le temps a proclamé nécessaire.
“L’esprit humain n’est jamais complètement stationnaire. La découverte de la veille n’est pour lui qu’un moyen de plus d’arriver à des découvertes nouvelles. Il est pourtant vrai de dire qu’il semble procéder par crises, parce-qu’il y a des époques où il est plus particulièrement tourmenté du besoin d’enfanter et de produire, d’autres, au contraire, où, satisfait de ses conquêtes, il paraît se reposer sur lui-même, et plus occupé de mettre ordre à ses richesses que d’en acquérir de nouvelles: le dix-septième siècle fut une de ces époques fortunées. L’esprit humain, étonné des richesses immenses dont l’imprimerie l’avait mis complètement en possession, s’arrêta d’admiration pour jouir de ce magnifique héritage. Tout entier aux jouissances des lettres, des sciences et des arts, il mit sa gloire et son bonheur à produire des chefs-d’œuvre. Tous les grands génies du siècle de Louis XIV. travaillèrent a l’envi à embellir un ordre social au-delà duquel ils ne voyaient rien, ils ne désiraient rien, et qui leur paraissait devoir durer autant que la gloire du grand Roi, objet de leurs respects et de leur enthousiasme. Mais quand on eut épuisé cette mine féconde de l’antiquité, l’activité de l’esprit humain se trouva presque forcée de chercher ailleurs, et il ne trouva de choses nouvelles que dans les études spéculatives qui embrassent tout l’avenir, et dont les limites sont inconnues. Ce fut dans ces dispositions que s’ouvrit le dix-huitième siècle, qui devait si peu ressembler au précédent. Aux leçons poétiques de Télémaque succédèrent les théories de l’esprit des lois, et Port-Royal fut remplacé par l’Encyclopédie.
“Je vous prie de remarquer, Messieurs, que je ne blâme ni n’approuve: je raconte.
“En nous rappelant tous les maux versés sur la France pendant la révolution, il ne faut cependant pas être tout-à-fait injuste envers les génies supérieurs qui l’ont amenée; et nous ne devons pas oublier que si dans leurs écrits ils n’ont pas toujours su se préserver de l’erreur, nous leur devons aussi la révélation de quelques grandes vérités. N’oublions pas surtout que nous ne devons pas les rendre responsables de la précipitation inconsidérée avec laquelle la France, presque tout entière, s’est lancée dans la carrière qu’ils s’étaient contentés d’indiquer. On a mis en pratique des aperçus, et toujours on a pu dire: ‘malheur à celui qui dans son fol orgueil veut aller au-delà des nécessités du temps, l’abîme ou quelque révolution l’attendent.’ Mais quand on ne fait que ce que le temps commande, on est sûr de ne pas s’égarer.
“Or, Messieurs, voulez-vous savoir quelles étaient en 1789 les véritables nécessités du temps? ouvrez les cahiers des différents ordres. Tout ce qui était alors le vœu réfléchi des hommes éclairés, voilà ce que j’appelle des nécessités. L’Assemblée Constituante n’en fut que l’interprète lorsqu’elle proclama la liberté des cultes, l’égalité devant la loi, la liberté individuelle, le droit des jurisdictions (nul ne peut être distrait de ses juges naturels), la liberté de la presse.
“Elle fut peu d’accord avec le temps lorsqu’elle institua une Chambre unique, lorsqu’elle détruisit le sanction royale, lorsqu’elle tortura les consciences, etc. etc. Et cependant, malgré ses erreurs, dont je n’ai cité qu’un petit nombre, erreurs suivies de si grandes calamités, la postérité qui a commencé pour elle, lui reconnaît la gloire d’avoir établi les bases de notre nouveau droit public.
“Tenons donc pour certain que ce qui est voulu, que ce qui est proclamé bon et utile par tous les hommes éclairés d’un pays, sans variation pendant une suite d’années diversement remplies, est une nécessité du temps. Telle est, Messieurs, la liberté de la presse. Je m’adresse à tous ceux d’entre vous qui sont plus particulièrement mes contemporains, n’était-elle pas l’objet des vœux de tous ces hommes excellents que nous avons admirés dans notre jeunesse, – des Malesherbes, des Trudaines, – qui certes valaient biens les hommes d’état que nous avons depuis? La place que les hommes que j’ai nommés occupent dans nos souvenirs prouve bien que la liberté de la presse consolide les renommées légitimes; et si elle ruine les réputations usurpées, où donc est le mal?
“Après avoir prouvé que la liberté de la presse est en France le résultat nécessaire de l’état actuel de la société, il me reste à établir ma seconde proposition, qu’un gouvernement s’expose quand il se refuse obstinément à ce que le temps a proclamé une nécessité.
“Les sociétés les plus tranquilles et qui devraient être les plus heureuses, renferment toujours dans leur sein un certain nombre d’hommes qui aspirent à conquérir, à la faveur du désordre, les richesses qu’ils n’ont pas et l’importance qu’ils ne devraient jamais avoir. Est-il prudent de mettre aux mains de ces ennemis de l’ordre social, des motifs de mécontentement sans lesquels leur perversité serait éternellement impuissante?
“La société, dans sa marche progressive, est destinée à subir de nouvelles nécessités; je comprends que les gouvernements ne doivent pas se hâter de les reconnaître et d’y faire droit; mais quand il les ont reconnues, reprendre ce qu’on a donné, ou, ce qui revient au même, le suspendre sans cesse, c’est une témérité dont, plus que personne, je desire que n’aient pas à se repentir ceux qui en conçoivent la commode et funeste pensée. Il ne faut jamais compromettre la bonne foi d’un gouvernement. De nos jours, il n’est pas facile de tromper longtemps. Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que Voltaire, plus d’esprit que Bonaparte, plus d’esprit que chacun des directeurs, que chacun des ministres passés, présents, à venir, c’est tout le monde. S’engager, ou du moins persister dans une lutte où tout le monde se croit intéresse, c’est une faute, et aujourd’hui toutes les fautes politiques sont dangereuses.

