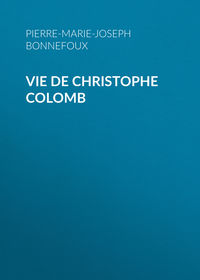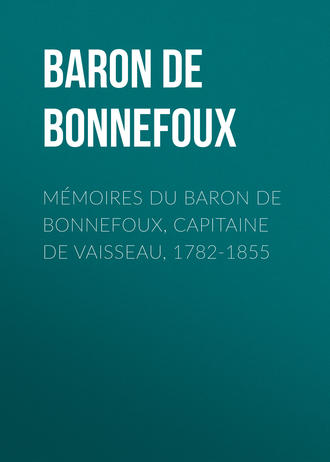
Полная версия
Mémoires du Baron de Bonnefoux, Capitaine de vaisseau, 1782-1855
Dans les garnisons où mon père se trouva après son voyage d'Afrique, la chasse occupa une partie de ses loisirs; mais on ne peut pas toujours chasser, et ce fut ce malheureux jeu qui vint en combler l'autre partie. Il gagna, il perdit, il fit des dettes, il se libéra; il ruina son colonel dans une nuit; à son tour il fut ruiné, il emprunta, il rendit; il acheta des bijoux, des chevaux, il les vendit… Cependant il faut observer que jamais il ne quittait une ville, sans être obligé d'avoir recours à son père qui, d'abord, paya, en l'avertissant toutefois que ces sommes seraient portées en décompte de ses droits à sa légitime ou portion de succession19, et qui bientôt déclara qu'il ne paierait plus.
Cette détermination sévère mais juste fit naître quelques moments de repentir, pendant lesquels, pour chercher à couper le mal dans sa racine, le chevalier de Beauregard résolut de passer dans les colonies, croyant fuir ainsi les occasions que la société d'alors ne lui présentait que trop souvent en France.
Il s'était fait des connaissances distinguées; il obtint donc d'y être promptement envoyé avec le régiment de Vermandois20, et profitant, en même temps, du crédit de ses amis, il pensa qu'il se rendrait agréable à sa famille, en allant prendre congé d'elle avec un brevet d'admission gratuite du jeune chevalier de Bonnefoux21, second fils de son frère aîné, dans une école d'où il sortirait pour entrer dans la Marine. Ce plan réussit à merveille; le joueur fut oublié; on ne vit plus que le fils revenu de ses erreurs, que le parent affectueux, que l'officier qui s'expatriait! la visite fut douce pour tous, et mon père quitta la maison paternelle, éprouvant et laissant les plus vives émotions.
Suivant son usage cependant de mêler l'extraordinaire ou l'éclat à toutes ses actions, il ne voulut partir que soixante heures précises avant l'instant où on lui avait mandé que son régiment, alors à Brest, se rendrait à bord22. En conséquence, un cheval de poste se trouva à sa porte; et, la montre à la main, il exécuta son projet et partit de Marmande en courrier. Un petit retard, qu'on lui fit éprouver à un relais où les chevaux étaient tous employés au dehors, fut sur le point de lui faire manquer son bâtiment; toutefois il arriva à temps; heureusement que ses camarades avaient pourvu, pour lui, à ces mille petits détails que nécessite un embarquement.
C'est aux Antilles que le régiment de Vermandois allait tenir garnison. La traversée ne présenta aucun incident remarquable; on fit bonne chère à bord; on y trouva des officiers de marine, qui sympathisèrent de jeunesse, de gaieté, avec les passagers; on y joua même un peu; mais tout se passa très bien. Une naïveté d'un camarade de mon père amusa surtout beaucoup ces Messieurs: ce pauvre jeune homme était horriblement malade du mal de mer; il eut la maladresse de céder à un perfide conseil, et il écrivit au commandant «qu'il le priait en grâce d'arrêter le bâtiment (qui faisait grand sillage vent arrière) ne fut-ce que pour quelques minutes». Il paraît que le commandant entendit fort bien la plaisanterie, car il répondit immédiatement au bas de la lettre: «Pas possible, Monsieur, nous sommes à la descente.» Mon père racontait ses histoires avec une grâce parfaite; il les embellissait de traits piquants, de détails scientifiques; il en était de même de ses lettres: le fond n'y était pas, l'orthographe non plus; mais telle est l'influence de l'habitude de la bonne compagnie, que ceux qui entendaient ses paroles ou son style, auraient supposé un homme d'une éducation littéraire soignée. On a souvent dit que Mme de Sévigné n'écrivait pas correctement, et l'exemple de mon père me fait pencher à trouver ce fait possible.
L'intention de se soustraire aux occasions de jouer en allant aux colonies était, sans doute, très bonne; mais c'était vraiment tomber de Charybde en Scylla. Les Antilles étaient alors dans leur plus beau temps; la ville du Cap-Français, à Saint-Domingue, celle du Fort-Royal de la Martinique, n'avaient point de rivales au monde pour l'opulence, le luxe, la magnificence. Comment le jeu, dont les chances irritantes conviennent si bien au caractère des créoles, ne s'y serait-il pas établi en souverain; comment, lorsqu'il se présentait sous les formes les plus séduisantes, mon père aurait-il résisté?
Le chevalier de Beauregard visita toutes les Antilles françaises; c'étaient donc, tous les jours, des dîners somptueux, des bals splendides, et des parties de vrai joueur. Une dame surtout, qui a rempli l'univers des produits d'une entreprise commerciale encore existante, Mme Anfoux, dont les liqueurs n'ont jamais été égalées, ne laissait jamais sortir les officiers qui allaient s'approvisionner chez elle, sans les faire participer à un repas exquis; et l'on passait de la table à la salle à manger à celle du Pharaon ou du Craëbs, qui étaient couvertes de quadruples, de moïdes23, de louis d'or; à peine l'argent blanc osait-il s'y montrer!
Dans ces temps de préjugés sur la naissance, c'était déroger que d'accepter ainsi les invitations d'un chef de manufacture; mais, ici, l'usage avait fait loi, et le plaisir, joint un peu, je suppose, à la réputation de chance habituellement contraire de Mme Anfoux, en perpétuait l'usage.
J'en ai bu, dans mon enfance, de cette liqueur qui réveillait tous les jeunes souvenirs de mon père; et j'entendais toujours, en même temps, une historiette nouvelle sur la partie et sur ses phases diverses de tel jour ou sur le dîner qui l'avait précédée. Mon père aimait passionnément la bonne chère: c'était un travers du temps et un nouveau résultat de l'absence de goûts plus solides; il poussait celui-ci jusqu'à se mêler de cuisine, et il prétendait tenir de la meilleure source le secret de la combinaison de certains plats où vraiment il excellait. J'imagine qu'il avait principalement recueilli ces notions chez les Bénédictins du Fort-Royal, au couvent desquels il y avait table ouverte et jeu de trictrac; dans la description de ces dîners ou de ces parties, pas un mets, pas un convive, pas un joueur, pas un coup n'étaient oubliés; mille amusantes anecdotes s'y trouvaient groupées; il était vraiment facile d'y assister en idée, de s'en représenter la réalité.
Lorsque le chevalier de Beauregard fut rappelé en France24, il est question de quatre cent mille francs qu'il avait conservés de ses gains au jeu, dans les colonies. Son régiment avait fait un long séjour dans ces pays; il y était même devenu si populaire que j'en ai retrouvé le nom dans quelques chansons de nègres, qui ont été chantées jusqu'à moi.
Revenir en France et avoir quatre cent mille francs, il y avait de quoi faire tourner la tête à bien des gens! Mon père fut de ce nombre, et comme il se rendait à la garnison de Metz, il ne crut pas pouvoir être digne de la société des dames chanoinesses de cette ville, où l'on retrouvait plusieurs habitudes des Antilles, sans s'annoncer par le fracas d'un équipage à la dernière mode et de tous les accessoires d'usage, comme domestiques, livrée, chevaux de main, toilette et habits fort riches, etc. Un petit nègre était même de la maison comme signe caractéristique de luxe et cachet de position. Toutefois tant de constance de la part de la fortune devait se démentir. Sans te raconter toutes les tribulations que le chevalier de Beauregard éprouva à Metz, il n'est que trop vrai qu'il perdit tout ce qu'il avait, et au delà, qu'il emprunta, que son père refusa de payer, qu'il fut emprisonné pour dettes, qu'il fut sur le point d'être destitué, enfin qu'il ne sortit de prison que parce que sa mère, en pleurs, parvint à fléchir son mari; mais plus de trente mille francs y passèrent, c'est-à-dire plus que sa légitime, en y comprenant les dettes précédemment acquittées.
Empressons-nous de jeter un voile sur cette période fatale; et, pour respirer plus à l'aise, reprenons mon père en garnison à Béziers, où il se rendit après avoir quitté Metz, songeant à se marier, et ayant fait le serment sur une parole d'honneur qu'il n'a jamais violée, de ne plus, à l'avenir, se livrer qu'à des jeux appelés de commerce; tels que piquet, reversis, boston, etc., et qu'à un taux de société.
L'époque où mon père quitta Metz est, à peu près, celle où éclata la guerre de l'Indépendance des États-Unis d'Amérique. À l'exception, toutefois, d'un très petit corps d'armée qui y fut envoyé sous les ordres du comte de Rochambeau, la France n'y prit part que comme puissance maritime.
Le régiment de Vermandois, où mon père était alors capitaine-commandant, continua donc, pendant cette période, à rester en garnison en France, et particulièrement dans le Midi.
Les parades ou revues de ce régiment étaient fort brillantes, à Béziers; elles se faisaient ou se passaient sur la vaste place de la Citadelle, d'où l'œil plane sur la verdoyante plaine de Saint-Pierre, et, par delà, va se perdre dans les flots azurés de la Méditerranée qui paraissent, eux-mêmes, bornés par un horizon à demi-teintes roses et bleues particulières à ces beaux climats. Deux balcons qui donnaient sur cette place appartenaient à M. Valadon25, docteur-médecin formé à l'École de Montpellier, renommé pour son savoir, maître d'une jolie fortune, allié à plusieurs des meilleures familles du pays, telles que celles de Lirou, de Ginestet, et beau-frère de Bouillet26 de l'Académie des Sciences de Berlin27, qui était en même temps l'un de ces magistrats municipaux qu'en Languedoc on appelait encore consuls. M. Valadon avait deux filles que l'on voyait souvent, avec leurs jeunes amies, décorer ces balcons; l'aînée de ces demoiselles était une jolie brune, vive, piquante, mariée douze ou quinze ans après à M. d'Hémeric, retiré du service comme capitaine de cavalerie, et dont les saillies spirituelles ont, jusqu'à sa mort, attiré chez elle l'élite de la société. L'autre, moins jolie, peut-être, mais plus grande, plus belle femme, fut celle qui ne put voir, sans émotion, les grâces, la bonne mine du chevalier de Beauregard, âgé pourtant d'un peu plus de quarante ans, et qui devint ma mère.
Il était dit, cependant, que l'exaltation de ce brillant officier se manifesterait encore dans cette circonstance, où il faut tant de prudence et d'égards. M. Valadon, en père éclairé, avait pris des informations qui lui avaient fait connaître les fautes encore récentes du joueur, et il fit des objections bien naturelles, mais qui blessèrent vivement le chevalier de Beauregard. Quelques ménagements, un peu de temporisation, auraient tout aplani; loin de là, le prétendant abusa de l'ascendant qu'il avait sur un jeune cœur; il menaça de se tuer si l'objet de ses vœux ne consentait pas à un enlèvement, et il assigna une heure pour cet enlèvement, garantissant, au reste, que tout serait prêt pour un mariage en règle, à la première poste où on s'arrêterait. Mlle Valadon résistait; mais malheureusement le chevalier d'H… l'un des camarades de mon père, était dans une position à peu près pareille; les deux jeunes personnes furent initiées au secret l'une de l'autre; on proposa de partir tous les quatre; et ces demoiselles, qui n'auraient pas accepté autrement, consentirent à un départ simultané.
Les torts furent grands de tous les côtés; mais, au moins, les paroles furent observées, les promesses tenues, les arrangements accomplis, et l'on s'était à peine aperçu du départ des fugitives qu'elles rentrèrent chez leurs pères, conduites par leurs maris, et implorant un pardon peu mérité. M. Valadon avait le cœur trop gros pour que la scène se passât sans orage; il parla longtemps avec amertume, et il termina, par les mots suivants, des apostrophes que des larmes et des sanglots avaient fréquemment interrompues: «Vous, Monsieur, pourquoi me demander ce qu'il n'est plus en mon pouvoir de refuser?
«Et vous, ma fille, vous avez, malgré moi, malgré vos devoirs, voulu vous lancer dans une sphère qui n'est ni la vôtre, ni la mienne; puissé-je me tromper; mais vous mourrez malheureuse!..» Hélas, il ne dit que trop vrai!
Ce mariage, dont les formes imprudentes sont judicieusement abolies par les stipulations de notre Code civil actuel, hâta peut-être la mort de mon grand-père, qui eut lieu peu de temps après; et l'on peut croire qu'alors il était encore sous l'influence des impressions fâcheuses qu'il en avait éprouvées, car il ne laissa à ma mère que la portion nommée légitime, résolution qu'il n'aurait pas prise, sans cela, on peut le présumer; quoique les usages du Languedoc fussent et soient toujours défavorables aux cadets.
Quatre enfants naquirent presque successivement de ce mariage, qui prospéra d'abord, comme on devait l'attendre de l'esprit d'ordre consommé de ma mère, de sa tendresse pour son mari, et du changement heureux qui s'opéra dans les habitudes de mon père. Il fut un excellent mari; et sa femme l'en récompensa par son dévouement, dévouement si passionné qu'il finit par lui coûter la vie à elle-même, comme tu le verras plus tard.
Ta tante Eugénie fut le premier de ces enfants; dès qu'elle fut d'âge à pouvoir profiter des leçons d'un pensionnat, on la plaça dans celui qui était alors connu très avantageusement dans toute la France sous le nom de couvent de Lévignac, près Toulouse. Quand elle en sortit, c'était une demoiselle d'une grande instruction, de manières très distinguées, d'une belle taille, et douée d'une figure où des yeux noirs veloutés faisaient une impression profonde, entourés qu'ils étaient d'une peau éblouissante de blancheur, de sourcils d'ébène, et de la chevelure la plus touffue. Le marquis de Lort, ancien chef d'escadre, lui fit une cour assidue; mais le joli, le loyal, l'agréable chevalier de Polhes, aujourd'hui baron de Maureilhan, revenait à vingt-cinq ans d'une émigration où il avait été entraîné à l'âge de quinze, et quoique dans une position bien inférieure à celle du marquis de Lort, sous le rapport de la fortune, sa demande de la main de ma sœur fut acceptée par elle, et tous les jours elle s'en applaudit.
Joséphine fut le second enfant de mon père. Celle-ci avait, sans mélange, tous les traits distinctifs des Bonnefoux; c'est-à-dire un teint ravissant, le nez aquilin, des yeux bleus d'une extrême douceur, quoique très vifs, et des cheveux d'un blond cendré charmant. Elle était remarquablement belle; mais sa beauté ne put la sauver du trépas; et à peine commençait-elle à frapper tous les regards qu'elle fut atteinte d'une maladie violente, et qu'elle y succomba.
Je naquis ensuite en 1782; j'avais tout au plus dix-huit mois, que la petite vérole fondit sur moi avec toute sa malignité. Les médecins me laissèrent pour mort; la garde-malade me jeta le linceul sur la tête; mais ma mère me découvrit vivement, et m'embrassa, m'étreignant avec tant de tendresse que j'en fus ranimé! Il ne m'est resté de cette affreuse maladie que quelques marques sur la figure; par compensation, peut-être, je n'ai pas eu, depuis lors, de maladie vraiment sérieuse. Quant à ma taille, elle est exactement devenue celle de mon père, cinq pieds cinq pouces.
Adélaïde, qui fut ma troisième sœur, mourut extrêmement jeune. Enfin, après une interruption assez longue, naquit ton oncle Laurent28; et, quatre ans après, c'est-à-dire en 1792, un sixième enfant, qui reçut le nom d'Aglaé, mais qui, comme Adélaïde, nous fut enlevée en bas âge.
CHAPITRE II
Sommaire: Mes premières années, le jardin de Valraz et son bassin. – Détachements du régiment de Vermandois en Corse, le chevalier de Beauregard à Ajaccio, ses relations avec la famille Bonaparte. – Voyage à Marmande. – M. de Campagnol, colonel de Napoléon. – Retour à Béziers. – La Fête du Chameau ou des Treilles. – L'École militaire de Pont-le-Voy. – Changement de son régime intérieur. – Renvoi des fils d'officiers. – À l'âge de onze ans et demi, je quitte Pont-le-Voy, vers la fin de 1793, pour me rendre à Béziers. – Rencontre du capitaine Desmarets. —Cincinnatus Bonnefoux. – Bordeaux et la guillotine. – Arrivée à Béziers.
Ma mère m'avait donné le jour; elle m'avait nourri de son lait; elle m'avait rendu la vie quand j'avais été abandonné, lors de ma petite vérole; j'eus ensuite le nez cassé dans une chute, et elle me prodigua les soins les plus touchants; une nouvelle chute que je fis, la bouche portant sur un verre cassé et ma bonne par-dessus moi faillit me rendre ce qu'on appelle bec-de-lièvre (Ne dirait-on pas qu'il y avait une conjuration générale contre ma pauvre figure?) et il fallut à cette digne mère un mois d'assiduités et de veilles pour m'empêcher de détruire l'effet des appareils que les chirurgiens avaient mis sur mes lèvres; cependant ce ne fut pas tout, sa tendresse eut à supporter une nouvelle épreuve, car elle avait encore une fois à me disputer à la mort et à remporter la victoire sur cette redoutable ennemie.
Nulle part plus que dans ma ville natale on n'aime les parties de campagne: une salade en est ordinairement le prétexte; mais chacun apporte son plat, et la collation y est fort agréable, fort abondante, surtout lorsque la réunion se compose de personnes possédant de l'aisance, gaies, aimables, et vivant sous un des plus riants climats de l'univers. De charmants jardins avoisinent la ville de Béziers; celui de Valraz avait alors la vogue. On venait d'y goûter. Les dames, les cavaliers, se promenaient sur la terrasse; les bonnes dansaient des rondes au dessous, et les enfants folâtraient alentour. Tout à coup je me sens poussé. Je recule de quelques pas; je rencontre un tertre d'un pied d'élévation; je tombe à la renverse, et il me reste encore, de cette scène, l'ineffaçable souvenir de la magnifique voûte azurée du ciel du Languedoc, que je n'avais jamais remarquée jusque-là, et qui se déroula tout entière à mes yeux; mais un froid glacial vint suspendre mon admiration, j'étais dans un bassin de six pieds de profondeur!.. mes camarades, seuls, m'avaient vu tomber; stupéfaits, ils n'osaient proférer une parole, et les bonnes dansaient toujours, lorsqu'un cri perçant se fit entendre. Quel pouvait-il être, si ce n'est celui d'une mère dont l'œil vigilant ne découvre plus son fils, et qui, à l'embarras des autres enfants, devine l'affreuse vérité? S'élancer vers le bassin en faisant retentir l'air de ces mots déchirants: «Mon fils est noyé!» fut pour ma mère l'acte d'un instant; mais un officier du régiment de Médoc, qui était au bas de la terrasse, lui barra le passage, la saisit par la taille et l'arrêta. Cet officier apprit, à ses dépens, ce qu'il en coûte de lutter contre l'énergique passion de l'amour maternel; ses bas de soie furent mis en lambeaux, et ses jambes, en sang, par les hauts talons (alors à la mode) de sa prisonnière; ses mains, sa figure furent en vingt endroits égratignés jusqu'au vif; mais la belle taille qu'il tenait captive ne lui échappa point, et pendant ce temps un jardinier m'avait retiré du bassin et m'avait remis à mon père, qui, averti dans le salon d'où il n'était pas sorti après la collation, était accouru, et arriva pour me recevoir.
Trois fois j'avais reparu sur l'eau, et trois fois j'étais retombé au fond; la vie n'était plus en moi qu'à sa dernière période; aussi tous les soins du monde ne purent-ils la rappeler qu'après un quart d'heure de la mort la plus apparente. Tous avaient renoncé à me sauver; ma mère, seule, ne s'était pas découragée. Elle me serrait de ses bras caressants; elle me réchauffait de son corps, et sa bouche, collée sur la mienne, m'envoyait sa bienfaisante haleine, afin de rendre leur jeu à mes poumons affaissés. C'est dans cette position que je la vis lorsque mes yeux se rouvrirent. Mes mains se croisèrent autour de son cou, comme pour la remercier; elle fut attérrée de bonheur! Je n'avais pas quatre ans; mais cette scène pathétique est encore devant mes yeux, comme si elle était d'hier.
Promenant ensuite mes regards autour de moi, je vis, avec une sorte de terreur, quarante spectateurs immobiles; mais, tel est le caractère frivole de l'enfance qu'apercevant un grand feu devant la porte du salon et la jardinière y faisant chauffer pour moi une ample chemise rousse, en la tenant fermée au collet par ses mains, et la faisant tourner et gonfler vivement autour de la flamme, je partis d'un grand éclat de rire à ce spectacle inconnu…
Jusqu'alors il était resté quelque doute à ma mère sur mon salut; mais ce rire inattendu la rassura complètement.
Dès lors, n'ayant plus besoin de l'effort surnaturel de courage avec lequel elle avait surmonté de si pénibles émotions, elle céda à l'épuisement de ses forces, et elle s'évanouit. Son retour à la connaissance fut bien doux, car j'étais tout à fait remis, et elle put, à son aise, se livrer aux transports de sa joie.
La Corse avait été réunie à la France en 1769; quelques années après le mariage de mon père, le régiment de Vermandois avait été tenu d'y fournir un certain nombre d'hommes de garnison. C'était un pays quasi barbare, d'une population ingouvernable, couvert de forêts où abondaient des sangliers redoutables. Lorsque mon père était forcé de quitter Béziers, il n'était jamais plus heureux que lorsque c'était pour aller dans cette île, où son activité, son courage, son goût pour la chasse qui ne s'était pas affaibli, trouvaient des aliments réitérés. Il se plaisait à gravir les rochers, à explorer les bois, à réduire les insurgés, autant qu'à affronter les terribles sangliers, à la poursuite desquels il courut souvent des dangers plus menaçants que dans ses autres excursions où, cependant, il avait, une fois, été atteint d'un coup de fusil à la jambe gauche.
Toutefois Bastia et Ajaccio lui procuraient de temps en temps d'agréables moments de repos ou de distraction. Ce fut à Ajaccio qu'il vit briller Mme Lætitia Bonaparte, alors dans la fleur de l'âge, et qui faisait l'ornement de la société qu'on trouvait réunie chez le gouverneur de l'île, M. le comte de Marbeuf. Elle était mère de huit enfants, et lorsque mon père leur adressait de ces paroles aimables qui sortaient si gracieusement de sa bouche, il était loin de prévoir les hautes destinées de cette famille. Mme Lætitia, encore vivante, n'a perdu qu'un de ses enfants: Napoléon, son second fils.
Mon père avait, en outre, quelques congés pour revenir à Béziers. C'étaient alors des moments charmants. Ma mère quittait la réclusion où, pendant l'absence de son mari, elle se condamnait sévèrement, afin de s'occuper, sans partage, des détails de sa maison; nous n'entendions plus parler que de fêtes ou de parties, et, une fois entre autres, nous exécutâmes celle d'aller à Marmande, voir mon respectable aïeul et les diverses personnes de la famille dont il était le chef.
Nous traversâmes le Languedoc sur le bateau de poste du canal du Midi; il s'y trouvait, à l'aller comme au retour, des officiers, des dames, des enfants, qui me parurent d'une grande amabilité; j'en ai conservé les souvenirs les plus agréables.
Arrivés à Marmande, non seulement nous visitâmes la famille qui, alors, s'y trouvant presque au grand complet, nous présenta une réunion de jeunes et brillants officiers, de charmantes filles, leurs sœurs ou leurs cousines, mais encore nous visitâmes tous les lieux des environs où se trouvait quelque Bonnefoux; nous allâmes même jusqu'en Périgord; et, dans nos tournées, nous eûmes l'occasion de voir un de nos parents, M. de Campagnol. Il était officier supérieur d'artillerie, et, depuis, il devint le colonel d'un régiment dans lequel servait Napoléon29.
Ma mère fut accueillie comme devait l'être une dame de son mérite. Quant à moi, je gagnai complètement les bonnes grâces de mon aïeul, et celles du chevalier de Bonnefoux, qui servait dans la marine. Mon aïeul avait, sur la cheminée de sa chambre, un petit soldat en ivoire auquel il tenait beaucoup et dont il arriva que j'eus grande envie. Il me le donna avant notre départ; mais il fit la remarque qu'il avait été vaincu par ma persévérance et par l'adresse avec laquelle j'avais fait changer ses dispositions, qui n'étaient nullement de me faire ce cadeau, dont j'étais si fier.
Ce que mon aïeul avait la bonté d'appeler de la persévérance était souvent de l'entêtement, défaut très grand, que, dans mon enfance, j'ai, quelquefois, poussé jusqu'à l'excès, qui a fait verser bien des larmes à ma mère, mais que mon père traitait avec beaucoup de discernement, quoiqu'il y mît une juste sévérité. Notre retour à Béziers fut marqué par la célébration d'une fête locale, qui porte le caractère, ainsi qu'on le remarque assez souvent dans le Midi, soit des rites du paganisme, soit de quelque fait historique important. Quoi qu'il en soit, cette fête a beaucoup d'éclat. Le jour qu'on lui assigne est celui de l'Ascension, c'est-à-dire l'époque la plus riante de l'année, dans un climat qui, lui-même, est d'une grande beauté; mais on ne la célèbre pas tous les ans; il faut de la joie dans les esprits, qui se rattache à quelque événement remarquable, et elle entraîne à de fortes dépenses; ainsi, depuis lors, on ne l'a guère plus revue qu'à la paix de 1802 et à celle de 181430; on l'appelle «Fête du Chameau» ou plus agréablement «Fête des Treilles».