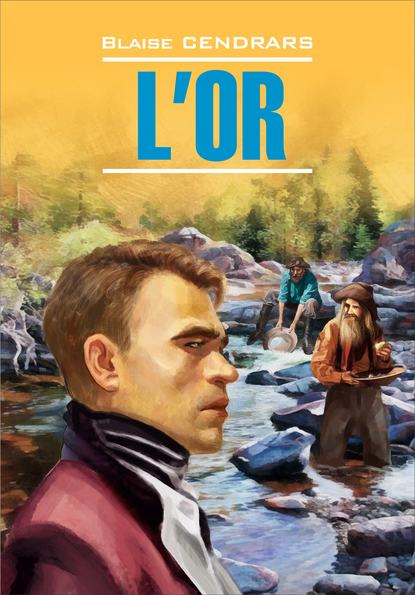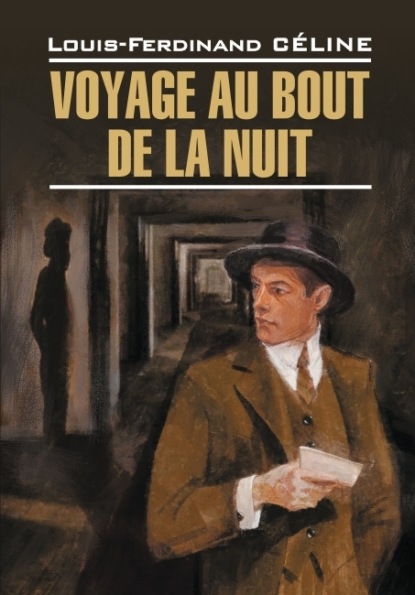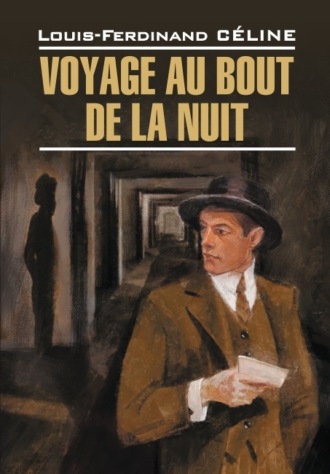
Полная версия
Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке
« Il a été épatant! Bravo, Sainte-Engence!.. Si vous l’aviez vu, messieurs! Quel assaut! » l’appuyait le capitaine Ortolan.
C’était dans l’escadron d’Ortolan que ça venait de se passer.
« Je n’ai rien perdu de l’affaire! Je n’en étais pas loin! Un coup de pointe au cou en avant et à droite!.. Toc! Le premier tombe!.. Une autre pointe en pleine poitrine!.. À gauche! Traversez! Une véritable parade de concours, messieurs!.. Encore bravo, Sainte-Engence! Deux lanciers! À un kilomètre d’ici! Les deux gaillards y sont encore! En pleins labours! La guerre est finie pour eux, hein, Sainte-Engence?.. Quel coup double! Ils ont dû se vider comme des lapins! »
Le lieutenant de Sainte-Engence, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent qu’Ortolan s’était porté garant de l’exploit, il était rassuré et il prenait du large, il ramenait sa jument au sec en la faisant tourner lentement en cercle autour de l’escadron rassemblé comme s’il se fût agi des suites d’une épreuve de haies.
« Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance et du même côté! Tout de suite! s’affairait le capitaine Ortolan décidément excité. Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d’autres derrière… Tenez, vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos quatre hommes! »
C’est à moi qu’il s’adressait le capitaine.
« Et quand ils vous tireront dessus, eh bien tâchez de les repérer et venez me dire tout de suite où ils sont! Ce doit être des Brandebourgeois!.. »
Ceux de l’active racontaient qu’au quartier, en temps de paix, il n’apparaissait presque jamais le capitaine Ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d’autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne qu’on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles, dès qu’il mettait pied à terre, il chancelait d’abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d’une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyés prendre du feu à la bouche des canons d’en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu’elle avait un contrat avec le capitaine Ortolan.
La première partie de sa vie (je me renseignai) s’était passée dans les concours hippiques à s’y casser les côtes, quelques fois l’an. Ses jambes, à force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leurs mollets. Il n’avançait plus Ortolan qu’à pas nerveux et pointus comme sur des triques. Au sol, dans la houppelande démesurée, voûté sous la pluie, on l’aurait pris pour le fantôme arrière d’un cheval de course.
Notons qu’au début de la monstrueuse entreprise, c’est-à-dire au mois d’août, jusqu’en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de routes, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés… On pouvait s’y laisser approcher par l’illusion d’être à peu près tranquille et croûter par exemple une boîte de conserve avec son pain, jusqu’au bout, sans être trop lancinés par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d’octobre ce fut bien fini ces petites accalmies, la grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d’obus et de balles. Bientôt on serait en plein orage et ce qu’on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi et on ne pourrait plus voir qu’elle: sa propre mort.
La nuit, dont on avait eu si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l’attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour. Et il n’y avait plus que cette différence qui comptait.
C’est difficile d’arriver à l’essentiel, même en ce qui concerne la guerre, la fantaisie résiste longtemps.
Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter dans l’eau.
On dénichait dans la nuit çà et là des quarts d’heure qui ressemblaient assez à l’adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s’accomplissaient tant d’autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix…
Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d’avant-garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en longs cortèges boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d’avoine, de riz et de gendarmes et de pinard aussi, en bonbonnes le pinard, qui rappellent si bien la gaudriole, cahotantes et pansues.
À pied, les traînards derrière la forge et le pain et des prisonniers à nous, des leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l’étrier des gendarmes, certains à fusiller demain, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi ceux‐là, leur ration de ce thon si difficile à digérer (ils n’en auraient pas le temps) en attendant que le convoi reparte, sur le rebord de la route – et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux, qu’on disait être un espion, et qui n’en savait rien. Nous non plus.
La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d’une grange inconnue vers l’autre, engueulés, menacés, de l’une à l’autre, hagards, sans l’espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d’avoir été torturés, dupés jusqu’au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d’autre chose, autant qu’ils étaient, que de tuer et d’être étripés sans savoir pourquoi.
Vautrés à terre entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de bottes, on se trouvait bientôt relevés par la gradaille et relancés encore un coup vers d’autres chargements du convoi, encore.
Le village en suintait de nourriture et d’escouades dans la nuit bouffie de graisse, de pommes, d’avoine, de sucre, qu’il fallait coltiner et bazarder en route, au hasard des escouades. Il amenait de tout le convoi, sauf la fuite.
Lasse, la corvée s’abattait autour de la carriole et survenait le fourrier alors avec son fanal au-dessus de ces larves. Ce singe à deux mentons qui devait dans n’importe quel chaos découvrir des abreuvoirs. Aux chevaux de boire! Mais j’en ai vu moi, quatre des hommes, derrière compris, roupiller dedans la pleine eau, évanouis de sommeil, jusqu’au cou.
Après l’abreuvoir il fallait encore la retrouver la ferme et la ruelle par où on était venus, et où on croyait bien l’avoir laissée l’escouade. Si on ne retrouvait rien, on était quittes pour s’écrouler une fois de plus le long d’un mur, pendant une seule heure, s’il en restait encore une à roupiller. Dans ce métier d’être tué, faut pas être difficile, faut faire comme si la vie continuait, c’est ça le plus dur, ce mensonge.
Et ils repartaient vers l’arrière les fourgons. Fuyant l’aube, le convoi reprenait sa route, en crissant de toutes ses roues tordues, il s’en allait avec mon vœu qu’il serait surpris, mis en pièces, brûlé enfin au cours de cette journée même, comme on voit dans les gravures militaires, pillé le convoi, à jamais, avec tout son équipage de gorilles gendarmes, de fers à chevaux et de rengagés à lanternes et tout ce qu’il contenait de corvées et de lentilles encore et d’autres farines, qu’on ne pouvait jamais faire cuire, et qu’on ne le reverrait plus jamais. Car crever pour crever de fatigue ou d’autre chose, la plus douloureuse façon est encore d’y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec.
Le jour où on les aurait ainsi bousillés jusqu’aux essieux ces salauds-là, au moins nous foutraient-ils la paix, pensais-je, et même si ça ne serait rien que pendant une nuit tout entière, on pourrait dormir au moins une fois tout entier corps et âme.
Ce ravitaillement, un cauchemar en surcroît, petit monstre tracassier sur le gros de la guerre. Brutes devant, à côté et derrière. Ils en avaient mis partout. Condamnés à mort différés on ne sortait plus de l’envie de roupiller énorme, et tout devenait souffrance en plus d’elle, le temps et l’effort de bouffer. Un bout de ruisseau, un pan de mur par là qu’on croyait avoir reconnus… On s’aidait des odeurs pour retrouver la ferme de l’escouade, redevenus chiens dans la nuit de guerre des villages abandonnés. Ce qui guide encore le mieux, c’est l’odeur de la merde.
Le juteux du ravitaillement, gardien des haines du régiment, pour l’instant le maître du monde. Celui qui parle de l’avenir est un coquin, c’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots. Dans la nuit du village de guerre, l’adjudant gardait les animaux humains pour les grands abattoirs qui venaient d’ouvrir. Il est le roi l’adjudant! Le Roi de la Mort! Adjudant Cretelle! Parfaitement! On ne fait pas plus puissant. Il n’y a d’aussi puissant que lui qu’un adjudant des autres, en face.
Rien ne restait du village, de vivant, que des chats effrayés. Les mobiliers bien cassés d’abord, passaient à faire du feu pour la cuistance, chaises, fauteuils, buffets, du plus léger au plus lourd. Et tout ce qui pouvait se mettre sur le dos, ils l’emmenaient avec eux, mes camarades. Des peignes, des petites lampes, des tasses, des petites choses futiles, et même des couronnes de mariées, tout y passait. Comme si on avait encore eu à vivre pour des années. Ils volaient pour se distraire, pour avoir l’air d’en avoir encore pour longtemps. Des envies de toujours.
Le canon pour eux c’était rien que du bruit. C’est à cause de ça que les guerres peuvent durer. Même ceux qui la font, en train de la faire, ne l’imaginent pas. La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route, qui pouvaient « encore servir ». Ainsi le mouton, sur le flanc, dans le pré, agonise et broute encore. La plupart des gens ne meurent qu’au dernier moment; d’autres commencent et s’y prennent vingt ans d’avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre.
Je n’étais point très sage pour ma part, mais devenu assez pratique cependant pour être lâche définitivement. Sans doute donnais-je à cause de cette résolution l’impression d’un grand calme. Toujours est-il que j’inspirais tel que j’étais une paradoxale confiance à notre capitaine, Ortolan lui‐même, qui résolut pour cette nuit‐là de me confier une mission délicate. Il s’agissait, m’expliqua‐t‐il, en confidence, de me rendre au trot avant le jour à Noirceur-sur-la-Lys, ville de tisserands, située à quatorze kilomètres du village où nous étions campés. Je devais m’assurer dans la place même, de la présence de l’ennemi. À ce sujet, depuis le matin, les envoyés n’arrivaient qu’à se contredire. Le général des Entrayes en était impatient. À l’occasion de cette reconnaissance, on me permit de choisir un cheval parmi les moins purulents du peloton. Depuis longtemps, je n’avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en voyage. Mais la délivrance était fictive.
Dès que j’eus pris la route, à cause de la fatigue, je parvins mal à m’imaginer, quoi que je fis, mon propre meurtre, avec assez de précision et de détails. J’avançais d’arbre en arbre, dans mon bruit de ferraille. Mon beau sabre à lui seul, pour le potin, valait un piano. Peut-être étais-je à plaindre, mais en tout cas sûrement, j’étais grotesque.
À quoi pensait donc le général des Entrayes en m’expédiant ainsi dans ce silence, tout vêtu de cymbales? Pas à moi bien assurément.
Les Aztèques éventraient couramment, qu’on raconte, dans leurs temples du soleil, quatre-vingt mille croyants par semaine, les offrant ainsi au Dieu des nuages, afin qu’il leur envoie la pluie. C’est des choses qu’on a du mal à croire avant d’aller en guerre. Mais quand on y est, tout s’explique, et les Aztèques et leur mépris du corps d’autrui, c’est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des Entrayes, plus haut nommé, devenu par l’effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi, une sorte de petit soleil atrocement exigeant.
Il ne me restait qu’un tout petit peu d’espoir, celui d’être fait prisonnier. Il était mince cet espoir, un fil. Un fil dans la nuit, car les circonstances ne se prêtaient pas du tout aux politesses préliminaires. Un coup de fusil vous arrive plus vite qu’un coup de chapeau dans ces moments-là. D’ailleurs, que trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe, et venu expressément pour m’assassiner de l’autre bout de l’Europe?.. S’il hésitait une seconde (qui me suffirait) que lui dirais‐je?.. Que serait‐il d’abord en réalité? Quelque employé de magasin? Un rengagé professionnel? Un fossoyeur peut-être? Dans le civil? Un cuisinier?.. Les chevaux ont bien de la chance eux, car s’ils subissent aussi la guerre, comme nous, on ne leur demande pas d’y souscrire, d’avoir l’air d’y croire. Malheureux mais libres chevaux! L’enthousiasme hélas! c’est rien que pour nous, ce putain!
Je discernais très bien la route à ce moment et puis posés sur les côtés, sur le limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons, aux murs blanchis de lune, comme de gros morceaux de glace inégaux, tout silence, en blocs pâles. Serait‐ce ici la fin de tout? Combien y passerais-je de temps dans cette solitude après qu’ils m’auraient fait mon affaire? Avant d’en finir? Et dans quel fossé? Le long duquel de ces murs? Ils m’achèveraient peut-être? D’un coup de couteau? Ils arrachaient parfois les mains, les yeux et le reste… On racontait bien des choses à ce propos et des pas drôles! Qui sait?.. Un pas du cheval… Encore un autre… suffiraient? Ces bêtes trottent chacune comme deux hommes en souliers de fer collés ensemble, avec un drôle de pas de gymnastique tout désuni.
Mon cœur au chaud, ce lapin, derrière sa petite grille des côtes, agité, blotti, stupide.
Quand on se jette d’un trait du haut de la Tour Eiffel on doit sentir des choses comme ça. On voudrait se rattraper dans l’espace.
Il garda pour moi secrète sa menace, ce village, mais toutefois, pas entièrement. Au centre d’une place, un minuscule jet d’eau glougloutait pour moi tout seul.
J’avais tout, pour moi tout seul, ce soir-là. J’étais propriétaire enfin, de la lune, du village, d’une peur énorme. J’allais me remettre au trot. Noirceur-sur-la-Lys ça devait être encore à une heure de route au moins, quand j’aperçus une lueur bien voilée au-dessus d’une porte. Je me dirigeai tout droit vers cette lueur et c’est ainsi que je me suis découvert une sorte d’audace, déserteuse il est vrai, mais insoupçonnée. La lueur disparut vite, mais je l’avais bien vue. Je cognai. J’insistai, je cognai encore, j’interpellai très haut, mi en allemand, mi en français, tour à tour, pour tous les cas, ces inconnus bouclés au fond de cette ombre.
La porte finit par s’entrouvrir, un battant.
« Qui êtes‐vous? » fit une voix. J’étais sauvé.
« Je suis un dragon…
– Un Français? » La femme qui parlait, je pouvais l’apercevoir.
« Oui, un Français…
– C’est qu’il en est passé ici tantôt des dragons allemands… Ils parlaient français aussi ceux-là…
– Oui, mais moi, je suis français pour de bon…
– Ah!.. »
Elle avait l’air d’en douter.
« Où sont-ils à présent? demandai-je.
– Ils sont repartis vers Noirceur sur les huit heures… » Et elle me montrait le nord avec le doigt.
Une jeune fille, un châle, un tablier blanc, sortaient aussi de l’ombre à présent, jusqu’au pas de la porte…
« Qu’est-ce qu’ils vous ont fait? que je lui ai demandé, les Allemands?
– Ils ont brûlé une maison près de la mairie et puis ici ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre… Comme il jouait sur le pont Rouge en les regardant passer… Tenez! qu’elle me montra… Il est là… »
Elle ne pleurait pas. Elle ralluma cette bougie dont j’avais surpris la lueur. Et j’aperçus – c’était vrai – au fond, le petit cadavre couché sur un matelas, habillé en costume marin; et le cou et la tête livides autant que la lueur même de la bougie, dépassaient d’un grand col carré bleu. Il était recroquevillé sur lui-même, bras et jambes et dos recourbés l’enfant. Le coup de lance lui avait fait comme un axe pour la mort par le milieu du ventre. Sa mère, elle, pleurait fort, à côté, à genoux, le père aussi. Et puis, ils se mirent à gémir encore tous ensemble. Mais j’avais bien soif.
« Vous n’avez pas une bouteille de vin à me vendre? que je demandai.
– Faut vous adresser à la mère… Elle sait peut-être s’il y en a encore… Les Allemands nous en ont pris beaucoup tantôt… »
Et alors, elles se mirent à discuter ensemble à la suite de ma demande et tout bas.
« Y en a plus! qu’elle revint m’annoncer, la fille, les Allemands ont tout pris… Pourtant on leur en avait donné de nous-mêmes et beaucoup…
– Ah oui, alors, qu’ils en ont bu! que remarqua la mère, qui s’était arrêtée de pleurer, du coup. Ils aiment ça…
– Et plus de cent bouteilles, sûrement, ajouta le père, toujours à genoux lui…
– Y en a plus une seule alors? insistai-je, espérant encore, tellement j’avais grand-soif, et surtout de vin blanc, bien amer, celui qui réveille un peu. J’ veux bien payer…
– Y en a plus que du très bon. Y vaut cinq francs la bouteille… consentit alors la mère.
– C’est bien! » Et j’ai sorti mes cinq francs de ma poche, une grosse pièce.
« Va en chercher une! » lui commanda-t-elle tout doucement à la sœur.
La sœur prit la bougie et remonta un litre de la cachette un instant plus tard.
J’étais servi, je n’avais plus qu’à m’en aller.
« Ils vont revenir? demandai-je, inquiet à nouveau.
– Peut‐être, firent‐ils ensemble, mais alors ils brûleront tout… Ils l’ont promis en partant…
– Je vais aller voir ça.
– Vous êtes bien brave… C’est par là! » que m’indiquait le père, dans la direction de Noirceur-sur-la-Lys… Même il sortit sur la chaussée pour me regarder m’en aller. La fille et la mère demeurèrent craintives auprès du petit cadavre, en veillée.
« Reviens! qu’elles lui faisaient de l’intérieur. Rentre donc Joseph, t’as rien à faire sur la route, toi…
– Vous êtes bien brave », me dit-il encore le père, et il me serra la main.
Je repris, au trot, la route du Nord.
« Leur dites pas que nous sommes encore là au moins! » La fille était ressortie pour me crier cela.
« Ils le verront bien, demain, répondis-je, si vous êtes là! » J’étais pas content d’avoir donné mes cent sous. Il y avait ces cent sous entre nous. Ça suffit pour haïr, cent sous, et désirer qu’ils en crèvent tous. Pas d’amour à perdre dans ce monde, tant qu’il y aura cent sous.
« Demain! » répétaient-ils, eux, douteux…
Demain, pour eux aussi, c’était loin, ça n’avait pas beaucoup de sens un demain comme ça. Il s’agissait de vivre une heure de plus au fond pour nous tous, et une seule heure dans un monde où tout s’est rétréci au meurtre c’est déjà un phénomène.
Ce ne fut plus bien long. Je trottais d’arbre en arbre et m’attendais à être interpellé ou fusillé d’un moment à l’autre. Et puis rien.
Il devait être sur les deux heures après minuit, guère plus, quand je parvins sur le faîte d’une petite colline, au pas. De là j’ai aperçu tout d’un coup en contrebas des rangées et encore des rangées de becs de gaz allumés, et puis, au premier plan, une gare tout éclairée avec ses wagons, son buffet, d’où ne montait cependant aucun bruit… Rien. Des rues, des avenues, des réverbères, et encore d’autres parallèles de lumières, des quartiers entiers, et puis le reste autour, plus que du noir, du vide, avide autour de la ville, tout étendue elle, étalée devant moi, comme si on l’avait perdue la ville, tout allumée et répandue au beau milieu de la nuit. J’ai mis pied à terre et je me suis assis sur un petit tertre pour regarder ça pendant un bon moment.
Cela ne m’apprenait toujours pas si les Allemands étaient entrés dans Noirceur, mais comme je savais que dans ces cas-là, ils mettaient le feu d’habitude, s’ils étaient entrés et s’ils n’y mettaient point le feu tout de suite à la ville, c’est sans doute qu’ils avaient des idées et des projets pas ordinaires.
Pas de canon non plus, c’était louche.
Mon cheval voulait se coucher lui aussi. Il tirait sur sa bride et cela me fit retourner. Quand je regardai à nouveau du côté de la ville, quelque chose avait changé dans l’aspect du tertre devant moi, pas grand-chose, bien sûr, mais tout de même assez pour que j’appelle. « Hé là! qui va là?.. » Ce changement dans la disposition de l’ombre avait eu lieu à quelques pas… Ce devait être quelqu’un…
« Gueule pas si fort! que répondit une voix d’homme lourde et enrouée, une voix qui avait l’air bien française.
– T’es à la traîne aussi toi? » qu’il me demande de même. À présent, je pouvais le voir. Un fantassin c’était, avec sa visière bien cassée « à la classe ». Après des années et des années, je me souviens bien encore de ce moment-là, sa silhouette sortant des herbes, comme faisaient des cibles au tir autrefois dans les fêtes, les soldats.
Nous nous rapprochions. J’avais mon revolver à la main. J’aurais tiré sans savoir pourquoi, un peu plus.
« Écoute, qu’il me demande, tu les as vus, toi?
– Non, mais je viens par ici pour les voir.
– T’es du 145e dragons?
– Oui, et toi?
– Moi, je suis un réserviste…
– Ah! » que je fis. Ça m’étonnait, un réserviste. Il était le premier réserviste que je rencontrais dans la guerre. On avait toujours été avec des hommes de l’active nous. Je ne voyais pas sa figure, mais sa voix était déjà autre que les nôtres, comme plus triste, donc plus valable que les nôtres. À cause de cela, je ne pouvais m’empêcher d’avoir un peu confiance en lui. C’était un petit quelque chose.
« J’en ai assez moi, qu’il répétait, je vais aller me faire paumer par les Boches… »
Il cachait rien.
« Comment que tu vas faire? »
Ça m’intéressait soudain, plus que tout, son projet, comment qu’il allait s’y prendre lui pour réussir à se faire paumer?
« J’ sais pas encore…
– Comment que t’as fait toujours pour te débiner?.. C’est pas facile de se faire paumer!
– J’ m’en fous, j’irai me donner.
– T’as donc peur?
– J’ai peur et puis je trouve ça con, si tu veux mon avis, j’ m’en fous des Allemands moi, ils m’ont rien fait…
– Tais-toi, que je lui dis, ils sont peut-être à nous écouter… » J’avais comme envie d’être poli avec les Allemands. J’aurais bien voulu qu’il m’explique celui-là pendant qu’il y était, ce réserviste, pourquoi j avais pas de courage non plus moi, pour faire la guerre, comme tous les autres… Mais il n’expliquait rien, il répétait seulement qu’il en avait marre.
Il me raconta alors la débandade de son régiment, la veille, au petit jour, à cause des chasseurs à pied de chez nous, qui par erreur avaient ouvert le feu sur sa compagnie à travers champs. On les avait pas attendus à ce moment-là. Ils étaient arrivés trop tôt de trois heures sur l’heure prévue. Alors les chasseurs, fatigués, surpris, les avaient criblés. Je connaissais l’air, on me l’avait joué.
« Moi, tu parles, si j’en ai profité! qu’il ajoutait. “Robinson, que je me suis dit! – C’est mon nom Robinson!.. Robinson Léon! – C’est maintenant ou jamais qu’il faut que tu les mettes”, que je me suis dit!.. Pas vrai? J’ai donc pris par le long d’un petit bois et puis là, figure‐toi, que j’ai rencontré notre capitaine… Il était appuyé à un arbre, bien amoché le piston!.. En train de crever qu’il était… Il se tenait la culotte à deux mains, à cracher… Il saignait de partout en roulant des yeux… Y avait personne avec lui. Il avait son compte… “Maman! maman!” qu’il pleurnichait tout en crevant et en pissant du sang aussi…
« “Finis ça! que je lui dis. Maman! Elle t’emmerde!”… Comme ça, dis donc, en passant!.. Sur le coin de la gueule!.. Tu parles si ça a dû le faire jouir la vache!.. Hein, vieux!.. C’est pas souvent, hein, qu’on peut lui dire ce qu’on pense, au capitaine… Faut en profiter. C’est rare!.. Et pour foutre le camp plus vite, j’ai laissé tomber le barda et puis les armes aussi… Dans une mare à canards qui était là à côté… Figure-toi que moi, comme tu me vois, j’ai envie de tuer personne, j’ai pas appris… J’aimais déjà pas les histoires de bagarre, déjà en temps de paix… Je m’en allais… Alors tu te rends compte?.. Dans le civil, j’ai essayé d’aller en usine régulièrement… J’étais même un peu graveur, mais j’aimais pas ça, à cause des disputes, j’aimais mieux vendre les journaux du soir et dans un quartier tranquille où j’étais connu, autour de la Banque de France… Place des Victoires si tu veux savoir… Rue des Petits-Champs… C’était mon lot… J’ dépassais jamais la rue du Louvre et le Palais-Royal d’un côté, tu vois d’ici… Je faisais le matin des commissions pour les commerçants… Une livraison l’après-midi de temps en temps, je bricolais quoi… Un peu manœuvre… Mais je veux pas d’armes moi!.. Si les Allemands te voient avec des armes, hein? T’es bon! Tandis que quand t’es en fantaisie, comme moi maintenant… Rien dans les mains… Rien dans les poches… Ils sentent qu’ils auront moins de mal à te faire prisonnier, tu comprends? Ils savent à qui ils ont affaire… Si on pouvait arriver à poil aux Allemands, c’est ça qui vaudrait encore mieux… Comme un cheval! Alors ils pourraient pas savoir de quelle armée qu’on est?..