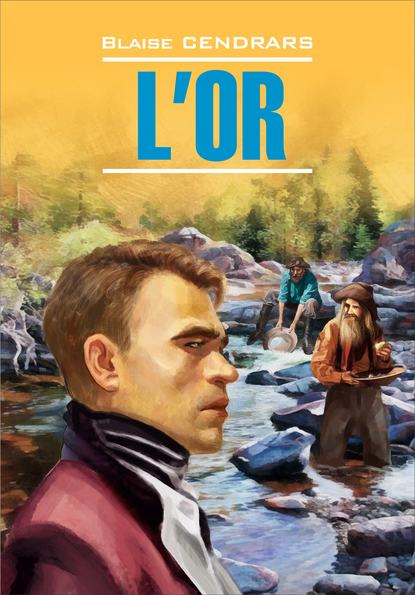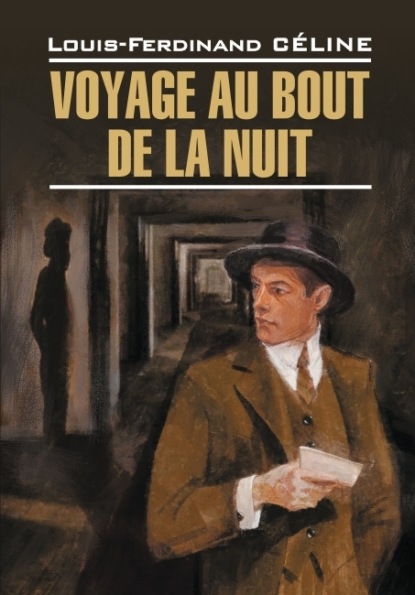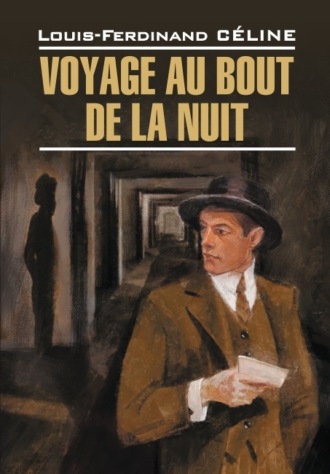
Полная версия
Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке
Je m’aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C’était à recommencer.
Il se remit à pleuvoir, les champs des Flandres bavaient l’eau sale. Encore pendant longtemps je n’ai rencontré personne, rien que le vent et puis peu après le soleil. De temps en temps, je ne savais d’où, une balle, comme ça, à travers le soleil et l’air me cherchait, guillerette, entêtée à me tuer, dans cette solitude, moi. Pourquoi? Jamais plus, même si je vivais encore cent ans, je ne me promènerais à la campagne. C’était juré.
En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille. Dans un pré qu’elle avait eu lieu cette cérémonie, au revers d’une colline; le colonel avec sa grosse voix avait harangué le régiment: « Haut les cœurs! qu’il avait dit… Haut les cœurs! et vive la France! » Quand on a pas d’imagination, mourir c’est peu de chose, quand on en a, mourir c’est trop. Voilà mon avis. Jamais je n’avais compris tant de choses à la fois.
Le colonel n’avait jamais eu d’imagination lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l’imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort, tardive… Dans vingt ans… Trente ans… Peut-être davantage, à celle qu’on me voulait de suite, à bouffer de la boue des Flandres, à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu’aux oreilles, par un éclat. On a bien le droit d’avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors où aller? Droit devant moi? Le dos à l’ennemi. Si les gendarmes ainsi, m’avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m’aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d’école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes, partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l’estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m’aurait fusillé: douze balles, plus une. Alors?
Et je repensais encore au colonel, brave comme il était cet homme-là, avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches, on l’aurait montré se promenant comme je l’avais vu moi, sous les balles et les obus, dans un music-hall, c’était un spectacle à remplir lA’lhambra d’alors, il aurait éclipsé Fragson, dans l’époque dont je vous parle une formidable vedette, cependant. Voilà ce que je pensais moi. Bas les cœurs! que je pensais moi.
Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j’aperçus enfin nos soldats devant un hameau de fermes. C’était un avant-poste à nous. Celui d’un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qu’on m’annonça. Tous vivants! Et moi qui possédais la grande nouvelle: « Le colonel est mort! » que je leur criai, dès que je fus assez près du poste. « C’est pas les colonels qui manquent! » que me répondit le brigadier Pistil, du tac au tac, qu’était justement de garde lui aussi et même de corvée.
« Et en attendant qu’on le remplace le colonel, va donc, eh carotte, toujours à la distribution de bidoche avec Empouille et Kerdoncuff et puis, prenez deux sacs chacun, c’est derrière l’église que ça se passe… Qu’on voit là-bas… Et puis vous faites pas refiler encore rien que les os comme hier, et puis tâchez de vous démerder pour être de retour à l’escouade avant la nuit, salopards! »
On a repris la route tous les trois donc.
« Je leur raconterai plus rien à l’avenir! » que je me disais, vexé. Je voyais bien que c’était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là, qu’un drame comme j’en avais vu un, c’était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareils! qu’il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que huit jours plus tôt on en aurait mis sûrement quatre colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d’un colonel comme c’était arrivé. Des abrutis.
C’était donc dans une prairie d’août qu’on distribuait toute la viande pour le régiment, – ombrée de cerisiers et brûlée déjà par la fin d’été. Sur des sacs et des toiles de tentes largement étendues et sur l’herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaïe, suintant en ruisselets ingénieux dans la verdure d’alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l’arbre, et sur lequel s’escrimaient encore en jurant les quatre bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d’abattis. On s’engueulait ferme entre escouades à propos de graisses, et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux.
Et puis du sang encore et partout, à travers l’herbe, en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà quatre hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir.
« C’est toi eh vendu! qui l’as étouffé hier l’aloyau!.. »
J’ai eu le temps encore de jeter deux ou trois regards sur ce différend alimentaire, tout en m’appuyant contre un arbre et j’ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu’un peu, jusqu’à l’évanouissement.
On m’a bien ramené jusqu’au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l’occasion pour me barboter mes deux sacs en toile cachou.
Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas.
Tout arrive et ce fut à mon tour de devenir brigadier vers la fin de ce même mois d’août. On m’envoyait souvent avec cinq hommes, en liaison, aux ordres du général des Entrayes. Ce chef était petit de taille, silencieux, et ne paraissait à première vue ni cruel, ni héroïque. Mais il fallait se méfier… Il semblait préférer par-dessus tout ses bonnes aises. Il y pensait même sans arrêt à ses aises et bien que nous fussions occupés à battre en retraite depuis plus d’un mois, il engueulait tout le monde quand même si son ordonnance ne lui trouvait pas dès l’arrivée à l’étape, dans chaque nouveau cantonnement, un lit bien propre et une cuisine aménagée à la moderne.
Au chef d’État-major, avec ses quatre galons, ce souci de confort donnait bien du boulot. Les exigences ménagères du général des Entrayes l’agaçaient. Surtout que lui, jaune, gastritique au possible et constipé, n’était nullement porté sur la nourriture. Il lui fallait quand même manger ses œufs à la coque à la table du général et recevoir en cette occasion ses doléances. On est militaire ou on ne l’est pas. Toutefois, je n’arrivais pas à le plaindre parce que c’était un bien grand saligaud comme officier. Faut en juger. Quand nous avions donc traîné jusqu’au soir de chemins en collines et de luzernes en carottes, on finissait tout de même par s’arrêter pour que notre général puisse coucher quelque part. On lui cherchait, et on lui trouvait un village calme, bien à l’abri, où les troupes ne campaient pas encore et s’il y en avait déjà dans le village des troupes, elles décampaient en vitesse, on les foutait à la porte, tout simplement; à la belle étoile, même si elles avaient déjà formé les faisceaux.
Le village c’était réservé rien que pour l’État-major, ses chevaux, ses cantines, ses valises, et aussi pour ce saligaud de commandant. Il s’appelait Pinçon ce salaud-là, le commandant Pinçon. J’espère qu’à l’heure actuelle il est bien crevé (et pas d’une mort pépère). Mais à ce moment-là, dont je parle, il était encore salement vivant le Pinçon. Il nous réunissait chaque soir les hommes de la liaison et puis alors il nous engueulait un bon coup pour nous remettre dans la ligne et pour essayer de réveiller nos ardeurs. Il nous envoyait à tous les diables, nous qui avions traîné toute la journée derrière le général. Pied à terre! À cheval! Repied à terre! Comme ça à lui porter ses ordres, de-ci, de‐là. On aurait aussi bien fait de nous noyer quand c’était fini. C’eût été plus pratique pour tout le monde.
« Allez-vous-en tous! Allez rejoindre vos régiments! Et vivement! qu’il gueulait.
– Où qu’il est le régiment, mon commandant? qu’on demandait nous…
– Il est à Barbagny.
– Où que c’est Barbagny?
– C’est par là! »
Par là, où il montrait, il n’y avait rien que la nuit, comme partout d’ailleurs, une nuit énorme qui bouffait la route à deux pas de nous et même qu’il n’en sortait du noir qu’un petit bout de route grand comme la langue.
Allez donc le chercher son Barbagny dans la fin d’un monde! Il aurait fallu qu’on sacrifiât pour le retrouver son Barbagny au moins un escadron tout entier! Et encore un escadron de braves! Et moi qui n’étais point brave et qui ne voyais pas du tout pour-quoi je l’aurais été brave, j’avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son Barbagny, dont il nous parlait d’ailleurs lui-même absolument au hasard. C’était comme si on avait essayé en m’engueulant très fort de me donner l’envie d’aller me suicider. Ces choses-là on les a ou on ne les a pas.
De toute cette obscurité si épaisse qu’il vous semblait qu’on ne reverrait plus son bras dès qu’on l’étendait un peu plus loin que l’épaule, je ne savais qu’une chose, mais cela alors tout à fait certainement, c’est qu’elle contenait des volontés homicides énormes et sans nombre.
Cette gueule d’État-major n’avait de cesse dès le soir revenu de nous expédier au trépas et ça le prenait souvent dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui à coups d’inertie, on s’obstinait à ne pas le comprendre, on s’accrochait au cantonnement pépère tant bien que mal, tant qu’on pouvait, mais enfin quand on ne voyait plus les arbres, à la fin, il fallait consentir tout de même à s’en aller mourir un peu; le dîner du général était prêt.
Tout se passait alors à partir de ce moment-là, selon les hasards. Tantôt on le trouvait et tantôt on ne le trouvait pas le régiment et son Barbagny. C’était surtout par erreur qu’on les retrouvait parce que les sentinelles de l’escadron de garde tiraient sur nous en arrivant. On se faisait reconnaître ainsi forcément et on achevait presque toujours la nuit en corvées de toutes natures, à porter beaucoup de ballots d’avoine et des seaux d’eau en masse, à se faire engueuler jusqu’à en être étourdi en plus du sommeil.
Au matin on repartait, groupe de la liaison, tous les cinq pour le quartier du général des Entrayes, pour continuer la guerre.
Mais la plupart du temps on ne le trouvait pas le régiment et on attendait seulement le jour en cerclant autour des villages sur les chemins inconnus, à la lisière des hameaux évacués, et les taillis sournois, on évitait tout ça autant qu’on le pouvait à cause des patrouilles allemandes. Il fallait bien être quelque part cependant en attendant le matin, quelque part dans la nuit. On ne pouvait pas éviter tout. Depuis ce temps-là, je sais ce que doivent éprouver les lapins en garenne.
Ça vient drôlement la pitié. Si on avait dit au commandant Pinçon qu’il n’était qu’un sale assassin lâche, on lui aurait fait un plaisir énorme, celui de nous faire fusiller, séance tenante, par le capitaine de gendarmerie, qui ne le quittait jamais d’une semelle et qui, lui, ne pensait précisément qu’à cela. C’est pas aux Allemands qu’il en voulait, le capitaine de gendarmerie.
Nous dûmes donc courir les embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient, rien qu’avec l’espérance de moins en moins raisonnable d’en revenir et celle-là seulement et aussi que si on en revenait qu’on n’oublierait jamais, absolument jamais, qu’on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi, mais bien plus charognard que les crocodiles et les requins qui passent entre deux eaux la gueule ouverte autour des bateaux d’ordures et de viandes pourries qu’on va leur déverser au large, à La Havane.
La grande défaite, en tout, c’est d’oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu’à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière.
Je l’aurais bien donné aux requins à bouffer moi, le commandant Pinçon, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre; et puis mon cheval aussi en même temps pour qu’il ne souffre plus, parce qu’il n’en avait plus de dos ce grand malheureux, tellement qu’il avait mal, rien que deux plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes deux mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu’aux jarrets. Il fallait cependant trotter là-dessus, un, deux… Il s’en tortillait de trotter. Mais les chevaux c’est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu’au grand air. Dans les granges, à cause de l’odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort, qu’on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu’il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi on aurait dit qu’on grimpait sur un âne. C’était plus commode ainsi, faut l’avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu’on supportait en aciers sur la tête et sur les épaules.
Le général des Entrayes, dans la maison réservée, attendait son dîner. Sa table était mise, la lampe à sa place.
« Foutez-moi tous le camp, nom de Dieu, nous sommait une fois de plus le Pinçon, en nous balançant sa lanterne à hauteur du nez. On va se mettre à table! Je ne vous le répéterai plus! Vont-ils s’en aller ces charognes! » qu’il hurlait même. Il en reprenait, de rage, à nous envoyer crever ainsi, ce diaphane, quelques couleurs aux joues.
Quelquefois le cuisinier du général nous repassait avant qu’on parte un petit morceau, il en avait de trop à bouffer le général, puisqu’il touchait d’après le règlement quarante rations pour lui tout seul! Il n’était plus jeune cet homme-là. Il devait même être tout près de la retraite. Il pliait aussi des genoux en marchant. Il devait se teindre les moustaches.
Ses artères, aux tempes, cela se voyait bien à la lampe, quand on s’en allait, dessinaient des méandres comme la Seine à la sortie de Paris. Ses filles étaient grandes, disait‐on, pas mariées, et comme lui, pas riches. C’était peut-être à cause de ces souvenirs-là qu’il avait tant l’air vétillard et grognon, comme un vieux chien qu’on aurait dérangé dans ses habitudes et qui essaye de retrouver son panier à coussin partout où on veut bien lui ouvrir la porte.
Il aimait les beaux jardins et les rosiers, il n’en ratait pas une, de roseraie, partout où nous passions. Personne comme les généraux pour aimer les rosiers. C’est connu.
Tout de même on se mettait en route. Le boulot c’était pour les faire passer au trot les canards. Ils avaient peur de bouger à cause des plaies d’abord et puis ils avaient peur de nous et de la nuit aussi, ils avaient peur de tout, quoi! Nous aussi! Dix fois on s’en retournait pour lui redemander la route au commandant. Dix fois qu’il nous traitait de fainéants et de tire-au-cul dégueulasses. À coups d’éperons enfin on franchissait le dernier poste de garde, on leur passait le mot aux plantons et puis on plongeait d’un coup dans la sale aventure, dans les ténèbres de ces pays à personne.
À force de déambuler d’un bord de l’ombre à l’autre, on finissait par s’y reconnaître un petit peu, qu’on croyait du moins… Dès qu’un nuage semblait plus clair qu’un autre on se disait qu’on avait vu quelque chose… Mais devant soi, il n’y avait de sûr que l’écho allant et venant, l’écho du bruit que faisaient les chevaux en trottant, un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu’on en veut pas. Ils avaient l’air de trotter jusqu’au ciel, d’appeler tout ce qu’il y avait sur la terre les chevaux, pour nous faire massacrer. On aurait pu faire ça d’ailleurs d’une seule main, avec une carabine, il suffisait de l’appuyer en nous attendant, le long d’un arbre. Je me disais toujours que la première lumière qu’on verrait ce serait celle du coup de fusil de la fin.
Depuis quatre semaines qu’elle durait, la guerre, on était devenus si fatigués, si malheureux, que j’en avais perdu, à force de fatigue, un peu de ma peur en route. La torture d’être tracassés jour et nuit par ces gens, les gradés, les petits surtout, plus abrutis, plus mesquins et plus haineux encore que d’habitude, ça finit par faire hésiter les plus entêtés, à vivre encore.
Ah! l’envie de s’en aller! Pour dormir! D’abord! Et s’il n’y a plus vraiment moyen de partir pour dormir alors l’envie de vivre s’en va toute seule. Tant qu’on y resterait en vie faudrait avoir l’air de chercher le régiment.
Pour que dans le cerveau d’un couillon la pensée fasse un tour, il faut qu’il lui arrive beaucoup de choses et des bien cruelles. Celui qui m’avait fait penser pour la première fois de ma vie, vraiment penser, des idées pratiques et bien à moi, c’était bien sûrement le commandant Pinçon, cette gueule de torture. Je pensais donc à lui aussi fortement que je pouvais, tout en brinquebalant, garni, croulant sous les armures, accessoire figurant dans cette incroyable affaire internationale, où je m’étais embarqué d’enthousiasme… Je l’avoue.
Chaque mètre d’ombre devant nous était une promesse nouvelle d’en finir et de crever, mais de quelle façon? Il n’y avait guère d’imprévu dans cette histoire que l’uniforme de l’exécutant. Serait-ce un d’ici? Ou bien un d’en face?
Je ne lui avais rien fait, moi, à ce Pinçon! À lui, pas plus d’ailleurs qu’aux Allemands!.. Avec sa tête de pêche pourrie, ses quatre galons qui lui scintillaient partout de sa tête au nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au 1/1000, donc? Je me demandais quelle rage d’envoyer crever les autres le possédait celui-là? Les autres qui n’avaient pas de carte.
Nous quatre cavaliers sur la route nous faisions autant de bruit qu’un demi-régiment. On devait nous entendre venir à quatre heures de là ou bien c’est qu’on voulait pas nous entendre. Cela demeurait possible… Peut-être qu’ils avaient peur de nous les Allemands? Qui sait?
Un mois de sommeil sur chaque paupière voilà ce que nous portions et autant derrière la tête, en plus de ces kilos de ferraille.
Ils s’exprimaient mal mes cavaliers d’escorte. Ils parlaient à peine pour tout dire. C’étaient des garçons venus du fond de la Bretagne pour le service et tout ce qu’ils savaient ne venait pas de l’école, mais du régiment. Ce soir-là, j’avais essayé de m’entretenir un peu du village de Barbagny avec celui qui était à côté de moi et qui s’appelait Kersuzon.
« Dis donc, Kersuzon, que je lui dis, c’est les Ardennes ici tu sais… Tu ne vois rien toi loin devant nous? Moi, je vois rien du tout…
– C’est tout noir comme un cul », qu’il m’a répondu Kersuzon. Ça suffisait…
« Dis donc, t’as pas entendu parler de Barbagny toi dans la journée? Par où que c’était? que je lui ai demandé encore.
– Non. »
Et voilà.
On ne l’a jamais trouvé le Barbagny. On a tourné sur nous-mêmes seulement jusqu’au matin, jusqu’à un autre village, où nous attendait l’homme aux jumelles. Son général prenait le petit café sous la tonnelle devant la maison du Maire quand nous arrivâmes.
« Ah! comme c’est beau la jeunesse, Pinçon! » qu’il lui a fait remarquer très haut à son chef d’État-major en nous voyant passer, le vieux. Ceci dit, il se leva et partit faire un pipi et puis encore un tour les mains derrière le dos, voûté. Il était très fatigué ce matin‐là, m’a soufflé l’ordonnance, il avait mal dormi le général, quelque chose qui le tracassait dans la vessie, qu’on racontait.
Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit, ça finissait par me distraire comme un tic. Il m’a répété ça encore deux ou trois fois à propos du noir et du cul et puis il est mort, tué qu’il a été, quelque temps plus tard, en sortant d’un village, je m’en souviens bien, un village qu’on avait pris pour un autre, par des Français qui nous avaient pris pour des autres.
C’est même quelques jours après la mort de Kersuzon qu’on a réfléchi et qu’on a trouvé un petit moyen, dont on était bien content, pour ne plus se perdre dans la nuit.
Donc, on nous foutait à la porte du cantonnement. Bon. Alors on disait plus rien. On ne rouspétait plus. « Allez-vous-en! qu’il faisait, comme d’habitude, la gueule en cire.
– Bien mon commandant! »
Et nous voilà dès lors partis du côté du canon et sans se faire prier tous les cinq. On aurait dit qu’on allait aux cerises. C’était bien vallonné de ce côté-là. C’était la Meuse, avec ses collines, avec des vignes dessus, du raisin pas encore mûr et l’automne, et des villages en bois bien séchés par trois mois d’été, donc qui brûlaient facilement.
On avait remarqué ça nous autres, une nuit qu’on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours du côté du canon. On en approchait pas beaucoup, pas de trop, on le regardait seulement d’assez loin le village, en spectateurs pourrait-on dire, à dix, douze kilomètres par exemple. Et tous les soirs ensuite vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l’horizon, ça se répétait, on en était entourés, comme par un très grand cercle d’une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages.
On voyait tout y passer dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière.
Ça se remarque bien comment que ça brûle un village, même à vingt kilomètres. C’était gai. Un petit hameau de rien du tout qu’on apercevait même pas pendant la journée, au fond d’une moche petite campagne, eh bien, on a pas idée la nuit, quand il brûle, de l’effet qu’il peut faire! On dirait Notre‐Dame! Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit, à la fin on dirait une fleur énorme, puis, rien qu’un bouton, puis plus rien.
Ça fume et alors c’est le matin.
Les chevaux qu’on laissait tout sellés, dans les champs à côté de nous, ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l’herbe, sauf un, qui prenait la garde, à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder la nuit passe bien mieux, c’est plus rien à endurer, c’est plus de la solitude.
Malheureux qu’ils n’ont pas duré les villages… Au bout d’un mois, dans ce canton-là, il n’y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au canon. Elles n’ont pas existé huit jours les forêts. Ça fait encore des beaux feux les forêts, mais ça dure à peine.
Après ce temps-là, les convois d’artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils qui se sauvaient, dans l’autre.
En somme, on ne pouvait plus, nous, ni aller, ni revenir; fallait rester où on était.
On faisait queue pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campements sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en pleins champs, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l’ont perdu. C’est à partir de ces mois-là qu’on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.
Après un repos, on est remontés à cheval, quelques semaines plus tard, et on est repartis vers le nord. Le froid lui aussi vint avec nous. Le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rencontrait guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs, par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s’en allait plus loin dès qu’on les apercevait. À chaque rencontre, deux ou trois cavaliers y restaient, tantôt à eux, tantôt à nous. Et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient à vide et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à troussequins bizarres, et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du jour de l’an. C’est nos chevaux qu’ils venaient rejoindre, amis tout de suite. Bien de la chance! C’est pas nous qu’on aurait pu en faire autant!
Un matin en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Sainte‐Engence invitait les autres officiers à constater qu’il ne leur racontait pas des blagues. « J’en ai sabré deux! » assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c’était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça.