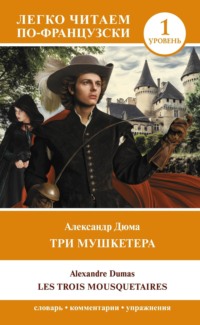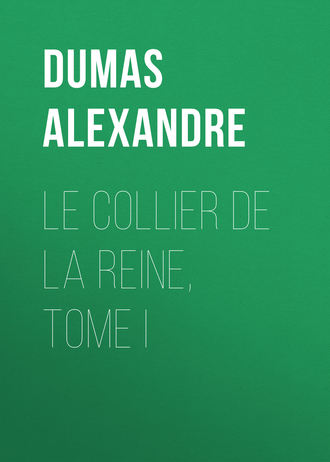 полная версия
полная версияLe Collier de la Reine, Tome I
De son côté, comme nous l'avons dit, le traîneau des deux hommes gagna sur celui des deux femmes, et finit par disparaître dans les premières brumes du soir, qui s'épaississaient autour de la colossale construction de la Bastille.
Le second traîneau, arrivé au boulevard de Ménilmontant, s'arrêta; de ce côté, les promeneurs étaient rares, la nuit les avait dispersés; d'ailleurs, en ce quartier lointain, peu de bourgeois se hasardaient sans falot et sans escorte, depuis que l'hiver avait aiguisé les dents de trois ou quatre mille mendiants suspects, changés tout doucement en voleurs.
La dame que nous avons déjà désignée à nos lecteurs comme donnant des ordres toucha du doigt l'épaule du cocher qui conduisait le traîneau.
Le traîneau s'arrêta.
– Weber, dit-elle, combien vous faut-il de temps pour amener le cabriolet où vous savez?
– Matame brend le gapriolet? demanda le cocher, avec un accent allemand des mieux prononcés.
– Oui, je reviendrai par les rues pour voir les feux. Or, les rues sont encore plus boueuses que les boulevards, et on roulerait mal en traîneau. Et puis, j'ai gagné un peu de froid. Vous aussi, n'est-ce pas, petite? dit la dame s'adressant à sa compagne.
– Oui, madame, répondit celle-ci.
– Ainsi, vous entendez, Weber? où vous savez, avec le cabriolet.
– Pien, matame.
– Combien de temps vous faut-il?
– Une temi-heure.
– C'est bien; voyez l'heure, petite.
La plus jeune des deux dames fouilla dans sa pelisse et regarda l'heure à sa montre avec assez de difficulté, car, nous l'avons dit, la nuit s'épaississait.
– Six heures moins un quart, dit-elle.
– Donc, à sept heures moins un quart, Weber.
Et, en disant ces mots, la dame sauta légèrement hors du traîneau, donna la main à son amie, et commença de s'éloigner, tandis que le cocher, avec des gestes d'un respectueux désespoir, murmura assez haut pour être entendu de sa maîtresse:
– Imbrutence! ah! mein Gott! quelle imbrutence!
Les deux jeunes femmes se mirent à rire, s'enfermèrent dans leurs pelisses, dont les collets montaient jusqu'à la hauteur des oreilles, et traversèrent la contre-allée du boulevard en s'amusant à faire craquer la neige sous leurs petits pieds, chaussés de fines mules fourrées.
– Vous qui avez de bons yeux, Andrée, fit la dame qui paraissait la plus âgée, et qui, cependant, ne devait pas avoir plus de trente à trente-deux ans, essayez donc de lire à cet angle le nom de la rue.
– Rue du Pont-aux-Choux, madame, dit la jeune femme en riant.
– Quelle rue est-ce là, rue du Pont-aux-Choux? Ah! mon Dieu! mais nous sommes perdues! rue du Pont-aux-Choux! on m'avait dit la deuxième rue à droite. Mais sentez-vous, Andrée, comme il flaire bon le pain chaud?
– Ce n'est pas étonnant, répondit sa compagne, nous sommes à la porte d'un boulanger.
– Eh bien! demandons-lui où est la rue Saint-Claude.
Et celle qui venait de parler fit un mouvement vers la porte.
– Oh! n'entrez pas, madame! fit vivement l'autre femme; laissez-moi.
– La rue Saint-Claude, mes mignonnes dames, dit une voix enjouée, vous voulez savoir où est la rue Saint-Claude?
Les deux femmes se retournèrent en même temps, et d'un seul mouvement, dans la direction de la voix, et elles virent, debout et appuyé à la porte du boulanger, un geindre1 affublé de sa jaquette, et les jambes et la poitrine découvertes, malgré le froid glacial qu'il faisait.
– Oh! un homme nu! s'écria la plus jeune des deux femmes. Sommes nous donc en Océanie?
Et elle fit un pas en arrière et se cacha derrière sa compagne.
– Vous cherchez la rue Saint-Claude? poursuivit le mitron qui ne comprenait rien au mouvement qu'avait fait la plus jeune des deux dames, et qui, habitué à son costume, était loin de lui attribuer la force centrifuge dont nous venons de voir le résultat.
– Oui, mon ami, la rue Saint-Claude, répondit l'aînée des deux femmes, en comprimant elle-même une forte envie de rire.
– Oh! ce n'est pas difficile à trouver, et, d'ailleurs, je vais vous y conduire, reprit le joyeux garçon enfariné, qui, joignant le fait à la parole, se mit à déployer le compas de ses immenses jambes maigres, au bout desquelles s'emmanchaient deux savates larges comme des bateaux.
– Non pas! non pas! dit l'aînée des deux femmes, qui ne se souciait sans doute pas d'être rencontrée avec un pareil guide; indiquez-nous la rue, sans vous déranger, et nous tâcherons de suivre votre indication.
– Première rue à droite, madame, répondit le guide en se retirant avec discrétion.
– Merci, dirent ensemble les deux femmes.
Et elles se mirent à courir dans la direction indiquée, en étouffant leurs rires sous leurs manchons.
Chapitre II
Un intérieur
Ou nous avons trop compté sur la mémoire de notre lecteur, ou nous pouvons espérer qu'il connaît déjà cette rue Saint-Claude, qui touche par l'est au boulevard et par l'ouest à la rue Saint-Louis; en effet, il a vu plus d'un des personnages qui ont joué ou qui joueront un rôle dans cette histoire la parcourir dans un autre temps, c'est-à-dire lorsque le grand physicien Joseph Balsamo y habitait avec sa sibylle Lorenza et son maître Althotas.
En 1784 comme en 1770, époque à laquelle nous y avons conduit pour la première fois nos lecteurs, la rue Saint-Claude était une honnête rue, peu claire, c'est vrai, peu nette, c'est encore vrai; enfin peu fréquentée, peu bâtie et peu connue. Mais elle avait son nom de saint et sa qualité de rue du Marais, et comme telle elle abritait, dans les trois ou quatre maisons qui composaient son effectif, plusieurs pauvres rentiers, plusieurs pauvres marchands et plusieurs pauvres pauvres, oubliés sur les états de la paroisse.
Outre ces trois ou quatre maisons, il y avait bien encore, au coin du boulevard, un hôtel de grande mine, dont la rue Saint-Claude eût pu se glorifier comme d'un bâtiment aristocratique; mais ce bâtiment, dont les hautes fenêtres eussent, par-dessus le mur de la cour, éclairé toute la rue dans un jour de fête avec le simple reflet de ses candélabres et de ses lustres; ce bâtiment, disions-nous, était la plus noire, la plus muette et la plus close de toutes les maisons du quartier.
La porte ne s'ouvrait jamais; les fenêtres, matelassées de coussins de cuir, avaient sur chaque feuille des jalousies, sur chaque plinthe des volets, une couche de poussière que les physiologistes ou les géologues eussent accusée de remonter à dix ans.
Quelquefois un passant désœuvré, un curieux ou un voisin, s'approchait de la porte cochère, et au travers de la vaste serrure examinait l'intérieur de l'hôtel.
Alors, il ne voyait que touffes d'herbe entre les pavés, moisissures et mousse sur les dalles. Parfois un énorme rat, suzerain de ce domaine abandonné, traversait tranquillement la cour et s'allait plonger dans les caves, modestie bien superflue, quand il avait à sa pleine et entière disposition des salons et des cabinets si commodes, où les chats ne pouvaient le venir troubler.
Si c'était un passant ou un curieux, après avoir constaté vis-à-vis de lui-même la solitude de cet hôtel, il continuait son chemin; mais si c'était un voisin, comme l'intérêt qui s'attachait à l'hôtel était plus grand, il restait presque toujours assez longtemps en observation pour qu'un autre voisin vînt prendre place auprès de lui, attiré par une curiosité pareille à la sienne; et alors presque toujours s'établissait une conversation dont nous sommes à peu près certain de rappeler le fond, sinon les détails.
– Voisin, disait celui qui ne regardait pas à celui qui regardait, que voyez-vous donc dans la maison de M. le comte de Balsamo?
– Voisin, répondait celui qui regardait à celui qui ne regardait pas, je vois le rat.
– Ah! voulez-vous permettre?
Et le second curieux s'installait à son tour au trou de la serrure.
– Le voyez-vous? disait le voisin dépossédé au voisin en possession.
– Oui, répondait celui-ci, je le vois. Ah! monsieur, il a engraissé.
– Vous croyez?
– Oui, j'en suis sûr.
– Je crois bien, rien ne le gêne.
– Et certainement, quoiqu'on en dise, il doit rester de bons morceaux dans la maison.
– De bons morceaux, dites-vous?
– Dame! M. de Balsamo a disparu trop tôt pour n'avoir pas oublié quelque chose.
– Eh! voisin, quand une maison est à moitié brûlée, que voulez-vous qu'on y oublie?
– Au fait, voisin, vous pourriez bien avoir raison.
Et, après avoir de nouveau regardé le rat, on se séparait effrayé d'en avoir tant dit sur une matière si mystérieuse et si délicate. En effet, depuis l'incendie de cette maison, ou plutôt d'une partie de la maison, Balsamo avait disparu, nulle réparation ne s'était faite, l'hôtel avait été abandonné.
Laissons-le surgir tout sombre et tout humide dans la nuit avec ses terrasses couvertes de neige et son toit échancré par les flammes, ce vieil hôtel près duquel nous n'avons pas voulu passer sans nous arrêter devant lui comme devant une vieille connaissance; puis, traversant la rue pour passer de gauche à droite, regardons, attenante à un petit jardin fermé par un grand mur, une maison étroite et haute, qui s'élève pareille à une longue tour blanche sur le fond gris-bleu du ciel.
Au faîte de cette maison, une cheminée se dresse comme un paratonnerre, et juste au zénith de cette cheminée, une brillante étoile tourbillonne et scintille.
Le dernier étage de la maison se perdrait inaperçu dans l'espace, sans un rayon de lumière qui rougit deux fenêtres sur trois qui composent la façade.
Les autres étages sont mornes et sombres. Les locataires dorment-ils déjà? Économisent-ils, dans leurs couvertures, et la chandelle si chère, et le bois si rare cette année? Toujours est-il que les quatre étages ne donnent pas signe d'existence, tandis que le cinquième non seulement vit, mais encore rayonne avec une certaine affectation.
Frappons à la porte; montons l'escalier sombre, il finit à ce cinquième étage où nous avons affaire. Une simple échelle posée contre le mur conduit à l'étage supérieur.
Un pied-de-biche pend à la porte; un paillasson de natte et une patère de bois meublent l'escalier.
La première porte ouverte, nous entrerons dans une chambre obscure et nue; c'est celle dont la fenêtre n'est pas éclairée. Cette pièce sert d'antichambre et donne dans une seconde dont l'ameublement et les détails méritent toute notre attention.
Du carreau au lieu de parquet, des portes grossièrement peintes, trois fauteuils de bois blanc garnis de velours jaune, un pauvre sofa dont les coussins ondulent sous les plis d'un amaigrissement produit par l'âge.
Les plis et la flaccidité2 sont les rides et l'atonie d'un vieux fauteuil: jeune, il rebondissait et chatoyait; hors d'âge, il suit son hôte au lieu de le repousser; et quand il a été vaincu, c'est-à-dire lorsqu'on s'est assis dedans, il crie.
Deux portraits pendus au mur attirent d'abord les regards. Une chandelle et une lampe, placées l'une sur un guéridon à trois pieds, l'autre sur la cheminée, combinent leurs feux de manière à faire de ces deux portraits deux foyers de lumière.
Toquet sur la tête, figure longue et pâle, œil mat, barbe pointue, fraise au col, le premier de ces portraits se recommande par sa notoriété; c'est le visage héroïquement ressemblant de Henri III, roi de France et de Pologne.
Au-dessus se lit une inscription tracée en lettres noires sur un cadre mal doré:
HENRI DE VALOISL'autre portrait, doré plus récemment, aussi frais de peinture que l'autre est suranné, représente une jeune femme à l'œil noir, au nez fin et droit, aux pommettes saillantes, à la bouche circonspecte. Elle est coiffée, ou plutôt écrasée d'un édifice de cheveux et de soieries, près duquel le toquet de Henri III prend les proportions d'une taupinière près d'une pyramide.
Sous ce portrait se lit également en lettres noires:
JEANNE DE VALOISEt si l'on veut, après avoir inspecté l'âtre éteint, les pauvres rideaux de siamoise du lit recouvert de damas vert jauni, si l'on veut savoir quel rapport ont ces portraits avec les habitants de ce cinquième étage, il n'est besoin que de se tourner vers une petite table de chêne sur laquelle, accoudée du bras gauche, une femme simplement vêtue révise plusieurs lettres cachetées et en contrôle les adresses.
Cette jeune femme est l'original du portrait.
À trois pas d'elle, dans une attitude semi-curieuse, semi-respectueuse, une petite vieille suivante, de soixante ans, vêtue comme une duègne de Greuze, attend et regarde.
«Jeanne de Valois», disait l'inscription.
Mais alors, si cette dame était une Valois, comment Henri III, le roi sybarite, le voluptueux fraisé, supportait-il, même en peinture, le spectacle d'une misère pareille, lorsqu'il s'agissait, non seulement d'une personne de sa race, mais encore de son nom?
Au reste, la dame du cinquième ne démentait point, personnellement, l'origine qu'elle se donnait. Elle avait des mains blanches et délicates qu'elle réchauffait, de temps en temps, sous ses bras croisés. Elle avait un pied petit, fin, allongé, chaussé d'une pantoufle de velours encore coquette, et qu'elle essayait de réchauffer aussi en battant le carreau luisant et froid comme cette glace qui couvrait Paris.
Puis comme la bise sifflait sous les portes et par les fentes des fenêtres, la suivante secouait tristement les épaules et regardait le foyer sans feu.
Quant à la dame maîtresse du logis, elle comptait toujours les lettres et lisait les adresses.
Puis, après chaque lecture d'adresse, elle faisait un petit calcul.
– Mme de Misery, murmura-t-elle, première dame d'atours de Sa Majesté. Il ne faut compter de ce côté que six louis, car on m'a déjà donné.
Et elle poussa un soupir.
– Mme Patrix, femme de chambre de Sa Majesté, deux louis. M. d'Ormesson, une audience. M. de Calonne, un conseil. M. de Rohan, une visite. Et nous tâcherons qu'il nous la rende, fit la jeune femme.
«Nous avons donc, continua-t-elle du même ton de psalmodie, huit louis assurés d'ici à huit jours.
Et elle leva la tête.
– Dame Clotilde, dit-elle, mouchez donc cette chandelle!
La vieille obéit et se remit en place, sérieuse et attentive.
Cette espèce d'inquisition dont elle était l'objet parut fatiguer la jeune femme.
– Cherchez donc, ma chère, dit-elle, s'il ne reste pas ici quelque bout de bougie, et donnez-le-moi. Il m'est odieux de brûler de la chandelle.
– Il n'y en a pas, répondit la vieille.
– Voyez toujours.
– Où cela?
– Mais dans l'antichambre.
– Il fait bien froid par là.
– Eh! tenez, justement on sonne, dit la jeune femme.
– Madame se trompe, dit la vieille, opiniâtre.
– Je l'avais cru, dame Clotilde.
Et, voyant que la vieille résistait, elle céda, grondant doucement, comme font les personnes qui, par une cause quelconque, ont laissé prendre sur elles par des inférieurs des droits qui ne devraient pas leur appartenir.
Puis elle se remit à son calcul.
– Huit louis, sur lesquels j'en dois trois dans le quartier.
Elle prit la plume et écrivit:
– Trois louis… Cinq promis à M. de La Motte pour lui faire supporter le séjour de Bar-sur-Aube. Pauvre diable! notre mariage ne l'a pas enrichi; mais patience!
Et elle sourit encore, mais en se regardant cette fois dans un miroir placé entre les deux portraits.
– Maintenant, continua-t-elle, courses de Versailles à Paris et de Paris à Versailles. Courses, un louis.
Et elle écrivit ce nouveau chiffre à la colonne des dépenses.
– La vie maintenant pour huit jours, un louis.
Elle écrivit encore.
– Toilettes, fiacres, gratifications aux suisses des maisons où je sollicite: quatre louis. Est-ce bien tout? Additionnons.
Mais, au milieu de son addition, elle s'interrompit.
– On sonne, vous dis-je.
– Non, madame, répondit la vieille, engourdie à sa place. Ce n'est pas ici; c'est dessous, au quatrième.
– Quatre, six, onze, quatorze louis: six de moins qu'il n'en faut, et toute une garde-robe à renouveler, et cette vieille brute à payer pour la congédier.
Puis, tout à coup:
– Mais je vous dis qu'on sonne, malheureuse! s'écria-t-elle en colère.
Et cette fois, il faut l'avouer, l'oreille la plus indocile n'eût pu se refuser à comprendre l'appel extérieur; la sonnette, agitée avec vigueur, frémit dans son angle et vibra si longtemps que le battant frappa les parois d'une douzaine de chocs.
À ce bruit, et tandis que la vieille, réveillée enfin, courait à l'antichambre, sa maîtresse, agile comme un écureuil, enlevait les lettres et les papiers épars sur la table, jetait le tout dans un tiroir, et, après un rapide coup d'œil lancé sur la chambre pour s'assurer que tout y était en ordre, prenait place sur le sofa dans l'attitude humble et triste d'une personne souffrante, mais résignée.
Seulement, hâtons-nous de le dire, les membres seuls se reposaient. L'œil, actif, inquiet, vigilant, interrogeait le miroir, qui reflétait la porte d'entrée, tandis que l'oreille aux aguets se préparait à saisir le moindre son.
La duègne ouvrit la porte, et l'on entendit murmurer quelques mots dans l'antichambre.
Alors une voix fraîche et suave, et cependant empreinte de fermeté, prononça ces paroles:
– Est-ce ici que demeure Mme la comtesse de La Motte?
– Mme la comtesse de La Motte Valois? répéta en nasillant Clotilde.
– C'est cela même, ma bonne dame. Mme de La Motte est-elle chez elle?
– Oui, madame, et trop souffrante pour sortir.
Pendant ce colloque, dont elle n'avait pas perdu une syllabe, la prétendue malade, ayant regardé dans le miroir, vit qu'une femme questionnait Clotilde, et que cette femme, selon toutes les apparences, appartenait à une classe élevée de la société.
Elle quitta aussitôt le sofa et gagna le fauteuil, afin de laisser le meuble d'honneur à l'étrangère.
Pendant qu'elle accomplissait ce mouvement, elle ne put remarquer que la visiteuse s'était retournée sur le palier et avait dit à une autre personne restée dans l'ombre:
– Vous pouvez entrer, madame, c'est ici.
La porte se referma, et les deux femmes que nous avons vues demander le chemin de la rue Saint-Claude venaient de pénétrer chez la comtesse de La Motte Valois.
– Qui faut-il que j'annonce à Mme la comtesse? demanda Clotilde en promenant curieusement, quoique avec respect, la chandelle devant le visage des deux femmes.
– Annoncez une dame des Bonnes-Œuvres, dit la plus âgée.
– De Paris?
– Non; de Versailles.
Clotilde entra chez sa maîtresse, et les étrangères, la suivant, se trouvèrent dans la chambre éclairée au moment où Jeanne de Valois se soulevait péniblement de dessus son fauteuil pour saluer très civilement ses deux hôtesses.
Clotilde avança les deux autres fauteuils, afin que les visiteuses eussent le choix, et se retira dans l'antichambre avec une sage lenteur, qui laissait deviner qu'elle suivrait derrière la porte la conversation qui allait avoir lieu.
Chapitre III
Jeanne de La Motte de Valois
Le premier soin de Jeanne de La Motte, lorsqu'elle put décemment lever les yeux, fut de voir à quels visages elle avait affaire.
La plus âgée des deux femmes pouvait, comme nous l'avons dit, avoir de trente à trente-deux ans; elle était d'une beauté remarquable, quoiqu'un air de hauteur répandu sur tout son visage dût naturellement ôter à sa physionomie une partie du charme qu'elle pouvait avoir. Du moins Jeanne en jugea ainsi par le peu qu'elle aperçut de la physionomie de la visiteuse.
En effet, préférant un des fauteuils au sofa, elle s'était rangée loin du jet de lumière qui s'élançait de la lampe, se reculant dans un coin de la chambre, et allongeant au-devant de son front la calèche de taffetas ouatée de son mantelet, laquelle, par cette disposition, projetait une ombre sur son visage.
Mais le port de la tête était si fier, l'œil si vif et si naturellement dilaté, que, tout détail fût-il effacé, la visiteuse, par son ensemble, devait être reconnue pour être de belle race, et surtout de noble race.
Sa compagne, moins timide, en apparence du moins, quoique plus jeune de quatre ou cinq ans, ne dissimulait point sa réelle beauté.
Un visage admirable de teint et de contour, une coiffure qui découvrait les tempes et faisait valoir l'ovale parfait du masque; deux grands yeux bleus calmes jusqu'à la sérénité, clairvoyants jusqu'à la profondeur; une bouche d'un dessin suave à qui la nature avait donné la franchise, et à qui l'éducation et l'étiquette avaient donné la discrétion; un nez qui, pour la forme, n'eût rien à envier à celui de la Vénus de Médicis, voilà ce que saisit le rapide coup d'œil de Jeanne. Puis, en s'égarant encore à d'autres détails, la comtesse put remarquer dans la plus jeune des deux femmes une taille plus fine et plus flexible que celle de sa compagne, une poitrine plus large et d'un galbe plus riche, enfin une main aussi potelée que celle de l'autre dame était à la fois nerveuse et fine.
Jeanne de Valois fit toutes ces remarques en quelques secondes, c'est-à-dire en moins de temps que nous n'en avons mis pour les consigner ici.
Puis, ces remarques faites, elle demanda doucement à quelle heureuse circonstance elle devait la visite de ces dames.
Les deux femmes se regardaient, et sur un signe de l'aînée:
– Madame, dit la plus jeune, car vous êtes mariée, je crois?
– J'ai l'honneur d'être la femme de M. le comte de La Motte, madame, un excellent gentilhomme.
– Eh bien, nous, madame la comtesse, nous sommes les dames supérieures d'une fondation de Bonnes-Œuvres. On nous a dit, touchant votre condition, des choses qui nous ont intéressées, et nous avons en conséquence voulu avoir quelques détails précis sur vous et sur ce qui vous concerne.
Jeanne attendit un instant avant de répondre.
– Mesdames, dit-elle en remarquant la réserve de la seconde visiteuse, vous voyez là le portrait de Henri III, c'est-à-dire du frère de mon aïeul, car je suis bien véritablement du sang des Valois, comme on vous l'a dit sans doute.
Et elle attendit une nouvelle question en regardant ses hôtesses avec une sorte d'humilité orgueilleuse.
– Madame, interrompit alors la voix grave et douce de l'aînée des deux dames, est-il vrai, comme on le dit, que Mme votre mère ait été concierge d'une maison nommée Fontette, sise auprès de Bar-sur-Seine?
Jeanne rougit à ce souvenir, mais aussitôt:
– C'est la vérité, madame, répliqua-t-elle sans se troubler, ma mère était la concierge d'une maison nommée Fontette.
– Ah! fit l'interlocutrice.
– Et, comme Marie Jossel, ma mère, était d'une rare beauté, poursuivit Jeanne, mon père devint amoureux d'elle et l'épousa. C'est par mon père que je suis de race noble. Madame, mon père était un Saint-Rémy de Valois, descendant direct des Valois qui ont régné.
– Mais comment êtes-vous descendue à ce degré de misère, madame? demanda la même dame qui avait déjà questionné.
– Hélas! c'est facile à comprendre.
– J'écoute.
– Vous n'ignorez pas qu'après l'avènement de Henri IV, qui fit passer la couronne de la maison des Valois dans celle des Bourbons, la famille déchue avait encore quelques rejetons, obscurs sans doute, mais incontestablement sortis de la souche commune aux quatre frères, qui tous quatre périrent si fatalement.
Les deux dames firent un signe qui pouvait passer pour un assentiment.
– Or, continua Jeanne, les rejetons des Valois, craignant de faire ombrage, malgré leur obscurité, à la nouvelle famille royale, changèrent leur nom de Valois en celui de Rémy, emprunté d'une terre, et on les retrouve, à partir de Louis XIII, sous ce nom, dans la généalogie jusqu'à l'avant-dernier Valois, mon aïeul, qui, voyant la monarchie affermie et l'ancienne branche oubliée, ne crut pas devoir se priver plus longtemps d'un nom illustre, son seul apanage. Il reprit donc le nom de Valois, et le traîna dans l'ombre et la pauvreté, au fond de sa province, sans que nul, à la cour de France, songeât que, hors du rayonnement du trône, végétait un descendant des anciens rois de France, sinon les plus glorieux de la monarchie, du moins les plus infortunés.
Jeanne s'interrompit à ces mots.
Elle avait parlé simplement et avec une modération qui avait été remarquée.
– Vous avez sans doute vos preuves en bon ordre, madame, dit l'aînée des deux visiteuses avec douceur, et en fixant un regard profond sur celle qui se disait la descendante des Valois.
– Oh! madame, répondit celle-ci avec un sourire amer, les preuves ne manquent pas. Mon père les avait fait faire, et en mourant me les a laissées toutes, à défaut d'autre héritage; mais à quoi bon les preuves d'une inutile vérité ou d'une vérité que nul ne veut reconnaître?