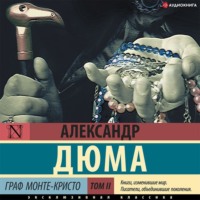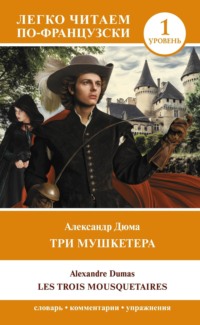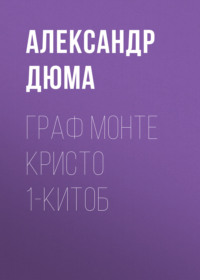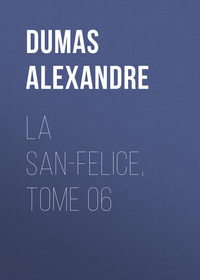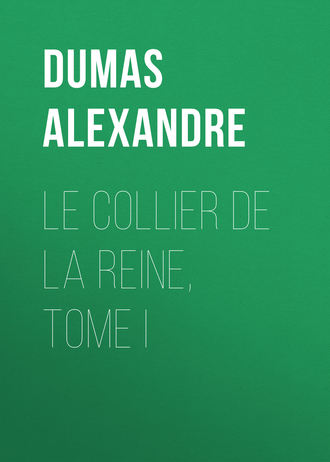 полная версия
полная версияLe Collier de la Reine, Tome I
– Ah! répliqua vivement le cardinal, qui craignait d'en avoir trop laissé soupçonner, oui, certes, ce portrait…
– Eh bien! ce portrait, monseigneur?
– Eh bien! ce portrait me fait toujours l'effet d'être…
– Celui de l'impératrice Marie-Thérèse, n'est-ce pas?
– Mais je crois que oui.
– Alors vous pensez?..
– Je pense que vous aurez reçu la visite de quelque dame allemande, de celles, par exemple, qui ont fondé une maison de secours…
– À Versailles?
– À Versailles, oui, madame.
Et le cardinal se tut.
Mais on voyait clairement qu'il doutait encore, et que la présence de cette boîte dans la maison de la comtesse avait renouvelé toutes ses défiances.
Seulement, ce que Jeanne ne distinguait pas complètement, ce qu'elle cherchait vainement d'expliquer, c'était le fond de la pensée du prince, pensée visiblement désavantageuse pour elle, et qui n'allait à rien de moins qu'à la soupçonner de lui tendre un piège avec des apparences.
En effet, on pouvait avoir su l'intérêt que le cardinal prenait aux affaires de la reine, c'était un bruit de cour qui était loin d'être demeuré même à l'état de demi-secret, et nous avons signalé tout le soin que mettaient certains ennemis à entretenir l'animosité entre la reine et son grand aumônier.
Ce portrait de Marie-Thérèse, cette boîte dont elle se servait habituellement et que le cardinal lui avait vue cent fois entre les mains, comment cela se trouvait-il entre les mains de Jeanne la mendiante?
La reine était-elle réellement venue ici elle-même dans ce pauvre logis?
Si elle était venue, était-elle restée inconnue à Jeanne? Pour un motif quelconque, dissimulait-elle l'honneur qu'elle avait reçu?
Le prélat doutait.
Il doutait déjà la veille. Le nom de Valois lui avait appris à se tenir en garde, et voilà qu'il ne s'agissait plus d'une femme pauvre, mais d'une princesse secourue par une reine apportant ses bienfaits en personne.
Marie-Antoinette était-elle charitable à ce point?
Tandis que le cardinal doutait ainsi, Jeanne, qui ne le perdait pas de vue, Jeanne, à qui aucun des sentiments du prince n'échappait, Jeanne était au supplice C'est, en effet, un véritable martyre, pour les consciences chargées d'une arrière-pensée, que le doute de ceux que l'on voudrait convaincre avec la vérité pure.
Le silence était embarrassant pour tous deux; le cardinal le rompit par une nouvelle interruption.
– Et la dame qui accompagnait votre bienfaitrice, l'avez-vous remarquée? Pouvez-vous me dire quel air elle avait?
– Oh! celle-là, je l'ai bien vue, dit la comtesse; elle est grande et belle, elle a le visage résolu, le teint superbe, les formes riches.
– Et l'autre dame ne l'a pas nommée?
– Si fait, une fois, mais par son nom de baptême.
– Et de son nom de baptême elle s'appelle?
– Andrée.
– Andrée! s'écria le cardinal.
Et il tressaillit.
Ce mouvement n'échappa pas plus que les autres à la comtesse de La Motte.
Le cardinal savait maintenant à quoi s'en tenir, le nom d'Andrée lui avait enlevé tous ses doutes.
En effet, la surveille, on savait que la reine était venue à Paris avec Mlle de Taverney. Certaine histoire de retard, de porte fermée, de querelle conjugale entre le roi et la reine avait couru dans Versailles.
Le cardinal respira.
Il n'y avait ni piège ni complot rue Saint-Claude. Mme de La Motte lui parut belle et pure comme l'ange de la candeur.
Pourtant il fallait tenter une dernière épreuve. Le prince était diplomate.
– Comtesse, dit-il, une chose m'étonne par-dessus tout, je l'avouerai.
– Laquelle, monseigneur?
– C'est qu'avec votre nom et vos titres vous ne vous soyez pas adressée au roi.
– Au roi?
– Oui.
– Mais, monseigneur, je lui ai envoyé vingt placets, vingt suppliques, au roi.
– Sans résultat?
– Sans résultat.
– Mais, à défaut du roi, tous les princes de la maison royale eussent accueilli vos réclamations. M. le duc d'Orléans, par exemple, est charitable, et puis il aime à faire souvent ce que ne fait pas le roi.
– J'ai fait solliciter Son Altesse le duc d'Orléans, monseigneur, mais inutilement.
– Inutilement! Cela m'étonne.
– Que voulez-vous, quand on n'est pas riche ou qu'on n'est pas recommandée, on voit chaque placet s'engloutir dans l'antichambre des princes.
– Il y a encore Mgr le comte d'Artois. Les gens dissipés font parfois de meilleures actions que les gens charitables.
– Il en a été de Mgr le comte d'Artois comme de Son Altesse le duc d'Orléans, comme de Sa Majesté le roi de France.
– Mais enfin, il y a Mesdames, tantes du roi. Oh! celles-là, comtesse, ou je me trompe fort, ou elles ont dû vous répondre favorablement.
– Non, monseigneur.
– Oh! je ne puis croire que Mme Elisabeth, sœur du roi, ait eu le cœur insensible.
– C'est vrai, monseigneur. Son Altesse Royale, sollicitée par moi, avait promis de me recevoir; mais je ne sais vraiment comment cela s'est fait, après avoir reçu mon mari, elle n'a plus voulu, quelques instances que j'aie faites auprès d'elle, daigner donner de ses nouvelles.
– C'est étrange, en vérité! dit le cardinal.
Puis, soudain, et comme si cette pensée se présentait seulement à cette heure en son esprit:
– Mais, mon Dieu! s'écria-t-il, nous oublions…
– Quoi?
– Mais la personne à laquelle vous eussiez dû vous adresser d'abord.
– Et à qui eussé-je dû m'adresser?
– À la dispensatrice des faveurs, à celle qui n'a jamais refusé un secours mérité, à la reine.
– À la reine?
– Oui, à la reine. L'avez-vous vue?
– Jamais, répondit Jeanne avec une parfaite simplicité.
– Comment, vous n'avez pas présenté de supplique à la reine?
– Jamais.
– Vous n'avez jamais cherché à obtenir de Sa Majesté une audience?
– J'ai cherché, mais je n'ai point réussi.
– Au moins avez-vous dû essayer de vous placer sur son passage, pour vous faire remarquer, pour vous faire appeler à la cour. C'était un moyen.
– Je ne l'ai jamais employé.
– En vérité, madame, vous me dites des choses incroyables.
– Non, en vérité, je n'ai jamais été que deux fois à Versailles, et je n'y ai vu que deux personnes, M. le docteur Louis, qui avait soigné mon malheureux père à l'Hôtel-Dieu, et M. le baron de Taverney, à qui j'étais recommandée.
– Que vous a dit M. de Taverney? Il était tout à fait en mesure de vous acheminer vers la reine.
– Il m'a répondu que j'étais bien maladroite.
– Comment cela?
– De revendiquer comme un titre à la bienveillance du roi une parenté qui devait naturellement contrarier Sa Majesté, puisque jamais parent pauvre ne plaît.
– C'est bien le baron égoïste et brutal, dit le prince.
Puis, réfléchissant à cette visite d'Andrée chez la comtesse:
«Chose bizarre, pensa-t-il, le père évite la solliciteuse, et la reine amène la fille chez elle. En vérité, il doit sortir quelque chose de cette contradiction».
– Foi de gentilhomme! reprit-il tout haut, je suis émerveillé d'entendre dire à une solliciteuse, à une femme de la première noblesse, qu'elle n'a jamais vu le roi ni la reine.
– Si ce n'est en peinture, dit Jeanne en souriant.
– Eh bien! s'écria le cardinal, convaincu cette fois de l'ignorance et de la sincérité de la comtesse, je vous mènerai, s'il le faut, moi-même à Versailles, et je vous en ferai ouvrir les portes.
– Oh! monseigneur, que de bontés! s'écria la comtesse au comble de la joie.
Le cardinal se rapprocha d'elle.
– Mais il est impossible, dit-il, qu'avant peu de temps tout le monde ne s'intéresse pas à vous.
– Hélas! monseigneur, dit Jeanne avec un adorable soupir, le croyez-vous sincèrement?
– Oh! j'en suis sûr.
– Je crois que vous me flattez, monseigneur.
Et elle le regarda fixement.
En effet, ce changement subit avait droit de surprendre la comtesse, elle que le cardinal, dix minutes auparavant, traitait avec une légèreté toute princière.
Le regard de Jeanne, décoché comme par la flèche d'un archer, frappa le cardinal soit dans son cœur soit dans sa sensualité. Il renfermait ou le feu de l'ambition ou le feu du désir; mais c'était du feu.
Monseigneur de Rohan, qui se connaissait en femmes, dut s'avouer en lui-même qu'il en avait vu peu d'aussi séduisantes.
«Ah! par ma foi! se dit-il avec cette arrière-pensée éternelle des gens de cour élevés pour la diplomatie, ah! par ma foi! il serait trop extraordinaire ou trop heureux que je rencontrasse à la fois et une honnête femme qui a les dehors d'une rusée, et dans la misère une protectrice toute-puissante.»
– Monseigneur, interrompit la sirène, vous gardez parfois un silence qui m'inquiète; pardonnez-moi de vous le dire.
– En quoi, comtesse? demanda le cardinal.
– En ceci, monseigneur: un homme comme vous ne manque jamais de politesse qu'avec deux sortes de femmes.
– Oh! mon Dieu! qu'allez-vous me dire, comtesse? Sur ma parole! vous m'effrayez.
Il lui prit la main.
– Oui, répondit la comtesse, avec deux sortes de femmes, je l'ai dit et je le répète.
– Lesquelles, voyons?
– Des femmes qu'on aime trop, ou des femmes qu'on n'estime pas assez.
– Comtesse, comtesse, vous me faites rougir. J'aurais moi-même manqué de politesse envers vous?
– Dame!
– Ne dites point cela, ce serait affreux!
– En effet, monseigneur, car vous ne pouvez m'aimer trop, et je ne vous ai point, jusqu'à présent du moins, donné le droit de m'estimer trop peu.
Le cardinal prit la main de Jeanne.
– Oh! comtesse, en vérité, vous me parlez comme si vous étiez fâchée contre moi.
– Non, monseigneur, car vous n'avez pas encore mérité ma colère.
– Et je ne la mériterai jamais, madame, à partir de ce jour où j'ai eu le plaisir de vous voir et de vous connaître.
«Oh! mon miroir, mon miroir!» pensa Jeanne.
– Et, à partir de ce jour, continua le cardinal, ma sollicitude ne vous quittera plus.
– Oh! tenez, monseigneur, dit la comtesse qui n'avait pas retiré sa main des mains du cardinal, assez comme cela.
– Que voulez-vous dire?
– Ne me parlez pas de votre protection.
– À Dieu ne plaise que je prononce ce mot protection! Oh! madame, ce n'est pas vous qu'il humilierait, c'est moi.
– Alors, monsieur le cardinal, admettons une chose qui va me flatter infiniment…
– Si cela est, madame, admettons cette chose.
– Admettons, monseigneur, que vous avez rendu une visite de politesse à Mme de La Motte-Valois. Rien de plus.
– Mais rien de moins alors, répondit le galant cardinal.
Et portant les doigts de Jeanne à ses lèvres, il y imprima un assez long baiser.
La comtesse retira sa main.
– Oh! politesse, dit le cardinal avec un goût et un sérieux exquis.
Jeanne rendit sa main, sur laquelle cette fois le prélat appuya un baiser tout respectueux.
– Ah! c'est fort bien ainsi, monseigneur.
Le cardinal s'inclina.
– Savoir, continua la comtesse, que je posséderai une part, si faible qu'elle soit, dans l'esprit si éminent et si occupé d'un homme tel que vous, voilà, je vous jure, de quoi me consoler un an.
– Un an! c'est bien court… Espérons plus, comtesse.
– Eh bien! je ne dis pas non, monsieur le cardinal, répondit-elle en souriant.
Monsieur le cardinal tout court était une familiarité dont, pour la seconde fois, se rendait coupable Mme de La Motte. Le prélat, irritable dans son orgueil, aurait pu s'en étonner; mais les choses en étaient à ce point, que non seulement il ne s'en étonna pas, mais encore qu'il en fut satisfait comme d'une faveur.
– Ah! de la confiance, s'écria-t-il en se rapprochant encore. Tant mieux, tant mieux.
– J'ai confiance, oui, monseigneur, parce que je sens dans Votre Éminence…
– Vous disiez monsieur tout à l'heure, comtesse.
– Il faut me pardonner, monseigneur; je ne connais pas la cour. Je dis donc que j'ai confiance, parce que vous êtes capable de comprendre un esprit comme le mien, aventureux, brave, et un cœur tout pur. Malgré les épreuves de la pauvreté, malgré les combats que m'ont livrés de vils ennemis, Votre Éminence saura prendre en moi, c'est-à-dire en ma conversation, ce qu'il y a de digne d'elle. Votre Éminence saura me témoigner de l'indulgence pour le reste.
– Nous voilà donc amis, madame. C'est signé, juré?
– Je le veux bien.
Le cardinal se leva et s'avança vers Mme de La Motte; mais, comme il avait les bras un peu trop ouverts pour un simple serment… légère et souple, la comtesse évita le cercle.
– Amitié à trois! dit-elle avec un inimitable accent de raillerie et d'innocence.
– Comment, amitié à trois? demanda le cardinal.
– Sans doute; est-ce qu'il n'y a pas, de par le monde, un pauvre gendarme, un exilé, qu'on appelle le comte de La Motte?
– Oh! comtesse, quelle déplorable mémoire vous possédez!
– Mais il faut bien que je vous parle de lui, puisque vous ne m'en parlez pas, vous.
– Savez-vous pourquoi je ne vous parle pas de lui, comtesse?
– Dites un peu.
– C'est qu'il parlera toujours bien assez lui-même; les maris ne s'oublient jamais, croyez-moi bien.
– Et s'il parle de lui?
– Alors on parlera de vous, alors on parlera de nous.
– Comment cela?
– On dira, par exemple, que M. le comte de La Motte a trouvé bon, ou trouvé mauvais, que M. le cardinal de Rohan vînt trois, quatre ou cinq fois la semaine visiter Mme de La Motte, rue Saint-Claude.
– Ah! mais vous m'en direz tant, monsieur le cardinal! Trois, quatre ou cinq fois la semaine?
– Où serait l'amitié alors, comtesse? J'ai dit cinq fois; je me trompais. C'est six ou sept qu'il faut dire, sans compter les jours bissextiles.
Jeanne se mit à rire.
Le cardinal remarqua qu'elle faisait pour la première fois honneur à ses plaisanteries, et il en fut encore flatté.
– Empêcherez-vous qu'on ne parle? dit-elle; vous savez bien que c'est chose impossible.
– Oui, répliqua-t-il.
– Et comment?
– Oh! une chose toute simple; à tort ou à raison, le peuple de Paris me connaît.
– Oh! certes, et à raison, monseigneur.
– Mais vous, il a le malheur de ne pas vous connaître.
– Eh bien!
– Déplaçons la question.
– Déplacez-la, c'est-à-dire…
– Comme vous voudrez… Si, par exemple…
– Achevez.
– Si vous sortiez au lieu de me faire sortir?
– Que j'aille dans votre hôtel, moi, monseigneur?
– Vous iriez bien chez un ministre.
– Un ministre n'est pas un homme, monseigneur.
– Vous êtes adorable. Eh bien! il ne s'agit pas de mon hôtel, j'ai une maison.
– Une petite maison, tranchons le mot.
– Non pas, une maison à vous.
– Ah! fit la comtesse, une maison à moi! Et où cela? Je ne me connaissais pas cette maison.
Le cardinal, qui s'était rassis, se leva.
– Demain, à dix heures du matin, vous en recevrez l'adresse.
La comtesse rougit, le cardinal lui prit galamment la main.
Et cette fois le baiser fut respectueux, tendre et hardi tout ensemble.
Tous deux se saluèrent alors avec ce reste de cérémonie souriante qui indique une prochaine intimité.
– Éclairez à monseigneur, cria la comtesse.
La vieille parut et éclaira.
Le prélat sortit.
«Eh! mais, pensa Jeanne, voilà un grand pas fait dans le monde, ce me semble.»
«Allons, allons, pensa le cardinal, en montant dans son carrosse, j'ai fait une double affaire. Cette femme a trop d'esprit pour ne pas prendre la reine comme elle m'a pris.»
Chapitre XVI
Mesmer et Saint-Martin
Il fut un temps où Paris, libre d'affaires, Paris, plein de loisirs, se passionnait tout entier pour des questions qui, de nos jours, sont le monopole des riches, qu'on appelle les inutiles, et des savants, qu'on appelle les paresseux.
En 1784, c'est-à-dire à l'époque où nous sommes arrivés, la question à la mode, celle qui surnageait au-dessus de toutes, qui flottait dans l'air, qui s'arrêtait à toutes les têtes un peu élevées, comme font les vapeurs aux montagnes, c'était le mesmérisme, science mystérieuse, mal définie par ses inventeurs, qui, n'éprouvant pas le besoin de démocratiser une découverte dès sa naissance, avaient laissé prendre à celle-là un nom d'homme, c'est-à-dire un titre aristocratique, au lieu d'un de ces noms de science tirés du grec à l'aide desquels la pudibonde modestie des savants modernes vulgarise aujourd'hui tout élément scientifique.
En effet, à quoi bon, en 1784, démocratiser une science? Le peuple qui, depuis plus d'un siècle et demi, n'avait pas été consulté par ceux qui le gouvernaient, comptait-il pour quelque chose dans l'État? Non: le peuple, c'était la terre féconde qui rapportait, c'était la riche moisson que l'on fauchait; mais le maître de la terre, c'était le roi; mais les moissonneurs, c'était la noblesse.
Aujourd'hui, tout est changé: la France ressemble à un sablier séculaire; pendant neuf cents ans, il a marqué l'heure de la royauté; la droite puissante du Seigneur l'a retourné: pendant des siècles, il va marquer l'ère du peuple.
En 1784, c'était donc une recommandation qu'un nom d'homme. Aujourd'hui, au contraire, le succès serait un nom de choses.
Mais abandonnons aujourd'hui pour jeter les yeux sur hier. Au compte de l'éternité, qu'est-ce que cette distance d'un demi-siècle? pas même celle qui existe entre la veille et le lendemain.
Le docteur Mesmer était donc à Paris, comme Marie-Antoinette nous l'a appris elle-même en demandant au roi la permission de lui faire une visite. Qu'on nous permette donc de dire quelques mots du docteur Mesmer, dont le nom, retenu aujourd'hui d'un petit nombre d'adeptes, était, à cette époque que nous essayons de peindre, dans toutes les bouches.
Le docteur Mesmer avait, vers 1777, apporté d'Allemagne, ce pays des rêves brumeux, une science toute gonflée de nuages et d'éclairs. À la lueur de ces éclairs, les savants ne voyaient que les nuages qui faisaient, au-dessus de leur tête, une voûte sombre; le vulgaire ne voyait que des éclairs.
Mesmer avait débuté en Allemagne par une thèse sur l'influence des planètes. Il avait essayé d'établir que les corps célestes, en vertu de cette force qui produit leurs attractions mutuelles, exercent une influence sur les corps animés, et particulièrement sur le système nerveux, par l'intermédiaire d'un fluide subtil qui remplit tout l'univers. Mais cette première théorie était bien abstraite. Il fallait, pour la comprendre être initié à la science des Galilée et des Newton. C'était un mélange de grandes variétés astronomiques avec les rêveries astrologiques qui ne pouvait, nous ne disons pas se populariser, mais s'aristocratiser: car il eût fallu pour cela que le corps de la noblesse fût converti en société savante. Mesmer abandonna donc ce premier système pour se jeter dans celui des aimants.
Les aimants, à cette époque, étaient fort étudiés; leurs facultés sympathiques ou antipathiques faisaient vivre les minéraux d'une vie à peu près pareille à la vie humaine, en leur prêtant les deux grandes passions de la vie humaine: l'amour et la haine. En conséquence, on attribuait aux aimants des vertus surprenantes pour la guérison des maladies. Mesmer joignit donc l'action des aimants à son premier système, et essaya de voir ce qu'il pourrait tirer de cette adjonction.
Malheureusement pour Mesmer, il trouva, en arrivant à Vienne, un rival établi. Ce rival, qui se nommait Hell, prétendit que Mesmer lui avait dérobé ses procédés. Ce que voyant, Mesmer, en homme d'imagination qu'il était, déclara qu'il abandonnerait les aimants comme inutiles, et qu'il ne guérirait plus par le magnétisme minéral, mais par le magnétisme animal.
Ce mot, prononcé comme un mot nouveau, ne désignait pas cependant une découverte nouvelle; le magnétisme, connu des Anciens, employé dans les initiations égyptiennes et dans le pythisme grec, s'était conservé dans le Moyen Age à l'état de tradition; quelques lambeaux de cette science, recueillis, avaient fait les sorciers des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Beaucoup furent brûlés qui confessèrent, au milieu des flammes, la religion étrange dont ils étaient les martyrs.
Urbain Grandier n'était rien autre chose qu'un magnétiseur.
Mesmer avait entendu parler des miracles de cette science.
Joseph Balsamo, le héros d'un de nos livres, avait laissé trace de son passage en Allemagne, et surtout à Strasbourg. Mesmer se mit en quête de cette science éparse et voltigeante comme ces feux follets qui courent la nuit au-dessus des étangs; il en fit une théorie complète, un système uniforme auquel il donna le nom de mesmérisme.
Mesmer, arrivé à ce point, communiqua son système à l'Académie des sciences à Paris, à la Société royale de Londres, et à l'Académie de Berlin; les deux premières ne lui répondirent même pas, la troisième dit qu'il était un fou.
Mesmer se rappela ce philosophe grec qui niait le mouvement, et que son antagoniste confondit en marchant. Il vint en France, prit, aux mains du docteur Stoerck et de l'oculiste Wenzel, une jeune fille de dix-sept ans atteinte d'une maladie de foie et d'une goutte sereine, et, après trois mois de traitement, la malade était guérie, l'aveugle voyait clair.
Cette cure avait convaincu nombre de gens, et, entre autres, un médecin nommé Deslon: d'ennemi, il devint apôtre.
À partir de ce moment, la réputation de Mesmer avait été grandissant; l'Académie s'était déclarée contre le novateur, la cour se déclara pour lui; des négociations furent ouvertes par le ministère pour engager Mesmer à enrichir l'humanité par la publication de sa doctrine. Le docteur fit son prix. On marchanda, M. de Breteuil lui offrit, au nom du roi, une rente viagère de vingt mille livres et un traitement de dix mille livres pour former trois personnes, indiquées par le gouvernement, à la pratique de ses procédés. Mais Mesmer, indigné de la parcimonie royale, refusa et partit pour les eaux de Spa, avec quelques-uns de ses malades.
Une catastrophe inattendue menaçait Mesmer. Deslon, son élève, Deslon, possesseur du fameux secret que Mesmer avait refusé de vendre pour trente mille livres par an; Deslon ouvrit chez lui un traitement public par la méthode mesmérienne.
Mesmer apprit cette douloureuse nouvelle; il cria au vol, à la fraude; il pensa devenir fou. Alors, un de ses malades, M. de Bergasse, eut l'heureuse idée de mettre la science de l'illustre professeur en commandite; il fut formé un comité de cent personnes au capital de trois cent quarante mille livres, à la condition qu'il révélerait la doctrine aux actionnaires. Mesmer s'engagea à cette révélation, toucha le capital et revint à Paris.
L'heure était propice. Il y a des instants dans l'âge des peuples, ceux qui touchent aux époques de transformation, où la nation tout entière s'arrête comme devant un obstacle inconnu, hésite et sent l'abîme au bord duquel elle est arrivée, et qu'elle devine sans le voir.
La France était dans un de ces moments-là; elle présentait l'aspect d'une société calme, dont l'esprit était agité; on était en quelque sorte engourdi dans un bonheur factice, dont on entrevoyait la fin, comme, en arrivant à la lisière d'une forêt, on devine la plaine par les interstices des arbres. Ce calme, qui n'avait rien de constant, rien de réel, fatiguait; on cherchait partout des émotions, et les nouveautés, quelles qu'elles fussent, étaient bien reçues. On était devenu trop frivole pour s'occuper, comme autrefois, des graves questions du gouvernement et du molinisme; mais on se querellait à propos de musique, on prenait parti pour Gluck ou pour Piccini, on se passionnait pour l'Encyclopédie, on s'enflammait pour les mémoires de Beaumarchais.
L'apparition d'un opéra nouveau préoccupait plus les imaginations que le traité de paix avec l'Angleterre et la reconnaissance de la République des États-Unis. C'était enfin une de ces périodes où les esprits, amenés par les philosophes vers le vrai, c'est-à-dire vers le désenchantement, se lassent de cette limpidité du possible qui laisse voir le fond de toute chose, et, par un pas en avant, essaie de franchir les bornes du monde réel pour entrer dans le monde des rêves et des fictions.
En effet, s'il est prouvé que les vérités bien claires, bien lucides, sont les seules qui se popularisent promptement, il n'en est pas moins prouvé que les mystères sont une attraction toute-puissante pour les peuples.
Le peuple de France était donc entraîné, attiré d'une façon irrésistible par ce mystère étrange du fluide mesmérien, qui, selon les adeptes, rendait la santé aux malades, donnait l'esprit aux fous et la folie aux sages.