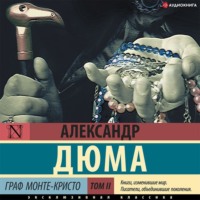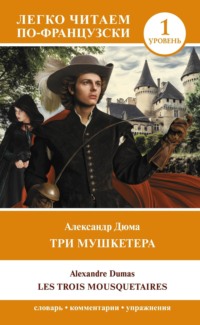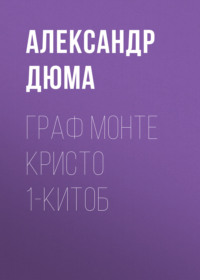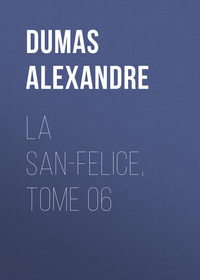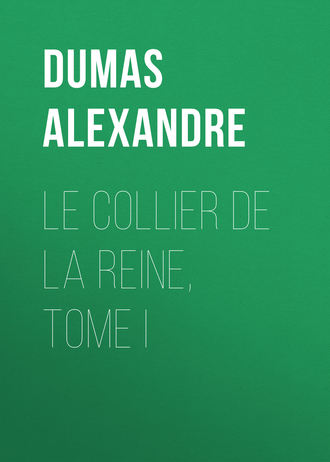 полная версия
полная версияLe Collier de la Reine, Tome I
La reine reconnut M. Louis de Rohan; elle le vit d'un bout de la salle à l'autre, et aussitôt détourna la tête sans même prendre la peine de dissimuler le froncement de ses sourcils.
Le prélat traversa toute l'assemblée sans saluer personne, et vint droit à la reine, devant laquelle il s'inclina bien plus en homme du monde qui salue une femme qu'en sujet qui salue une reine.
Puis il adressa un compliment fort galant à Sa Majesté, qui détourna la tête, murmura deux ou trois mots d'un cérémonial glacé, et reprit sa conversation avec Mme de Lamballe et Mme de Polignac.
Le prince Louis ne parut point s'être aperçu du mauvais accueil de la reine. Il accomplit ses révérences, se retourna sans précipitation, et avec toute la grâce d'un parfait homme de cour, s'adressa à Mesdames, tantes du roi, qu'il entretint longtemps, attendu qu'en vertu du jeu de bascule en usage à la cour, il obtenait là un accueil aussi bienveillant que celui de la reine avait été glacé.
Le cardinal Louis de Rohan était un homme dans la force de l'âge, d'une imposante figure, d'un noble maintien; ses traits respiraient l'intelligence et la douceur; il avait la bouche fine et circonspecte, la main admirable; son front, un peu dégarni, accusait l'homme de plaisir ou l'homme d'étude; et chez le prince de Rohan, il y avait effectivement de l'un et de l'autre.
C'était un homme recherché par les femmes qui aimaient la galanterie sans fadeur et sans bruit. On le citait pour sa magnificence. Il avait en effet trouvé moyen de se croire pauvre avec seize cent mille livres de revenu.
Le roi l'aimait parce qu'il était savant; la reine le haïssait au contraire.
Les raisons de cette haine n'ont jamais été bien connues à fond, mais elles peuvent soutenir deux sortes de commentaires.
D'abord, en sa qualité d'ambassadeur à Vienne, le prince Louis aurait écrit, disait-on, au roi Louis XV, sur Marie-Thérèse, des lettres pleines d'ironie que jamais Marie-Antoinette n'aurait pu pardonner à ce diplomate.
En outre, et ceci est plus humain et surtout plus vraisemblable, l'ambassadeur, à propos du mariage de la jeune archiduchesse avec le dauphin, aurait écrit, toujours au roi Louis XV, qui aurait lu tout haut la lettre à un souper chez Mme Du Barry, aurait écrit, disons-nous, certaines particularités hostiles à l'amour-propre de la jeune femme, fort maigre à cette époque.
Ces attaques auraient vivement blessé Marie-Antoinette, qui ne pouvait s'en reconnaître publiquement la victime, et se serait juré d'en punir tôt ou tard l'auteur.
Il y avait naturellement là-dessous toute une intrigue politique.
L'ambassade de Vienne avait été retirée à M. de Breteuil au bénéfice de M. de Rohan.
M. de Breteuil, trop faible pour lutter ouvertement contre le prince, avait alors employé ce qu'en diplomatie on appelle l'adresse. Il s'était procuré les copies, ou même les originaux des lettres du prélat, alors ambassadeur, et balançant les services réels rendus par le diplomate avec la petite hostilité qu'il exerçait contre la famille impériale autrichienne, il avait trouvé dans la dauphine un auxiliaire décidé à perdre un jour M. le prince de Rohan.
Cette haine couvait sourdement à la cour: elle y rendait difficile la position du cardinal.
Chaque fois qu'il voyait la reine, il subissait ce glacial accueil dont nous avons essayé de donner une idée.
Mais plus grand que le dédain, soit qu'il fût réellement fort, soit qu'un sentiment irrésistible l'entraînât à pardonner tout à son ennemie, Louis de Rohan ne négligeait aucune occasion de se rapprocher de Marie-Antoinette, et les moyens ne lui manquaient pas, le prince Louis de Rohan étant grand aumônier de la cour.
Jamais il ne s'était plaint, jamais il n'avait rien avancé à personne. Un petit cercle d'amis, parmi lesquels on distinguait le baron de Planta, officier allemand, son confident intime, servait à le consoler des rebuffades royales quand les dames de la cour, qui en fait de sévérité pour le cardinal ne se modelaient pas toutes sur la reine, n'avaient point opéré cet heureux résultat.
Le cardinal venait de passer comme une ombre sur le tableau riant qui se jouait dans l'imagination de la reine. Aussi, à peine se fut-il éloigné d'elle, que Marie-Antoinette se rassérénant:
– Savez-vous, dit-elle à Mme la princesse de Lamballe, que le trait de ce jeune officier, neveu de M. le bailli, est un des plus remarquables de cette guerre? Comment l'appelle-t-on, déjà?
– M. de Charny, je crois, répondit la princesse.
Puis, se retournant du côté d'Andrée pour l'interroger:
– N'est-ce point cela, mademoiselle de Taverney? demanda-t-elle.
– Charny, oui, Votre Altesse, répondit Andrée.
– Il faut, continua la reine, que M. de Charny nous raconte à nous-même cet épisode, sans nous faire grâce d'un seul détail. Qu'on le cherche. Est-il toujours ici?
Un officier se détacha et s'empressa de sortir pour exécuter l'ordre de la reine.
Au même instant, comme elle regardait autour d'elle, elle aperçut Philippe, et, impatiente comme toujours:
– Monsieur de Taverney, dit-elle, voyez donc.
Philippe rougit; peut-être pensait-il qu'il eût dû prévenir le désir de sa souveraine. Il se mit donc à la recherche de ce bienheureux officier qu'il n'avait pas quitté de l'œil depuis sa présentation.
La recherche lui fut donc bien facile.
M. de Charny arriva l'instant d'après entre les deux messagers de la reine.
Le cercle s'élargit devant lui; la reine put alors l'examiner avec plus d'attention qu'il ne lui avait été possible de le faire la veille.
C'était un jeune homme de vingt-sept à vingt-huit ans, à la taille droite et mince, aux épaules larges, à la jambe parfaite. Sa figure, fine et douce à la fois, prenait un caractère d'énergie singulière à chaque fois qu'il dilatait son grand œil bleu au regard profond.
Il était, chose étonnante pour un homme arrivant de faire les guerres de l'Inde, il était aussi blanc de teint que Philippe était brun; son col nerveux, et d'un dessin admirable, se jouait dans une cravate d'une blancheur moins éclatante que celle de sa peau.
Lorsqu'il s'approcha du groupe au centre duquel se tenait la reine, il n'avait encore en aucune façon manifesté qu'il connût soit Mlle de Taverney, soit la reine elle-même.
Entouré d'officiers qui le questionnaient et auxquels il répondait civilement, il semblait avoir oublié qu'il y eût un roi auquel il avait parlé, une reine qui l'avait regardé.
Cette politesse, cette réserve étaient de nature à le faire remarquer beaucoup plus encore par la reine, si délicate sur tout ce qui tenait aux procédés.
Ce n'était pas seulement aux autres que M. de Charny avait raison de cacher sa surprise à la vue si inattendue de la dame du fiacre. Le comble de la prud'homie, c'était de lui laisser, s'il était possible, ignorer à elle-même qu'elle venait d'être reconnue.
Le regard de Charny, demeuré naturel, et chargé d'une timidité de bon goût, ne se leva donc point avant que la reine ne lui eût adressé la parole.
– Monsieur de Charny, lui dit-elle, ces dames éprouvent le désir, désir bien naturel puisque je l'éprouve comme elles, ces dames éprouvent le désir de connaître l'affaire du vaisseau dans tous ses détails; contez-nous cela, je vous prie.
– Madame, répliqua le jeune marin au milieu d'un profond silence, je supplie Votre Majesté, non point par modestie, mais par humanité, de me dispenser de ce récit; ce que j'ai fait comme lieutenant du Sévère, dix officiers, mes camarades, ont pensé à le faire en même temps que moi; j'ai exécuté le premier, voilà tout mon mérite. Quant à donner à ce qui a été fait l'importance d'une narration adressée à Sa Majesté, non, madame, c'est impossible, et votre grand cœur, votre cœur royal, surtout, le comprendra.
«L'ex-commandant du Sévère est un brave officier qui, ce jour-là, avait perdu la tête. Hélas! madame, vous avez dû l'entendre dire aux plus courageux, on n'est pas brave tous les jours. Il lui fallait dix minutes pour se remettre; notre détermination de ne pas nous rendre lui a donné ce répit, et le courage lui est revenu; dès ce moment, il a été le plus brave de nous tous; voilà pourquoi je conjure Votre Majesté de ne pas exagérer le mérite de mon action, ce serait une occasion d'écraser ce pauvre officier qui pleure tous les jours l'oubli d'une minute.
– Bien! bien! dit la reine touchée et rayonnante de joie, en entendant le favorable murmure que les généreuses paroles du jeune officier avaient soulevé autour d'elle; bien! monsieur de Charny, vous êtes un honnête homme, c'est ainsi que je vous connaissais.
À ces mots, l'officier releva la tête, une rougeur toute juvénile empourprait son visage; ses yeux allaient de la reine à Andrée avec une sorte d'effroi. Il redoutait la vue de cette nature si généreuse et si téméraire dans sa générosité.
En effet, M. de Charny n'était pas au bout.
– Car, continua l'intrépide reine, il est bon que vous sachiez tous que M. de Charny, ce jeune officier, ce débarqué d'hier, cet inconnu, était déjà fort connu de nous avant qu'il nous fût présenté ce soir, et mérite d'être connu et admiré de toutes les femmes.
On vit que la reine allait parler, qu'elle allait raconter une histoire dans laquelle chacun pouvait glaner, soit un petit scandale, soit un petit secret. On fit donc cercle, on écouta, on s'étouffa.
– Figurez-vous, mesdames, dit la reine, que M. de Charny est aussi indulgent envers les dames qu'il est impitoyable envers les Anglais. On m'a conté de lui une histoire qui, je vous le déclare d'avance, lui a fait le plus grand honneur dans mon esprit.
– Oh! madame, balbutia le jeune officier.
On devine que les paroles de la reine, la présence de celui auquel elles s'adressaient, ne firent que redoubler la curiosité.
Un frémissement courut dans tout l'auditoire.
Charny, le front couvert de sueur, eût donné un an de sa vie pour être encore dans l'Inde.
– Voici le fait, poursuivit la reine: Deux dames que je connais étaient attardées, embarrassées dans une foule. Elles couraient un danger réel, un grand danger. M. de Charny passait en ce moment, par hasard ou plutôt par bonheur; il écarta la foule et prit, sans les connaître et quoiqu'il fût difficile de reconnaître leur rang, il prit les deux dames sous sa protection, les accompagna fort loin… à dix lieues de Paris, je crois.
– Oh! Votre Majesté exagère, dit en riant Charny rassuré par le tour qu'avait pris la narration.
– Voyons, mettons cinq lieues et n'en parlons plus, interrompit le comte d'Artois, se mêlant soudain à la conversation.
– Soit, mon frère, continua la reine; mais ce qu'il y eut de plus beau, c'est que M. de Charny ne chercha même pas à savoir le nom des deux dames auxquelles il avait rendu ce service, c'est qu'il les déposa à l'endroit qu'elles lui indiquèrent, c'est qu'il s'éloigna sans retourner la tête, de sorte qu'elles échappèrent de ses mains protectrices sans avoir été inquiétées un seul instant.
On se récria, on admira; Charny fut complimenté par vingt femmes à la fois.
– C'est beau, n'est-ce pas? acheva la reine; un chevalier de la Table Ronde n'eût pas fait mieux.
– C'est superbe! s'écria le chœur.
– Monsieur de Charny, continua la reine, le roi est occupé sans doute de récompenser M. de Suffren, votre oncle; moi, de mon côté, je voudrais bien faire quelque chose pour le neveu de ce grand homme.
Elle lui tendit la main.
Et tandis que Charny, pâle de joie, y collait ses lèvres, Philippe, pâle de douleur, s'ensevelissait dans les amples rideaux du salon.
Andrée avait aussi pâli, et cependant elle ne pouvait deviner tout ce que souffrait son frère.
La voix de M. le comte d'Artois rompit cette scène, qui eût été si curieuse pour un observateur.
– Ah! mon frère de Provence, dit-il tout haut, arrivez donc, monsieur, arrivez donc; vous avez manqué un beau spectacle, la réception de M. de Suffren. En vérité, c'était un moment que n'oublieront jamais les cœurs français! Comment diable avez-vous manqué cela, vous, mon frère, l'homme exact par excellence?
Monsieur pinça ses lèvres, salua distraitement la reine, et répondit une banalité.
Puis, tout bas, à M. de Favras, son capitaine des gardes:
– Comment se fait-il qu'il soit à Versailles?
– Eh! monseigneur, répliqua celui-ci, je me le demande depuis une heure et ne l'ai point encore compris.
Chapitre XIII
Les cent louis de la reine
Maintenant que nous avons fait faire ou fait renouveler connaissance à nos lecteurs avec les principaux personnages de cette histoire, maintenant que nous les avons introduits, et dans la petite maison du comte d'Artois, et dans le palais de Louis XIV, à Versailles, nous allons les mener à cette maison de la rue Saint-Claude où la reine de France est entrée incognito, et est montée, avec Andrée de Taverney, au quatrième étage.
Une fois la reine disparue, Mme de La Motte, nous le savons, compta et recompta joyeusement les cent louis qui venaient de lui choir si miraculeusement du ciel.
Cinquante beaux doubles louis de quarante-huit livres qui, étalés sur la pauvre table, et rayonnant aux reflets de la lampe, semblaient humilier par leur présence aristocratique tout ce qu'il y avait de pauvres choses dans l'humble galetas.
Après le plaisir d'avoir, Mme de La Motte n'en connaissait pas de plus grand que de faire voir. La possession n'était rien pour elle si la possession ne faisait pas naître l'envie.
Il lui répugnait déjà, depuis quelque temps, d'avoir sa femme de chambre pour confidente de sa misère; elle se hâta donc de la prendre pour confidente de sa fortune.
Alors elle appela dame Clotilde, demeurée dans l'antichambre, et ménageant habilement le jour de la lampe de manière que l'or resplendît sur la table:
– Clotilde? lui dit-elle.
La femme de ménage fit un pas dans la chambre.
– Venez ici et regardez, ajouta Mme de La Motte.
– Oh! madame… s'écria la vieille en joignant les mains et en allongeant le cou.
– Vous étiez inquiète de vos gages? dit Mme la comtesse.
– Oh! madame, jamais je n'ai dit un mot de cela. Dame! j'ai demandé à Madame la comtesse quand elle pourrait me payer, et c'était bien naturel, n'ayant rien reçu depuis trois mois.
– Croyez-vous qu'il y ait là de quoi vous payer?
– Jésus! madame, si j'avais ce qu'il y a là, je me trouverais riche pour toute ma vie.
Mme de La Motte regarda la vieille en haussant les épaules avec un mouvement d'inexprimable dédain.
– C'est heureux, dit-elle, que certaines gens aient souvenir du nom que je porte, tandis que ceux qui devraient s'en souvenir l'oublient.
– Et à quoi allez-vous employer tout cet argent? demanda dame Clotilde.
– À tout.
– D'abord, moi, madame, ce que je trouverais de plus important, à mon avis, ce serait de monter ma cuisine, car vous allez donner à dîner, n'est-ce pas, maintenant que vous avez de l'argent?
– Chut! fit Mme de La Motte, on frappe.
– Madame se trompe, dit la vieille, toujours économe de ses pas.
– Mais je vous dis que si.
– Oh! je promets bien à madame…
– Allez voir.
– Je n'ai rien entendu.
– Oui, comme tout à l'heure; tout à l'heure, vous n'aviez rien entendu non plus: eh bien! si les deux dames étaient parties sans entrer?
Cette raison parut convaincre dame Clotilde, qui s'achemina vers la porte.
– Entendez-vous? s'écria Mme de La Motte.
– Ah! c'est vrai, dit la vieille; j'y vais, j'y vais.
Mme de La Motte se hâta de faire glisser les cinquante doubles louis de la table dans sa main, puis elle les jeta dans un tiroir.
Et elle murmura en repoussant le tiroir:
– Voyons, Providence, encore une centaine de louis.
Et ces mots furent prononcés avec une expression de sceptique avidité qui eût fait sourire Voltaire.
Pendant ce temps, la porte du palier s'ouvrait, et un pas d'homme se faisait entendre dans la première pièce.
Quelques mots s'échangèrent entre cet homme et dame Clotilde sans que la comtesse pût en saisir le sens.
Puis la porte se referma, les pas se perdirent dans l'escalier, et la vieille rentra une lettre à la main.
– Voilà, dit-elle, en donnant la lettre à sa maîtresse.
La comtesse en examina attentivement l'écriture, l'enveloppe et le cachet, puis, relevant la tête:
– Un domestique? demanda-t-elle.
– Oui, madame.
– Quelle livrée?
– Il n'en avait pas.
– C'est donc un grison?
– Oui.
– Je connais ces armes, reprit Mme de La Motte en donnant un nouveau coup d'œil au cachet.
Puis, approchant le cachet de la lampe:
– De gueules à neuf macles d'or, dit-elle; qui donc porte de gueules à neuf macles d'or?
Elle chercha un instant dans ses souvenirs, mais inutilement.
– Voyons toujours la lettre, murmura-t-elle.
Et, l'ayant ouverte avec soin pour n'en point endommager le cachet, elle lut:
«Madame, la personne que vous avez sollicitée pourra vous voir demain au soir, si vous avez pour agréable de lui ouvrir votre porte.»
– Et c'est tout?
La comtesse fit un nouvel effort de mémoire.
– J'ai écrit à tant de personnes, dit-elle. Voyons un peu, à qui ai-je écrit?.. À tout le monde. Est-ce un homme, est-ce une femme qui me répond?.. L'écriture ne dit rien… insignifiante… une véritable écriture de secrétaire… Ce style? style de protecteur… plat et vieux.
Puis elle répéta:
«La personne que vous avez sollicitée…»
– La phrase a l'intention d'être humiliante. C'est certainement d'une femme.
Elle continua:
«…viendra demain soir, si vous avez pour agréable de lui ouvrir votre porte.»
– Une femme eût dit: «Vous attendra demain soir.» C'est d'un homme… Et, cependant, ces dames d'hier, elles sont bien venues, et pourtant c'était de grandes dames. Pas de signature… Qui donc porte de gueules à neuf macles d'or? Oh! s'écria-t-elle, ai-je donc perdu la tête? Les Rohan, pardieu! Oui, j'ai écrit à M. de Guéménée et à M. de Rohan; l'un d'eux me répond, c'est tout simple… Mais l'écusson n'est pas écartelé, la lettre est du cardinal… Ah! le cardinal de Rohan, ce galant, ce dameret, cet ambitieux; il viendra voir Mme de La Motte, si Mme de La Motte lui ouvre sa porte!
«Bon! qu'il soit tranquille, la porte lui sera ouverte. Et quand cela? demain soir.»
Elle se mit à rêver.
– Une dame de charité qui donne cent louis peut être reçue dans un galetas; elle peut geler sur mon carreau froid, souffrir sur mes chaises dures comme le gril de saint Laurent, moins le feu. Mais un prince de l'Église, un homme de boudoir, un seigneur des cœurs! Non, non, il faut à la misère que visitera un pareil aumônier, il faut plus de luxe que n'en ont certains riches.
Puis se retournant vers la femme de ménage qui achevait de préparer son lit:
– À demain, dame Clotilde, dit-elle, n'oubliez pas de me réveiller de bonne heure.
Là-dessus, pour penser plus à son aise sans doute, la comtesse fit signe à la vieille de la laisser seule.
Dame Clotilde raviva le feu qu'on avait enterré dans les cendres pour donner un aspect plus misérable à l'appartement, ferma la porte et se retira dans l'appentis où elle couchait.
Jeanne de Valois, au lieu de dormir, fit ses plans pendant toute la nuit. Elle prit des notes au crayon à la lueur de la veilleuse; puis, sûre de la journée du lendemain, elle se laissa, vers trois heures du matin, engourdir dans un repos dont dame Clotilde, qui n'avait guère plus dormi qu'elle, vint, fidèle à sa recommandation, la tirer au point du jour.
Vers huit heures, elle avait achevé sa toilette, composée d'une robe de soie élégante et d'une coiffure pleine de goût.
Chaussée à la fois en grande dame et en jolie femme, la mouche sur la pommette gauche, la militaire brodée au poignet, elle envoya quérir une espèce de brouette à la place où l'on trouvait ce genre de locomotive, c'est-à-dire rue du Pont-aux-Choux.
Elle eût préféré une chaise à porteurs, mais il eût fallu l'aller quérir trop loin.
La brouette-chaise roulante, attelée d'un robuste Auvergnat, reçut l'ordre de déposer Mme la comtesse à la place Royale, où, sous les arcades du Midi, dans un ancien rez-de-chaussée d'un hôtel abandonné, logeait maître Fingret, tapissier décorateur, tenant meubles d'occasion et autres au plus juste prix pour la vente et la location.
L'Auvergnat brouetta rapidement sa pratique de la rue Saint-Claude à la place Royale.
Dix minutes après sa sortie, la comtesse abordait aux magasins de maître Fingret, où nous allons la trouver tout à l'heure admirant et choisissant dans une espèce de pandémonium dont nous allons essayer de faire l'esquisse.
Qu'on se figure des remises d'une longueur de cinquante pieds environ sur trente de large, avec une hauteur de dix-sept; sur les murs toutes les tapisseries du règne de Henri IV et de Louis XIII; aux plafonds, dissimulés par le nombre des objets suspendus, des lustres à girandoles du XVIIème siècle heurtant les lézards empaillés, les lampes d'église et les poissons volants.
Sur le sol entassés tapis et nattes, meubles à colonnes torses, à pieds équarris, buffets de chêne sculptés, consoles Louis XV à pattes dorées, sofas couverts de damas rose ou de velours d'Utrecht, lits de repos, vastes fauteuils de cuir, comme les aimait Sully, armoires d'ébène aux panneaux en relief et aux baguettes de cuivre, tables de Boule à dessus d'émaux ou de porcelaine, trictracs, toilettes toutes garnies, commodes aux marqueteries d'instruments ou de fleurs.
Lits en bois de rose ou en chêne à estrade ou à baldaquin, rideaux de toutes formes, de tous dessins, de toutes étoffes, s'enchevêtrant, se confondant, se mariant ou se heurtant dans les pénombres de la remise.
Des clavecins, des épinettes, des harpes, des sistres sur un guéridon; le chien de Marlborough empaillé, avec des yeux d'émail.
Puis du linge de toute qualité: des robes pendues à côté d'habits de velours, des poignées d'acier, d'argent, de nacre.
Des flambeaux, des portraits d'ancêtres, des grisailles, des gravures encadrées, et toutes les imitations de Vernet, alors en vogue, de ce Vernet à qui la reine disait si gracieusement et si finement:
– Décidément, monsieur Vernet, il n'y a que vous en France pour faire la pluie et le beau temps.
Chapitre XIV
Maître Fingret
Voici tout ce qui séduisait les yeux, et par conséquent l'imagination des petites fortunes, dans les magasins de maître Fingret, place Royale.
Toutes marchandises qui n'étaient pas neuves, l'enseigne le disait loyalement, mais qui, réunies, se faisaient valoir l'une l'autre et finissaient par représenter un total beaucoup plus considérable que les marchandeurs les plus dédaigneux ne l'eussent exigé.
Mme de La Motte, une fois admise à considérer toutes ces richesses, s'aperçut seulement alors de ce qui lui manquait rue Saint-Claude.
Il lui manquait un salon pour contenir sofa, fauteuils et bergères.
Une salle à manger pour renfermer buffets, étagères et dressoirs.
Un boudoir pour renfermer les rideaux perses, les guéridons et les écrans.
Puis, enfin, ce qui lui manquait, eût-elle salon, salle à manger et boudoir, c'était l'argent pour avoir les meubles à mettre dans ce nouvel appartement.
Mais avec les tapissiers de Paris, il y a eu des transactions faciles dans toutes les époques, et nous n'avons jamais entendu dire qu'une jeune et jolie femme soit morte sur le seuil d'une porte qu'elle n'ait pas pu se faire ouvrir.
À Paris, ce qu'on n'achète point, on le loue, et ce sont les locataires en garni qui ont mis en circulation le proverbe: «Voir, c'est avoir.»
Mme de La Motte, dans l'espérance d'une location possible, après avoir pris des mesures, avisa un certain meuble de soie jaune bouton d'or qui lui plut au premier coup d'œil. Elle était brune.
Mais jamais ce meuble, composé de dix pièces, ne tiendrait au quatrième de la rue Saint-Claude.
Pour tout arranger, il fallait prendre à loyer le troisième étage, composé d'une antichambre, d'une salle à manger, d'un petit salon et d'une chambre à coucher.
De telle sorte que l'on recevrait au troisième étage les aumônes des cardinaux, et au quatrième celles des bureaux de charité, c'est-à-dire dans le luxe les aumônes des gens qui font la charité par ostentation, et dans la misère les offrandes de ces gens à préjugés qui n'aiment point à donner à ceux qui n'ont pas besoin de recevoir.
La comtesse, ayant ainsi pris son parti, tourna les yeux du côté obscur de la remise, c'est-à-dire du côté où les richesses se présentaient les plus splendides, côté des cristaux, des dorures et des glaces.