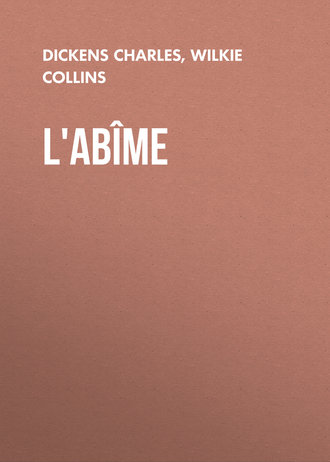 полная версия
полная версияL'abîme
Le temps passait. Les heureuses soirées auprès de Marguerite s'écoulaient trop rapidement. Dix jours après qu'il avait écrit à la maison de Suisse, Vendale, un matin, trouva la réponse sur son pupitre avec les autres lettres apportées par le courrier.
Chers Messieurs,
Nous vous présentons nos excuses pour la petite erreur dont vous vous plaignez. En même temps nous regrettons d'ajouter que les recherches dont cette erreur a été la cause nous ont amenés à une découverte inattendue, car c'est une affaire des plus graves pour vous et pour nous.
N'ayant plus de Champagne de la dernière récolte, nous prîmes des arrangements pour créditer votre maison de la valeur des dix caisses que vous savez. Alors, et pour obéir à certaines formes que nous avons l'habitude d'observer, nous nous sommes renseignés, aussi bien sur les livres de notre banquier que sur les nôtres, et nous avons été surpris d'acquérir la certitude qu'aucun payement en argent de la nature de celui dont vous nous parlez ne peut être arrivé en notre maison. Nous sommes également persuadés qu'aucun versement à notre compte n'a été fait à la Banque.
Il n'est pas nécessaire, au point où en sont les choses, de vous fatiguer par des détails inutiles. Cet argent aura sans doute été volé dans le trajet qu'il a dû parcourir pour arriver de vos mains dans les nôtres. Certaines particularités relatives à la façon dont la fraude a été commise, nous amènent à penser que le voleur peut avoir espéré se mettre en mesure de payer à nos banquiers la somme soustraite avant qu'on ne découvrit la soustraction en relevant les comptes de fin d'année. Ce relevé ne doit être fait que dans trois mois. Sans la circonstance actuelle, nous eussions pu ignorer jusqu'au bout le vol dont vous êtes les victimes.
Nous vous faisons part de ce dernier détail, qui vous démontrera que nous n'avons pas affaire à un voleur ordinaire, et nous espérons que vous voudrez bien nous aider dans les recherches que nous allons commencer, en examinant tout d'abord le reçu qui doit vous être arrivé comme émanant de notre maison et qui ne peut être qu'un faux. Ayez la bonté de vous assurer, en premier lieu, si la facture est entièrement manuscrite ou si elle est imprimée et numérotée. Dans ce dernier cas, on n'aurait eu à inscrire que le montant de la somme. Ce détail, futile en apparence, est, croyez-le, très important.
Nous attendons votre réponse avec la plus grande impatience, et demeurons avec estime et considération vos serviteurs.
Defresnier et Cie.
Vendale posa la lettre sur le bureau et attendit quelques instants pour donner à son esprit le temps de se remettre du coup qui venait de le frapper. Au moment où il était pour lui d'une si précieuse importance de voir augmenter le produit de sa maison, il perdait cinq cents livres. Ce fut à Marguerite qu'il pensa, tout en prenant une clef qui ouvrait une chambre de fer pratiquée dans la muraille, où les livres et les papiers de l'association étaient conservés. Il était encore là, cherchant ce reçu maudit, lorsqu'il tressaillit au son d'une voix qui lui parlait.
– Je vous demande pardon… J'ai peur de vous avoir dérangé.
C'était la voix d'Obenreizer.
– Je suis passé chez vous, – reprit le Suisse, – pour savoir si je ne peux vous être utile à quelque chose. Des affaires personnelles m'obligent à me rendre pour quelques jours à Manchester et à Liverpool. Voulez-vous qu'en même temps je m'y occupe des vôtres? Je suis entièrement à votre disposition, et, je puis être le voyageur de la maison Wilding et Co…
– Excusez-moi pour quelques minutes, – dit Vendale, – nous causerons tout à l'heure.
En disant cela, il continuait à fouiller les papiers et à examiner les registres.
– Vous êtes arrivé à propos, – dit-il, – les offres de l'amitié me sont plus précieuses en ce moment que jamais, car j'ai reçu ce matin de mauvaises nouvelles de Neufchâtel.
– De mauvaises nouvelles! – s'écria Obenreizer.
– De Defresnier et Cie.
– De Defresnier?..
– Oui, une somme d'argent que nous leur avons envoyée a été volée. Je suis menacé d'une perte de cinq cents livres.
– Qu'est-ce que cela? – dit Obenreizer.
Mais en rentrant dans le bureau, Vendale aperçut son buvard qui venait de tomber par terre, et Obenreizer à genoux qui en ramassait le contenu.
– Combien je suis maladroit, – s'écria le Suisse. – Cette nouvelle que vous m'avez annoncée m'a tellement surpris qu'en reculant…
Il s'intéressait si vivement à la réunion des différents papiers tombés du buvard qu'il n'acheva point sa phrase.
– Ne prenez pas tant de peine, – dit Vendale, – un commis fera cette besogne.
– Mauvaise nouvelle! – répéta Obenreizer, qui continuait à ramasser les enveloppes et les lettres, – mauvaise nouvelle!
– Si vous lisiez la missive que je viens de recevoir, – continua Vendale, – vous verriez que j'ai bien raison de m'alarmer. Tenez! elle est là, ouverte sur mon pupitre.
Quant à lui, il continua ses recherches; une minute après, il trouvait le faux reçu. C'était bien le modèle imprimé et numéroté qu'indiquait la maison Suisse. Vendale prit note du numéro et de la date. Après avoir classé le reçu et fermé la chambre de fer, il eut le loisir de remarquer Obenreizer qui lisait la lettre de Defresnier, à l'autre bout de la chambre, dans l'enfoncement de la croisée.
– Venez donc auprès du feu. Vous grelottez de froid là-bas, je vais sonner pour qu'on apporte du charbon.
Obenreizer revint lentement au pupitre.
– Marguerite sera aussi désolée de cette nouvelle que moi-même, – dit-il d'un ton amical; – qu'avez-vous l'intention de faire?
– Je suis à la discrétion de Defresnier et Cie, – répondit Vendale. – Dans l'ignorance absolue des circonstances qui ont accompagné le vol, je ne puis que faire ce qu'ils me recommandent. Le reçu que je tenais à l'instant est numéroté et imprimé. Ils paraissent attacher à ce détail une importance particulière. Pourquoi?.. Vous qui avez dû acquérir une certaine connaissance de leurs affaires, tandis que vous étiez dans leur maison, pouvez-vous me le dire?
Obenreizer réfléchit.
– Si j'examinais le reçu! – dit-il.
– Bon! – s'écria Vendale, frappé par le changement qui venait de s'opérer sur sa physionomie. – Vous sentez-vous incommodé? Encore une fois, approchez-vous donc du feu. Vous avez l'air d'être transi… Oh! j'espère que vous n'allez, pas tomber malade.
– Je ne sais, – dit Obenreizer. – Peut-être ai-je pris froid. Votre climat Anglais aurait bien fait d'épargner l'un de ses admirateurs… Mais, faites-moi voir le reçu.
Tandis que Vendale rouvrait la chambre de fer, Obenreizer prit une chaise et s'assit; il étendit ses deux mains au-dessus de la flamme.
– Ce reçu! – s'écria-t-il encore avec une vivacité extraordinaire, lorsque Vendale reparut, tenant un papier à la main.
Le portier, au même instant, entrait avec une provision de charbon de terre; son maître lui recommanda de faire un bon feu. L'homme obéit avec un empressement funeste; il fit quelques pas en avant, et tandis qu'il enlevait le seau plein de charbon, il se prit un pied dans un pli de tapis. Il trébucha, tout le contenu du seau tomba dans la grille, la flamme en fut étouffée tout net et un énorme flot de fumée jaunâtre remplit la chambre.
– Imbécile! – murmura Obenreizer en lançant sur le malheureux portier un regard, dont, après tant d'années, celui-ci se souvient encore.
– Voulez-vous venir dans le bureau des commis? – demanda Vendale. – Il y a un poêle.
– Ce n'est pas la peine.
Et il tendait la main. Et sa main tremblait.
Vendale lui donna le reçu. L'intérêt qu'Obenreizer paraissait prendre à cette affaire sembla s'éteindre aussi subitement que le feu même, dès qu'il fut le maître de ce papier. Il ne fit qu'y jeter un coup d'œil.
– Non, – dit-il, – je n'y comprends rien. Désolé de ne pouvoir vous éclairer.
– J'écrirai donc à Neufchâtel par le courrier de ce soir, – dit Vendale, en mettant le reçu de côté pour la seconde fois, – il nous faut attendre et voir ce qui arrivera.
– Par le courrier de ce soir, – répéta Obenreizer. – Voyons! vous aurez la réponse dans huit ou neuf jours. Je serai de retour auparavant. Si je puis vous être utile comme voyageur de commerce, vous me le ferez savoir. En ce cas, vous m'enverriez des instructions écrites. Mes meilleurs remerciements… Je suis très curieux de connaître la réponse de Defresnier. Qui sait? Ce n'est peut-être qu'une erreur. Courage, mon cher ami, courage.
Il n'avait point du tout l'air pressé quand il était arrivé dans la maison, et maintenant il saisissait son chapeau en toute hâte, il prit congé de l'air d'un homme qui n'a pas un instant à perdre.
Vendale se mit à marcher en réfléchissant dans les chambres.
Sa première impression sur Obenreizer s'était bien modifiée durant ce nouvel entretien, et il se demandait s'il n'avait point commis la faute de le juger trop sévèrement et trop vite. C'est qu'en vérité la surprise et les regrets du Suisse, en apprenant la fâcheuse nouvelle que la maison Wilding et Co. venait de recevoir, avaient un grand caractère de franchise. On voyait bien que ces regrets étaient honnêtement sentis, et l'expression qu'Obenreizer leur avait donnée était bien loin de la simple et banale politesse d'usage. Ayant lui-même à lutter contre des soucis personnels, souffrant peut-être des premières atteintes d'un mal grave, il n'en avait pas moins eu dans cette circonstance l'air et le ton d'un homme qui déplore du fond du cœur ce qui arrive de mal à son ami. Jusque-là, Vendale avait en vain essayé souvent de concevoir une opinion plus favorable du tuteur de Marguerite, et cela pour l'amour de Marguerite même. Mais après les témoignages d'intérêt qu'Obenreizer venait de lui donner, il n'hésitait plus à penser qu'il avait été injuste envers lui; tous les généreux instincts de sa nature lui disaient qu'il s'était arrêté trop vite à de certains indices fâcheux.
– Qui sait? – se disait-il, – je peux très bien avoir mal lu sur la physionomie de cet homme.
Le temps s'écoula de nouveau. Les heureuses soirées passées avec Marguerite s'enfuyaient plus promptes. Le dixième jour était encore une fois arrivé depuis l'envoi de la seconde lettre de Vendale à Neufchâtel. La réponse vint.
Cher Monsieur,
Notre principal associé, M. Defresnier, a été forcé de se rendre à Milan pour des affaires très urgentes. En son absence et avec son entière participation et son aveu, je vous écris de nouveau relativement à ces cinq cents livres disparues.
Votre déclaration que le faux reçu a été fait sur un modèle imprimé et numéroté nous a causé une surprise et un chagrin inexprimables. À l'époque où cette fraude a été commise, il n'existait que trois clefs ouvrant le coffre-fort où nos modèles sont renfermés. Mon associé avait une de ces clefs, j'en avais une autre, la troisième était aux mains d'une personne qui occupait alors chez nous un poste de confiance; nous aurions plutôt songé à nous accuser nous-mêmes qu'à élever aucun soupçon contre cette personne. Et cependant…
Je ne puis aller jusqu'à vous dire pour le moment qui est cette personne; je ne vous le dirai point tant que je verrai l'ombre d'une chance pour elle de se tirer avec honneur de l'enquête que nous allons commencer. Pardonnez-moi cette réserve, car le motif en est louable.
Le genre d'investigations que nous allons poursuivre est fort simple. Nous ferons comparer notre reçu par des experts avec quelques spécimens d'écriture que nous avons en notre possession. Je ne puis vous adresser ces spécimens pour de certaines raisons que vous approuverez certainement lorsqu'elles vous seront connues. Je vous prie donc de m'envoyer le reçu à Neufchâtel; et je fais suivre cette prière de quelques mots indispensables pour vous mettre sur vos gardes.
Si la personne sur laquelle, nous faisons à regret placer nos soupçons est réellement celle qui a commis le faux, nous avons quelque motif de craindre que de certaines circonstances ne lui aient déjà donné l'éveil. La seule preuve contre cette personne est le reçu qui est dans vos mains; elle remuera ciel et terre pour l'obtenir de vous et la détruire. Je vous prie donc instamment de ne pas confier cette pièce à la poste. Envoyez-la-moi sans perdre de temps par un messager particulier et ne choisissez ce messager que parmi les gens qui sont depuis longtemps à votre service. Il faut aussi que ce soit un homme accoutumé aux voyages, parlant bien le Français, un homme courageux, et un honnête homme. Vous devez le connaître assez bien pour ne pas craindre qu'il se laisse aller en route à aucun étranger cherchant à lier connaissance avec lui. Ne dîtes qu'à lui, à lui seul la nature de cette affaire et la tournure qu'elle va prendre. Je vous engage à suivre l'interprétation littérale de tous ces avis que je vous donne, convaincu que l'arrivée à bon port du faux reçu en dépend.
Je n'ai plus à ajouter qu'une chose. C'est que votre promptitude à agir est de la plus haute importance. Il nous manque plusieurs de nos modèles de reçus et nous ne pouvons prévoir quelles fraudes seront commises, si nous ne mettons la main sur le voleur!
Votre dévoué serviteur,
Pour Defresnier et Cie,
RollandQuel était donc celui qu'on soupçonnait?
Vendale pensa qu'il chercherait inutilement à le deviner. Mais qui pouvait-il bien envoyer à Neufchâtel avec le reçu? Certes il n'était pas difficile de trouver au Carrefour des Écloppés un homme courageux et honnête. Mais où était l'homme accoutumé aux voyages, parlant le Français, et sur qui l'on pourrait réellement compter pour tenir à distance tout étranger qui voudrait lier connaissance avec lui pendant la route? Vendale n'avait réellement qu'un seul compagnon sous la main, qui réunit toutes les conditions dans sa personne. C'était lui-même.
Un grand sacrifice sans doute que de quitter sa maison, un plus grand sacrifice encore que de quitter Marguerite. Mais après tout, il s'agissait de cinq cents livres et Rolland insistait si positivement sur l'interprétation littérale des démarches par lui conseillées, qu'il ne fallait point hésiter à lui obéir. Plus Vendale réfléchissait, plus la nécessité de son départ lui apparaissait clairement.
– Partons!.. – soupira-t-il.
Comme il remettait le reçu et la nouvelle lettre sous clef, certaine association d'idée lui vint qui lui rappela Obenreizer. Il pensa qu'avec l'aide de celui-ci, il lui deviendrait bien plus facile de deviner quel pouvait être le voleur; Obenreizer pouvait le lui faire connaître.
Cette pensée avait à peine traversé son esprit que la porte s'ouvrit et qu'Obenreizer entra.
– On m'a dit dans Soho Square qu'on attendait votre retour dans la soirée d'hier, – lui dit Vendale en lui souhaitant la bienvenue. – Avez-vous fait de bonnes affaires en province?.. Êtes-vous mieux portant?
– Mille grâces, – répondit Obenreizer, – j'ai fait admirablement mes affaires. – Je suis bien!.. très bien!.. Et maintenant, quelles nouvelles? Avez-vous des lettres de Suisse?
– Une lettre bien extraordinaire, – dit Vendale, – L'affaire a pris une tournure nouvelle, et l'on me recommande de Neufchâtel le plus profond secret sur les mesures que nous allons adopter. Ce secret doit être gardé vis-à-vis de tout le monde.
– Sans en excepter personne? – demanda Obenreizer.
Et tout en répétant: «Personne,» il se retira d'un air pensif du côté de la croisée, à l'autre bout de la chambre, regarda pendant un moment dans la rue; puis tout à coup, revenant à Vendale.
– Sûrement, ils ont perdu la mémoire, – dit-il, – puisqu'ils ne font pas même une exception en ma faveur.
– C'est Rolland qui m'écrit, – répliqua Vendale, – comme vous le dites, il doit avoir perdu la mémoire. Ce côté de l'affaire m'échappait complètement. Je souhaitais de vous voir et de vous consulter au moment même où vous êtes entré. Je suis pourtant lié par une défense formelle, mais je ne puis croire qu'elle vous concerne. Tout cela est bien fâcheux.
Les yeux d'Obenreizer, couverts de leur nuage, se fixèrent sur Vendale.
– Peut-être est-ce bien plus que fâcheux, – dit-il. – Je suis venu ce matin, non seulement pour avoir des nouvelles, mais pour m'offrir à vous comme intermédiaire ou comme messager. Le croirez-vous? J'ai reçu des lettres qui m'obligent à me rendre en Suisse sans tarder. J'aurais pu me charger des pièces et documents de cette affaire et les remettre à Defresnier.
– Vous êtes bien l'homme qu'il me fallait, – fit Vendale. – Il n'y a pas cinq minutes que cherchant autour de moi et ne trouvant personne qui pût me remplacer dans le voyage, j'avais résolu de l'entreprendre moi-même… Laissez-moi relire cette lettre.
Il ouvrit la chambre de fer pour y reprendre la lettre. Obenreizer jeta un coup d'œil rapide autour de lui pour bien s'assurer qu'ils étaient seuls, le suivit à deux pas de distance, et sembla le mesurer du regard. Vraiment, Vendale était plus grand que lui et sans doute plus fort. Obenreizer recula et s'approcha de la cheminée.
Vendale pendant ce temps, lisait pour la troisième fois le dernier paragraphe de la lettre. Il y avait là un avis très clair et la dernière phrase demandait au jeune négociant de suivre cet avis à la lettre.
D'un côté une grosse somme d'argent en jeu, de l'autre un terrible soupçon à éclaircir. Vendale comprit que s'il agissait à sa guise et si quelque événement arrivait ensuite et déjouait toutes les mesures prises, la faute lui en serait imputée, le blâme retomberait sur lui seul. En sa qualité d'homme d'affaires, il n'avait vraiment qu'un parti à suivre. Il remit la lettre sous clef.
– Quel ennui! – dit-il à Obenreizer. – Il y a sans doute ici de la part de Rolland un oubli inconcevable et qui me met dans une sotte et fausse position vis-à-vis de vous. Que dois-je faire? Il me semble qu'ayant un si grand intérêt dans cette fâcheuse aventure dont j'ignore tous les détails, je n'ai pas la liberté de ne pas obéir aux injonctions de mon correspondant et que je dois au contraire m'y conformer sans résistance. Vous me comprendrez certainement. Vous me voyez esclave des ordres que je reçois, et je ne peux assez vous dire combien j'aurais été heureux, en cette occasion, d'accepter vos services…
– N'en parlons plus, – dit Obenreizer. – À votre place, je n'agirais pas différemment. Je ne suis donc point du tout offensé de votre conduite, et je vous remercie pour le compliment que vous me faites… Bah! nous serons au moins compagnons de voyage. Vous partez avec moi aujourd'hui même.
– Aujourd'hui. Mais il faut, cela va sans dire, que je voie Marguerite.
– Assurément. Voyez-la ce soir. Vous me prendrez au passage et nous nous rendrons ensemble au chemin de fer. Nous partirons à huit heures par le train poste.
– Par le train poste, – dit Vendale.
Il était plus tard que Vendale ne le croyait, lorsqu'il arriva à la maison de Soho Square. Les affaires suscitées par ce départ précipité avaient surgi devant lui par douzaines. Toutes sortes d'obligations qu'il ne pouvait négliger le forcèrent de se résigner à cette cruelle perte d'un temps si court et si précieux qu'il voulait consacrer à Marguerite. À sa grande surprise et à son extrême joie, elle était seule dans le salon lorsqu'il entra.
– Nous n'avons que peu d'instants à nous, George – dit-elle, – mais grâce à la bonté de Madame Dor nous pouvons au moins les passer tous deux seuls ensemble.
Elle lui jeta les bras autour du cou.
– George, – lui dit-elle tout bas, – avez-vous fait quelque chose qui ait pu blesser Monsieur Obenreizer?
– Moi! – s'écria Vendale stupéfait.
– Taisez-vous, – dit-elle, – il faut que je vous parle bien bas. Rappelez-vous le petit portrait photographié que vous m'avez donné? Cette après-midi, je ne sais comment il le trouva sur la cheminée. Il le prit, le regarda, et moi, je voyais son visage dans ce miroir… Ah! je suis sûre que vous l'avez offensé. Il est vindicatif, implacable, et aussi muet qu'une tombe. Ne partez pas avec lui… George… ne partez pas!
– Mon cher amour, – répondit Vendale, – vous vous laissez égarer par votre imagination. Jamais Obenreizer et moi n'avons été meilleurs amis qu'à présent.
Avant que Marguerite n'eût pu répondre, un pas sonore et le poids d'un corps majestueux firent trembler le parquet de la pièce voisine, et Madame Dor apparut.
– Obenreizer, – dit-elle.
Puis elle se laissa tomber lourdement sur une chaise, à sa place ordinaire, devant le poêle.
Obenreizer entra avec un sac de courrier qu'il portait en bandoulière.
– Êtes-vous prêt? – demanda-t-il à Vendale – Puis-je porter quelque chose pour vous?.. Eh quoi! n'avez-vous point un sac de voyage? Je viens d'en acheter un. Regardez. Ici est la poche aux papiers. Elle est à votre service.
– Je vous remercie, – dit Vendale, – je n'ai qu'un seul papier important, je suis forcé de ne pas m'en dessaisir et il est là, il doit rester là, jusqu'à ce que nous arrivions à Neufchâtel.
Vendale, en même temps, touchait la poche de son habit. Il sentit la main de Marguerite qui pressait la sienne. La jeune fille examinait Obenreizer jusqu'au fond de l'âme. Mais déjà celui-ci s'était retourné vers Madame Dor, et prenait congé de la bonne dame.
– Adieu, ma chère Marguerite, – s'écria t-il en revenant vers sa pupille pâle et épouvantée. – Allons, Vendale, êtes-vous prêt, enfin? En route! En route! mon ami, pour Neufchâtel!
Il frappa légèrement Vendale à la poitrine, à la place où était la poche qui contenait le reçu et sortit le premier.
Le dernier regard de Vendale fut pour Marguerite.
Les derniers mots de la jeune fille furent ceux-ci:
– Ne partez pas!
TROISIÈME ACTE
Dans la vallée
On était alors au milieu du mois de Février, l'hiver était des plus rigoureux et les chemins mauvais pour les voyageurs, si mauvais qu'en arrivant à Strasbourg, Vendale et Obenreizer trouvèrent les meilleurs hôtels absolument vides. Les quelques personnes qu'ils avaient rencontrées en route et qui se rendaient pour affaires dans l'intérieur de la Suisse renonçaient à leur voyage et revenaient sur leurs pas.
Les chemins de fer qui conduisent aujourd'hui les touristes dans ce beau pays étaient encore en ce temps-là pour la plupart inachevés. Les lignes exploitées, semées d'ornières profondes, étaient impraticables, et partout l'hiver avait interrompu les communications. Partout on n'entendait qu'histoires de voyageurs arrêtés en chemin par des accidents dont on exagérait la gravité, sans doute. Cependant, comme la voie de Bâle restait libre, la résolution de Vendale de poursuivre sa route n'en fut nullement troublée.
Quant à la résolution d'Obenreizer, elle fut la même que celle de Vendale.
Il se voyait aux abois, désespéré, perdu, il lui fallait à tout prix anéantir la preuve que Vendale portait avec lui, dût-il pour cela anéantir Vendale lui-même!
Menacé d'une ruine certaine, enfermé dans un cercle que l'activité de Vendale resserrait d'heure en heure autour de lui, Obenreizer haïssait son compagnon avec la férocité d'une bête fauve. De tout temps il avait nourri de mauvaises pensées contre le jeune négociant. Était-ce la sourde rancune du paysan contre le gentleman? Était-ce le contraste de sa nature avec cette nature franche et généreuse? Était-ce la beauté de Vendale? Était-ce le bonheur qu'il avait eu de se faire aimer de Marguerite? Étaient-ce toutes ces causes réunies ensemble? Il le haïssait, il l'avait haï dès qu'il l'avait vu. À présent, il le regardait comme celui qui le conduisait à sa perte. Et cette pensée redoublait la fureur de sa haine.
Vendale, au contraire, qui, si souvent, avait lutté contre lui-même pour se défendre de cette instinctive et vague méfiance qu'Obenreizer lui avait inspirée si longtemps, se regardait à présent comme obligé d'effacer de son esprit jusqu'à la trace de ce sentiment involontaire. Il se disait qu'Obenreizer était le tuteur de Marguerite, qu'il vivait avec lui désormais dans les termes d'une amitié véritable, que c'était lui qui, de son plein gré, avait voulu être son compagnon de route sans avoir aucun motif intéressé à partager les fatigues et les dangers d'un tel voyage…
À toutes ces raisons, qui plaidaient si fortement en faveur d'Obenreizer, le hasard vint en ajouter une autre, lorsqu'ils arrivèrent à Bâle, après un trajet deux fois plus long que de coutume.
Ils avaient fini de dîner fort tard, et ils étaient seuls dans une chambre d'auberge. Le Rhin coulait au pied de la maison, profond, rapide, bruyant, grossi par les neiges. Vendale était nonchalamment étendu sur un canapé. Obenreizer marchait de long en large, s'arrêtait par moment devant la fenêtre, regardait, dans les eaux noires, le reflet tortueux des feux de la ville et peut-être se disait-il:









