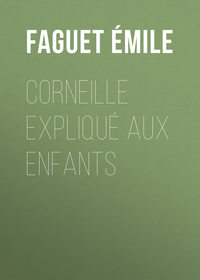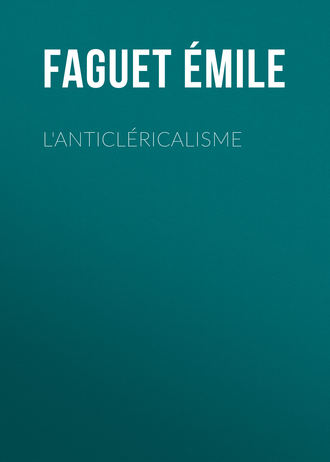
Полная версия
L'Anticléricalisme
Il vit à court terme, d'une vie énergique, parfois «intense»; mais comme saccadée et à brèves étapes. «Les Français, a dit Napoléon, sont des machines nerveuses.» Il n'y a rien, à ce qu'il peut paraître, de moins nerveux que l'éternel. Le Français et le divin ne sont évidemment pas très bien faits pour s'entendre. Je ne sais plus si Sainte-Beuve a dit de son cru ou dit en citant quelqu'un: «Dieu n'est pas français.» Il y a du vrai.
Aussi bien, voyez comme ils comprennent Dieu quand ils le font, j'entends quand ils ne le reçoivent pas, quand ils n'en reçoivent pas l'idée toute faite d'une religion antérieure, antique, qu'ils ont acceptée; mais quand, libres de tout lien dogmatique et affranchis de toute pensée traditionnelle et héritée, ils se font un Dieu à leur guise et à leur gré. Pour Montesquieu Dieu est la plus froide des abstractions. C'est la Loi des Lois, c'est l'esprit des Lois, je l'ai dit sans aucune plaisanterie; c'est «la raison primitive… qui agit selon les règles qu'elle a faites, qui les connaît parce qu'elle les a faites et qui les a faites parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance»; c'est la Loi des Lois, intelligente, personnelle – personnelle autant qu'il faut l'être pour être intelligente; – mais rien de plus. Le Dieu de Montesquieu est un Dieu personnel qui est à peine une personne. Il n'y a pas un atome de sentiment religieux dans la religion de Montesquieu.
Pour Voltaire Dieu est un Lieutenant surnaturel de police, dont il a besoin pour que «la canaille» soit maintenue dans une crainte salutaire et pour que M. de Voltaire ne soit pas assassiné par ses domestiques.
Pour Rousseau, quoique Rousseau ait quelques traits vagues d'une âme religieuse, Dieu est, comme pour Voltaire, en dernière analyse, une idée qui importe à la conservation de l'état social et que l'État doit imposer par la force aux citoyens; Dieu est un article important du Contrat social.
Et enfin, pour Diderot, Dieu n'existe pas et n'est qu'une invention de ces sophistes oppresseurs, qui, pour dominer l'homme, ont créé un «homme artificiel».
Voilà comme les Français, quand ils sont dégagés de la trame des liens traditionnels, inventent Dieu, conçoivent Dieu. Ils l'inventent, ils le conçoivent de la façon la plus superficielle du monde. Le profond sentiment religieux leur est à peu près inconnu.
Je n'ai pas besoin, ou à peine, de dire que les réactions religieuses (toujours mis à part la religion traditionnelle et le domaine où elle agit et l'empire qu'elle exerce, et ici comme plus haut je ne parle que des Français inventant Dieu) sont aussi superficielles que les théodicées philosophiques. Les poètes qui, de 1802 à 1850, ont exprimé des idées religieuses, ont fait preuve d'un sentiment religieux extrêmement inconsistant et débile. Tous ont été frappés des «beautés» de la religion, et non de sa grandeur, et non du besoin, en quelque sorte, constitutionnel, que l'homme en a. Eux-mêmes semblent en avoir eu besoin pour leurs œuvres et non pour leurs cœurs. La religion fut pour eux un excellent répertoire de thèmes poétiques. Leur génie fut plus religieux que leur cœur, et même ce fut leur art qui fut plus religieux que leur génie. Musset, peut-être seul, et un seul jour, eut un cri où se sent le véritable, profond, absolument sincère sentiment religieux, ou besoin de sentiment religieux. – La légèreté française, même chez les plus grands Français, est décidément un obstacle assez fort à la pénétration du sentiment religieux; et l'état d'âme religieux n'est chose française que par exception et par accident.
Outre le besoin de clarté apparente ou de clarté provisoire, outre la légèreté d'esprit, la vanité, très répandue chez les Français, ne va pas sans les écarter beaucoup des voies religieuses ou des chemins qui pourraient mener à la religion.
La vanité française est chose très différente de l'orgueil tel qu'on le peut voir et constater dans d'autres nations. L'orgueil est national et la vanité est individuelle. L'Anglais, l'Allemand, l'Américain sont extrêmement orgueilleux; mais ils le sont surtout d'être américains, allemands et anglais. L'orgueil est volontiers collectif et, à être collectif, il est une force plutôt qu'une faiblesse. L'orgueil sous sa forme française, c'est à savoir la vanité, est tout à fait individualiste. Le Français s'admire en soi, de tout son cœur. Il se fait centre naturellement et se persuade très volontiers que la circonférence doit l'admirer.
Les mots d'enfants recueillis par Taine sont bien à leur place ici: une petite fille à son oncle qui lui demande ce qu'elle est en train de faire: «Ouvre les yeux, mon oncle, tu le verras.» Elle n'est pas fâchée d'indiquer à son oncle qu'elle le considère comme un imbécile. – Une autre enfant remarque entre son père et elle-même un trait de ressemblance: «Tu tiens de moi.» Elle rapporte déjà tout à elle et a tendance naturelle à se tenir pour une cause et non pour un effet.
Tout vieux professeur a remarqué des inclinations toutes pareilles chez les jeunes Français. Ils n'ont presque aucune méchanceté; mais leur amour-propre est immensurable. Deux traits essentiels: ils sont moqueurs et ils ne peuvent supporter la moquerie. C'est la vanité sous ses deux aspects. Ils se vantent à tout propos, ou, plus avertis, laissent seulement voir qu'ils se tiennent en haute estime. Tout petits, ils cherchent continuellement à attirer l'attention et ils semblent ne vivre que de l'attention qu'ils veulent attirer et ne vivre que quand ils l'attirent. Si parmi eux il en est un qui semble vivre d'une vie intérieure, qui soit réfléchi et méditatif et ne soit pas toujours comme en scène, il est traité de «sournois».
Plus tard, adolescent, jeune homme, le Français, très souvent, est proprement insupportable. Il semble toujours avoir conquis le monde ou être sur le point de le conquérir, pourvu qu'il le veuille et qu'il fasse un geste pour cela. Il est tranchant, décisif et décisionnaire. Son opinion est la seule opinion qu'il considère et qui soit digne de considération. Il s'étonne qu'il puisse y en avoir une autre et qu'on fasse quelque attention à celles qu'il n'a pas. Surtout il croit toujours avoir inventé les idées qu'il a ou qu'il pense avoir. Il expose des opinions très connues comme des découvertes qu'il vient de faire et qui attendaient sa venue au monde pour y paraître elles-mêmes. Tout au plus, il associe un nom célèbre au sien, non pas comme le nom d'un maître à celui d'un disciple, mais comme celui d'un égal à celui d'un égal. Il dit: «Comte et moi.» Il dit: «Renan et moi.» Se mettre de pair avec un grand homme est jusqu'où sa modestie puisse atteindre.
Tout jeune Français a inventé une philosophie, créé un art nouveau et improvisé un genre littéraire qui était inconnu.
C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de peuple au monde, excepté peut-être le peuple grec, où il y ait autant de déclassés. Le déclassé est un homme qui se sent tellement né pour les grandes choses qu'il ne peut prendre sur lui de faire les petites ou les moyennes. Reste qu'il ne fait rien et traîne d'expédients en expédients en rêvant toujours des grands rôles auxquels il était destiné et que les circonstances l'ont empêché de jouer. La France contient beaucoup de ces dévoyés qu'un peu de connaissance de soi aurait préservés.
On s'étonne qu'il n'y en ait pas davantage; car tous les Français, à bien peu près, sont terriblement vains. Mais il faut reconnaître que, tout à côté de leur vanité, ils ont un certain sens pratique. S'ils ne se rendent pas compte d'eux-mêmes, ils se rendent assez bien compte des choses. Ils reconnaissent qu'il faut se résigner à la médiocrité de situation, tout en gardant la haute opinion de soi-même, qui console et qui réconforte. «Le mérite console de tout», disait Montesquieu. C'est la devise de la plupart des bourgeois français.
De là tant de petits employés qui sont des poètes et qui lisent leurs vers en famille et à leurs amis, en se disant qu'il ne leur a manqué que quelque loisir et une petite fortune indépendante pour être des Lamartine; qui ont un système politique et toute une sociologie et qui gémissent de l'obscurité où ce système reste enseveli avec eux; qui font des romans et des pièces de théâtre et poursuivent toute leur vie le rêve d'être imprimés ou d'être joués; du reste, ponctuels à leur bureau, sinon zélés, et acceptant en maugréant, mais relativement avec patience, la vie terne que l'injuste destin leur a faite. La France est pleine de grands hommes inconnus de tous, mais très manifestes à eux-mêmes, que le silence accable, et de très honnêtes petits employés des contributions indirectes qui se répètent sans cesse à eux-mêmes: «Qualis artifex pereo!»
Peut-être cela ne va-t-il point sans quelque inconvénient pour le métier que ces honnêtes gens exercent et les fonctions que l'État leur confie, et ce serait un point à considérer, mais qui nous écarterait de notre sujet.
Pour n'en point sortir, considérez et ces hommes dont leur vanité fait des déclassés, ou des demi-déclassés, ou des inquiets et des neurasthéniques, légion qui en France est une armée; et ces autres hommes, moins privés du sens du réel et qui, à cause de cela, se classent, mais tout aussi vains, tout aussi prétentieux, tout aussi enivrés de sens propre; et voyez, au point de vue religieux, ce qu'ils peuvent être.
Ils ont comme une tendance instinctive à repousser ce sentiment. Le sentiment religieux en général, le christianisme en particulier, le catholicisme plus particulièrement encore, est avant tout humilité. Il est avant tout reconnaissance et confession du peu que nous sommes pour connaître et pour agir. Et, pour ce qui est de la connaissance et pour suppléer à notre impuissance en cet ordre, les religions ont inventé la révélation. Et pour ce qui est de l'action et pour suppléer à notre débilité en cette matière, elles ont inventé la grâce. L'acte d'humilité est la première démarche religieuse; le premier mot de l'homme qui est attiré vers Dieu est: «Ma substance n'est rien devant vous.»
Si l'humilité est le principe de toute religion, nos Français sont bien peu nés pour être religieux, et la religion, comme l'a très bien vu Pascal, est quelque chose comme leur ennemie personnelle. Ils la voient comme un personnage doucement ironique qui rabat leur superbe et qui se moque de leurs prétentions. Chacun la voit comme quelqu'un qui lui dirait: «Votre plus cher entretien est de vous croire quelque chose et vous n'êtes rien du tout.» Le Français est l'être du monde entier qui aime le moins qu'on lui dise cela. Contester à un Français sa puissance de savoir, de connaître et de décider, cela, pour lui, ne se peut souffrir. Lui contester son infaillibilité, dont, au fond, et même quand il évite de la proclamer, il est toujours convaincu, cela ne vous fait pas de lui un ami. Tout Français est un Voltaire ou un Rousseau, moins le génie, qui n'est pas loin de croire qu'il est impossible qu'il n'ait pas toujours raison, qui n'est pas loin d'estimer que les autres hommes sont imbéciles dans la proportion où ils le contredisent et qu'il n'y a besoin ni d'autre signe ni d'autre mesure.
La religion, selon cette façon de juger, ne peut qu'avoir tort. Ils l'accusent à la fois de présomption et de bassesse, de superbe et de lâcheté. De superbe, parce qu'elle prétend imposer ses décisions; de lâcheté parce que, si elle nie chez les autres la capacité de connaître, elle se la refuse à elle-même et ne se croit en possession de la vérité que parce que celle-ci lui a été révélée. Rien ne peut être à la fois plus insupportable à la vanité du Français et plus propre à exciter sa raillerie, pleine de vanité encore, que cette double formule: «Vous ne savez rien et êtes incapable de rien savoir; et, du reste, nous sommes exactement dans les mêmes conditions».
Il y a beaucoup d'analogie entre la situation de l'Église en face des Français et celle de Socrate en face des Athéniens: «Je sais que je ne sais rien, disait Socrate; et vous, vous ne savez rien en croyant savoir quelque chose.»
«Fausse humilité, répondaient les Athéniens, pour ce qui est de ce que tu dis de toi-même; insolence pour ce qui est de ce que tu dis de nous. Et dans ton humilité, insolence encore, car tu ne dis que tu ne sais rien que pour faire entendre à quel point nous sommes vains de croire savoir quelque chose quand Socrate ne sait rien et confesse ne rien savoir.»
De même le Français en veut autant à l'Eglise de sa négation du savoir humain qui le blesse, que de son humilité qui elle-même l'humilie. Vanité française et humilité ecclésiastique, que cette humilité soit par l'Église commandée aux autres ou qu'elle soit pratiquée par elle, ne peuvent faire bon ménage ensemble.
Remarquez, comme j'en ai déjà dit quelque chose, que l'orgueil est plus compatible avec la religion que la vanité, pour cette simple raison que la vanité est individuelle et que l'orgueil peut être collectif. C'est même ici la vraie distinction, ou l'une au moins des vraies distinctions entre ces deux sentiments. Sans doute, l'orgueil opposé à la vanité, c'est surtout un sentiment puissant opposé à un sentiment mesquin: l'orgueil est une exaltation, la vanité est une démangeaison; l'orgueil est une grandeur fausse, la vanité est une petitesse; l'orgueil ne se satisfait que des grands succès et dédaigne les médiocres jouissances, la vanité se repaît de tout et ne dédaigne rien; l'orgueil n'atteint jamais son but, tant il le met haut; la vanité, quoique insatiable, atteint ou manque son but tous les jours et presque à chaque heure, le mettant partout.
Tout cela est vrai; mais on n'a pas assez remarqué qu'une des distinctions, et très considérable et très significative, entre l'orgueil et la vanité, c'est que la vanité est individuelle et que l'orgueil peut être collectif. Il est souvent individuel lui-même, mais il peut être collectif. La vanité ne peut être qu'individuelle. Elle consiste à vouloir se distinguer, à tous moments et par toutes sortes de choses, de tous les autres, et à montrer que l'on est un être tout particulièrement privilégié. Elle est individuelle par définition. Elle n'est même que l'individualisme lui-même, qu'un individualisme enfantin et naïf. Elle dit sans cesse: «Moi… Moi, au contraire… Tandis que moi…» L'orgueil souvent dit: «Moi.» Mais il peut dire: «Nous.» C'est une sensible différence.
L'orgueil peut se satisfaire et presque se remplir dans la contemplation d'une grande œuvre accomplie en commun. L'orgueil romain fut collectif; l'orgueil anglais, l'orgueil allemand sont collectifs. On ne peut guère dire: «la vanité nationale», et l'on dit très bien: «l'orgueil national». L'orgueil ne fait jamais abstraction du moi; mais, précisément parce qu'il est un sentiment grand et fort, il peut sentir le moi s'exprimer, se déployer et triompher dans une grande œuvre faite à plusieurs. L'homme vain dit: «Moi.» L'orgueilleux peut très bien dire: «civis romanus sum», ou: «je suis anglais; je suis allemand», et trouver à le dire une immense satisfaction de son orgueil même.
Un des phénomènes de l'histoire de France est précisément ceci que certains hommes ont trouvé le moyen de transformer la vanité des Français en orgueil: Louis XIV, Napoléon. Sous l'empire de l'un et de l'autre, le Français a cessé d'être vain pour devenir orgueilleux. Il a confondu sa personnalité dans l'ensemble de la communauté française; et, dans les succès et dans la grandeur de cette communauté, il s'est enorgueilli de telle sorte qu'il a presque oublié les sollicitations de sa vanité individuelle. – Mais ceci n'est, pour ainsi parler, que de l'orgueil intermittent. Le véritable orgueil n'a pas besoin du succès et de la gloire pour être entier, pour être sans défaillance et pour être actif. Aux heures de deuil et même d'écrasement, il demeure ferme, et conçoit et il prépare les revanches, les relèvements et les restaurations futures. La vanité française ne devient orgueil collectif qu'assez rarement et sous l'impulsion d'une volonté puissante et dans l'exaltation d'une grande gloire acquise. A l'état normal, elle est simplement vanité individuelle.
Or, c'est la vanité qui est incompatible avec la religion et non pas l'orgueil; ou la vanité est beaucoup plus incompatible que l'orgueil avec la religion. L'orgueil, sans doute, peut mépriser la religion, et ce n'est pas à tort que la religion a fait de l'orgueil un péché; mais la vanité la méprise bien plus encore, ou se sent beaucoup plus atteinte et mortellement blessée par elle. L'orgueil peut s'accommoder de cette œuvre collective qu'est la religion et même y trouver son compte et sa satisfaction. On peut être fier d'être chrétien, comme on est fier d'être romain, ou comme on est fier d'être anglais ou allemand. On peut être fier d'appartenir à une institution qui a transformé l'humanité. On peut être fier d'appartenir à une collectivité qui a comme substitué un genre humain à un autre genre humain. Personne n'ignore que l'orgueil, s'il est qualifié de péché par l'Église, est précisément un péché très ecclésiastique. – Mais comment veut-on que la vanité puisse supporter la religion? Elle consiste précisément à repousser tout ce qui est collectif; elle consiste précisément en ceci qu'un homme est secrètement convaincu «qu'il n'y a que lui». Elle consiste à se traiter intimement d'excellence et d'éminence. Elle consiste à ne guère admettre qu'un autre que vous puisse avoir complètement raison, ou qu'un autre que vous réalise pleinement en lui l'humanité.
Tout ce qui est collectif répugne donc comme naturellement à l'homme vain. Il en serait plutôt comme jaloux. Il voit en une collectivité des hommes qui, contrairement à lui, font abstraction de leur personnalité; et différence engendre haine. Il voit en une collectivité des gens, aussi, qui, par la force que donne l'union, peuvent l'offusquer, lui, et l'éclipser, et il en prend ombrage; et jalousie engendre haine.
L'homme vain est donc anticollectif par définition, et, par parenthèse, le furieux individualisme des Français qui les rend ennemis de toute caste, de toute classe, de toute corporation, n'est qu'une forme de leur vanité. Or, si le Français, de par sa vanité, est déjà ennemi de toute collectivité, dans quels sentiments voulez-vous qu'il soit à l'égard d'une collectivité qui, d'abord est une collectivité, et qui ensuite est une collectivité qui recommande et commande l'humilité comme la première des vertus humaines? Non, il est très difficile que l'homme vain soit religieux; et il est très facile que l'homme vain soit ennemi de la religion, ou, tout au moins, ait à son égard quelque impatience.
Ce qui suit n'est qu'un autre aspect de ce qui précède et n'est, au fond, qu'à très peu près la même chose. Pour ces mêmes raisons de vanité et de fanfaronnade, le Français a horreur de la tradition. Que quelque chose, institution, loi, maxime publique, mœurs, idée généralement répandue, ait régné jusqu'au jour où il naît, et semble avoir fait la grandeur de sa nation ou y avoir contribué, ce lui est une raison pour n'y pas tenir et pour la repousser instinctivement plus ou moins fort. Il y a des peuples pour qui le mot «antiquité» a un grand prestige; pour le Français «antiquité» est «vieillerie», et vieillerie est ridicule et absurdité.
Pour beaucoup de Français, la nouveauté d'une idée est preuve qu'elle est juste. Une idée vraie, c'est une idée nouvelle: il ne faut pas chercher davantage: le criterium est aisé. La plupart des Français sont parfaitement convaincus que l'on n'a commencé à faire usage de la raison qu'à dater du moment où ils ont eu dix-huit ou vingt ans et que tout ce qui a précédé cette époque ne fut que ténèbres. C'est une illusion assez naturelle à la jeunesse, et qui même ne laisse pas d'avoir sa part d'utilité; mais c'est une illusion assez forte cependant, et qui a, somme toute, plus d'inconvénients que d'avantages.
Il en résulte une chose que l'on n'a peut-être pas assez remarquée: c'est l'effet tout particulier que l'éducation a en France. L'éducation, en France, a pour effet de convaincre la génération éduquée juste à l'inverse de la génération éducatrice; de suggérer à la génération éduquée toutes les idées contraires à celles de la génération éducatrice. Le mépris des fils pour les pères et des élèves pour les maîtres est, en France, très général, et il semble très légitime. Ceux-là ne sont-ils pas jeunes et ceux-ci ne sont-ils pas vieux? Que faut-il davantage?
Tout n'est pas mauvais en cela; car il faut certainement que chaque génération cherche par elle-même et ne s'endorme pas sur la parole d'autrui; et ce n'est pas sans quelque raison, forme paradoxale mise à part, qu'un père me disait: «Oui, les enfants méprisent les pères: c'est providentiel.» Mais il faudrait que cet esprit d'indépendance ne fût pas accompagné d'une grande légèreté, d'une grande vanité, ou plutôt n'eût pas légèreté et vanité pour ses sources mêmes.
Toujours est-il que les choses vont ainsi; et tout père français peut être sûr que son fils a pour lui une douce pitié, tempérée par un assez faible respect; et tout professeur français peut croire aux mêmes sentiments chez ses élèves, chez ceux, du moins, de ses élèves qui n'ont pas pour lui une complète indifférence.
La nation entière a un peu le même caractère, et voici pourquoi. Si l'amour des nouveautés paradoxales n'était qu'une maladie de jeunesse dont chacun guérit vers la trentaine, il n'en serait que cela, et le corps même de la nation resterait sain et resterait ferme dans des idées générales traditionnelles qui feraient sa force morale et sa vigueur intellectuelle. Mais l'empêchement à cela, c'est que le Français n'a pas de passion plus violente que celle qui consiste à ne point vouloir paraître vieux, et à ne point s'avouer qu'il le soit. Il en résulte que les idées des jeunes gens, ces idées qu'ils se sont données en prenant juste le contrepied des idées de leurs pères, leurs pères eux-mêmes les prennent à leur tour, gauchement, maladroitement, lourdement; mais enfin ils les prennent, en tout ou en partie, pour ne point paraître démodés, surannés et tout encombrés de «vieilleries». – «Nous aussi, nous sommes modernes. Nous aussi, nous marchons avec notre temps.» Ils marchent, si suivre peut s'appeler marcher.
C'est ainsi que, même sans souci de popularité, même sans souci de rester en bons termes avec les gouvernements nouveaux et de se tenir toujours du côté du manche, même sans tout cela, tel vieux brave homme de 1906 exprimera, étalera en ses propos un mélange prodigieux de ses idées de 1869, de ses idées de 1872 et de ses idées, pour ainsi parler, de 1906, et offrira aux regards une synthèse bizarre de Duruy, de Gambetta, de Jules Ferry et de M. Jaurès. Je rencontre un brave homme de ce genre, plus ou moins éloquent, plus ou moins spécieux, plus ou moins brillant, et, mon Dieu, toujours aussi sincère, ou à peu près, toutes les fois que je me promène. Cela est si délicieux de ne point vieillir, de croire que l'on ne vieillit pas et de croire persuader aux autres qu'on ne vieillit point! Presque tout Français de soixante ans est un vieux beau qui suit la mode, qui en a le respect et aussi comme une espèce de terreur, et qui serait désespéré si l'on pouvait soupçonner qu'il n'est plus homme à la comprendre.
C'est ainsi que, chez d'autres, chez les outranciers et les inquiets et les nerveux, le désir de n'être pas dépassés va jusqu'à être plus avancés, non seulement qu'ils n'ont jamais été dans leur jeunesse, mais que ne sont même les jeunes gens qui les entourent et dont ils veulent passionnément être entourés toujours. Ils voudraient les effrayer par leur jeunesse. Ils multiplient les audaces, les témérités et les bravades. Ils sont iconoclastes avec une frénésie croissante. Ils brisent davantage à mesure qu'ils ont les mains plus faibles. De ceux-ci la ligne de vie est assez bizarre. Ils ont été sages et modérés, quelquefois d'un doux scepticisme, dans leur jeunesse; ils sont affirmatifs et ils sont révolutionnaires dans leur âge avancé. Les années, au lieu de les mûrir, les rendent acides. Ils semblent avoir marché à reculons dans le sentier de la vie et avoir cheminé, à partir de vingt ans, d'une douce et sereine vieillesse à une jeunesse inquiète et à une adolescence tumultueuse.
Remarquez que le phénomène n'est pas nouveau en France et que c'est (surtout) à partir de son âge mûr que Voltaire, et lui aussi, ce semble bien, pour suivre la mode et courir après la popularité, est devenu partiellement révolutionnaire, avec le tempérament le plus conservateur du monde, poussant toujours de ce côté avec plus d'âpreté et de violence. Il faut dire seulement, à l'éloge de son bon sens et aussi, relativement, de son courage, il faut dire, pour être juste, que cependant il n'a pas eu tout à fait la terreur d'être dépassé et a laissé d'autres aller plus loin que lui en disant nettement qu'il n'allait pas jusqu'où ils allaient.