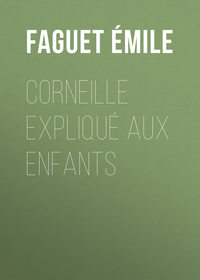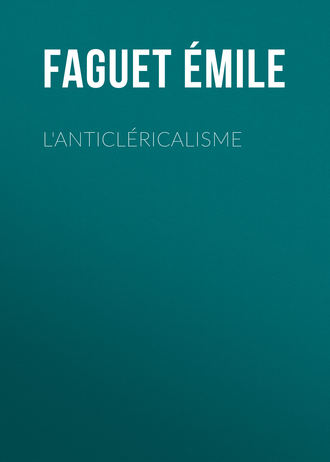
Полная версия
L'Anticléricalisme
La Bruyère est très bon chrétien; il fait un chapitre contre les esprits forts. Voyez-vous La Bruyère naissant trente ans plus tard; est-ce que vous le vous figurez très chrétien? Est-ce que vous le vous figurez autre que libre penseur ou tout au moins très détaché, à la manière des Lettres persanes? Que La Bruyère soit très chrétien, c'est une preuve que tout le monde l'était alors et jusqu'aux esprits naturellement satiriques et impertinents.
Songez encore que toute la bourgeoisie et tout le peuple, sauf les protestants, ont applaudi, tous jusqu'à un innocent païen comme La Fontaine, à l'exécrable révocation de l'Édit de Nantes. Il n'y a pas de signe plus frappant que celui-ci. La France de 1685 est profondément religieuse et profondément catholique. On n'a pas besoin de me prier pour me faire dire qu'elle l'est beaucoup trop.
Que ceci soit donc retenu. L'anticléricalisme existe au XVIIe siècle. Il est très faible. On peut aller jusqu'à dire qu'il est imperceptible, parce qu'il est encore latent.
Seulement aucun siècle plus que le XVIIe siècle n'a préparé merveilleusement et comme couvé l'anticléricalisme. Voici pourquoi et voici comment.
Au XVIIe siècle, tout au moins à partir de Louis XIV, le protestantisme est définitivement vaincu. Il n'est plus un péril; il n'est plus même une opposition gênante; il est absolument inoffensif. C'est le moment, bien entendu, que l'on prend et que l'on saisit pour le combattre avec sauvagerie et férocité. C'est d'ordre commun, particulièrement en France. Avoir vaincu cela ne donne que l'envie d'écraser. Plus on est sûrement maître, plus on veut être tyran. Car, je vous le demande, à quoi servirait-il d'être maître?
De même de nos jours, le catholicisme n'ayant plus ni ongles ni dents, que reste-t-il? A le tuer. Et c'est ce qu'on fait avec allégresse.
Donc, au XVIIe siècle, le protestantisme étant vaincu, on le combattit, et l'on fit le ferme propos de l'exterminer.
On y parvint à très peu près, dans toute la mesure du possible. La France en fut affaiblie; mais pour un parti il ne s'agit jamais de la France; et Louis XIV, en cette affaire, chose honteuse pour un roi, ne fut pas autre chose qu'un chef de parti. Il eut tout juste la largeur d'esprit et la portée d'intelligence d'un Combes. Il est honorable pour M. Combes de ressembler à Louis XIV; il est moins honorable pour Louis XIV de ressembler à M. Combes.
Donc on persécuta avec acharnement le protestantisme désarmé et inoffensif.
On persécuta plus inoffensif et plus désarmé encore, puisqu'on persécuta des gens qui, non seulement n'avaient plus d'armes, mais qui n'en avaient jamais eu. On traqua et l'on chassa à courre le janséniste, on sait avec quelle vigueur et avec quelle persévérance. C'est ici que se voit bien, peut-être, la pensée maîtresse du gouvernement de cette époque. Que l'on combatte à mort un parti qui a été puissant, cela se comprend encore. Ce peut être une illusion. Il se peut qu'on le croie encore vivant. Mais que l'on combatte une opinion qui comme parti n'a jamais existé, cela montre bien que c'est l'opinion que l'on combat, la manière de voir et rien de plus, et que l'on a pour principe que personne dans tout le pays n'a le droit de penser autrement que vous, et que tout homme dans le pays a le devoir strict de penser exactement comme vous pensez.
Je m'étonne que Louis XIV ait pu dire que Boileau s'entendait en vers mieux que lui. Au fond, je n'en crois pas un mot. Ou, s'il est vrai, on voit assez à quel point cela a stupéfié les contemporains, puisqu'ils ont rapporté cela comme un trait de libéralisme absolument extraordinaire.
En tout cas Louis XIV n'admettait pas que quelqu'un s'entendît en théologie mieux que lui, ni que quelqu'un s'y entendît d'une autre façon que la sienne.
Il est possible et même probable qu'il y eût autre chose encore dans la pensée ou dans l'arrière-pensée du gouvernement d'alors. Pour le gouvernement de Louis XIV, les protestants étaient des républicains et les jansénistes étaient des demi-protestants, et la guerre aux protestants et aux jansénistes c'était le royalisme qui se défendait, et les persécutions contre les protestants et contre les jansénistes c'était une expédition de Hollande à l'intérieur.
Tout n'était pas faux dans cette arrière-pensée du gouvernement; mais ceci est caractéristique d'une autre manie, très analogue du reste à la précédente, des gouvernements despotiques. Ils ont la manie de se chercher des ennemis et de tellement les chercher qu'ils en créent pour en trouver. Les gouvernements despotiques sont des femmes jalouses. Celles-ci veulent absolument que leurs maris les trompent; je veux dire qu'elles en ont tant peur qu'elles se figurent toujours que la chose est, et qu'elles semblent vouloir qu'elle soit, et qu'à force de la redouter il semble qu'elles la désirent.
Le gouvernement despotique veut avoir des ennemis; et il les suppose pour en avoir; et il en arrive ainsi, par procès de tendances à très longue trajectoire, à considérer comme républicains des gens qui le sont en puissance, c'est-à-dire qui pourraient l'être; et des gens aussi qui ne le sont point du tout, mais qui ressemblent un peu, à d'autres égards, à ceux qui pourraient le devenir. Le procès de tendances consiste à poursuivre des personnes, pour opinions, d'abord, et ensuite pour des opinions qu'elles n'ont pas, mais qu'il ne serait pas impossible qu'elles eussent si elles en avaient d'autres que celles qu'elles ont.
Tel est l'état d'esprit des gouvernements despotiques. Et c'est-à-dire, comme l'a démontré Platon dans une jolie page, que ce ne sont pas des gouvernements, mais des «factions». Ce sont des partis qui ont besoin d'avoir des ennemis; ce qui est précisément le propre des partis; et qui sentent continuellement ce besoin comme une condition et comme une nécessité de leur existence; et qui ont besoin d'opprimer quelqu'un pour se prouver à eux-mêmes qu'ils existent et qui, par conséquent, inventent des ennemis pour pouvoir se battre et des oppressibles pour pouvoir être oppresseurs.
Ce ne sont donc pas des gouvernements, puisqu'ils ne gouvernent pas à proprement parler, mais mènent les citoyens à la bataille les uns contre les autres; ce sont des factions au pouvoir. Louis XIV, pendant toute une partie de son règne, a été un factieux.
Quoi qu'il en soit, tel a été le XVIIe siècle au point de vue religieux. Il a été persécuteur de gens désarmés et conculcateur de gens à terre. Or un tel siècle prépare mieux à l'irréligion qu'un siècle de guerres civiles proprement dites.
Un homme naissant après le XVIe siècle, en France, peut se dire: «On s'est battu. On s'est battu pour cause de religion et sous prétexte de religion. On s'est battu pour que la messe fût dite en français et pour conquérir le pouvoir. C'est épouvantable. On ne devrait être que Français. Mais encore, on se battait à armes égales ou qui semblaient l'être, rendant coups pour coups et ne frappant que par souvenir d'avoir été frappé ou crainte de l'être. C'était la guerre. Que les religions soient cause de cela ou mêlées très intimement à cela, c'est très regrettable; mais encore ce n'est pas une raison pour détester toute religion ou se tenir éloigné de toute religion. La preuve n'est pas faite que les religions soient éternellement et indéfiniment persécutrices. Pour ce qu'elles ont de bon, on peut les garder, chacun la sienne et, tout compte fait, je garde celle dans laquelle on m'a élevé.»
Oui, un homme naissant après le XVIe siècle, en France, pouvait raisonner à peu près de cette façon.
Mais un homme de la fin du XVIIe siècle était frappé de ceci que les discordes religieuses survivaient à leurs grandes causes, à leurs grandes causes morales, nationales, ethniques et politiques; qu'elles se continuaient et prolongeaient comme par elles-mêmes; qu'elles se multipliaient, du reste, en se subdivisant; qu'il ne suffisait plus que protestants et catholiques se combattissent d'un bout de l'Europe à l'autre; mais qu'il fallait que les catholiques se partageassent en jansénistes et ultramontains et les protestants en orthodoxes et en libéraux, et que c'était d'une part l'Église de France proscrivant les jansénistes et que c'était d'autre part Jurieu poursuivant Bayle d'une haine implacable et le dénonçant furieusement à tous les tribunaux comme athée et comme criminel, si bien que Bayle écrivait à un protestant de France: «Si vous voulez rester fidèle à votre religion, vivez dans le pays où elle est persécutée, et Dieu vous garde de vivre dans celui où, étant maîtresse, elle est persécutrice.»
Devant ce spectacle, l'homme de la fin du XVIIe siècle en venait à se dire que la cause des querelles et des violences entre les hommes était la religion elle-même, quelle qu'elle fût, et qu'il fallait détruire toute religion.
Surtout l'intervention du pouvoir civil dans les querelles religieuses, alors que le pouvoir civil n'était menacé en rien et n'avait nullement affaire, sous la secte religieuse, à un parti politique, surtout cela amenait comme naturellement un homme d'esprit moyen à se dire que les religions étaient les mauvais démons des pouvoirs civils et leur donnaient de détestables inspirations, et c'était droit au mauvais démon qu'il poussait, et le mauvais démon qu'il dénonçait et voulait détruire.
Il ne savait pas dire aux gouvernements: «Ne vous mêlez jamais d'affaires religieuses et laissez les religions se quereller par la parole et se disputer les populations par la parole; et n'intervenez que comme chef de police quand elles déchaînent la guerre civile, et alors avec une parfaite impartialité; et, en d'autres termes, soyez neutres tant qu'on parle; et, quand on agit, n'intervenez que pour qu'on cesse d'agir: et réprimez la guerre civile, ne la faites pas.»
Il ne savait pas dire cela aux gouvernements; mais sachant, non sans raison historique, que les gouvernements intervenaient toujours, soit pour une religion, soit pour une autre, il se disait plutôt: «Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y eût plus de religion du tout; ce qu'il faudrait, c'est que la cause pour laquelle les gouvernements font des guerres à l'intérieur disparût.»
A se déchirer les unes les autres, les religions ont fait souhaiter que toutes disparussent; à soutenir les sectes religieuses les unes contre les autres, les gouvernements ont fait souhaiter que toutes les religions cessassent d'être.
Quand on proscrit, sans la moindre utilité démontrée, successivement protestants, jansénistes et quiétistes, en définitive, ce sont des athées que l'on fait.
La prodigieuse rapidité avec laquelle, sinon la France, du moins la classe dite éclairée, en France, est devenue irréligieuse, ou indifférente en matière de religion, ou sarcastique à l'égard des religions, dès le commencement du XVIIIe siècle, s'explique, à mon avis, par ce qu'il y avait de prodigieusement inutile, de prodigieusement dénué de raison et même de prétexte et de prodigieusement stupide dans les longues persécutions religieuses du XVIIe siècle.
CHAPITRE III
L'ANTICLÉRICALISME AU XVIIIe SIÈCLE
L'anticléricalisme au XVIIIe siècle fut plus bruyant qu'il ne fut profond. Comme le prouve tout ce qu'on connaît des cahiers de 1789, il ne pénétra que fort peu dans les couches dites inférieures de la nation. Comme tendent à le prouver quelques procès célèbres du XVIIIe siècle où les choses religieuses sont mêlées, la population aussi bien du midi que du nord était encore très catholique et très cléricale. C'est Voltaire et c'est du reste tout ce qui nous est rapporté par tout le monde sur les affaires Calas, Sirven et La Barre qui nous sont témoins que la population de Toulouse et de la province de Toulouse, que la population d'Abbeville et de la région d'Abbeville étaient «unanimes» contre Calas, contre Sirven et contre La Barre. Les passions catholiques étaient tout aussi fortes dans la bourgeoisie et dans le peuple au XVIIIe siècle qu'au XVIIe.
M. Cruppi l'a dit et, du reste, rien n'est plus évident, si le jury eût existé au XVIIIe siècle, Calas, Sirven, La Barre et d'Etallonde eussent été condamnés; Calas et La Barre eussent été suppliciés tout comme ils l'ont été par l'arrêt des juges. La chose seulement eût été plus certaine dès le premier moment de l'affaire. Il n'y a aucun doute sur ce point.
Quant à la magistrature, elle était en immense majorité catholique; mais elle l'était d'une façon particulière. Elle était toute janséniste. Elle lutta, depuis le commencement du siècle jusqu'en 1771, contre les évêques et les curés ultramontains et dominés par l'influence des Jésuites, qui refusaient les sacrements aux jansénistes. Elle était janséniste, gallicane et antipapiste; elle voyait, non sans raison, dans les jansénistes des hommes indépendants qui ne se croyaient pas obligés de penser exactement en religion et en autres choses comme le roi voulait qu'on pensât; mais elle était profondément catholique et d'autant plus sérieusement, d'autant plus intimement, d'un sentiment d'autant plus réfléchi et d'autant plus passionné que, précisément, elle était janséniste et de la religion de Pascal.
Or la magistrature, c'était la bourgeoisie; c'était la grande bourgeoisie française; c'était la bourgeoisie française assez riche, fort instruite et fort éclairée, très patriote, catholique gallicane et catholique libérale, antiprotestante, à tendances ou à sympathies jansénistes, adversaire, généralement, de la noblesse et du haut clergé, adversaire du despotisme, dévouée au roi, mais indépendante à son égard et voulant qu'il fût respectueux des «lois fondamentales». Il y eut accord presque parfait entre la bourgeoisie française et la magistrature jusqu'aux approches de la Révolution de 1789.
On peut donc dire qu'au XVIIIe siècle l'anticléricalisme ne pénétra pas très profondément. Il n'atteignit ni le peuple, ni la petite bourgeoisie, ni la grande. Il fut encore très nettement en minorité et en minorité très faible.
Mais il fut bruyant et très brillant, parce qu'il fut très répandu parmi les hommes de lettres, qui étaient devenus comme une classe dans la nation.
On peut dire que ce fut le XVIIe siècle qui fut encore cause de cela et que le XVIIe siècle contribua de loin, très indirectement et très involontairement, à la cause de l'anticléricalisme, en ce sens que c'est sa gloire littéraire qui fit des hommes de lettres une classe, et une classe très considérable, et qu'il se trouva que les hommes de lettres, après lui, furent anticléricaux.
Imaginez, après Balzac, Descartes, Corneille, Molière, La Rochefoucauld, Sévigné, Bossuet, Racine, Boileau, La Bruyère et le retentissement de ces grands noms dans toute l'Europe et la diffusion, grâce à eux, de la langue française dans toute l'Europe, et la gloire européenne de la France, gloire qu'elle sent qu'elle doit principalement à ses hommes de lettres, imaginez bien ce que c'est qu'un homme de lettres en 1700.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.