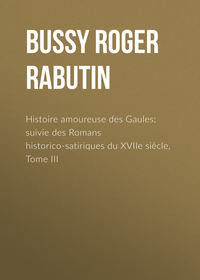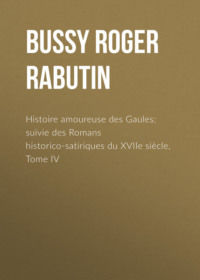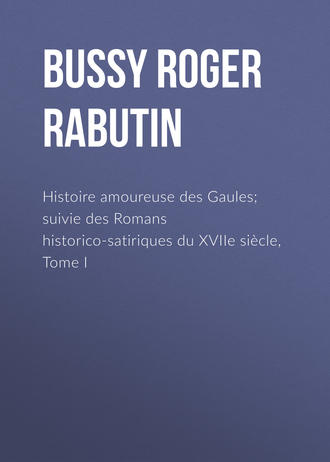
Полная версия
Histoire amoureuse des Gaules; suivie des Romans historico-satiriques du XVIIe siècle, Tome I
Le mariage eut lieu peu de temps après. V. Montpensier, t. 2, p. 246 de la Collection Petitot.
Ce n'est toutefois qu'en 1656 que mademoiselle de Montpensier parle du bruit que «commençoit à faire» la beauté de madame d'Olonne; mais les souvenirs de mademoiselle sont quelquefois un peu confus, et d'ailleurs on peut admettre qu'elle attache une idée fâcheuse au mot bruit.
À peine mariée, notre belle dame laisse son mari auprès du roi, et chevauche parmi les hardies frondeuses (Montpensier, t. 2, p. 245). Le temps n'est pas venu où madame de Sévigné écrira (13 novembre 1675): «Le nom d'Olonne est trop difficile à purifier»; où l'on chantera:
La d'OlonneN'est plus bonneQu'à ragoutter les laquais;(Ms. 444, Suppl. Bibl nat.)
où La Bruyère (t. 1, p. 203 de l'édit. Jannet) dira: «Claudie attend pour l'avoir qu'il soit dégoûté de Messaline.» Il s'agit de Baron; Claudie, c'est madame de la Ferté; Messaline, c'est madame d'Olonne. Nous sommes en 1652, à la date du mariage, et Baron n'est pas encore né. Son acte de naissance, cité par M. Taschereau (Vie de Molière, 3e éd., p. 249), le fait naître le 8 octobre 1653. Quant à la maréchale de la Ferté, on sait que sous ce nom tristement célèbre il faut reconnoître mademoiselle de La Loupe la cadette, celle que Saint-Simon a si souvent fouettée. Elle étoit belle aussi et le fut long-temps. Les deux sœurs vécurent jusqu'en 1714, et jouirent à leur aise de leur gloire.
4
Louis de la Trémoille, comte d'Olonne, avoit été arrêté sous la Fronde, en 1649, «comme il se vouloit sauver habillé en laquais» (Retz, p. 100). Il est mort en 1686. Boisrobert s'étoit moqué de lui de bonne heure; on s'en moqua plus cruellement lorsque sa femme eut rendu publiques ses infortunes. Avec Saint-Evremont et Sablé Bois-Dauphin, il se consoloit en fondant l'ordre des Coteaux, dont Boileau nous a conservé le souvenir. La Bruyère, à ce point de vue, l'a peint sous le nom de Cliton le fin gourmet (t. 2, p. 93). À un autre point de vue, Racine a parlé de lui dans cette jolie épigramme faite sur Andromaque:
Le vraisemblable est peu dans cette pièce,Si l'on en croit et d'Olonne et Créqui:Créqui dit que Pyrrhus aime trop sa maîtresse,D'Olonne qu'Andromaque aime trop son mari.À l'article de la mort, un prêtre nommé Cornouaille lui offre ses services. L'anecdote veut qu'il se soit écrié avec quelque colère: «Serai-je encornaillé jusqu'à la mort?»
5
François d'Harcourt, deuxième du nom, marquis de Beuvron, né le 15 octobre 1598, mort à Paris le 30 janvier 1658, enfant d'honneur de Louis XIII, adversaire de Boutteville dans un duel fameux, avoit deux fils, qui furent notre marquis et le comte de Beuvron.
Saint-Simon, en 1705 (t. 4, p. 437, de la nouvelle édition Chéruel), dit dans ses Mémoires: «M. de Beuvron, chevalier de l'ordre et lieutenant-général de Normandie, mourut à plus de quatre-vingts ans, chez lui, à la Meilleraye, avec la consolation d'avoir vu son fils Harcourt arrivé à la plus haute et à la plus complète fortune, et son autre fils, Sézanne, en chemin d'en faire une, et déjà chevalier de la Toison-d'Or. On a vu comment elle étoit due aux agrémens de la jeunesse du père. C'étoit un très honnête homme et très bon homme, considéré et encore plus aimé.»
Ce très honnête et très bon homme nous appartient ici. Son frère mourut bien avant lui. Voyez Dangeau. (28 septembre 1688): «Le comte de Beuvron est mort cette nuit. Il avoit un justaucorps en broderie et des pensions, et avoit été capitaine des gardes de Monsieur. Il avoit depuis deux ans déclaré son mariage avec mademoiselle de Téobon, dont il n'a point d'enfans.» – «Homme liant et doux, ajoute Saint-Simon (t. 3, p. 181), mais qui voulut figurer chez Monsieur, dont il étoit capitaine des gardes, et surtout tirer de l'argent pour se faire riche, en cadet de Normandie fort pauvre.»
On sait qu'il a été accusé, avec le chevalier de Lorraine et d'Effiat, d'avoir travaillé à l'empoisonnement de Madame. V. La Fayette.
Sa femme, fille du marquis de Théobon, «étoit une femme (Saint-Simon, t. 3, p. 186) qui avoit beaucoup d'esprit, et qui, à travers de l'humeur et une passion extrême pour le jeu, étoit fort aimable et très bonne et sûre amie.» Elle étoit «originairement huguenote (Journal du marquis de Sourches, t. 2, p. 190), mais, s'étant convertie, avoit été nommée fille d'honneur de la reine; et, quand on rompit la chambre des filles de la reine, Monsieur la mit auprès de Madame», la seconde Madame, qui l'aima beaucoup. V. ses lettres.
Le père des Beuvron avoit épousé, en 1626, Renée d'Espinay, sœur du comte d'Estelan. On disoit de lui:
Beuvron, espouse-tu
Saint-Luc, qui tant est belle?
Si tu veux estre cocu,
N'en espouse d'autre qu'elle.
Ah! petite brunette,
Ah! tu me fais mourir!
Il étoit lieutenant du roi en Normandie et gouverneur du vieux palais de Rouen (Montpensier, t. 2, p. 177). C'étoit un ami de Racan. «Les enfans de Beuvron, dit Tallemant des Réaux (t. 2, p. 367, de l'édition Paulin Paris), ont plus d'esprit que leur père.» Cet ami de Racan n'étoit donc pas un personnage très ingénieux. Sous la Fronde, en 1650, il reste fidèle au duc de Longueville, et résiste, à Rouen, à la duchesse et au parlement; toutefois (Motteville, t. 4, p. 16) on ne faisoit pas grand cas de lui à la cour. Il obtint alors pour son fils aîné (La Rochefoucauld, p. 436, édit. Michaud) la survivance du vieux palais.
Beuvron (le nôtre) a joué jusqu'à sa mort un grand rôle en Normandie (Voy. Saint-Simon, t. I, p. 117, 123), et ne fut pas toujours en faveur (Dangeau, 13 mars 1689).
Si ce n'est lui, c'est son frère, le favori de Monsieur (Mém. de du Plessis, édit. Michaud, p. 446, et Mém. de Montp., t. 4, p. 211), qui a commis le crime que reproche à un Beuvron ce couplet (Nouveau siècle de Louis XIV, p. 88)
On dit que Beuvron a gâté
Le grand chemin de la Ferté,
Qui fut jadis si fréquenté.
Une accusation plus grave a pesé un instant sur lui: la Brinvilliers, disait-on (Sévigné, 26 juin 1676), affirmoit qu'il avoit réellement empoisonné Madame. Ce bruit n'eut pas de suites.
Les Beuvron étoient parens de la comtesse de Fiesque, que nous allons voir entrer bientôt en scène. (Montpensier, t. 3, p. 104.)
Leur sœur (Catherine-Henriette d'Harcourt-Beuvron) mérite qu'on ne l'oublie pas dans un livre où il s'agit d'un grand nombre de divinités. Loret (26 avril 1659) l'appelle «l'admirable Beuvron». Elle venoit alors d'épouser le duc d'Arpajon, déjà deux fois veuf. Somaize (Précieuses, édit, Jannet, t. 1, p. 71) l'a inscrite sous le nom de Dorénice dans la grande compagnie des Précieuses. Elle n'eut jamais rien de ridicule. Sa beauté a trouvé grâce devant Tallemant des Réaux (chap. 304, t. 9, p. 75, de la 2e édition). Elle fut dame d'honneur de la Dauphine. Saint-Simon parle de sa «grande mine», de sa vertu, de son honneur intact (t. 1, p. 221).
Louis XIV lui fit de belles amitiés. Lors qu'elle fut nommée dame d'honneur, madame de Sévigné écrit (13 juin 1684): «C'est l'ouvrage de madame de Maintenon, qui s'est souvenue fort agréablement de l'ancienne amitié de M. de Beuvron et de madame d'Arpajon pour elle, du temps de madame Scarron.» Ce dire est confirmé par madame de Caylus (p. 4 de l'édit. de 1808), qui cite le marquis de Beuvron comme l'un des garants de la constante chasteté de sa tante.
6
Madame de Saint-Loup (V. Tallemant des Réaux).
7
Chemin faisant, nous ferons longue connoissance avec Candale. Une note ne suffiroit pas et elle couvriroit bien vite vingt pages.
Les garnitures à la Candale
Font paroître un visage pâle,
dit un vers boiteux du Nouveau siècle de Louis XIV (1856, p. 69). Ce vers atteste l'empire que Candale exerça sur les modes de son temps; cet empire est attesté en mille endroits, par exemple dans le Roman Bourgeois de Furetière (p. 73 de l'édit. elzevirienne): «On descendit sur les chausses à la Candalle; on regarda si elles estoient trop plissées en devant ou derrière.» De la tête aux pieds, ce beau seigneur règle le costume des délicats. Louis-Charles-Gaston de Nogaret et de Foix, duc de Candale, né à Metz en 1627, étoit fils de Bernard de Nogaret, duc d'Épernon, et de Gabrielle-Angélique, fille légitimée de Henri IV. Il avoit du sang royal dans les veines: au dix-septième siècle ce n'étoit pas un médiocre avantage en amour. En 1646, il est au siége de Mardick; en 1648, il est à Paris auprès du duc d'Orléans (Motteville, t. 3, p. 103); en 1649, il commande le régiment de son nom; en 1652, il a, par avance, la charge paternelle de colonel général et le gouvernement d'Auvergne; en 1654, il est lieutenant général sous Conti et d'Hocquincourt, deux des personnages de la présente histoire. Il meurt à Lyon le 28 janvier 1658. Il faut lire Saint-Évremont pour le voir à son avantage.
Le jour de sa mort fut un jour de deuil pour les dames. L'abbé Roquette, coutumier du fait, acheta du père Hercule, général des Pères de la Doctrine, l'oraison funèbre qu'il lui consacra (Voy. Tallem., t. 10, p. 239). Ce n'est pas là qu'il faut chercher l'histoire de sa vie.
Une sœur qu'il avoit lui survécut bien long-temps; elle est morte sans alliance, comme lui, le 22 août 1701, à soixante-dix-sept ans, après cinquante-trois années de couvent des Carmélites (Saint-Simon, t. 10 de l'édit. Sautelet).
Madame de Motteville n'a pas flatté son père (t. 4, p. 71), seigneur hautain, jaloux, brutal, cruel, criminel peut-être. Candale, beau garçon, d'humeur galante, blond, langoureux, coquet, garda quelque chose du caractère paternel. Ne voyons pas en un rose obstiné toutes les prouesses de ces messieurs: ils cachoient la griffe sous la patte de velours. Ces «princes chimériques», les Candale, les Manicamp, les Jarzay, ne doivent pas être canonisés sans information parcequ'ils ont plu à un nombre infini de belles.
8
Le frère de Condé.
9
«Maistre des requestes», dit Tallemant (t. 2, p. 115), puis intendant des finances; «protecteur des partisans», ajoute le Portrait des Maîtres des requêtes, «et qui de peu a fait beaucoup par toutes sortes de voies».
L'État de la France pour 1658 lui donne, comme intendant: Toulouse, Montpellier, la ferme des entrées de Paris, l'artillerie et le pain de munition.
En 1661, on le rembourse à 200,000 livres seulement, c'est-à-dire qu'on le destitue, et bien d'autres du même coup. C'est l'année des comptes sévères.
La femme de Paget étoit belle (V. le Recueil des Portraits de Mademoiselle: c'est la Polénie de Somaize (t. 1, p. 194, 206). Sa ruelle étoit vantée. Tallemant des Réaux (t. 2, p. 407) a raconté, à propos de madame Paget, une anecdote piquante. Bois-Robert et Ninon, l'une de nos amies en ce volume, y jouent un rôle.
10
Elle jouoit; son mari joua bien davantage. Voy. l'Oraison funèbre que lui fait dans son Journal l'estimable marquis de Sourches (janvier 1686, t. 1, p. 103). «On vit alors mourir le comte d'Aulonne, de la maison de Noirmoustier (La Trémouille), qui avoit été guidon des gendarmes du roi pendant les guerres civiles, et chez lequel s'assembloient alors presque tous les gens de qualité pour y jouer ou pour y trouver bonne compagnie.»
11
3,000 francs d'aujourd'hui.
12
60,000 francs.
13
On conçoit facilement que je n'aie rien trouvé dans les histoires pour me renseigner sur la généalogie de Quentine.
14
Surtout si cher que cela! vingt mille francs par jour!
15
(1656).
16
Candale le prenoit de très haut avec tout ce qui n'étoit pas de la plus haute noblesse. On juge par là ce qu'il pensoit des gens d'affaires. Bartet, secrétaire du roi, lui ayant déplu, voyez la hardiesse avec laquelle il le fait arrêter et raser d'un côté du visage, barbe et cheveux! (Sévigné, juin 1655; Montp., t. 2, p. 488, t. 3, p. 22.) Cela ne parut pas trop étonnant. Encore fit-il exiler sa victime! Les dames sourirent. Belle prouesse de prince chimérique! Mademoiselle de Montpensier (t. 3, p. 128) dit que «c'étoit un garçon plein d'honneur et incapable d'aucune mauvaise action.» Elle dit cela à la date de 1657, lorsque arriva l'affaire Montrevel. Ce Montrevel, se battant en duel avec Candale, est tué par derrière d'un coup d'épée que La Barte, un des suivants du grand roi de la mode, lui donne inopinément. Cette fois on crie: Il faut donner une garde du corps à Candale pour le protéger. Son courage, toutefois, n'est pas mis en doute (Voy. Motteville, t. 3, p. 293); mais la fierté de son rang lui monte bien vite à la tête. Le pauvre Bartet n'avoit pas été bien audacieux; il n'avoit rien imaginé; il avoit dit tout bas, et pour se venger de se voir prendre la marquise de Gouville, que Candale n'étoit peut-être pas un amant d'une énergie incontestable. De fait, Candale s'en faisoit accroire, comme Guiche, comme d'autres. Soyecourt étoit moins galant de mine, mais c'étoit un autre homme. Au surplus, ce n'est pas pour cela que je lui chercherai querelle: c'est parceque je le suppose moins doucereux qu'on ne le croyoit. Qu'est-ce que cette note de Tallemant? (T. 4, p. 355). «Madame Pilou étoit fort embarrassée d'un certain brave, nommé Montenac, qui vouloit enlever madame de la Fosse. Un jour, ayant trouvé feu M. de Candale: Monsieur, lui dit-elle, vous menez tous les ans tant de gens à l'armée, ne sçauriez-vous nous desfaire de Montenac? Tous les ans vous me faittes tuer quelques-uns de mes amys, et celuy-là revient tousjours! – Il faut, respondit-il, que je me desfasse de deux ou trois hommes qui m'importunent, et après je vous desferay de cestuy-là.» N'y a-t-il pas là de quoi le condamner?
17
Ses amis, nous les verrons bientôt figurer dans ce livre.
18
Trésorier de l'épargne. «Ces offices (Est. de la Fr., 1649) se vendent un million de livres chacun; ceux qui les possèdent ont douze mille livres de gages, et, en outre, trois deniers par livre de tout l'argent qu'ils manient, ce qui monte à des sommes excessives.» Nicolas Jeannin de Castille étoit petit-fils du président Jeannin, ministre de Henri IV. Ce Jeannin avoit marié sa fille à P. Castille, ancien marchand de soie, devenu receveur du clergé, et affirmant alors qu'il étoit bâtard de Castille. En généalogie tout marche à la longue. Soit pour la bâtardise! Ce qui est certain, c'est qu'une Jeannin (de Castille), en 1705, épouse un prince d'Harcourt, et a pour filles des duchesses de Bouillon et de Richelieu. Au bout d'un siècle, voilà ce qui fleurit sur la tige.
Jeannin, beau-frère de Chalais par sa sœur à lui, «belle personne», dit Tallemant des Réaux (t. 3, p. 193), se trouva un moment près de la banqueroute. (Épigr. Bibl nat., ms. sup. fr., n. 540, f. 56). Adieu alors la galanterie! De bonne heure il s'étoit montré «coquet» (Tallem. t. 4, p. 32). Entre autres maîtresses on lui connoît cette malheureuse Guerchy, qui mourut d'une si triste mort (Nouveau siècle de Louis XIV, p. 60). La galante madame de Nouveau s'amouracha de lui (Tallem. 2e édit., t. 7, p. 241).
En 1678, il est vieux. Madame de Sévigné, son amie, lui reproche ses fredaines; Bussy lui dit: «Vous savez (lettre du 31 décembre) que sur le chapitre des dames il n'est pas tout à fait si régulier que les évêques.»
Nicolas Jeannin de Castille étoit marquis de Montjeu ou de Mondejeu (Loret, 7 février 1654). Le nom n'y fait rien (Walckenaër, t. 2, p. 470). Madame de Sévigné (20 mai 1676) l'appelle Montjeu tout court et se moque de son marquisat; mais elle l'aime véritablement, va loger chez lui, date de chez lui quelques lettres (22 juillet 1672). Bussy l'aimoit de même (lettre du 22 mars 1678).
Mademoiselle de Montpensier (t. 4, p. 441) a daigné écrire: «Famille des Castille, gens que je considérois.» Notre Jeannin n'est pas un pied plat. Il étoit greffier de l'ordre dès 1657. C'est le premier exemple de ce que Saint-Simon appelle les râpés (t. 4, p. 161).
La seconde femme de Fouquet, celle à qui La Fontaine a adressé des vers (Odes, livre I), étoit Marie-Madeleine Castille-Villemareuil, une Castille par conséquent. On voit dans les Mémoires du duc d'Orléans un Castille-Villemareuil intendant de la maison de Monsieur (le petit Gaston, en 1615), «à la recommandation du président Janin».
Revers de la médaille: Après la chute de Fouquet, à côté d'un la Bazinière taxé à 962,198 livres (Voy. le Colbert de P. Clément, p. 105), notre pauvre Jeannin en a pour 894,224 livres. Les actions de madame d'Olonne, pour parler ce style, baissent beaucoup (Bussy à Sévigné, 20 juin 1678).
Jeannin, retiré des affaires, mena assez grand train. Malheureusement, il eut un fils à moitié fou (Sévigné, 9 déc. 1688), et fut presque obligé de ne pas s'affliger de sa mort.
Jeannin est mort à Paris en juillet 1691 (Voy. Dangeau, 1er août). Il y avoit long-temps qu'on lui avoit (à cause même du râpé) enlevé le cordon de l'ordre. Saint-Simon, dans ses Notes sur le manuscrit de Dangeau, écrit ces lignes un peu sèches: «Ce M. de Castille n'étoit rien. Son père, qui avoit fait fortune jusqu'à être contrôleur général des finances sous les surintendans, c'est-à-dire commis médiocrement renforcé, lui fit épouser une Jeannin pour le décrasser. Il fut trésorier de l'épargne et greffier de l'ordre, qu'il eut du président de Novion en 1657. Il fut culbuté avec M. Fouquet, prisonnier, puis exilé vingt-cinq ans en Bourgogne… Son fils vécut conseiller au parlement de Metz.»
19
Ce goût dura tout le temps du règne. Dangeau et Saint-Simon en parlent assez.
20
Il faut en finir avec Candale. Tallemant met ceci dans son Historiette de Sarrazin: «On croit que Sarrazin a été empoisonné par un Catelan (Catalan), dont la femme couchoit avec lui.» Et dans une note il ajoute ceci: «Le père Talon dit que la femme ne fut point empoisonnée; que son mary, qui estoit bien gentilhomme, l'espargnoit à cause de ses parens, qui estoient plus de qualité que luy; mais il empoisonnoit les galans d'un poison bruslant. Il croit que M. de Candalle en est mort.» Cosnac (t. 1, p. 190) veut que la femme soit morte aussi. Ce n'est pas la femme qui nous intéresse le plus; nous ne devons remarquer dans ce texte de Tallemant que la singulière explication donnée à la mort de Candale. Mais en voici bien d'autres: ce Vanel qui a écrit les Galanteries de la cour de France (édit. de 1695, p. 232) pense que «la marquise de Castellane fut cause de sa mort, luy ayant donné de trop violentes marques de son amour lorsqu'il passa par Avignon, où elle demeuroit ordinairement.» Croira-t-on Vanel cette fois, lui qui, le plus souvent, mérite si peu qu'on le croie? Desmaizeaux (édit. de Saint-Evremont de 1706) affirme qu'il mourut «des suites d'une galanterie avec une dame célèbre dans ce temps-là par sa beauté, et depuis par sa mort tragique». Ce seroit la marquise de Ganges, si célèbre en effet. Guy-Patin, l'homme au nez fin, ne veut pas chercher si loin (Lettre du 1er mars 1658): selon lui Candale est mort «pourri d'une vieille gonorrhée».
Nous avons eu occasion de savoir ce que valoit la marquise de la Beaume, nièce du maréchal de Villeroy; il faut lui pardonner quelque chose, parcequ'elle semble avoir bien aimé Candale. Elle avoit les plus admirables cheveux blonds du monde: elle se les coupa en signe de deuil (Montpensier, t. 3, p. 400). Cette anecdote est partout; on ne la raconte pas de la même façon partout. Quoi qu'il en soit, l'infortuné Candale est mort bien jeune. Il avoit eu plus de bonnes fortunes qu'un seul homme n'a raisonnablement le droit d'en espérer. Le tragique n'y manqua pas toujours. C'est Chavagnac (Mém., t. 1, p. 210) qui le peint accourant au galop à Bordeaux pour y revoir, après une longue absence, une amie fortement aimée: il la trouve morte, étendue sur son lit, entre les mains des chirurgiens qui pratiquent l'autopsie. Encore une fois, il faut lire Saint-Evremont pour l'amour de Candale.
Candale, en 1649, avoit failli devenir le neveu de Mazarin. C'étoit une affaire qui paroissoit arrangée (Omer Talon, collect. Michaud, p. 393; Motteville, collect. Petitot, t. 4, p. 356); mais Condé ne le voulut pas permettre (Voy l'Histoire de Condé de Pierre Coste): ce fut Conti, le frère de Condé, ce à quoi Condé ne s'attendoit certainement pas, qui épousa mademoiselle Martinozzi. Madame de Motteville (t. 4, p. 78) prétend que Candale travailla à cette conclusion. Cela étonne. Il étoit, du reste, très ardent pour le ministre. En 1651, les Bordelais, moins enthousiastes, brûlèrent son effigie (Voy. la Relation de ce qui s'est passé à Bordeaux, à la prise de trois personnes qui ressembloient au cardinal Mazarin, au duc d'Epernon et à la niepce Mancini). Le petit Tancrède de Rohan passoit pour être de lui, dit Tallemant des Réaux (t. 3, p. 441). On dit que les Mémoires manuscrits du chanoine Favart, de Reims, l'affirment. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Candale est mort en 1658, à 31 ans, et Tancrède est né en 1630.
Nous ne voudrions pas paroître rien retrancher de ce qui atteste l'estime des contemporains pour ce roi des galants à panaches. Madame de Motteville (t. 4, p. 422) s'exprime sur son compte d'une façon bien avantageuse: «Le duc de Candale, le premier de la cour en bonne mine, en magnificences et en richesses, celui que tous les hommes envioient et dont toutes les dames galantes souhaitoient de mériter l'estime, si elles n'en pouvoient faire le trophée de leur gloire.»
Jamais les carrousels et les ballets ne perdirent un cavalier plus magnifique et un danseur plus admirable. Les spectatrices ne perdoient pas un geste du triomphateur. Dès 1648 (ballet du 23 janvier), madame de Motteville fait son éloge. En 1656, au carrousel du Palais-Royal, près le palais Brion, elle enregistre ses hauts faits; elle le peint (t. 4, p. 371) à la tête de la troisième troupe, qui portoit les couleurs vert et argent; elle cite sa devise: une massue avec ces mots: «Elle peut même me placer parmi les astres»; elle vante «sa belle taille, sa belle tête blonde». Mais où sont les neiges du dernier hiver? Ah! Candale, si ce n'est quelques érudits, qui connoît votre nom et quelle belle vous regrette?
21
Assurément cette lettre est pleine de tristesse, et madame d'Olonne ne put la lire sans peine.
22
Nous n'en sommes pas quittes avec ce nom-là.
23
Pour l'honneur de ces annotations, je dois déclarer que tout ce que j'ai trouvé en fait de Mérille, c'est un jurisconsulte de Troyes, né en 1579, mort en 1647. Ce n'est pas ce que je cherchois.
24
Ceux qui s'imaginent que l'Histoire amoureuse est un livre ordurier seront bien étonnés en lisant toutes ces pages délicates.
25
Anne-Élisabeth de Rassan, «la belle Provençale», veuve de M. de Castellane. Elle épousa le marquis de Ganges. On connoît son effroyable histoire: ses deux beaux-frères, qui l'aimoient, ne pouvant la séduire, la massacrèrent.
Ce nom de Castellane me rappelle une autre femme, dont il faut respecter le souvenir: c'est Marcelle d'Altovitti-Castellane, qu'aima et délaissa Guise, le petit-fils du Balafré. Elle mourut de douleur au bout d'un an, après avoir écrit ces admirables vers:
Il s'en va, ce cruel vainqueur,Il s'en va plein de gloire!Il s'en va mesprisant mon cœur,Sa plus noble victoire!Et, malgré toute sa rigueur,J'en garde la memoire.Je m'imagine qu'il prendraQuelque nouvelle amante;Mais qu'il fasse ce qu'il voudra,Je suis la plus galante.Le cœur me dit qu'il reviendra:C'est ce qui me contente.Jamais romance atteignit-elle cette fierté, cette tendresse?
26
Voilà Vanel soutenu, et Desmaizeaux.
27
Saint-Evremont ne vient prendre place dans ce livre que comme un figurant muet. Nous n'avons donc pas à dire grand'chose de ce personnage, qui est d'ailleurs suffisamment connu, «connu, dit Saint-Simon (t. 4, p. 185), par son esprit, par ses ouvrages et son constant amour pour madame de Mazarin». Amant malheureux de Ninon (nous avons oublié de dire que Candale étoit de ceux qu'elle aima), Saint-Evremont avoit joué un grand rôle parmi les délicats de son temps. Il avoit l'esprit caustique: il en usa pour apprécier à sa manière le traité des Pyrénées. Ce qu'il en écrivoit ayant été découvert, il fut exilé. Il se consola en vivant libre en Angleterre; là il se fit une cour de beaux-esprits qui ne craignoient pas Louis XIV. Quand on lui offrit, après bien des années, de revenir en France, il répondit qu'il s'étoit procuré une patrie. On lui demandoit, à l'article de la mort, s'il ne vouloit pas se réconcilier. «De tout mon cœur, dit-il; je voudrois me réconcilier avec l'appétit.» (La Place, Recueil de pièces, t. 4, p. 440.) C'étoit un philosophe très hardi.