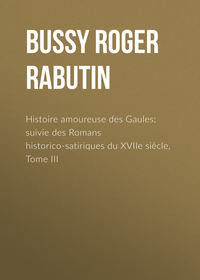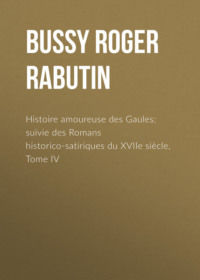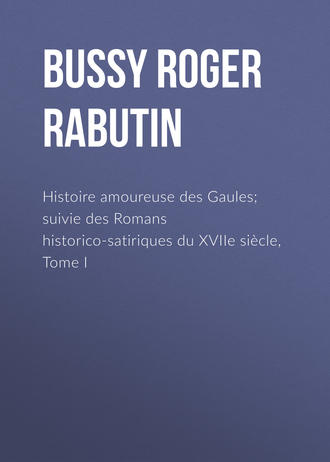
Полная версия
Histoire amoureuse des Gaules; suivie des Romans historico-satiriques du XVIIe siècle, Tome I
J'emprunterai encore, au sujet de Candale, quelques lignes à Amelot de la Houssaye:
«Le dernier duc de Candale prétendoit être prince, à cause que sa mère étoit fille bâtarde d'Henri IV; mais toute la cour se moquoit de cette prétention, dont il ne recueillit que le sobriquet de Prince des Vandales.
«Mademoiselle d'Epernon, sœur unique du duc de Candale, aimoit éperdument le chevalier de Fiesque, et voulut lui faire faire sa fortune en l'épousant.» (Amelot de la Houssaye, t. 2, p. 411.)
Il meurt à Mardick; elle se fait religieuse.
J'ai laissé Conti de côté, non pour l'oublier, mais dans l'intention de le placer plus loin, à côté de son frère.
M. Walckenaer (t. 4, p. 350) a expliqué très clairement comment Jeannin étoit possesseur du marquisat de Montjeu. Expilly (t. 4, p. 855) parle aussi de ce marquisat. Mais ce n'est pas pour indiquer ces éclaircissements géographiques que je remettrai Jeannin, le «coquet» Jeannin en scène; c'est pour demander à Saint-Simon (t. 5, p. 3) d'autres éclaircissements plus utiles, et qu'il donne de la manière la plus imprévue en parlant des fêtes de Sceaux, vers l'année 1703. Voici la page du maître:
«Il s'y étoit fourré, sur le pied de petite complaisante, bien honorée d'y être, comme que ce fût, soufferte, une mademoiselle de Montjeu, jaune, noire, laide en perfection, de l'esprit comme un diable, du tempérament comme vingt, dont elle usa bien dans la suite, et riche en héritière de financier. Son père s'appeloit Castille, comme un chien citron, dont le père, qui étoit aussi dans les finances, avoit pris le nom de Jeannin pour décorer le sien, en l'y joignant de sa mère, fille du célèbre M. Jeannin, ce ministre d'État au dehors et au dedans, si connu sous Henri IV.
«Le père de notre épousée avoit pris le nom de Montjeu d'une belle terre qu'il avoit achetée. Il avoit ajouté beaucoup aux richesses de son père dans le même métier. Il avoit la protection de M. Fouquet; elle lui valut l'agrément de la charge de greffier de l'ordre, que Novion, depuis premier président, lui vendit en 1657, un an après l'avoir achetée. La chute de M. Fouquet l'éreinta. Après que les ennemis du surintendant eurent perdu l'espérance de pis que la prison perpétuelle, les financiers de son règne furent recherchés. Celui-ci se trouva fort en prise: on ne l'épargna pas; mais il avoit su se mettre à couvert sur bien des articles; cela même irrita. Le roi lui fit demander la démission de sa charge de l'ordre, et, sur ses refus réitérés, il eut défense d'en porter les marques.
«Il avoit long-temps trempé en prison, on le menaça de l'y rejeter; il tint ferme. On prit un milieu: on l'exila chez lui en Bourgogne, et Châteauneuf, secrétaire d'État, porta l'ordre, et fit par commission la charge de greffier. Enfin le financier, mâté de sa solitude dans son château de Montjeu, où il ne voyoit point de fin, donna sa démission. La charge fut taxée et Châteauneuf pourvu en titre. Montjeu eut après cela liberté de voir du monde, et même de passer les hivers à Autun. Bussy-Rabutin, qui étoit exilé aussi, en parle assez souvent dans ses fades et pédantes lettres. À la fin, Montjeu eut permission de revenir à Paris, où il mourut en 1688. Sa femme étoit Dauvet, parente du grand fauconnier.
«Madame du Maine conclut le mariage et en fit la noce à Sceaux. Le duc de Lorraine s'en brouilla avec le prince et la princesse d'Harcourt, et fit défendre à leur fils et à leur belle-fille de se présenter jamais devant lui, surtout de ne mettre pas le pied dans son État.»
Le livret du Musée de Versailles (par M. E. Soulié), dont j'ai déjà loué ou louerai l'exactitude, commet une erreur (t. 2, p. 466) à propos du nom de comtesse de Fiesque: il confond la mère (Anne Le Veneur) et la belle-fille (Gilonne d'Harcourt). La belle-fille ne doit pas être trop sacrifiée à l'amour de l'anecdote. Elle eut réellement de l'esprit, elle ne fut pas libertine et elle aima les lettres jusqu'à la folie. Somaize (t. 1, p. 96) la traite fort bien:
«Felicie est une prétieuse de haute naissance qui fleurissoit du temps de Valère (Voiture), bien qu'elle fût dans un âge où à peine les autres sçavent-elles parler. Sa ruelle est encore aujourd'hui la plus fréquentée de tout Athènes, et l'esprit de cette illustre femme est généralement cherché de tout ce qu'il y a de plus grand et de plus spirituel dans cette grande ville. Les autheurs les plus connus et qui ont le plus de réputation font gloire de soumettre leurs ouvrages à son jugement: aussi a-t-elle des lumières qui ne sont pas communes à celles de son sexe, ce qui est aisé de juger par les visites que les deux Scipions (M. le Prince et son fils) luy rendent. La belle Dorimenide (madame d'Olonne) est une de ses plus intimes amies.»
Son persécuteur, le chevalier de Grammont (dans Somaize, le chevalier de Galerius, poursuivant de Lidaspasie, mademoiselle Leseville, et de sa sœur), avoit été abbé. Peut-être n'ai-je pas dit de cet homme assez de mal. L'esprit séduit si bien, même en ses débauches! Mais Saint-Simon nous ramènera dans le vrai, s'il ne nous pousse pas au delà. Il le cite à son tribunal (t. 5, p. 333) lorsqu'il meurt, en 1707:
«C'étoit un homme de beaucoup d'esprit, mais de ces esprits de plaisanterie, de réparties, de finesse et de justesse à trouver le mauvais, le ridicule, le foible de chacun, de le peindre en deux coups de langue irréparables et ineffaçables, d'une hardiesse à le faire en public, en présence et plutôt devant le roi qu'ailleurs, sans que mérite, grandeur, faveurs et places en puissent garantir hommes ni femmes quelconques. À ce métier, il amusoit et instruisoit le roi de mille choses cruelles, avec lequel il s'étoit acquis la liberté de tout dire jusque de ses ministres. C'étoit un chien enragé à qui rien n'échappoit. Sa poltronnerie connue le mettoit au dessous de toutes suites de ses morsures; avec cela, escroc avec impudence et fripon au jeu à visage découvert.
«Avec tous ces vices, sans mélange d'aucun vestige de vertu, il avoit débellé la cour et la tenoit en respect et en crainte. Aussi se sentit-elle délivrée d'un fléau que le roi favorisa et distingua toute sa vie.»
Vient la tribu des La Rochefoucauld: le père, François VI; le fils Marsillac, François VII, et Sillery, son oncle. Que voici encore une vive peinture de Saint-Simon! Nous sommes en 1706 (t. 5, p. 261), et nos héros ont perdu leurs grâces juvéniles:
«Ce Marly produisit une querelle assez ridicule. Il faisoit une pluie qui n'empêcha pas le roi de voir planter dans ses jardins. Son chapeau en fut percé: il en fallut un autre. Le duc d'Aumont étoit en année, le duc de Tresmes servoit pour lui. Le porte-manteau du roi lui donna le chapeau; il le présenta au roi. M. de La Rochefoucauld étoit présent. Cela se fit en un clin d'œil. Le voilà aux champs, quoique ami du duc de Tresmes. Il avoit empiété sur sa charge, il y alloit de son honneur: tout étoit perdu. On eut grand' peine à les raccommoder. Leurs rangs, ils laissent tout usurper à chacun; personne n'ose dire mot, et pour un chapeau présenté tout est en furie et en vacarme. On n'oseroit dire que voilà des valets.»
À quoi bon s'acharner après Marsillac? Je n'ai nulle raison pour ne montrer que ses ridicules, et je dois enregistrer ses états de services. Né le 15 juin 1634, il commence à servir en 1652; au siége de Landrecies, en 1655; il est mestre de camp du régiment de Royal-Cavalerie en 1666; il va en Flandre en 1667, en Franche-Comté en 1668; il est gouverneur du Berry en 1671; il prend part au passage du Rhin en 1672; il devient grand veneur en 1679, et chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1689. Il est mort le 11 janvier 1714.
Ai-je dit qu'il aima la première Madame? (V. La Fayette.)
Quant à Sillery, voici ce qu'Amelot de la Houssaye (t. 1, p. 539) dit de l'origine de sa maison; cela nous dispense de parler aux généalogistes: «Brulart. Cette maison est originaire d'Artois et vient d'un Adam Brulart, seigneur de Hez audit pays, lequel Filippe de Valois fit grand maître des engins, cranequiniers et arbalestriers de France.»
L'amour de la généalogie m'entraîne. Les Villarceaux sont des Mornay de la branche d'Ambleville et Villarceaux. Ils se manifestent ainsi dans le monde:
Pierre de Mornay, assassiné en 1626, épouse le 6 avril 1616 Anne-Olivier de Leuville, morte en 1653.
De ce mariage:
1º Louis, mort le 21 février 1691, à soixante-douze ans, après avoir épousé, en 1643, Denise de La Fontaine, d'où trois fils et une fille;
2º Claude, mort jeune;
3º René, mort le 2 septembre 1691;
4º Madeleine, abbesse de Gif;
5º Charlotte, qui épousa (1643) Jacques Rouxel, comte de Grancey, maréchal de France, etc. (morte le 6 mai 1694).
J'ai fait l'éloge de Mercœur. Ce Somaize qui, en somme, apprend peu de chose, apprend qu'il aima une demoiselle Sciroeste d'Avignon (t. 1, p. 215). Ce fut sans doute littérairement et en tout honneur. Il ne faut pas nous gâter nos bons maris, qui sont rares dans la société dont nous faisons l'histoire.
Villars étoit peu de chose par la naissance, avons-nous dit. Saint-Simon (t. 1, p. 26) n'y va pas de main morte; il écrit: «petit-fils d'un greffier de Coindrieu». Bagatelle.
Nous ne sommes pas très riches de documents sur le compte des Manicamp. N'oublions donc pas un fait, si petit qu'il soit (Amel. de la Houss., t. 2, p. 430). «Le maréchal d'Estrées, frère de Gabrielle, a pour troisième femme Gabrielle de Longueval, fille d'Achille de Manicamp.»
La terre de Manicamp est une terre de Soissonnois érigée en comté (octobre 1693) pour Louis de Madaillan de l'Esparre, marquis de Montataire (Expilly).
Et je n'ai plus qu'un ou deux mots, l'un pour madame de Bonnelle, l'autre pour Guitaut.
Le surintendant Bullion, père de M. de Bonnelle, soutient en 1636, après Corbie, le courage du cardinal. Cette année même il fait nommer son fils président à mortier à la place de Le Coigneux. En 1643, à la rentrée en grâce des proscrits, le président Le Coigneux demande sa place; on fait Bonnelle conseiller d'honneur et cordon bleu (Amelot de la Houssaye, t. 2, p. 100). Le président Bellièvre, son beau-frère, le trouva bien accommodant.
C'est peu de chose que nous dirons de Guitaut:
Le vieux Guitaut est mort le 12 mars 1663, à quatre-vingt-deux ans. Notre Guitaut est né le 5 octobre 1626, et est mort le 27 décembre 1685. On comprend bien qu'il y a de l'intérêt, dans une Histoire amoureuse, à savoir au juste l'âge des gens.
C'est dans la rue Saint-Anastase, et non dans la rue Culture-Sainte-Catherine, où elle alla demeurer plus tard, qu'il est voisin de madame de Sévigné (Walck., t. 4, p. 68).
68
Quel duelliste que Boutteville, le père de madame de Châtillon! Il alloit provoquer quiconque étoit devant lui cité comme une fine lame. Chaque matin, chez lui, dans une salle basse, il y avoit assaut de braves; le vin et le pain étoient en permanence sur la table avec les fleurets (Amelot de la Houssaye, t. 2, p. 262). On sait quelle fut sa mort. Avant de monter sur l'échafaud, Cospean l'amena à se convertir (La Houssaye, t. 1, p. 518).
Sa fille, madame de Châtillon, ne sera que trop souvent sur la scène. Boutteville laissa aussi un fils posthume, né en 1627, François-Henri de Montmorency, qui devint Luxembourg. Dans sa tendre jeunesse, il ne paroît pas si bravache que son père: le chevalier de Roquelaure lui donne un soufflet qu'il accepte (Tallem., chap. 202, t. 6, p. 178). Il est assidu auprès de Condé, son parent. En 1649 il fait partie de la confédération des nobles contre les tabourets de quelques duchesses (Mottev., t. 3, p. 375); il figure chez Renard à côté de Jarzay (La Rochefoucauld, p. 431) et provoque Beaufort, qui refuse de se battre avec lui, le 23 janvier 1650. Il aimoit alors la belle et jeune marquise de Gouville; mais le temps des amours tranquilles étoit passé: il faut qu'il combatte pour Condé. Il s'enferme alors dans Bellegarde avec Tavannes. La ville est dégarnie; qu'importe? «Ils arborent sur le rempart (Désormeaux, Vie de Condé, t. 2, p. 351) un drapeau blanc, semé de têtes de morts, pour annoncer qu'ils étoient bons François, mais qu'ils se défendroient jusqu'au dernier soupir.» C'est là l'apprentissage du futur tapissier de Notre-Dame. Il partage la fortune de Condé chez les Espagnols; il est fait prisonnier après l'engagement de Furnes (Montglat, p. 331). Il se marie, le 17 mars 1661, avec l'héritière de Piney-Luxembourg.
Sa jeunesse, si agitée, ne ressemble pas entièrement à celle des langoureux Guiche et Candale; d'ailleurs, il avoit le malheur d'être contrefait. On a toutefois écrit avec beaucoup d'abondance l'Histoire des amours du maréchal de Luxembourg (1695).
Saint-Simon, qui ne l'a point connu jouvenceau et qui ne peut lui pardonner ce qu'il a fait pour passer du dix-huitième rang des pairs au second (chap. 9, 1694), a plus d'une fois taillé pointue sa plume pour dire de lui le mal qu'il en pensoit. Ce n'en fut pas moins, lorsque l'heure arriva, l'un de nos plus habiles capitaines. Saint-Simon l'avoue, au reste (t. 1, p. 144): «Rien de plus juste que le coup d'œil de M. de Luxembourg, rien de plus brillant, de plus avisé, de plus prévoyant que lui devant les ennemis ou un jour de bataille, avec une audace, et en même temps un sang-froid qui lui laissoit tout voir et tout prévoir au milieu du plus grand feu et du danger du succès le plus imminent; et c'étoit là où il étoit grand. Pour le reste, la paresse même.»
Luxembourg est mort le 4 janvier 1695 (V. Dangeau). Sa mère227, également mère de madame de Châtillon, lui survit; elle meurt à 91 ans, en 1696, après avoir (Saint-Simon, t. 1, p. 215) vécu «toute sa vie retirée à la campagne».
69
Gaspard IV de Coligny, marquis d'Andelot, puis duc de Châtillon, promettoit d'être un jour un général. Dès 1641 il est nommé maître de camp du régiment (Daniel, t. 2, p. 381) de Piémont, quoique son père vînt de perdre la bataille de la Marfée.
En 1644, le père de mademoiselle de Vigean, que Condé aimoit, s'entend avec le maréchal de Châtillon pour marier sa fille à son fils (Mottev., t. 2, p. 129). C'est alors que Condé pousse le fils à aimer passionnément et à enlever mademoiselle de Montmorency. Châtillon s'attache de plus en plus à son protecteur; il combat près de lui à Lens. Condé l'envoie raconter sa victoire et demande pour lui le bâton de maréchal (Mottev., t. 3, p. 3); il n'obtient qu'un brevet de duc (t. 3, p. 117) à la fin de l'année 1648 (et non 1646. – Saint-Simon, t. 1, chap. 8). Saint-Simon l'appelle «bon et paisible mari». Pourquoi cela?
Quoi qu'il en soit, c'est lui qui commence la réputation de Ninon (V. Saint-Evremont); il étoit beau et vraiment aimable. Le coup de canon ou la balle qui le tua à Charenton, en 1649, fut détesté dans les deux partis (Guy Joly, p. 20). Chavagnac a raconté cette triste mort (9 février). Diverses pièces, publiées alors, contiennent son panégyrique; elles sont numérotées 22706, 22707, 22708, dans la Bibliothèque du P. Lelong. Châtillon ne laissa aucuns biens (Omer Talon, 331). «Il étoit beau», avons-nous dit déjà, «bien fait de sa personne et brave au dernier point.» Au moment où il mourut, il aimoit mademoiselle de Guerchy. «Dans le combat (Montp., t. 2, p. 47) il avoit une de ses jarretières (bleues) nouée à son bras.»
Son frère aîné, Coligny, a été, avec le duc de Guise, le héros du duel romanesque de la place Royale, que M. V. Cousin a raconté dans son Histoire de madame de Longueville; mais il en a été le héros malheureux.
70
Nécessité sera de s'y prendre à deux et à trois fois pour dire ce que je puis avoir à dire de madame de Châtillon. Ce ne fut pas seulement une dame galante, comme madame d'Olonne; ce fut aussi une femme politique, une Aspasie, une Impéria. Mais je n'ai pas à l'encenser, car elle n'a été que belle et n'a pas été aimable.
Les notes que nous consacrerons à éclaircir ou à garantir l'histoire que Bussy a faite de madame de Châtillon ne peuvent avoir la prétention de former un ensemble chronologique: ce sont les traits épars d'un tableau qui ne diffère pas de celui qu'il a peint. M. Walckenaer, dans le premier volume de ses Mémoires, a d'ailleurs étudié avec soin toute cette histoire.
On ne doit pas se fier éperdument à l'Histoire véritable de la duchesse de Châtillon, Cologne, Pierre Marteau (Hollande, à la Sphère), 1699, petit in-12 (catalogue Le Ber, nº 2224). Madame de Châtillon est née en 1626; elle a été mariée à Coligny en 1645; elle est devenue veuve en 1649; elle s'est remariée en 1664 au duc de Mecklembourg; elle est morte le 24 janvier 1695. Boutteville avoit laissé trois enfants: madame de Châtillon (Isabelle-Angélique), Marie-Louise, qui fut madame la marquise de Valençay, et enfin François-Henri, qui devint le maréchal de Luxembourg. On voit dans les Prétieuses de Somaize (t. 1, p. 191) cette prédiction, qui s'applique à madame de Châtillon sous le nom de Camma (1661): «L'amour se deffera de sa puissance entre les mains de Camma et luy donnera tout ce qu'il possède, ce qui s'appellera du nom de Métamorphose galante.»
Presque partout nous citons Somaize: c'est que tout notre monde a vécu de la vie précieuse, c'est que tous ces libertins et toutes ces femmes légères ont filé dans les ruelles le parfait amour avant de passer si chaleureusement à la réalité. Les lettres et les dialogues de Bussy, s'ils ne sont pas authentiques, sont parfaitement vraisemblables. Ainsi s'exprimoit la galanterie la plus hardie. Madame de Châtillon «faisoit la prude (Conrart, p. 231) et la sévère plus qu'aucune autre dame.» Elle étoit Montmorency, elle étoit Coligny elle avoit du sang d'azur dans les veines; elle se sentoit duchesse et bel-esprit. Mademoiselle Desjardins a écrit pour elle le Triomphe d'Amarillis; elle y passe divinité et y trône sur les nuages. Nous sommes loin des gourgandines de Régnier avec ce monde beau parleur; nous sommes loin aussi des vigoureuses passions de l'Italie ou de l'Espagne. Peu s'en faut que madame de Châtillon ne figure parmi les dévotes. Parmi les pièces justificatives de l'Histoire de madame de Longueville par M. V. Cousin, il y a quelques lettres de Madame de Longueville, de la princesse douairière et de Madame de Châtillon: ce sont des mères de douleur, des colombes chrétiennes; elles parlent le mielleux langage de saint François de Sales. On a quelque peine à tenir ses lèvres pincées lorsqu'on voit madame de Châtillon déposer solennellement en faveur de la sainteté de la mère Magdelaine de Saint-Joseph (1655), religieuse carmélite dont on poursuivoit à Rome la béatification.
Parlons d'abord de son second mari, de celui qui lui donna le nom de Meckelbourg, pour qu'il n'y ait plus qu'à songer librement à madame de Châtillon. C'est en février 1664, à trente-huit ans, qu'elle l'épousa. Christian-Louis de Meckelbourg (Mecklembourg) – Schwerin, chevalier de l'ordre le 4 novembre 1663, étoit veuf et avoit à peu près le même âge qu'elle. Il est mort à La Haye en 1692 (Saint-Simon, Notes à Dangeau, t. 2, p. 273). Il étoit rêveur, et sa femme lui donna de quoi rêver. Madame de Sévigné nous apprend (30 décembre 1672) qu'on se moquoit de lui volontiers. Madame (28 août 1719) dit: «C'étoit un singulier personnage que ce prince. Il étoit bien élevé, il apprécioit fort bien les affaires, il raisonnoit avec justesse; mais, dans tout ce qu'il faisoit, il étoit plus simple qu'un enfant de six ans.»
Et le reste.
Il y avoit une chanson ainsi tournée:
Ventadour et Mecklembourg
Sont toujours tout seuls au cours;
Ce n'est pas que l'amour
Leur tracasse la cervelle,
Mais c'est qu'à la cour
On les fuit comme des ours.
Laissons ce malheureux, qui n'a pas mérité son sort, et qu'après tout il ne faut pas plaindre s'il a tenu absolument à posséder la brillante madame de Châtillon.
De très bonne heure, mademoiselle de Boutteville s'étoit montrée encline à l'amour. D'abord elle s'imagine que Condé l'adore (1644). Condé faisoit semblant de l'aimer par ordre de mademoiselle du Vigean, qu'il aimoit en réalité (Motteville, t. 2, p. 130). Elle n'a que dix-neuf ans quand Coligny l'enlève. Ce fut une scène de mélodrame: un suisse de madame de Valençay, sa sœur, y périt vertueusement. La mère poussoit des cris de Rachel désespérée. Un amant évincé, Brion, faisoit chorus. Voiture n'y vit pas de mal (Œuv., t. 2, p. 174), et dit du ravisseur, dans un rondeau que nous approuvons:
Il a bien fait, s'il faut que l'on m'en croye.
On parloit beaucoup alors de la beauté de mademoiselle de Guerchy. Madame de Châtillon apprit avec une grande joie que le jeune prince de Galles la jugeoit plus belle que sa rivale (Montp., t. 2, p. 1, 1647); mais M. de Châtillon devoit, au jour de sa mort, avoir la jarretière de cette rivale nouée autour de son bras.
Je sais bien que les Mémoires de M. de *** ne peuvent pas être considérés comme des mémoires d'une grande valeur et qu'ils ressemblent à une compilation; je les appellerai toutefois en témoignage. Ce qu'ils disent nous fait faire un grand pas dans notre histoire, et, aux louanges méritées en 1648 par la beauté de la duchesse, ils ajoutent déjà quelque chose des critiques sévères que sa conduite postérieure va attirer sur elle.
«Élisabeth de Montmorency étoit de belle taille; son air et son port étoient nobles et pleins d'agréments; ses traits étoient réguliers, et son teint avoit tout l'éclat que peut avoir une brune; mais sa gorge et ses mains ne répondoient pas à la beauté de son visage. Son esprit vif et plein de feu rendoit sa conversation agréable, et elle avoit des manières douces et flatteuses dont il étoit impossible de se défendre. Elle avoit de la vanité et aimoit la dépense; mais, comme elle n'avoit pas assez de bien pour la soutenir, elle obligeoit ceux qui s'attachoient auprès d'elle à fournir à ses profusions. Bien qu'elle eût beaucoup de discernement, après avoir vu à ses pieds un prince aussi grand par ses belles qualités que par sa naissance, elle s'abaissoit souvent à des complaisances indignes d'elle pour des personnes qui lui étoient inférieures en toutes choses, mais qui pouvoient être utiles à ses desseins.» (Mém. de M. de ***, Collect. Michaud, p. 469.)
Mais il faut d'abord que la dame soit veuve; mariée elle est contrainte; Châtillon expire donc dans l'une des premières journées sérieuses de la Fronde.
«Ce jeune seigneur fut regretté publiquement de toute la cour à cause de son mérite et de sa qualité, et tous les honnêtes gens eurent pitié de sa destinée. Sa femme, la belle duchesse de Châtillon, qu'il avoit épousée par une violente passion, fit toutes les façons que les dames qui s'aiment trop pour aimer beaucoup les autres ont accoutumé de faire en de telles occasions; et comme il lui étoit déjà infidèle et qu'elle croyoit que son extrême beauté devoit réparer le dégoût d'une jouissance légitime, on douta que sa douleur fût aussi grande que sa perte.» (Mott., t. 3, p. 183.)
Voilà la veuve en campagne. Un prêtre que nous reverrons, Cambiac, M. de Nemours, Condé et d'autres de ci et de là, lui enlèvent son cœur, qu'elle expose fort aux surprises, peu par amour sincère, si ce n'est pour Nemours, beaucoup par intérêt. Cambiac lui servit à conquérir un pouvoir absolu sur la princesse douairière, qu'il dirigeoit, et qui lui légua des rentes considérables (Lenet, p. 219). On verra ce que signifia l'intrigue qu'elle eut avec Condé. En 1652, au moment de la bataille Saint-Antoine, elle ne lui plaît pas encore beaucoup, car il lui fait une rude grimace chez Mademoiselle (Montp., t. 2, p. 269). Le canon avoit tonné tout le jour. À dîner, «elle faisoit des mines les plus ridicules du monde, et dont l'on se seroit bien moqué si l'on eût été en humeur de cela». Un peu plus tard, la même année (Montp., t. 2, p. 326), elle «mouroit d'envie de donner dans la vue à M. de Lorraine. Elle vint un soir chez moi, dit Mademoiselle, parée, ajustée, la gorge découverte», etc. «Dès qu'elle fut partie, M. de Lorraine nous dit: Voilà la plus sotte femme du monde; elle me déplaît au dernier point.» – La veille ou l'avant-veille, elle avoit fait venir un joaillier, lui présent, et avoit en vain essayé de se faire offrir quelque bijou.
En même temps elle aime Nemours, et la guerre n'y fait rien. Mademoiselle est toujours bonne à interroger (t. 2, p. 214); elle nous dira comment les amoureux couroient alors les grands chemins au travers des mousquetades. Belle époque! et qu'un écrivain a récemment eu raison (M. Feillet, dans la Revue de Paris) de traiter mal. Les seigneurs mettent tout en révolution; ils jouent à la bataille, ils écrivent des billets doux pendant que les campagnes succombent sous une effroyable misère.