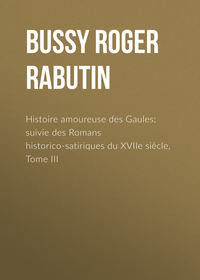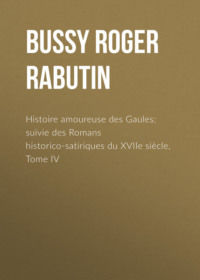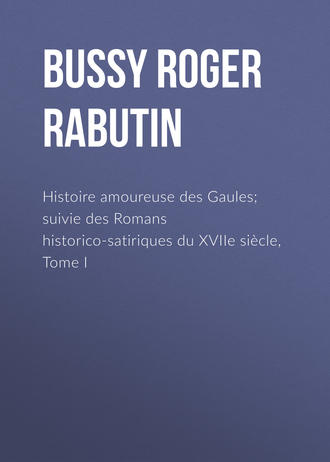
Полная версия
Histoire amoureuse des Gaules; suivie des Romans historico-satiriques du XVIIe siècle, Tome I
82
Mazarin donna l'abbaye de Doudeauville à l'abbé Cl. Quillet, qui lui avoit dédié le poème latin de la Callipædia, dont le début n'a rien de trop élégant:
Quid faciat lætos thalamos, quo semine felix
Exsurgat proles…
Je ne prétends pas dire que c'est là le plus beau trait de sa vie et l'action la plus utile à la France qu'il ait faite; mais cela ne laisse pas de montrer qu'il entendoit la gaudriole. Ah! si l'on en croyoit les Mazarinades! Si même on en croyoit La Porte, le valet de chambre de Louis XIV! Voici au moins l'incontestable vérité: «Le cardinal Mazarin avoit été soupçonné de n'avoir pas eu beaucoup de religion; sa jeunesse étoit déshonorée par une mauvaise réputation qu'il avoit eue en Italie, et il n'avoit jamais témoigné assez de vénération pour les mystères les plus sacrés.» (Motteville, 5e p., t. 5, p. 94.)
Giulio Mazarini est né à Piscina228, dans l'Abruzze, le 14 juillet 1602; il est mort à Vincennes le 9 mars 1661. Ce fut un grand homme d'État, un homme d'esprit et un homme de cœur dans son genre. Il paroît démontré qu'il fut l'heureux amant de la reine-mère (V. ses lettres, Société de l'histoire de France, 1836, édit. Ravenel, in-8).
On l'a raillé pour les travers de son humeur; on a fait de lui un Harpagon: il achetoit des tableaux, il avoit une bibliothèque admirable, il dépensoit un argent fou pour des machines d'opéra. En 1658 il monte une loterie gratuite (Montp., t. 3, p. 304) de cinq cent mille livres! Et puis il aima les lettres et les gens de lettres sans appareil de mécénat.
Nous ne songeons pas à le canoniser, pas même à l'absoudre du mal qu'il a laissé faire dans l'administration du royaume; mais il faut être juste pour sa mémoire, qui a été, comme sa vie, si agitée.
83
Henri d'Orléans, descendant de Dunois, né le 27 avril 1595, marié: 1. en 1617, à Louise de Bourbon, fille du comte de Soissons, morte en 1637; 2. le 2 juin 1642, à Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, née le 27 août 1619. Il est mort le 11 mars 1663. Le duc de Longueville, en sa jeunesse, étoit galant et brave. On lui connoît une fille naturelle, l'abbesse de Maubuisson, morte en 1664. Somaize a trouvé joli (t. 1, p. 187) de l'appeler Léonidas.
84
Anne Poussart, fille de François Poussart, sieur de Fors (Faure) et marquis du Vigean, et d'Anne de Neubourg, dame d'honneur de la reine, puis de madame la Dauphine, épousa: 1. François d'Albret, sire de Pons, comte de Marennes; 2. Armand-Jean du Plessis.
Il ne faut pas la confondre avec Judith de Pons, fille de Jean-Jacques de Pons, marquis de La Caze, et de Charlotte de Parthenay, dame de Genouillé, qui fut l'une des maîtresses, l'une des victimes du duc de Guise (Motteville, t. 2, p. 202), qui étoit fille d'honneur de la reine-mère (Tallem. des Réaux, 2e édit., chap. 232) et qui mourut fille en 1688. Madame de Motteville dit qu'elle étoit «gloutonne de plaisirs». Voyant que Guise ne se pressoit pas de se faire roi de Naples et de la faire reine (Mottev., t. 2, p. 348), elle se livra à Malicorne, son écuyer.
Deux nièces éloignées du maréchal d'Albret ont aussi porté le nom de Pons. Mademoiselle de Pons l'aînée épousa le frère du maréchal (François-Amanieu), s'appela madame de Miossens, et mourut en 1714, sans enfants. Saint-Simon (chap. 22, t. 1, p. 367) dit qu'elle faisoit peur par la longueur de sa personne. La cadette, «belle comme le jour», fut mariée à un Sublet, qui devint d'Heudicourt, grand louvetier.
Le roi avoit failli aimer cette seconde mademoiselle de Pons, qui s'y seroit prêtée et auroit peut-être prévenu La Vallière, si la reine-mère et le maréchal (1661) ne l'avoient fait enlever. Elle revint tard à la cour et déjà sans jeunesse: aussi se maria-t-elle avec joie. Vive, enjouée et badine, madame d'Heudicourt a paru aussi un peu folle.
85
«Il étoit de basse naissance, et, parmi quelques bonnes qualités, il en avoit aussi de mauvaises.» (Mott., t. 3, p. 373.)
Louis Barbier de la Rivière, fils d'Antoine Barbier, sieur de la Rivière, commissaire de l'artillerie en Champagne, est né en 1695 à Montfort-l'Amauri (Amel. de la Houssaye, t. 1, p. 367). D'abord régent de philosophie au collège du Plessis et de Navarre, il dut à l'évêque de Cahors, Pierre Habert, d'être introduit auprès de Gaston, et à son esprit agréable de lui plaire. Amelot de la Houssaye dit que Gaston, qui aimoit Rabelais passionnément, fut bien content de trouver quelqu'un qui le sût par cœur. Successivement premier aumônier de Monsieur, abbé de quinze abbayes, ministre d'État pendant la Fronde, chancelier des ordres, il est disgracié tout à coup pour s'être attaché à Condé, malgré le duc d'Orléans. Néanmoins, il meurt (30 janvier 1670) évêque de Langres, c'est-à-dire duc et pair. Le château de Petit-Bourg a été rebâti par lui. Il en a fait un château remarquable, et y mena une vie assez douce (Omer Talon, p. 381) pour se consoler de n'être pas devenu cardinal. L'abbé de la Rivière avoit eu de nombreuses intrigues: il aima, entre autres, la présidente Lescalopier (Tallem. des Réaux, ch. 202).
Dans les Honny soit-il de Maurepas il y a celui-ci en son honneur:
S'advancer et se mesconnoître,
Vendre deux ou trois fois son maître,
Trahir son pays par argent,
Mépriser avec insolence
Ceux qui l'ont veu estre indigent:
Honny soit-il qui mal y pense!
86
Turenne a aimé beaucoup et long-temps les femmes. C'est ce que ne disent ni l'abbé Raguenet, ni Ramsay, ni les diverses histoires de Turenne approuvées par les archevêques de Tours et de Rouen.
Personne n'ignore qu'il fut très épris de madame de Longueville. Pierre Coste (p. 87) ne le cache point, tout en affirmant que Turenne n'étoit pas d'un naturel impétueux:
«Quoique le vicomte de Turenne ne fût pas fort porté à l'amour, le commerce continuel qu'il eut alors avec cette belle princesse l'ayant rendu plus sensible qu'à son ordinaire, il tâcha de s'en faire aimer. La duchesse de Longueville non seulement ne répondit point à son amour, mais le sacrifia à La Moussaye, qui étoit alors gouverneur de Stenay.»
Ramsay (t. 2, p. 155) explique l'histoire à sa manière. C'est comme dans les panégyriques ou dans les oraisons funèbres: tout est sagesse, mouvement de l'esprit, politique profonde. Le cœur humain, la nature, ne paroît point.
«Quoique madame de Longueville fût dans une dévotion si grande qu'elle ne se mêloit d'aucune cabale, néanmoins son esprit avoit tant d'ascendant sur les personnes qu'elle les faisoit pencher du côté où elle avouoit bien que son inclination la portoit, c'est-à-dire du côté de Monsieur son frère.»
Turenne «aimoit naturellement la joie». (Mém. de Grammont, ch. 4.) Avec la joie il aima extrêmement, jusqu'à la compromettre, madame de Sévigné. Il avoit soixante ans quand il soupiroit aux pieds de madame de Coaquin (Choisy, p. 354), et se laissoit arracher le secret de l'État. En 1650, tenant campagne contre le parti de la cour, il entretenoit à Paris, dans la rue des Petits-Champs, une jolie grisette (V. les Mémoires de Retz).
87
Bussy doit une fameuse chandelle à madame de Longueville. Aussitôt après l'apparition de l'Histoire amoureuse des Gaules, les officiers et jusqu'aux valets de Condé poussent des cris, s'empressent autour du maître, demandent à tuer l'auteur de cette histoire. Condé n'est apaisé que par sa sœur. (Recueil de la Place, t. 7, p. 88.) Plus tard, elle travailla en vain à protéger celui qui l'avoit flattée si peu.
Nous pourrions tout uniment renvoyer le lecteur au livre de M. Cousin, qui est un ardent panégyrique; du moins nous ne traînerons pas la note en longueur.
L'affaire dramatique, dans cette vie si occupée, c'est, en 1643, le duel de Maurice, comte de Coligny, frère de notre Châtillon, contre le duc de Guise. Madame de Motteville (t. 2, p. 44) en a parlé suffisamment.
Tallemant des Réaux (Historiette de Sarrazin) dit que madame de Longueville aima Charles de Bourdeilles, comte de Mastas en Saintonge: c'est le Matha des Mémoires de Grammont, mort en 1674. Je ne sais si on peut dire qu'elle aima son frère Conti. Celui-ci, du moins, a conçu pour elle une passion très vive. M. de Longueville, à qui d'autres sont plus favorables, «avoit la mine basse», si l'on en croit M. de *** (p. 470), «et n'avoit dans sa personne aucun des agréments qui peuvent plaire aux femmes.» Ce même M. de *** dit de madame de Longueville: «Le duc de Châtillon avoit eu ses premières inclinations, et comme ce duc, après son mariage, n'eut plus pour elle les mêmes empressements, elle conserva toujours contre la duchesse une haine secrète.»
Et M. Cousin (2e édit., p. 28): «Elle a pu être touchée du dévoûment de Coligny, qui donna son sang pour la venger des outrages de madame de Montbazon; elle prêta un moment une oreille distraite aux galanteries du brave et spirituel Miossens; plus tard, elle se compromit un peu avec le duc de Nemours; mais elle n'a aimé véritablement qu'une seule personne: La Rochefoucauld; elle s'est donnée à lui tout entière; elle lui a tout sacrifié, ses devoirs, ses intérêts, son repos, sa réputation. Pour lui elle a joué sa fortune et sa vie; elle est entrée dans les conduites les plus équivoques et les plus contraires. C'est La Rochefoucauld qui l'a jetée dans la Fronde.»
Madame de Longueville, née le 27 août 1619, a été réellement une femme d'une très grande beauté. En 1647, madame de Motteville (t. 2, p. 240) fait son portrait avec un certain enthousiasme: «Quoiqu'elle eût eu la petite vérole depuis la régence et qu'elle eût perdu quelque peu de la perfection de son teint, l'éclat de ses charmes attiroit toujours l'inclination de ceux qui la voyoient; et surtout elle possédoit au souverain degré ce que la langue espagnole exprime par ces mots de donayre brio y bizaria (bon air, air galant); elle avoit la taille admirable, et l'air de sa personne avoit un agrément dont le pouvoir s'étendoit même sur notre sexe. Il étoit impossible de la voir sans l'aimer et sans désir de lui plaire. Sa beauté, néanmoins, consistoit plus dans les couleurs de son visage que dans la perfection de ses traits. Ses yeux n'étoient pas grands, mais beaux, doux et brillants, et le bleu en étoit admirable: il étoit pareil à celui des turquoises. Les poètes ne pouvoient jamais comparer aux lis et aux roses le blanc et l'incarnat qu'on voyoit sur son visage, et ses cheveux blonds et argentés, et qui accompagnoient tant de choses merveilleuses, faisoient qu'elle ressembloit beaucoup plus à un ange que non pas à une femme.»
On a une lettre de mademoiselle de Vandy (Manuscrits de Conrart, t. 8, p. 145) où il est dit qu'elle a un «teint de perle, l'esprit et la douceur d'un ange». Le mot ange se retrouve ailleurs encore. Félicitons-en M. de La Rochefoucauld.
Madame de Longueville a été précieuse. C'est tantôt Léodamie (Somaize, t. 1, p. 241), tantôt Ligdamire (t. 1, p. 141): «Du temps de Valère (Voiture), lorsqu'elle donnoit un peu plus de son temps à la galanterie, c'estoit chez elle que la parfaite se pratiquoit, et, à présent qu'elle a d'autres pensées, c'est chez elle que l'on apprend les plus austères vertus.»
88
Charlotte-Marguerite de Montmorency, née en 1593, mariée le 3 mars 1609 à Henri II de Bourbon-Condé, est morte le 2 décembre 1650. Son extraordinaire beauté fit faire à Henri IV bien des folies. Toute jeune qu'elle étoit, et mariée, elle y trouva de l'agrément. On croit qu'elle espéroit, à la suite d'un double divorce, arriver jusqu'au trône de son admirateur. Cela aussi étoit bien fantastique.
Elle montra de la tête, au temps de la Fronde, lorsqu'il fallut soutenir Condé. Alors elle est chef du parti, elle délibère. Désormeaux (Vie de Condé, t. 2, p. 354) en donne un exemple: «La nuit venue, la princesse douairière assembla un petit conseil, où elle n'admit que la princesse sa bru, la duchesse de Châtillon, sa parente et sa favorite, la comtesse de Tourville, Lenet, conseiller d'État, l'abbé de La Roquette et quatre gentilshommes.»
Le Père Lelong (n. 22,711 et n. 23,096) et le catalogue de la Bibliothèque nationale (Histoire, t. 2, n. 1682) indiquent diverses pièces mises alors sous son nom par les fabricants de livres politiques. Mais plus qu'habile elle avoit été et elle étoit restée belle. Croyons-en Voiture:
La belle princesse n'est pas
Du rang des beautés d'ici-bas,
Car une fraischeur immortelle
Se voit en elle.
M. Cousin (Longueville, 2e édit., p. 180) cite des vers de fête qui lui furent adressés. Le titre en est un peu bien pompeux: La Vie et les miracles de sainte Marguerite-Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, mis en vers à Liancourt.
Jamais sainte ne fut canonisée si facilement. Madame la Princesse douairière étoit d'abord la fierté en personne. Madame de Motteville (t. 4, p. 91) est bien informée: «Cette princesse étoit dans un âge qui pouvoit encore lui faire espérer une longue suite d'années; elle paroissoit saine, elle avoit encore de la beauté, et l'on peut croire que l'amertume de sa disgrâce contribua beaucoup à sa fin. Elle étoit un peu trop fière, haïssant trop ses ennemis et ne pouvant leur pardonner. Dieu voulut sans doute l'humilier avant sa mort pour la prévenir de ses graces et la faire mourir plus chrétiennement.»
Passe pour l'arrogance. Madame la princesse étoit une Madeleine non repentie, et quelle Madeleine pour la grace, pour la pénitence, pour la béatification! Dans l'Église ce n'est pas l'Église elle-même, l'épouse du doux Jésus, qu'elle avoit aimée. Madame de Motteville (t. 4, p. 94) garantira ce qu'on avance: «Madame la Princesse avoit été fortement occupée de l'amour d'elle-même et des créatures. Je lui ai ouï dire, un jour qu'elle railloit avec la reine sur ses aventures passées, parlant du cardinal Pamphile, devenu pape, qu'elle avoit regret de ce que le cardinal Bentivoglio, son ancien ami, qui vivoit encore lors de cette élection, n'avoit point été élu en sa place, afin, lui dit-elle, de se pouvoir vanter d'avoir eu des amants de toutes conditions, des papes, des rois, des cardinaux, des princes, des ducs, des maréchaux de France, et même des gentilshommes.»
Amelot de la Houssaye (t. 2, p. 405) entre dans le détail: «Le cardinal de La Valette aimoit éperdûment la princesse de Condé, Charlotte de Montmorency, et elle, à ce qu'on disoit alors, l'aimoit réciproquement, parceque, outre qu'il étoit bien fait, il lui donnoit beaucoup.»
Je recommande tous ces textes religieux au benoît M. Louis Veuillot et à Monseigneur Parisis.
89
Cambiac étoit un «ecclésiastique de Toulouse, dit Lenet (p. 379, en 1650), doux, modeste, beau, propre et fort intrigant». Sauval, mauvaise source quelquefois (Walck., t. 2, p. 445), le fait chanoine d'Alby et de Montauban. Le même Sauval donne Bouchu pour amant à madame de Châtillon en même temps que Cambiac.
Cambiac étoit tout à fait attaché à la famille des Condé: c'étoit l'un de leurs conseillers intimes.
90
Il y a madame de Brienne la mère (Louise de Béon, fille de Bernard, seigneur du Massés), mariée en 1623, morte le 2 septembre 1667; mademoiselle de Brienne (madame de Gamaches), et madame de Brienne la jeune, mariée en 1656, morte en 1664.
«La reine estimoit» la mère «pour son mérite (Mottev., t. 4, p. 293) et sa piété». C'étoit l'amie de madame de Motteville (t. 5, p. 234). Elle soigna avec dévoûment la reine-mère dans sa longue et triste maladie.
Madame de Brienne la jeune étoit fille du comte de Chavigny:
Pour mettre leur pouvoir au jour,
Le ciel, la nature et l'amour,
De corail, d'ivoire et d'ébène
Firent Brienne,
Firent Brienne.
Elle étoit donc belle. Elle étoit sage aussi:
Un prélat à Pont-sur-Seine
Adresse souvent ses pas
Pour voir la chaste Brienne,
Pleine de divins appas;
Mais c'est pour lui chose vaine
S'il y va crotter ses bas.
Somaize la désigne, à ce qu'il paroît, sous le nom de la précieuse Bérélise (t. 1, p. 38, 228). Mais arrêtons-nous. Le destin de ce livre veut que quand les gens sont sages nous n'en parlions pas beaucoup.
91
À la fin de 1650.
92
«Merlou, autrefois Mello, bourg avec un château, une église collégiale, un prieuré, une maison religieuse de filles, etc., dans le Beauvoisis, élection de Clermont, à deux lieues ouest-nord-ouest de Creil. C'est une ancienne baronnie qui relève du roi et appartient à la maison de Luxembourg. Elle avoit donné le nom à une illustre maison, éteinte il y a environ trois cents ans, et de laquelle étoit Dreux de Mello, connétable de France sous Philippe-Auguste. Celles de Nesle, d'Offemont, de Montmorency et de Bourbon-Condé, l'ont possédée successivement.
«Le château est sur une hauteur; c'est un bâtiment très ancien.» (Expilly.)
93
Cinquième fils de Henri II de Bourbon-Condé, né le 11 octobre 1629, mort le 21 février 1666 à Pézenas, où il eut une cour très littéraire. Molière y fut son poète favori, ce qu'il ne faut pas oublier pour son honneur.
Conti avoit la tête foible. Destiné d'abord à l'Église, abbé de Saint-Denis et de Cluny, puis renégat de dévotion (en 1646), général, et général médiocre; dévot une seconde fois; puis libertin, amoureux; puis dévot de rechef, prétendant au chapeau rouge, et encore renégat; irrésolu enfin, rebelle, sujet dévoué, enthousiaste, sceptique, girouette des plus aisées, il a une physionomie à lui.
Armand de Conti avoit passé sa thèse en Sorbonne; ce fut l'occasion d'une querelle qu'Amelot de La Houssaye (t. 1, p. 37) a indiquée. Le goût de ces exercices, des discours, des oraisons, des petites pièces pompeuses, lui demeura. Le plus curieux de ses écrits est assurément ce vœu explicite (V. Amelot de La Houssaye, t. 2, p. 143), qui fut trouvé dans les papiers de sa très chère sœur, madame de Longueville.
«Parmi les lettres et les papiers de feue madame la duchesse de Longueville se trouve la copie d'un vœu que M. le prince de Conty avoit fait en 1653 à Bordeaux d'entrer et de mourir dans la compagnie de Jésus. Le voici en la forme qu'il étoit écrit:
Jesus, Maria, Joseph, Angelus custos,
Beatus Pater Ignatius.
Omnipotens, sempiterne Deus, ego Armandus de Bourbon, licet undecumque divino tuo conspectu indignissimus, fretus tamen pietate ac misericordia infinita, et impulsus tibi serviendi desiderio, voveo coram sacratissima Virgine Maria et curia cœlesti universa, divinæ majestati tuæ castitatem perpetuam, et propono firmiter Societatem Jesu me ingressurum, in qua vivere et mori ad majorem tuam gloriam ardentissime cupio. A tua ergo immensa bonitate et clementia infinita per Jesu Christi sanguinem peto suppliciter ut hoc holocaustum in odorem suavitatis admittere digneris, et, ut largitus es ad hoc desiderandum et offerandum, sic etiam ad explendum gratiam uberem largiaris. Amen. Datum Burdigalæ die 2 Februari, purificationi B. Mariæ Virginis consecrata, et sanguine meo subsignatum, anno Domini 1653, ætatis meæ 23 cum quatuor mensibus.
«Armandus de Bourbon.
«Sancta Maria, mater Dei et virgo, ego te in dominam, patronam et advocatam eligo, rogoque enixe ut me adjuves ad servandum votum meum et ad executioni mandandum propositum meum. Amen.»
Latin médiocre, vœu de maniaque, que la sainte Vierge n'a point exaucé. Cette pièce n'en a pas moins son agrément.
Nous avons vu que ce jésuite aimoit Bussy, qu'il cultivoit le vers badin et la prose salée. Au besoin il faisoit un sermon et anathématisoit les spectacles.
Allons aux sources, interrogeons Choisy d'abord: «Conti avoit une sorte d'esprit indécis, voulant et ne voulant pas, changeant d'avis, alternativement dévot et voluptueux, d'une santé médiocre, d'une taille très contrefaite».
Un peu plus loin (p. 625), le vénérable Choisy contrecarre M. Cousin et ses douces légendes: «Chacun sait comme quoi ce prince s'abandonna à la passion éperdue qu'il eut pour madame de Longueville.»
Ne criez pas haro sur Choisy; Lenet (p. 474) dit bien la même chose: «Ce jeune prince avoit pris une folle passion pour la duchesse de Longueville, sa sœur, quelques années avant sa prison, et se l'étoit mise si avant dans le cœur, qu'il ne songeoit qu'à faire des choses extrêmes pour lui en donner des marques.»
Il dit même que la manie du vœu l'avoit déjà pris dans sa prison. Cette fois, ce n'étoit pas jésuite qu'il vouloit être: il se donnoit au diable corps et âme. L'homme se doit d'être moins prodigue de son moi, d'où qu'il vienne. En attendant Dieu ou le diable, Conti se donnoit volontiers et souvent aux dames, qu'il aimoit, et auxquelles son rang, sa figure et son esprit plaisoient, malgré les défauts de sa taille. Condé le railloit; Conti le provoqua (Saint-Simon, t. 1, p. 16).
Laigues lui voulut faire épouser mademoiselle de Chevreuse (Mottev., t. 4, p. 182), en 1651; lui-même courtisoit madame de Sévigné. Enfin il arriva (V. les Mém. du marq. de Chouppes et de Gourville), poussé par Cosnac, par Sarrazin et d'autres, à épouser une fille de madame Martinozzi, qui avoit de la beauté et de la vertu. Condé ne fut pas flatté de voir son frère neveu du cardinal.
Il y a ceci de remarquable dans l'histoire de Conti que Louis XIV, malade en 1663, jeta les yeux sur lui, préférablement à tout autre, pour lui confier le gouvernement après sa mort (Motteville, t. 5, p. 187).
Madame de La Fayette le dit aussi.
94
François VI de La Rochefoucauld n'a rien oublié pour se faire bien connoître. Il a laissé un petit livre, cinquante pages immortelles, et des Mémoires: en 1658, il écrit: «Je suis d'une taille médiocre, libre et bien proportionnée; j'ai le teint brun, mais assez uni; le front élevé et d'une raisonnable grandeur; les yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés. Je serois fort empêché de dire de quelle sorte j'ai le nez fait, car il n'est ni camus, ni aquilin, ni gros, ni pointu, au moins à ce que je crois; tout ce que je sçais, c'est qu'il est plutôt grand que petit et qu'il descend un peu trop bas. J'ai la bouche grande, les lèvres assez rouges d'ordinaire et ni bien ni mal taillées. J'ai les dents blanches et passablement bien rangées. On m'a dit autrefois que j'avois un peu trop de menton; je viens de me regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est, et je ne sçais pas trop bien qu'en juger. Pour le tour du visage, je l'ai ou carré ou en ovale; lequel des deux? Il me seroit fort difficile de le dire. J'ai les cheveux noirs, naturellement frisés; et avec cela assez épais et assez longs pour pouvoir prétendre à une belle tête.
«J'ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine: cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisant, quoique je ne le sois point du tout. J'ai l'action fort aisée, et même un peu trop, et jusqu'à faire beaucoup de gestes en parlant. Voilà naïvement comme je pense que je suis fait au dehors, et l'on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus n'est pas fort eloigné de ce qui en est.»
En 1648, il étoit encore prince de Marcillac; madame de Motteville dit: «Ce seigneur étoit peut-être plus intéressé qu'il n'étoit tendre (Mottev., t. 3, p. 128). Il avoit beaucoup d'esprit et l'avoit fort agréable, mais il avoit encore plus d'ambition» (t. 3, p. 154).
En 1643, elle ajoutoit à son nom (t. 2, p. 9) cette phrase: «Ami de madame de Chevreuse et de la dame de Hautefort, qui étoit fort bien fait, avoit beaucoup d'esprit et de lumière, et dont le mérite extraordinaire le destinoit à faire une grande figure dans le monde.»
Il n'est pas nécessaire d'être diffus lorsqu'il s'agit d'une personne que tout le monde connoît si bien.
95
Son affaire est bonne. C'est le Desfonandrès de Molière. Il avoit de la réputation; on le consulte lorsque Mazarin va mourir. «Charlatan, dit Guy Patin, charlatan s'il en fut jamais; homme de bien, à ce qu'il dit, et qui n'a jamais changé de religion que pour faire fortune et mieux avancer ses enfants.»
Il fit avorter en effet, lorsqu'elle eut occasion de le désirer, madame de Châtillon. Un petit Nemours, qui eût peut-être été un hardi capitaine ou un brillant abbé, disparut ainsi.
96
Bossuet a tout dit pour sa gloire. Ce fut un grand général et un grand esprit. Le petit portrait que Bussy lui consacre n'est pas une si mauvaise chose pour n'être pas une oraison funèbre.