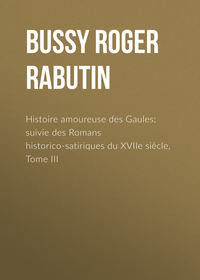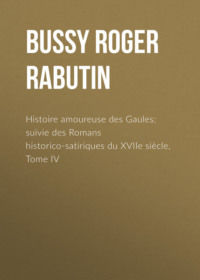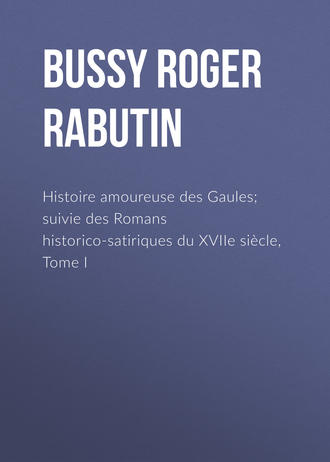
Полная версия
Histoire amoureuse des Gaules; suivie des Romans historico-satiriques du XVIIe siècle, Tome I
«D'ordinaire, les personnes de ce caractère, pour dire un bon mot, en hasardent cent de méchans, et l'expérience fait voir que les plus habiles dans ces jeux d'esprit n'en ont pas dit, en toute leur vie, deux douzaines de tout à fait bons. La raison qu'on en peut rendre, c'est que les bons mots sont des fruits qui viennent sans être cultivés. Tout d'un coup ils naissent, et tout d'un coup ils font leur effet, comme les éclairs. Ils surprennent autant ceux qui les disent que ceux qui les écoutent. Ce sont, pour ainsi dire, de petits libertins qui ne veulent dépendre que d'eux-mêmes. Quand on les cherche ils ne viennent pas, ou, s'ils viennent, c'est de mauvaise grâce, se faisant tirer à force, et se défigurant en se faisant tirer. A-t-on dit un bon mot, le plaisir et les louanges qu'on en reçoit excitent la vanité et la présomption naturelle à en produire plusieurs tout de suite; mais ce sont ou des monstres ou des avortons. On en rit soi-même pour les faire trouver bons; mais personne n'en rit, parcequ'en effet ils ne sont pas bons.
«Madame de Cornuel n'avoit pas un de ces défauts. Elle ne parloit point par vanité, mais par raison, et avec autant de jugement que d'esprit. Comme elle savoit que les véritables bons mots ne dépendent point de nous, elle se contentoit de les produire avec ce beau naturel qui en est comme la fleur, sans presque y toucher. Mais, comme il y a des influences du ciel qui tombent plus heureusement sur de certaines terres que sur d'autres, il semble aussi que les bons mots viennent aussi plus aisément à la bouche des personnes qui savent leur donner un beau tour et les bien exprimer. Tout ce que disoit madame de Cornuel, elle le disoit bien, et jamais pas une de ses paroles n'a été rejetée par les personnes d'un goût raffiné, parceque, outre qu'elles renfermoient toujours un grand sens, elles étoient toujours belles et bien choisies. C'étoit autant de sentences et de maximes, tenant en cela du génie des Salomon, des Socrate et des César, qui ne parloient que pour instruire; génie grand et heureux qui s'est réveillé de nos jours dans MM. de La Rochefoucauld et Pascal, et enfin dans madame de Cornuel, qui auroit dû écrire ses sentences et ses maximes, si, comme les oracles, elle ne s'étoit contentée de dire les vérités et les laisser écrire aux autres.»
L'éloge est en règle; il n'est pas au dessus du sujet. Je ne puis songer à enregistrer maintenant ces mots excellents, et me bornerai à dresser la liste d'indications dont j'ai parlé: Titon du Tillet (Parnasse françois); Tallemant des Réaux (chap. 299); Paulin Paris (Notes aux Lettres, t. 5, p. 139); Sévigné (t. 3, p. 31, édit. Didot, t. 3, p. 47); Vigneul de Marville (t. 1, p. 341, Recueil d'ana); La Place (Pièces curieuses, t. 3, p. 377); Conrart (p. 270); Le Père Brottier (Paroles mémorables, p. 85); Sévigné (8 septembre 1680, 11 septembre 1676, 7 octobre 1676, 16 mars 1672, 6 mai 1672, 17 avril 1676); Quatremère de Quincy (Ninon de Lenclos); Tallemant (t. 10, p. 187, de la 3e édition); La Place (t. 1, p. 202); Tallemant (t. 4, p. 185, édit. P. Paris); Tallemant (t. 3, p. 245, 160); Lettres de Bussy (28 avril 1690); Tallemant (t. 2, p. 411); La Place (t. 1, p. 377); Ménagiana (édit. de La Monnoye, t. 1, p. 317, 332, 354; t. 2, p. 8, 124, 131, 407); Lettres de Madame (t. 1, p. 130, 129); Tallemant (t. 1, p. 388, note); Tallemant (t. 2, p. 170, 411); Saint-Simon (t. 1, p. 116); Dangeau (t. 4, p. 449); Walckenaer (Mémoires sur Sévigné, t. 5, p. 13; t. 1, p. 39; t. 1, 260), et Guy Patin, Loret, mademoiselle de Montpensier, les Mercures, les Gazettes, les Romans, les Poésies du temps.
52
Le mot cher, ainsi employé, vient des Précieuses.
53
En 1658, vers la fin de l'année.
54
La mode d'aller aux eaux n'est pas nouvelle. On les aimoit extrêmement au XVIIe siècle. J'en pourrois donner beaucoup de preuves; il faut nous contenter de celle-ci, qui ne nous fait pas sortir du cercle de nos connoissances. En 1658, précisément en l'année où nous sommes, mademoiselle de Montpensier, selon son habitude régulière, va aux eaux de Forges. Elle dit: «La maréchale de La Ferté étoit à Forges. Madame d'Olonne y vint, madame de Feuquières de Salins, mademoiselle Cornuel (Margot), force dames de Paris.» (Montp., t. 3, p. 325.)
Les eaux de Forges passent pourtant pour être de celles dont les qualités ne sauroient être recherchées par les héroïnes de Bussy.
55
Tout cela est long, bien long. Aussi, dans quelques éditions, a-t-on supprimé en cet endroit quatre ou cinq pages. Sans vouloir faire le juré-mesureur de style, il me semble que ces quatre ou cinq pages ne sont pas les meilleures de Bussy, si elles sont de lui. Il a ordinairement la plume plus légère, le tour plus libre, la pensée plus claire.
56
M. le duc d'Anjou auroit pu prétendre au rôle des Candale et des Guiche; mais il préféra aux belles quelques uns de ses amis. Madame de Motteville l'a peint lorsqu'il étoit encore jeune (1647, t. 2, p. 267): «Il seroit à souhaiter, dit-elle, qu'on eût travaillé à lui ôter les vains amusemens qu'on lui a soufferts dans sa jeunesse. Il aimoit à être avec des femmes et des filles, à les habiller et à les coiffer; il sçavoit ce qui seyoit à l'ajustement mieux que les femmes les plus curieuses, et sa plus grande joie, étant devenu grand, étoit de les parer et d'acheter des pierreries pour prêter et donner à celles qui étoient assez heureuses pour être ses favorites. Il étoit bien fait; les traits de son visage paroissoient parfaits; ses yeux noirs étoient admirablement beaux et brillans, ils avoient de la douceur et de la gravité; sa bouche étoit semblable en quelque façon à celle de la reine, sa mère; ses cheveux noirs, à grosses boucles naturelles, convenoient à son teint, et son nez, qui paraissoit devoir être aquilin, étoit alors assez bien fait. On pouvoit croire que, si les années ne diminuoient point la beauté de ce prince, il en pourroit disputer le prix avec les plus belles dames; mais, selon ce qui paroissoit à sa taille, il ne devoit pas être grand.» Il ne le fut pas en effet, et sa figure s'épaissit un peu; mais il n'en fut pas moins beau à la façon des efféminés. Il eut de temps en temps des velléités d'amour naturel, mais jamais elles ne durèrent. Madame d'Olonne, et, un peu plus tard, la gracieuse et plaintive duchesse de Roquelaure, faillirent être aimées. Pour ce qui est de madame d'Olonne, mademoiselle de Montpensier (t. 3, p. 405; 1659) vient en aide à Bussy et développe son texte: «Comme le roi fait toujours la guerre à Monsieur, un jour il lui demandoit: «Si vous eussiez été roi, vous auriez été bien embarrassé; madame de Choisy et madame de Fienne ne se seroient pas accordées, et vous n'auriez su laquelle vous auriez dû garder. Toutefois, ç'auroit été madame de Choisy; c'étoit elle qui vous donnoit madame d'Olonne pour maîtresse. Elle auroit été la sultane reine; et, lorsque je me mourois, madame de Choisy ne l'appeloit pas autrement.» Monsieur étoit fort embarrassé sur tout cela, et disoit au roi, d'un ton qui paroissoit sincère, qu'il n'avoit jamais souhaité sa mort, et qu'il avoit trop d'amitié pour lui pour se résoudre à le perdre. Le roi lui répondit: «Je le crois tout de bon.» Puis il disoit: «Lorsque vous serez à Paris, vous serez donc amoureux de madame d'Olonne? Le comte de Guiche le lui a promis, à ce que l'on mande de Paris.» Monseigneur rougit, et la reine lui dit d'un ton de colère: «C'est bien vous faire passer pour un sot que de promettre ainsi votre amitié! Si j'étois à votre place, je trouverois cela bien mauvais. Pour vous, qui admirez en tout le comte de Guiche, vous en êtes ravi.» Puis elle ajouta: «Cela sera beau de vous voir sans cesse chez une femme qui peste continuellement contre vous, et qui n'a ni honneur, ni conscience. Vous deviendrez un joli garçon!» Monsieur dit qu'il ne la verroit pas.»
Tout efféminé qu'il étoit, et peut-être même en raison de son caractère, Monsieur paroît avoir eu quelques grands élans de sensibilité. Il éclate en sanglots à la mort de sa mère; il est alors plus affligé fils que Louis XIV (Montp., t. 4, p. 95). À la mort de madame de Roquelaure il montre aussi une tristesse enfantine. Nous demanderons à sa femme, madame la Palatine, de nous achever son portrait. Il aimoit passionnément le bruit des cloches, jusqu'à revenir exprès à Paris la veille de toute grande fête carillonnée: à l'automne, quand les dernières feuilles, jaunies, déjà glacées, tremblent au bruit des sonneries de la Toussaint; au printemps, quand le chant joyeux des cloches de Pâques s'envole, comme un essaim de jeunes oiseaux, au travers des sérénités du ciel bleu. Avec cela il étoit joueur, mauvais joueur même (Lettres, t. 1, p. 48). Il n'aimoit pas la chasse et il ne consentoit à monter à cheval que pour aller à la guerre, où il se conduisit en bon capitaine. Il écrivoit avec une telle négligence qu'il ne pouvoit se relire; du reste, il écrivoit peu (t. 1, p. 257). Madame raconte tranquillement qu'elle n'avoit pas grand plaisir au lit avec lui (t. 1, p. 300) et qu'il ne vouloit pas être dérangé pendant son sommeil. Il étoit superstitieux (t. 2, p. 276), et Madame le surprit à promener des médailles bénites, la nuit, sur les diverses parties de son corps de la santé desquelles il doutoit.
Il n'est pas probable que ce soit Madame qui ait tort (t. 1, p. 402), et les libelles ou les couplets qui aient raison, lorsqu'elle dit: «La maréchale de Grancey étoit la femme la plus sotte du monde. Feu Monsieur feignit d'être amoureux d'elle; mais si elle n'avoit pas eu d'autre amant, elle auroit certes conservé toute sa bonne renommée. Il ne s'est jamais rien passé de mal entre eux. Elle-même disoit que, s'il venoit à se trouver seul avec elle, il se plaignoit aussitôt d'être malade: il prétendoit avoir mal de tête ou mal de dents. Un jour la dame lui proposa une liberté singulière: Monsieur mit vite ses gants. J'ai vu souvent qu'on le plaisantoit à cet égard, et j'en ai bien ri. Cette Grancey avoit une fort belle figure et une belle taille lorsque je vins en France, et tout le monde n'avoit pas pour elle le même dédain que Monsieur, car, avant que le chevalier de Lorraine ne fût son amant, elle avoit déjà eu un enfant.»
La femme défend bien son mari. Mieux vaudroit pour lui qu'elle pût se plaindre. Elle ne le flatte pas, d'ailleurs, et raconte parfaitement (27 janvier 1720) tous ses travers: «Feu Monsieur aimoit beaucoup les bals et les mascarades; il dansoit bien, mais c'étoit à la manière des femmes; il ne pouvoit danser comme un homme, parcequ'il portoit des souliers trop hauts.»
Achevons avec dix lignes de Saint-Simon (t. 3, p. 170):
«Monsieur, qui, avec beaucoup de valeur, avoit gagné la bataille de Cassel, et qui en avoit montré toujours de fort naturelle en tous les siéges où il s'étoit trouvé, n'avoit d'ailleurs que les mauvaises qualités des femmes. Avec plus de monde que d'esprit et nulle lecture, quoique avec une connoissance étendue et juste des maisons, des naissances et des alliances, il n'étoit capable de rien. Personne de si mou de corps et d'esprit, de plus foible, de plus timide, de plus trompé, de plus gouverné, ni de plus méprisé par ses favoris, et très souvent de plus mal mené par eux.»
57
Quelque délicatesse est de temps en temps indispensable. Rien ne nous oblige, toutes les fois qu'un nom se présente, à rechercher tous les souvenirs guillerets qu'il peut rappeler et à vouloir absolument enluminer toutes nos notes de couleurs voyantes. C'est affaire aux gens qui écrivent les Crimes des rois de France et autres ouvrages de cette force de raconter comment toute reine a été nécessairement une Messaline. Anne d'Autriche, même en admettant bien des choses, a été une femme digne d'estime, une mère de famille pleine de dignité, une reine indulgente et honnête. Ce qu'on a dit des affaires arrivées du temps de Louis XIII et ce qui arriva sous la régence ne la déshonore en rien. Elle ne fut pas galante, elle ne fut pas coquette, encore moins débauchée. On ne peut lui reprocher que d'avoir aimé un peu, et ce n'est pas ici le lieu d'être si impitoyable. Les pamphlets ne doutent jamais de rien. En voici un qui a de l'audace (Cat. de la Bibl. nat., t. 2, n. 3547): Les Amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, avec M. le C. de R., père de Louis XIV; Cologne, P. Marteau, 1693, in-12.
Le brillant Montmorency se déclara, dès 1626, le chevalier de la reine (Tallem., t. 2, p. 307). À Castelnaudary, sur le champ de sa défaite, il portoit le portrait d'Anne d'Autriche lorsqu'il fut pris (Vittorio Siri, Memorie Recondite, t. 7), et cela, dit-on, rendit Louis XIII inflexible au jour de sa condamnation. De simples gentilshommes, avant ce fou de Jarzay, se mirent à l'aimer: ainsi d'Esguilly-Vassé (Tallem., t. 2, p. 241). Bellegarde (Roger de Saint-Lary) employa Malherbe à exprimer sa passion, et l'on a un pont-breton de Voiture qui indique l'heure où le duc de Bellegarde dut cesser de faire le beau poète:
L'astre de Roger
Ne luit plus au Louvre;
Chascun le descouvre,
Et dit qu'un berger
Arrivé de Douvre
L'a fait deloger.
Qui ne connoît, de ce même Voiture, la pièce charmante adressée à la reine-régente, pièce dans laquelle il lui rappelle ce temps de pastorales, de fêtes romanesques, de scènes de chevalerie, et dans laquelle il ose lui dire: «Lorsque vous étiez
Je ne veux pas dire amoureuse;
La rime le veut toutefois.»
Tout le scandaleux de l'amourette Buckingham, Tallemant (t. 2, p. 10) l'a resserré en une très courte phrase. Il n'y a rien de plus à imaginer que des folies:
«Ce qui fit le plus de bruit, ce fut quand la cour alla à Amiens, pour s'approcher d'autant plus de la mer: Bouquinquant tint la reyne toute seule dans un jardin; au moins il n'y avoit qu'une madame du Vernet, sœur de feu M. de Luynes, dame d'atours de la reyne; mais elle estoit d'intelligence et s'estoit assez éloignée. Le galant culebutta la reyne et luy escorcha les cuisses avec ses chausses en broderies; mais ce fut en vain.»
Pour le mariage de la régente avec le cardinal Mazarin, on ne voit pas qu'il soit plus possible d'en douter, et rien n'est plus facile à excuser et à comprendre.
Dès le temps de la première Fronde, nul n'étoit ignorant de la liaison formée entre la mère du roi et le ministre. Un couplet dit en 1650:
Mazarin, plie ton paquet:
Notre roi est devenu sage;
Ton adultère lui déplaît.
Si mesdames de Motteville, Talon et la duchesse de Nemours disculpent la reine, les mémoires de Brienne le fils (t. 2, p. 40, 337), ceux de Retz, les Lettres de Madame, et la Correspondance même de Mazarin (Lettres inédites, publiées par M. Ravenel, p. 491), maintiennent l'opinion générale. Madame, dont il ne faut pas se défier obstinément, et qui a pu être bien instruite, dit en propres termes (27 septembre 1718): «La reine-mère, veuve de Louis XIII, a fait encore bien pis que d'aimer le cardinal Mazarin: elle l'a épousé. Il n'étoit pas prêtre, et n'avoit pas les ordres qui pussent empêcher de se marier.»
C'est encore Madame (16 avril 1718) qui dit: «La reine-mère avoit l'habitude de manger énormément quatre fois par jour.» Si cela est, ses enfants ont tenu d'elle. Mais il faut finir par quelque morceau de panégyrique. Madame de Motteville s'offre à nous pour cette besogne, qui lui a tant plu.
Vers les derniers moments de la vie de la reine, quand son affreuse maladie redoublait de pourriture, madame de Motteville fait un retour sur le passé (t. 5, p. 248): «La grandeur de sa naissance l'avoit accoutumée à l'usage des choses délicieuses qui peuvent contribuer à l'aise du corps, et sa propreté étoit sur cela si extrême, qu'on pouvoit s'étonner doublement quand on voyoit que sa vertu la rendoit si dure sur elle-même. Selon ses inclinations naturelles et selon la délicatesse de sa peau, ce qui étoit innocemment délectable lui plaisoit; elle aimoit les bonnes senteurs avec passion. Il étoit difficile de lui trouver de la toile de batiste assez fine pour lui faire des draps et des chemises, et, avant qu'elle pût s'en servir, il falloit la mouiller plusieurs fois pour la rendre plus douce.»
Elle s'étoit maintenue propre et agréable fort long-temps. En 1661, sa fidèle amie (t. 5, p. 112) l'affirme: «Quoique elle approchât alors de soixante ans, elle étoit encore aimable, et, sans flatterie, on pouvoit dire qu'elle avoit de grandes beautés. Outre qu'elle avoit de la fraîcheur sur le visage, ses belles mains et ses beaux bras n'avoient rien perdu de leur perfection, et les belles tresses de ses cheveux étoient de même grosseur et de même couleur qu'elles avoient été à vingt-cinq ans.»
Décidément elle n'avoit pas été laide. Écoutons madame de Motteville en 1644 (t. 2, p. 71): «Il y avoit un plaisir non pareil à la voir coiffer et habiller. Elle étoit adroite, et ses belles mains, en cet emploi, faisoient admirer toutes leurs perfections. Elle avoit les plus beaux cheveux du monde; ils étoient fort longs et en grande quantité, qui se sont conservés long temps sans que les années aient eu le pouvoir de détruire leur beauté…
«… Après la mort du feu roi elle cessa de mettre du rouge, ce qui augmenta la blancheur et la netteté de son teint.»
58
Au dessous des deux raies circulaires qui s'élevoient du milieu du front et gagnoient le derrière de l'oreille.
59
J'ignore absolument ce que signifie cette manière de parler, et ne l'expliquerai pas.
60
Voyez ce qu'on a dit de Guiche et de Manicamp.
61
Toutes les fois qu'il y a, comme pour mademoiselle de Montpensier, des mémoires qui nous restent, cela nous dispense de la plus grande partie de notre tâche. La grande Mademoiselle n'a pas besoin d'une notice. Née en 1627, elle a déjà passé la trentaine au moment où nous la rencontrons. Elle étoit grande, fort blonde, d'une haute mine, pétrie de fierté et affable, rieuse au besoin; amie de l'extraordinaire, peu habituée aux rigueurs de l'orthographe et curieuse de romans, voire même de poésies; précieuse assez, point libertine, mais mal satisfaite du célibat. Bussy ne lui déplaisoit pas. On connoît sa vie, sa jeunesse active, ses prouesses sous les murs d'Orléans et à la porte Saint-Antoine, ses mariages manqués, ses amours avec Lauzun, son admiration pour Condé.
J'ai dit qu'elle aimoit les écrits et n'écrivoit pas correctement. En voici la preuve fournie par le bibliographe G. Peignot (Documents authentiques sur les dépenses de Louis XIV, p. 44):
«À Choisy, ce 5 août 1665.
«Monsieur le Sr Segrais qui est de la cadémie et qui a bocoup travalie pour la gloire du Roy et pour le public aiant este oublie lannee passée dans les gratifications que le Roy a faicts aux baus essprit ma prie de vous faire souvenir de luy set un aussi homme de mérite et qui est a moy il y a long tams lespere que sela ne nuira pas a vous obliger a avoir de la consideration pour luy set se que je vous demande et de me croire
«Monsieur Colbert
Votre afectionee amie
«Anne-Marie Louise d'Orléans.»
De même son courage, soutenu par son humeur aventureuse, est incontestable; néanmoins elle étoit peureuse (Montp., t. 2, p. 383) et avoit particulièrement peur des morts (t. 2, p. 418). En 1648, madame de Motteville (t. 3, p. 102) disoit d'elle: «Elle avoit de la beauté, de l'esprit, des richesses, de la vertu, et une naissance royale. Cette princesse crut que toutes ces choses ensemble pouvoient mériter cet honneur. Sa beauté, néanmoins, n'étoit pas sans défaut, et son esprit, de même, n'étoit pas de ceux qui plaisent toujours. Sa vivacité privoit toutes ses actions de cette gravité qui est nécessaire aux personnes de son rang, et son âme étoit trop peu portée par ses sentiments. Ce même tempérament ôtoit quelquefois à son teint un peu de sa perfection en lui causant quelques rougeurs; mais comme elle étoit blanche, qu'elle avoit les yeux beaux, la bouche belle, qu'elle étoit de belle taille et blonde, elle avoit tout à fait en elle l'air de la grande beauté.»
Et elle-même, dans son portrait (Mém. t. 4, p. 105), elle dit: «Je suis grande, ni grasse ni maigre, d'une taille belle et fort aisée; j'ai bonne mine, la gorge assez bien faite, les bras et les mains pas beaux, mais la peau belle, ainsi que la gorge. J'ai la jambe droite et le pied bien fait; mes cheveux sont blonds et d'un beau cendré; mon visage est long, le tour en est beau; le nez grand et aquilin, la bouche ni grande ni petite, mais façonnée et d'une manière fort agréable; les lèvres vermeilles, les dents point belles, mais pas horribles aussi; mes yeux sont bleus, ni grands ni petits, mais brillants, doux et fiers comme ma mine. J'ai l'air haut sans l'avoir glorieux.»
Sa statue, au Luxembourg, est loin d'être un chef-d'œuvre, mais elle ne la représente pas mal. Il y a à Versailles une dizaine de portraits d'elle: en bergère, en déesse, etc., et au naturel, qui ne lui nuisent pas tous.
Mademoiselle est née le 29 mai 1627, et elle est morte le 5 mars 1693.
À la suite de ses Mémoires on classe ordinairement divers écrits qui assurément ne sont pas d'elle, mais dont quelques uns ont vu le jour dans les réunions de son palais du Luxembourg. Ainsi:
1. Relation de l'île imaginaire. – 2. Histoire de la princesse de Paphlagonie. – 3. Portraits. – 4. Lettre à et de madame de Motteville. – 5. Réflexions morales et chrétiennes sur le livre de l'Imitation de Jésus-Christ. – 6. Un discours sur les béatitudes.
Nous ne parlerons pas de l'ouvrage les Amours de M. de Lauzun (t. 3 de l'Hist. amoureuse des Gaules, édition de 1740).
Somaize (t. 1, p. 56) la désigne sous le nom de la princesse Cassandane. Jean de la Forge l'a encensée sous le nom de Madonte. Vertron (Nouvelle Pandore, t. 1, p. 276) l'a louée également. Dans la satire des Vins de la cour, le vin de Mademoiselle est pétillant.
Mademoiselle a eu, tant qu'elle a vécu, les sympathies des gens de lettres. Encore aujourd'hui sa renommée est restée debout. Le canon de la Bastille, qui a tué son mari, lui a conquis un certain retentissement de gloire.
62
On a fait la vie de Lauzun. Elle ne seroit pas faite que les mémoires suffisent bien. Quel homme incompréhensible que ce favori, qui a une jeunesse si triomphante, une virilité si pavanée encore, et, dans la personne de son neveu, Riom, une vieillesse si vertement gaillarde!
Parmi les pièces historiques qui datent de la Fronde, la Bibliothèque nationale en possède une (Catal., t. 2, n. 3142) qui a pour titre: La défaite des troupes des sieurs de l'Isle-Bonne et du Plessis-Belière et Sauvebœuf par le comte de Lauzun, en Guienne (30 septembre), etc., 1652, in-4. Lauzun avoit juste vingt ans. Si c'est de lui qu'il s'agit, il commençoit bien. En 1660, aux fêtes de la Bidassoa, Antoine Nompar de Caumont est capitaine d'une compagnie des gardes à bec de corbin, charge de la famille (Montp., t. 3, p. 515); en 1668 il est nommé colonel-général des dragons (Daniel, t. 2, p. 505); en 1662 il avoit déjà tâté de la prison. «Il y eut de grandes intrigues, dit Mademoiselle (t. 4, p. 35) entre beaucoup de femmes de la cour, dans lesquelles M. de Péguilin fut mêlé et envoyé à la Bastille pendant sept ou huit mois, avec un ordre exprès du roi de ne lui laisser voir personne. Bien des gens sentirent sa prison avec douleur, et, quoique je ne le connusse pas dans ce temps-là aussi particulièrement que j'ai fait depuis, je ne laissai pas de le plaindre sur la réputation générale et particulière qu'il avoit d'être un des plus honnêtes hommes de la cour, celui qui avoit le plus d'esprit et le plus de fidélité pour ses amis, le mieux fait, qui avoit l'air le plus noble. L'histoire véritable ou médisante disoit qu'il faisoit du fracas parmi les femmes; qu'il leur donnoit souvent des sujets de se plaindre pour n'avoir pas la force d'être cruel à celles qui lui vouloient du bien. Ainsi elles se faisoient des affaires et lui attirèrent ce châtiment, qui ne lui étoit rude que par rapport à la peine qu'il souffroit d'avoir déplu au roi, pour lequel il avoit une amitié passionnée.»
Le style de ce morceau est vif, on y sent l'instinct de l'amoureuse, on y voit l'hyperbole dans ce mot: «le mieux fait».
Un fait certain, c'est que Lauzun étoit, suivant l'expression vulgaire, la coqueluche des dames de la cour. La plupart le vouloient pour amant. Cela tenoit à une certaine suffisance très apparente qui ne déplaît jamais lorsqu'elle n'est point fade, et à des qualités secrètes qui plaisent encore plus. Tout se sait, grâce à la médisance; on sut ce que Lauzun valoit, on le courtisa: il fut forcé d'être brusque, inconstant, et, avec cette brusquerie et cette inconstance, il ne contenta pas toutes les coquettes.