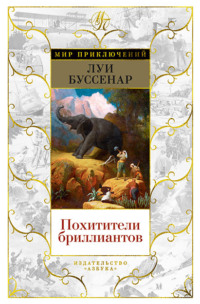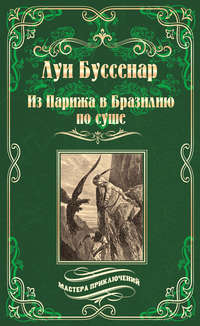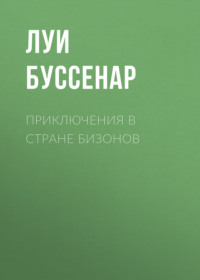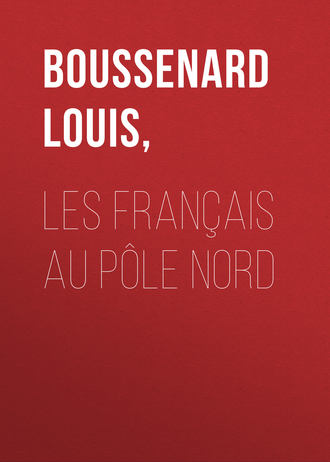
Полная версия
Les français au pôle Nord
Le capitaine allait donner l'ordre d'obliquer un peu à l'ouest, quand les gestes et les cris d'un petit groupe de matelots debout à l'avant, attirèrent son attention.
«Je te dis que c'est un ours.
– Je t'assure que c'est un homme.
– Peuh! dans ce pays cite! répliqua un organe bas-normand, ils sont habillés pareil au même.
– Mais, il y en a trois, d'ours… un gros et deux petits.
«Preuve qu'y sont blancs… autant dire jaune-soufre.
– Et que l'homme est marron.
– Et qu'y s'ensauve comme un quéqu'un qu'aurait le feu quelque part.
– Sûr qu'y vont lui manger ses aloyaux!
– Il n'a qu'à les faire monter à l'arbre, s'écrie Plume-au-Vent.
– Tu blagues, toi, Parisien! reprend le Normand, t'as pourtant un bon cœur, à preuve que t'as évu celui de me retirer de la grand'tasse, là ousque je buvais mon dernier coup.
– Parlons pas de ça, Guignard… d'abord t'es mon matelot.
– Eh!.. eh!.. s'écrient les marins, pas bête, l'homme!
«Y jette à l'ours son suroît en fourrure.
– … Pour gagner du temps!
– Et l'ours batifole avec le paletot.
– Oui, mais ça ne va pas durer longtemps.»
Le fugitif – c'est bien réellement un homme auquel donne la chasse un ours blanc monstrueux – détale à fond de train, en semant sur la glace quelques pièces de son habillement.
Mais le féroce plantigrade, talonné par la faim, ne se laisse plus prendre à cette ruse. Il galope avec cette allure si lourde en apparence, mais tellement rapide en fait, qu'elle peut égaler la vitesse d'un cheval.
L'homme auquel une terreur bien légitime semble donner des ailes, s'approche visiblement du navire. Mais il se trouve encore éloigné de quatre cents mètres, et l'ours gagne de plus en plus.
– Il faut à tout prix sauver ce malheureux, dit le capitaine.
– Stop!
«Parez la baleinière!
«Cinq hommes de bonne volonté!»
Le docteur et le lieutenant sont accourus, armés chacun d'une carabine à deux coups.
Les matelots se présentent en groupe, réclamant tous le périlleux honneur de combattre le monstre.
Un cri d'horreur échappe aux moins impressionnables. Le fugitif a glissé, puis s'est abattu lourdement. L'ours n'est plus qu'à deux pas de lui.
Un coup de feu retentit, et la balle frappant à un mètre de l'animal, fait voler un éclat de glace.
L'ours, un moment effrayé par le choc et le sifflement du projectile, s'arrête et regarde avec inquiétude le navire.
Ce répit, si court qu'il soit, permet à l'homme de se relever et de reprendre sa course, mais en zigzag.
Un second coup de feu se fait entendre, mais sans plus de résultat.
«Maladroit!» s'écrie le docteur tout dépité, en glissant deux cartouches métalliques dans le tonnerre de son arme encore fumante.
Le lieutenant fait feu à son tour et manque la bête qui semble invulnérable.
«Cent francs à qui l'abat,» dit le capitaine.
Castelnau arrivait portant de chaque main une carabine toute chargée.
Dumas le cuisinier, son tablier blanc relevé d'un bord, en triangle, comme un foc, l'arrête au passage.
«Donne-moi ça, petit, dit-il à l'armurier, et je veux toute ma vie manger de la cuisine au beurre si je ne gagne pas la prime.»
Avec une aisance parfaite, il saisit une carabine, la porte à l'épaule, met en joue et s'adressant au docteur avec sa familiarité provençale:
«Trois cents mètres… plein guidon, n'est-ce pas monsieur le dôtur?
– Plein guidon! et tâchez de faire mieux que moi.
– Eh!.. zou!»
Il ajuste trois secondes à peine et presse doucement la détente.
Paf!.. pîîî… îcth!.. il semble qu'on suive le sillage de la balle qui s'éloigne en sifflant.
Et soudain, l'ours fait un bond énorme, se dresse convulsivement sur les pieds de derrière, oscille et s'écroule sur le dos en gigotant.
«Tonnerre de Brest!.. un mathurin de Lorient n'eût pas mieux fait, s'écrie Guénic n'en pouvant croire ses yeux.
– Eh, millé dioux! il y en a encore deux autres, s'écrie le Provençal.
«Les petits… les mouçerons…
«Ce que ze vais t'éçeniller ces vermines!»
M. Dumas, superbe comme un capitan, la barbe hirsute, l'œil allumé, reçoit une cartouche, charge le canon droit de sa carabine, et avec le sang-froid d'un chasseur qui fusille des perdreaux, fait feu, deux fois coup sur coup.
Les deux oursons qui se sont arrêtés près du cadavre de leur mère, tressautent brusquement, et chose à peine croyable qui stupéfie littéralement l'équipage, tombent, foudroyés!
«Coup double! dit avec son large rire le cuisinier.
«Ce n'était pas plus difficile que ça!
– Sacrebleu! mon garçon, quel joli tireur vous faites!
– Oh! monsieur le dôtur, répond modestement Dumas, tout le monde pourrait en faire autant à Beaucaire.
«Seulement, on n'y trouve zénéralement pas d'ours.
– Très bien, Dumas, très bien! interrompt le capitaine.
«Je ne te connaissais pas ce talent, et puisque tu aimes la chasse, tu auras plus tard occasion de satisfaire ton goût.»
L'homme ainsi miraculeusement sauvé s'était avancé jusqu'au bord du chenal où venait de stopper la Gallia.
La baleinière, armée au moment où l'habile tireur accomplissait son exploit, abordait en deux coups de rame au glaçon au milieu duquel les trois ours frissonnaient leur agonie.
Sur un signe du patron, le malheureux à demi nu, tout grelottant, prenait place dans l'embarcation, pendant que deux matelots munis de grelins, allaient crocher les plantigrades pour les haler sur le pack.
Mais une difficulté se présente tout d'abord. L'ourse est tellement pesante, qu'on ne peut la mouvoir. Il faut un palan!
«Tron de l'air! monsieur le dôtur, c'est donc une bestiole conséquente? demande à son interlocuteur le Provençal.
– Le diable soit de votre bestiole!
«Mais, mon garçon, ça pèse au moins cinq cents kilos!
– Bagasse! monsieur… et moi qui n'ai zamais çassé que la grive et l'ortolan.
– Eh bien! ça vous a joliment fait la main.
«Ma foi, vous êtes digne de rivaliser avec le héros de Tarascon.
«Le grand… l'illustre Tartarin, votre homonyme.
– Faites excuse, monsieur le dôtur, mais je suis né natif de Beaucaire et zamais ze n'ai mis le pied à Tarascon.
«Ze ne sais pas qui est ce monsieur Tartareïn, dont ce mouçeron de Parisien m'a donné le surnom, et qu'il m'appelait chasseur de casquettes…
– Je vous ferai connaître ce héros dont un de nos plus illustres écrivains, votre compatriote, M. Daudet, a écrit les aventures extraordinaires, mais authentiques!
«Le livre est dans la bibliothèque, vous le dégusterez pendant l'hivernage.
«Et maintenant, comme à un tireur de votre force il faut une arme digne de lui, je suis heureux de vous offrir cette excellente carabine anglaise de Dougall.
– Mais, monsieur… je ne veux pas vous priver de…
– J'en ai une autre toute pareille.
«Allons ne faites pas la petite bouche… acceptez!..
«Sur ce, mon brave, allons voir vos victimes que l'on hisse en ce moment à bord.
«Nous ferons l'autopsie ensemble.»
VIII
Histoire d'Oûgiouk. – Comment on déshabille un ours polaire. – Capacité d'un estomac groenlandais. – Un amateur de tripes. – Symphonie de blanc et de bleu. – La tempête. – Déviations de la boussole. – A Port-Foulque. – Forêts en miniature. – A terre. – Tentative malheureuse d'un cocher improvisé. – Des effets d'une morue sèche sur un attelage récalcitrant. – Un ours blessé.
Le docteur n'avait point exagéré le poids réellement surprenant du monstre si proprement dépêché par Dumas dit Tartarin, cuisinier de la Gallia.
La femelle pesait cinq cent cinquante kilogrammes, et les oursons chacun trois cents.
Une véritable montagne de victuailles, et trois fourrures splendides qui furent préparées ultérieurement d'après le procédé groenlandais, par le nouveau passager, désormais en sûreté à bord, grâce au tour d'adresse exécuté par monsieur Dumas.
Le pauvre diable, fou de terreur, claquant des dents, à la pensée du danger auquel il a miraculeusement échappé, raconte son histoire.
Oh! très sommairement. Car, en sa qualité d'Esquimau pur sang, de nomade errant sur le désert de glace, il possède un vocabulaire des plus restreints. Une centaine de mots anglais ou danois, accrochés de bric et de broc, en fréquentant les baleiniers.
Quelques matelots de la Gallia sont eux-mêmes nantis d'un nombre égal d'expressions groenlandaises.
Avec beaucoup de gestes et pas mal de bonne volonté, on finit par s'entendre.
L'homme était le chef d'un petit clan anéanti l'année précédente par la variole. Ainsi réduit à une épouvantable solitude, il avait hiverné sur la côte, dans une hutte de neige. Manquant de provisions, réduit à manger ses chiens, il cherchait à rallier Upernavik, au moment où la goélette franchissant la baie de Melville se trouvait arrêtée par les glaces.
L'apparition du navire modifia aussitôt ses intentions. Le prenant pour un baleinier, il résolut de venir offrir au capitaine ses services, ou tout au moins de lui demander assistance. Il se mit en marche sur le floe, mais, tout en cheminant, fut éventé de loin par une famille d'ours blancs qui lui donnèrent la chasse.
Telle fut à peu près la substance du récit, nécessairement fort incomplet, que fit à ses sauveurs le Groenlandais Oûgiouk, c'est-à-dire le Grand-Phoque, dont le nom revint à satiété, pendant la narration.
Il termina en disant qu'il avait faim, qu'il avait soif, et ne savait que devenir. Les capitaines blancs en général étant des pères pour les Esquimaux, le capitaine de la goélette était son père, à lui, Oûgiouk. Il ne pouvait, par conséquent, le laisser dans la détresse. Bref un petit boniment point maladroit, et rendu intéressant par la bonne figure sympathique et la situation cruelle du postulant.
Bien que d'Ambrieux eût résolu en principe de n'adjoindre à son œuvre que des éléments exclusivement français, l'humanité lui faisait un devoir de garder à bord le Grand-Phoque. Impossible, en effet, de le rapatrier, puisque le temps manquait. Impossible également de le renvoyer à Upernavik avec un traîneau, des vivres et des chiens, le nombre de ces auxiliaires à quatre pattes étant à peine suffisant.
Donc, Oûgiouk restera sur la goélette en qualité de passager.
Enfin rassuré sur les éventualités du lendemain, se croyant matelot pour tout de bon, passablement excité par une rasade copieuse qui l'a fortement allumé en éteignant sa soif, le Grand-Phoque devient étonnamment prolixe. Il baragouine, interpelle un à un les marins, veut savoir leur nom, court visiter les chiens et les fait aboyer avec fureur, en leur jetant des syllabes gutturales, et finalement revient près des trois ours.
Cet amas de chair fraîche l'attire, le fascine d'autant plus qu'il est à jeun, et que les provisions de la cambuse ne paraissent pas l'allécher outre mesure.
Ses petits yeux bridés scintillent comme des diamants noirs, sa bouche palissadée de défenses à rendre jaloux un morse, s'entre-bâille jusqu'à ses oreilles, et ses joues, de la nuance d'une vieille casserole graisseuse, se gonflent comme deux outres, quand l'hiatus qui sépare le nez du menton se ferme, dans le mouvement rythmique d'une mastication imaginaire.
Dumas s'est emparé de l'ourse, et armé du grand couteau professionnel, détache par principes la peau du colosse.
Mais les principes du maître-coq ne sont pas ceux de l'homme des glaces qui proteste avec véhémence, et finalement enlève des mains de son sauveur le vaste tranche-lard.
Avec une adresse merveilleuse et une célérité inouïe, ma foi, ce petit homme rabougri, tontonnant, remuant, bavard, coupe, rogne, dissèque, écorche, décolle, arrache, tant et si bien, que l'animal est déshabillé en un tour de main.
A présent, la curée.
C'est plus curieux encore. Un seul coup suffit à ouvrir l'abdomen et à faire surgir de la cavité béante, un véritable monceau d'entrailles fumantes.
Oûgiouk saisit le foie, crache dessus et le lance par-dessus bord au grand scandale du cuisinier.
«Laissez-le faire, interrompt le docteur.
«Il a parfaitement raison, car le foie de l'ours est très malsain.
«On peut même être empoisonné si on a l'imprudence d'en manger.
«Je profite de l'occasion pour vous recommander de vous en abstenir en toute circonstance, comme aussi du foie de phoque.»
Les viscères de l'ours sont absolument vides. Preuve que depuis longtemps l'animal était soumis à un jeûne rigoureux.
La constatation de ce fait amène un vaste rire sur la face camuse du Groenlandais. Sans perdre un moment, il tranche au niveau de l'orifice inférieur l'intestin, encore tout chaud, l'introduit dans sa bouche, et absorbe avec d'intraduisibles mouvements de tête et de cou.
La bouche est pleine et les bajoues gonflées comme celles d'un singe dévalisant un verger.
Ne pouvant plus, sous peine d'asphyxie, introduire un atome de substance, Oûgiouk, d'un second coup de tranche-lard, abat, au ras de ses lèvres, le bout de boyau, fait un violent effort de déglutition, et le paquet franchissant l'isthme du gosier, tombe dans les profondeurs insondables d'un estomac polaire.
Puis il recommence, avec ce mouvement de va-et-vient familier aux canards, entonne une bouchée dont le volume ferait reculer un chien d'équarrisseur, bleuit quand la masse filandreuse pénètre dans le pharynx… et continue de plus belle.
Tant et si bien que la tripaille entière, l'estomac compris, y passa sans encombre. En tout, une dizaine de kilogrammes.
Souriant, heureux, épanoui, le brave Esquimau se frotte avec une béatitude comique le ventre, puis, se ravisant tout à coup, semble se dire:
«Mais il y a encore de la place.
«De quoi loger un dessert, une friandise, un rien.»
L'épine dorsale de l'ourse est capitonnée, au niveau des reins, d'une couche de graisse jaune qui tire l'œil d'Oûgiouk.
«Allons! les dernières bouchées, les meilleures, celles qui font la joie du gastronome, celles qu'on absorbe pour le divin plaisir de la gourmandise.»
Et le Grand-Phoque arrache une pleine poignée de graisse encore tiède, emplit sa bouche, écouvillonne la charge avec ses doigts, et finit, après un tassement laborieux, par introduire jusqu'aux derniers vestiges.
Les matelots témoins de ce festin qui eût fait frémir le bon Gargantua, le grand amateur de tripes, sont littéralement confondus, sauf les baleiniers, depuis longtemps édifiés sur les capacités d'une panse groenlandaise.
Plume-au-Vent et Dumas n'en peuvent croire leurs yeux.
Le cuisinier, pendant cet engloutissement qui n'a pas duré plus de cinq minutes, est passé par les phases de la surprise, de l'étonnement, puis de la stupeur.
On l'entend murmurer:
«C'est pas un hôme… c'est un puits… un gouffre… un abîme…
– N'est-ce pas, hein! Dumas.
«Je ne connais, moi, que mon fourneau de chauffe pour être aussi vorace.
«Et encore!
– Et c'est du monde! pécaïre!
– Ça y ressemble, tout de même.»
Puis, s'adressant au bonhomme qui essuie ses mains à sa face, il ajoute:
«Dites donc, monsieur Untel, si le cœur vous en dit, je vous emmènerai après la campagne.
«Je veux vous conduire aux restaurants à trente-deux sous, là où l'on donne du pain à discrétion.
«Fiche mon billet que vous aurez du succès, et que le patron fera une de ces têtes!..»
Le digne Oûgiouk, comme s'il eût compris et apprécié l'offre du Parisien, sourit en signe d'aquiescement, lui tend sa patte huileuse, puis, avisant une place libre entre deux rouleaux de cordages, s'allonge, ferme les yeux et se met à ronfler.
Pendant cet épisode répugnant, mais authentique, la Gallia qui s'est avancée vers le Nord-Ouest, a trouvé les eaux libres et réussi enfin à franchir la baie de Melville.
Ce n'est pas à dire pour cela que la mer soit débarrassée des glaces flottantes. Mais, les floes en dérive ne sont plus soudés ensemble, leur contexture n'est plus aussi rigide, ni leurs bords aussi vifs. La débâcle est sans doute commencée un peu plus haut, car la neige est fondue en partie, et les hummocks, dont les croupes émergent des plaques horizontales, laissent suinter de minces filets d'eau.
De loin en loin apparaissent de gros icebergs dont les pointes, émoussées sous l'action incessante du soleil qui ne descend jamais au-dessous de l'horizon, se sont mamelonnées en grosses protubérances d'aspect débonnaire.
La glace n'a plus sa physionomie rechignée des jours froids. On la sent mollir, s'adoucir, se faire moins inhospitalière, se laisser pénétrer par l'alanguissante senteur du renouveau qui plane sur le désert arctique.
La mer, d'un bleu turquoise, moutonne gaiement au pied des blocs en dérive, dont la base transparaît comme un cristal sous le flot qui la désagrège. Au-dessus, le ciel, d'un azur intense, forme un fond sur lequel se détachent étrangement, presque sans perspective, et avec une singulière crudité, les masses bleuâtres, çà et là plaquées de blanc mat.
Une véritable symphonie de bleu et de blanc à désespérer un peintre et à faire hurler notre public habitué à d'autres aspects, surtout à d'autres conventions.
Rien qui puisse reposer l'œil ou le distraire de cette énervante monotonie qui n'est pas sans charmes, et de cette incessante mobilité qui transforme, à chaque minute, le tableau invariablement composé des mêmes éléments, et toujours semblable à lui-même.
De temps en temps, cet étrange paysage fait de taches nacrées, mouvantes sur un fond de saphir, prend un peu d'animation. C'est une masse qui chavire brusquement dans un remous, oscille et continue à dériver avec sa lenteur immuable. C'est aussi une plaque de neige qui se décolle et glisse dans la mer avec un petit clapotement très doux, à peine perceptible. Puis l'apparition de phoques à la figure bonasse, qui batifolent avec des gestes de nageurs savourant avec béatitude leur première pleine eau. Puis encore des oiseaux qui, abandonnant résolument leurs hivernages du Sud, s'en vont à tire-d'aile vers le Septentrion, se posent un moment sur la croupe d'un iceberg, et repartent effrayés par la toux saccadée de la machine. Les canards, les oies, les eiders accourent en bandes innombrables, puis des essaims bruyants de grives d'eau, de tourne-pierres, de bruants des neiges et de canuts. Ces derniers ont même déjà quitté leur livrée grise d'hiver, pour la rutilante parure des jours d'été.
Et quand parfois, à la vue de gros nuages blancs produits par la condensation des brumes du Nord, qui arrivent en flocons détachés glissant sur l'azur céleste, l'œil se porte involontairement sur l'azur des flots constellé de glaces dérivant languissamment, on se demande si l'on se trouve en présence d'images réelles ou si l'on n'est pas le jouet d'un mirage.
Le 8 juin, la Gallia se trouvait enfin par le travers du cap York, dont les falaises, revêtues de glaces, coupaient à une grande hauteur la ligne d'horizon.
Le soixante-quinzième parallèle venait d'être franchi, et la Gallia naviguait définitivement dans les eaux du Nord qui s'étendent depuis le cap jusqu'à l'entrée du détroit de Smith.
Le capitaine, plein d'espoir, comptait arriver en trois jours au cap Alexandre, célèbre par l'hivernage du docteur Hayes qui donna au fiord, où s'abrita en 1860 (par 78° 15′), son navire, le nom de Port-Foulque.
Trois degrés en trois jours, ce n'était point être exigeant, surtout si la mer conservait son calme, l'atmosphère sa sérénité. Mais, hélas! qui peut répondre non seulement du lendemain, mais encore de l'heure à venir, sous une latitude où les variations les plus inattendues se produisent instantanément.
A mesure qu'elle s'avance vers le Nord-Ouest, pour doubler le cap Atholl, la Gallia rencontre des glaces de plus en plus nombreuses. Une désagréable facétie de la mer libre qui, loin de justifier son nom, est aussi encombrée que la baie de Melville.
Peu à peu, la température, jusque-là si clémente, s'abaisse de plusieurs degrés, le vent qui soufflait du Sud tourne au Nord, et le baromètre subit une dépression considérable.
Ne voulant pas risquer d'être pris par un grain en vue des abruptes falaises qui s'étendent jusqu'au petit détroit de Wolstenholme, le capitaine fit forcer de vapeur, quitte à heurter les icebergs, et mit résolument le cap sur les îles Carry, où il espérait trouver la mer entièrement débarrassée.
Il comptait de là se diriger vers le cap Sabine, couper le détroit de Hayes en vue des îles Henry et Bache, puis s'abriter derrière les monts Victoria et Albert, en attendant la débâcle définitive. La route minutieusement relevée, les corrections faites à la boussole pour éviter toute erreur au timonier, d'Ambrieux ayant pris toutes les précautions dictées par l'expérience, se reportait par la pensée au temps où le vieux Baffin s'en allait, à l'aventure, sur son petit navire de cinquante tonneaux, stupéfait, en approchant du détroit auquel il allait donner le nom de Smith, de voir son compas dévier de quantités incroyables. Aussi écrivait-il sur son journal: «Ce détroit, qui court au Nord de 78°, est remarquable en un point, parce que là est la plus grande variation de la boussole connue dans le monde entier. Car, par de bonnes observations, j'ai trouvé qu'elle était déviée de plus de cinq quarts ou 56° vers l'Ouest, de sorte que le Nord-Est-quart-Est est lu sur la boussole correspondant au Nord vrai du monde, et ainsi du reste.»
Et il y avait de cela plus de deux siècles et demi! (272 ans.)
Aussi, d'Ambrieux montant un navire dont il avait pu apprécier les qualités, secondé par un excellent équipage, traitait-il de misères les empêchements auxquels il se heurtait, en comparaison des difficultés écrasantes qui étaient le lot de ces intrépides chercheurs.
Cependant le vent fraîchissait de plus en plus. La goélette, forcée de marcher debout à la lame et à la brise, tanguait rudement et embarquait presque à chaque coup.
Le ciel se couvrit de nuées épaisses, et la neige se mit à tomber abondamment.
Pour comble d'ennui, l'eau embarquée se gelait presque instantanément sur le pont bientôt couvert d'une nappe unie comme un miroir, qu'il fallut recouvrir d'escarbilles.
A peine si l'on put s'élever d'un demi-degré qu'il fallut changer la route et abandonner le projet de rallier les îles Carry. Il y eût eu plus que de la témérité à continuer dans de telles conditions. Quoi qu'il pût advenir, le péril était moindre à naviguer près des falaises, hautes de quatre cents mètres, qui, du moins, abritaient en partie le navire contre les rafales.
Brusquement le temps s'éclaircit. L'ouragan balaya les nuées, et le soleil apparut radieux, dardant ses flots de lumière sur les éléments déchaînés.
Mais la furie de la tempête ne désarme pas. Le cap Parry se montre au loin, par 77°, comme l'arête monstrueuse d'un cétacé battu par les flots qui le criblent d'une averse de glaçons. Sur le front des falaises où le vent fait rage, s'élèvent d'épais tourbillons de neige qui, saisis par le mouvement giratoire des trombes, s'éparpillent comme d'impalpables duvets, avec des poudroiements diamantés.
La mer est étrange, formidable et sinistre. Tout craque, tout détone, tout mugit. Les icebergs, heurtés comme des galets, s'écrasent et disparaissent, en quelque sorte volatilisés. Là-bas, en avant du cap, une barre de rochers noirs, dépouillés de leur croûte hivernale, émergent de l'écume laiteuse qui rejaillit en colonnes de vapeurs.
La goélette, après vingt heures de lutte sans merci, doubla enfin le cap, et trouvant le détroit de Murchison débarrassé, s'y engagea lentement.
Elle passa ensuite entre les îles Herbert et Northumberland, obliqua vers le fiord de Peterhavick et continua sa navigation côtière jusqu'au cap Sanmarez, au moment où la tempête s'apaisait enfin.
Le capitaine Georges Nares, favorisé par un temps exceptionnel, avait mis seulement deux jours – du 25 au 27 juillet 1875 – pour aller du cap York au cap Alexandre. Le commandant de la Gallia fut trop heureux, malgré un temps épouvantable, d'accomplir le même trajet en quatre jours.
Le lendemain, 12 juin, la goélette laisse à deux milles et demi, par tribord, l'île Sutherland, faite d'un grès très grossier profondément érodé par l'action des glaces.
Enfin voici le cap Alexandre, un superbe promontoire dont l'altitude atteint quatre cent vingt-sept mètres, et qui avec le cap Isabelle, situé sur l'autre rive, forme l'entrée du défilé connu de géographes sous le nom de détroit de Smith.
La Gallia le contourne de près, au point qu'on peut distinguer à l'œil nu la couleur fauve de ses assises, et la colonne basaltique dont il est surmonté. Elle pénètre enfin, avec des difficultés inouïes, dans le fiord de Port-Foulque où elle se trouve en sûreté.