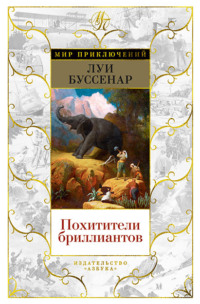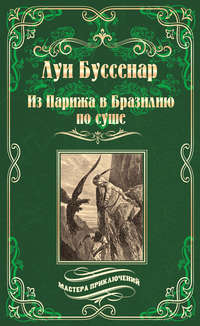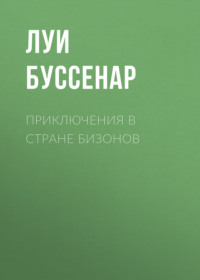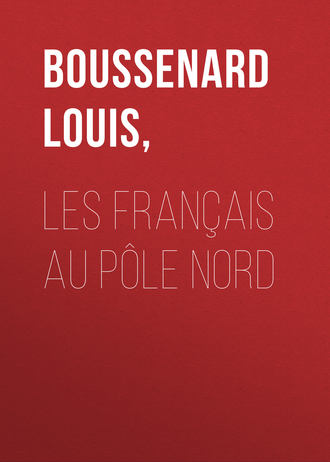
Полная версия
Les français au pôle Nord
«Voici pourquoi: c'est que depuis 1595, depuis Barentz, toutes les expéditions qui ont tenté de s'élever par la première, et elles sont nombreuses, ont été sans exception refoulées par les masses de glaces polaires dérivant constamment au Sud.
«A ce point que pas une seule n'a pu dépasser 80°.
– C'est parfaitement exact, car dans les années les plus favorables, c'est à peine si l'on a pu gagner cent milles au Nord.
– Donc, en dépit de l'engouement des géographes et des voyageurs allemands, dont mon patriotisme ne m'empêche pas de proclamer les mérites, cette route, à mon avis, doit être abandonnée.
«D'autant plus qu'elle ne laisse aucun espoir d'explorer une aire étendue, et que, en toutes circonstances, les découvertes accessoires en géologie, en botanique, en ethnologie, en géodésie ne sauraient être opérées.
«Voyez-vous, docteur, les faits sont là!
«Pensez donc que depuis cent vingt ans, les Russes, les Suédois, les Hollandais et les Anglais se sont heurtés constamment à une difficulté matérielle ne laissant pour ainsi dire aucun espoir.
«Jugez-en plutôt.
«En 1764, Vassili Tchitchakoff est brutalement arrêté par les glaces par 80° 26′. En 1773, les Anglais Phipps et Lutwidge, ayant à bord un volontaire qui devint notre ennemi acharné, Nelson, atteignirent 80° 30′. Puis, ce fut Buchan qui en 1818 arrive à 80°… Clavering et Sabine, immobilisés comme Phipps et Lutwidge à 80° 30′… Parry, incapable, en 1829, de dépasser 79° 33′.
«Exceptionnellement, les Suédois atteignent en 1868 la latitude 81° 42′. Mais cette même année, l'Allemand Karl Koldeway, commandant la Germania, s'arrête à 81° 5′, et en 1870 est pris dans les glaces par 77° 1′.
«Vous citerai-je enfin Leigh-Smith arrivant en 1871 à 81° 24′, alors que Scoresby, en 1806, montait à 81° 30′? Et l'échec du lieutenant suédois Palander… et celui plus récent de Leigh-Smith, qui par trois fois lutte en désespéré pour revenir vaincu?.. Et cette terrible campagne du Tégetthoff commandé par des hommes comme le capitaine autrichien Weyprecht et l'intrépide lieutenant Payer! Un désastre, docteur… un désastre qui se termine par la perte du navire, sans autre résultat que de pouvoir dresser un cairn par 79° 61′.
«Donc, impossibilité reconnue, du moins jusqu'à présent, de s'élever plus haut que les Suédois en 1871.
– Cet historique est singulièrement éloquent, répond le docteur, et je comprends que vous n'ayez pas hésité…
– A choisir l'autre voie.
«Par le détroit de Smith, on a du moins la presque assurance d'atteindre les Eaux du Nord, impitoyablement barrées du côté du Spitzberg.
«C'est là un immense avantage, puisqu'on peut toujours ainsi s'élever de plusieurs degrés au Nord.
«Je ne vous ferai pas l'énumération des expéditions polaires entreprises de ce côté.
«Nous aurons occasion d'en parler au fur et à mesure que nous avancerons.
«Je vous dirai seulement comment je compte procéder, sauf modifications, suivant les exigences du moment.
«Vous savez que l'Eau du Nord s'étend, depuis la baie de Pond sur la côte occidentale, et s'en va vers le Nord-Ouest jusqu'au cap York.
– Parfaitement, capitaine, et les variations de ces eaux libres sont insignifiantes.
– Vous savez également qu'il y a, pour atteindre l'Eau du Nord, trois routes à travers la Glace du Milieu qui la borde au Midi.
«La première est celle que les baleiniers ont appelée le Passage du Nord. Il longe la côte du Groenland, et c'est, dit-on, le plus sûr.
«La seconde passe se trouve au centre de la baie, dans la masse en dérive. On l'appelle pour cette raison le Passage du Milieu. On ne doit le tenter que plus tard, quand on peut raisonnablement croire que les glaces de la baie de Melville sont brisées. La troisième enfin, appelée Passage du Sud, est le long de la côte Ouest de la baie de Baffin. On ne peut la franchir que plus tard encore, vers la fin de l'été, ou quand les vents du Sud ont longtemps soufflé.
«Puisque le Passage du Nord est plus sûr, je l'ai choisi, bien qu'il semble plus long, pour des voiliers s'entend.
«Chose indifférente pour nous qui montons un vapeur.
«Il fallait, autrefois, vingt-cinq jours pour franchir la baie de Melville, ce que fit le premier, en 1616, le vieux Baffin dans un rafiot de cinquante-cinq tonneaux.
«En 1874, la flotte à vapeur des baleiniers anglais mit deux jours.
«Comme la saison est peu avancée, peut-être serons-nous plus longtemps.
«Peu importe, d'ailleurs… l'essentiel est de passer, et nous passerons!.. dussé-je user sur les packs l'éperon d'acier de la Gallia.
– Parbleu! répond le docteur qui, depuis la première attaque, ne doute plus de rien.
– Du reste, continue le capitaine, les glaces de la baie de Melville sont moins redoutables que je ne le croyais.
«Elles sont également plus légères que celles du Spitzberg où elles atteignent jusqu'à sept ou huit mètres d'épaisseur.
«Elles n'ont guère ici que deux mètres… Ce qui d'ailleurs suffit à mon ambition.
– Mais, capitaine, il me vient une idée, à propos du grand Pack du Spitzberg qui empêche les explorateurs de dépasser 80°.
– Dites, mon cher docteur.
– La route que nous suivons est la meilleure, je n'en disconviens pas; et pourtant, depuis près de soixante ans, malgré les plus vaillants efforts, on n'a même pas réussi à gagner un degré, c'est-à-dire, depuis Edouard Parry qui fut contraint de s'arrêter par 82° 45′.
– Sans doute; mais du moins les navires peuvent s'avancer beaucoup plus loin, comme le Polaris de l'Américain Hall qui, en 1871, put hiverner par 82° 16′, en un point que nul autre bâtiment n'avait jamais atteint.
«On est en droit de se demander jusqu'où fût allé, en traîneau, un homme de la trempe de Hall, quand la pusillanimité de son équipage et de son second Sydney Buddington le forcèrent à rétrograder.
«La voie du Nord n'était-elle pas ouverte aux traîneaux dont Hall appréciait si vivement les services?
«Voyez-vous, docteur, il est essentiel d'hiverner le plus loin possible dans la direction du Pôle, comme le comprit si bien sir Georges Nares qui put amener son navire, l'Alert en face le cap Sheridan, et 8′ plus loin que Hall conduisit le Polaris, c'est-à-dire par 82° 24′.
«De cette latitude élevée, le second du capitaine G. Nares, l'intrépide lieutenant Markham, put piquer en traîneau droit au Nord et arriver, le 12 mai 1876, après une marche terrible de trente-neuf jours, à 83° 20′, là où jamais voyageur n'avait posé le pied.
«C'est ce qu'avait également senti le lieutenant américain Greely dont l'expédition, si féconde en résultats de toute sorte, fut malheureusement frappée de revers affreux.
«N'ayant pas de navire à lui, Greely se fit conduire avec ses hommes et son matériel, par le vapeur Proteus, jusqu'à la baie de la Discovery, ainsi nommée en souvenir de l'hivernage du second navire de sir Georges Nares.
«Puis Greely, s'installa bravement avec son personnel par 81° 44′ pendant que le Proteus retournait en Amérique avec promesse de revenir, au bout de trois ans, chercher l'expédition.
«S'étant ainsi condamné à un exil volontaire de trente-six mois, le vaillant officier fit bâtir Fort Conger, pour les besoins de l'hivernage, et attendit patiemment la saison de 1881 pour commencer les explorations.
«Secondé par des hommes admirables, votre collègue, notre infortuné compatriote, le docteur Pavy, et surtout l'héroïque lieutenant Lockwood, et des sous-officiers de son régiment, le Signal-Corps, on peut dire qu'il accomplit des merveilles.
«C'est ainsi, notamment, que Lockwood put arriver, en traîneau, jusqu'à 83° 23′, dépassant de 3′ le lieutenant Markham, en enlevant aux Anglais une victoire si chèrement conquise sur tous leurs devanciers.
«Par malheur, Lockwood, qui n'était pas à bout de vivres et moins encore d'énergie, fut arrêté par les eaux libres.
«Là, où sir Georges Nares avait trouvé les blocs informes et monstrueux, s'étendant à perte de vue sur les flots invisibles d'une mer qu'il croyait à jamais emprisonnée, au point qu'il lui donna le nom d'océan Paléocrystique, Lockwood rencontra des passes navigables… et il n'avait que son traîneau!
«Qui peut prévoir jusqu'où il se fût avancé, s'il eût seulement disposé d'un misérable canot groenlandais!
– Il est évident qu'une pareille contradiction donne fort à penser.
«Cette région mystérieuse est véritablement féconde en surprises.
«On ne peut en effet taxer de légèreté un observateur aussi expérimenté, aussi consciencieux que le commodore anglais…
«Il a réellement constaté la présence de glaces dont la structure, le volume, la contexture indiquaient une formation très ancienne… il a cru de bonne foi qu'elles étaient là depuis des siècles, et supposé, selon toute vraisemblance, qu'elles y resteraient indéfiniment…
– Et six ans après, elles n'existaient plus!
– De telle façon que Markham et Lockwood sont immobilisés presque au même point, le premier par d'infranchissables hummocks, alors qu'il espérait trouver les eaux libres, le second par ces mêmes eaux libres, alors que, confiant dans l'affirmation de sir Georges Nares, il croyait continuer son voyage sur le champ de glace!
– Que comptez-vous faire?
– Ce double échec renferme un enseignement que je n'oublierai pas.
«J'aviserai en temps opportun, et je m'arrangerai, vous pouvez m'en croire, de façon à passer là où l'Anglais et l'Américain ont dû rétrograder.
«Vous verrez cela, docteur, ou la glace polaire sera mon tombeau.»
VII
La goélette arrêtée par les glaces. – Une idée du capitaine. – Beaucoup d'efforts et un peu de dynamite. – Formidable explosion. – Voie libre. – Est-ce un homme, est-ce un ours? – Trois ours et un homme. – Poursuite. – Manqué! – Où le docteur trouve son maître et n'est pas jaloux. – Les exploits d'un cuisinier. – Digne de son illustre homonyme le grand Tartarin. – Montagne de viande fraîche.
«Sapristi! la baie de Melville se défend.
– Sûr, qu'elle se défend, monsieur le docteur, opine gravement le maître d'équipage.
– Ma parole! nous sommes bloqués.
– Faudrait voir.
– Cela me semble vu… tout à fait vu.
«Depuis vingt-quatre heures le froid a repris brusquement, les chenaux sont refermés, les floes sont soudés les uns aux autres et pas moyen de les attaquer à coups d'éperon, puisque la goélette, immobile comme une bouée, ne peut ni avancer ni reculer.»
Le vieux baleinier, toujours très calme se hausse au-dessus de la lisse, regarde au loin le morne champ de glace, la main en avant, au-dessus des sourcils, et semble humer l'air comme un chien de chasse.
«Eh bien! maître Guénic, interrompt le docteur agacé de ce long silence.
– Dame! monsieur le docteur, cela fait vingt-quatre heures de perdues, et c'est tant pis pour le capitaine, vu qu'il est pressé.
– Voilà tout ce que vous trouvez à dire?
– C'est-y la peine de se déralinguer la fressure pour une chose que ni vent, ni marée, ni vapeur, ni soleil ne peuvent empêcher.
«Le capitaine a voulu passer un peu trop tôt, c'est vrai.
«Mais, il est le maître.
«D'ailleurs, y avait chance.
– Et maintenant?
– Y a toujours chance.
«Quelques heures de vent du sud, un peu de soleil, et tout ce mauvais pavage s'en ira en dérive.
– Et s'il n'y a ni vent du sud, ni soleil?
– M'est avis que faudra patienter.
«A moins que le capitaine n'ait une idée.
«Il est le capitaine.
– Mon brave Guénic vous êtes exaspérant, avec votre sang-froid.
– Vous savez bien, monsieur le docteur, que le sang-froid, c'est la vertu du marin, vous qu'êtes un fin matelot de la flotte de Terre-Neuve.
– Mais, à Terre-Neuve, il s'agit simplement de pièces de cent sous représentées par des morues.
«Peu importe d'arriver un peu plus tôt, un peu plus tard… le chargement se complète toujours.
«Tandis qu'ici, nous luttons pour la gloire… l'honneur du pavillon est en jeu.
«Une semaine de retard peut amener une catastrophe irréparable.
– Euh!.. moi et les autres, nous sommes prêts à risquer nos os pour les couleurs.
«Mais, voyez-vous, la glace est toujours la glace.
– Vous voulez dire qu'elle existe pour nous comme pour notre concurrent.
«Et s'il trouve une passe libre, lui!
– Ça ne me paraît guère possible.
«Et puis, ce n'est jamais qu'un Allemand, et le capitaine doit avoir son idée.
«Voilà!
«… Tiens!.. pas possible!..
«Ah! malheur!
– Qu'y a-t-il encore, bon Dieu!
– Causons bas, monsieur le docteur.
«Y a que nous dérivons.
– Ah!.. Nous avançons en arrière!
«Eh bien! c'est du propre!
«Je cours, avertir le capitaine.
– Pas besoin, allez!
«Sûr qu'y sait la chose, et qu'il a son idée.
– Tu as raison, mon vieux Guénic, interrompt une voix bien connue et je vais la mettre, sans tarder, à exécution.
– Je m'en doutais bien, allez, capitaine, dit avec une déférence affectueuse le maître en chavirant lestement, par-dessus bord, le paquet de tabac dont il exprime le jus avec sensualité.
– Quant à vous, docteur, répond l'officier, je vais vous faire assister à un feu d'artifice comme vous n'en avez jamais vu.
«Une brute d'obstacle matériel m'arrêterait!..
«Sangdieu! Je ne serais plus moi!
«Allons, Guénic, en haut le monde, et leste!»
Le maître porte aussitôt à ses lèvres son sifflet d'argent, en tire des sons aigus, fignolés de trilles et de roulades qui font accourir au pied du mât de misaine l'équipage tout entier.
«Le charpentier! dit brièvement le capitaine.
– Présent! répond Jean Itourria le second Basque, compatriote du pilote des glaces.
– Descends avec quatre hommes au magasin et apporte douze tarières… les plus grandes.
«C'est compris?
– Oui, capitaine.
– Guénic, un falot.
– Oui, capitaine.
– Va m'attendre au panneau de la soute aux poudres et emmène avec toi l'armurier, Castelnau, et ton matelot Le Guern.
– Oui, capitaine.»
L'officier rentre dans son appartement et revient presque aussitôt portant une clef, celle de la soute probablement.
Tous quatre enfilent l'escalier de l'arrière, s'arrêtent devant une petite porte que le capitaine ouvre lestement, et pénètrent dans un réduit assez vaste, où sont rangées symétriquement une infinité de caisses fermées avec des boulons.
Le capitaine en choisit deux marqués d'un D majuscule, les fait enlever aux matelots et ajouta:
«Portez cela sur le pont et en douceur, garçons.»
Par les soins du charpentier, les tarières sont déjà rangées au pied du mât.
Avec une clef anglaise, l'armurier déboulonne les caisses qui apparaissent doublées de cuivre à l'intérieur, avec une lame obturatrice en caoutchouc entre le couvercle et les bords.
Chacune renferme une centaine de cylindres en gros papier verni, longs de vingt-cinq centimètres et portant à peu près cinq centimètres de diamètre. Puis, une fine cordelette noirâtre lovée sur elle-même, comme un brin de filin, et une petite boîte contenant des étoupilles analogues à celles dont se servent les artilleurs.
C'est tout.
Le capitaine ajoute, s'adressant à l'armurier:
«Ces cartouches renferment chacune cent cinquante grammes de dynamite.
«La charge est suffisante pour briser la glace dont l'épaisseur ne dépasse pas deux mètres.
– Certainement, capitaine.
«Les carriers de la forêt de Fontainebleau font éclater, avec des cartouches de même dimension, des blocs de grès non moins épais.
– Et tu sais la manière de les mettre en état de faire explosion.
– Oui, capitaine.
«Comme la dynamite ne produit son effet détonant que si elle est enflammée par une étoupille, il suffit de percer, dans le sens de la longueur, la cartouche avec un poinçon, et de glisser dans le trou l'étoupille munie d'un bout de cordon Bickford.
– Bien!
«Tu sais également charger un trou de mine.
– Oui, capitaine.
«Les fragments de glace pilée amenés par les tarières, fourniront d'excellents matériaux.
«Il est très facile, d'autre part, de calculer la longueur que doit avoir le cordon Bickford pour provoquer l'explosion dans un temps plus ou moins long, et à volonté.
– A merveille!
«Et maintenant, que chacun se tienne paré pour m'accompagner.
«Guénic, fais descendre sur la glace les outils et les deux caisses.
Le capitaine se rendit à la machine et appela Fritz Hermann, le maître mécanicien.
– Fritz, lui dit-il, tu vas chauffer et atteindre le maximum de pression.
«Tu as trois heures pour cela.
«J'ai besoin de tout le monde, tu garderas avec toi un seul chauffeur.
– Bien, capitaine! je serai paré dans trois heures.»
D'Ambrieux remonta sur le pont, donna l'ordre au second de rester à bord avec un timonier, puis commanda:
«Tout le monde sur la glace!
«Vous nous accompagnez, n'est-ce pas, docteur?»
Puis, il descendit le dernier, prit la tête de la petite troupe composée de quatorze hommes portant, les uns les tarières, les autres les caisses de cartouches et se mit en marche vers le nord en comptant ses pas.
Quand il eut ainsi parcouru mille mètres il s'arrêta et dit aux marins:
«Espacez-vous de dix en dix mètres, dans la direction du navire, et creusez dans la glace chacun un trou avec votre tarière.
«Ne dépassez pas en profondeur cinquante centimètres.
«Et du leste, garçons! car le temps presse; il y aura double ration une fois la besogne terminée.»
Sans plus tarder, les matelots s'alignent au pas gymnastique et attaquent l'énorme couche de glace avec tant d'adresse et de vigueur qu'en douze minutes, montre en main, les dix trous sont creusés à la profondeur voulue.
«A ton tour, dit le capitaine à l'armurier qui, pendant ce temps, a garni d'étoupilles un certain nombre de cartouches.
– Je vous prierai, capitaine, de m'indiquer combien de temps doit s'écouler entre l'inflammation de la mèche et l'explosion?
– Une demi-heure.
– Alors, il faut une brasse de cordon, répond l'armurier, en déroulant la petite ficelle noirâtre.»
Puis il la tronçonne en longueurs égales, pendant que le capitaine s'entretient à voix basse avec Guénic.
– C'est compris, n'est-ce pas?
– Compris, oui, capitaine.
«C'est égal, vous avez là une crâne idée, termine le maître avec la respectueuse familiarité des vieux serviteurs.»
Castelnau ayant ainsi fractionné le cordon Bickford, introduit dans le premier trou une cartouche, le remplit avec de la glace pulvérisée par la tarière, la tasse du pied et allonge le même cordon qui apparaît, comme un morceau de fil téléphonique.
«C'est très bien, observe le capitaine satisfait, tu n'as plus qu'à continuer.»
Le forage est poussé activement, mais, au lieu d'opérer en suivant la direction occupée par les dix premiers trous de mine s'étendant sur une longueur de cent mètres, les matelots se sont portés à dix mètres sur la gauche.
Puis, une nouvelle ligne de cent mètres étant ainsi minée, ils reviennent sur la droite, dans le prolongement de la première.
On comprend sans peine le but de cette disposition intelligente.
D'Ambrieux ne voulant rien laisser au hasard, s'est dit avec raison, que l'explosion d'une série de pétards exposés sur une seule ligne pourrait disloquer un espace insuffisant.
Aussi a-t-il pris soin de l'interrompre tous les cent mètres et de la doubler, en quelque sorte, en lui donnant la disposition d'un créneau.
Il est à supposer que tout en économisant la main-d'œuvre et la substance explosive, il aura le même résultat que si les deux lignes étaient continues dans toute leur étendue.
Cependant le travail poussé avec une énergie fiévreuse touche à sa fin.
Les derniers trous de mine, par conséquent les plus rapprochés du navire, sont chargés.
La Gallia, immobile comme dans un dock et flottant toujours, halète sur place et dégage d'énormes tourbillons de fumée noire. Le sifflet de la machine pousse un hurlement prolongé, Fritz est prêt.
Le capitaine envoie chercher à bord un long bout d'amarre goudronnée, le fait couper en dix morceaux. Chaque matelot reçoit un de ces morceaux, l'enflamme, et va se placer à chacune des sections de la ligne représentant un groupe de dix trous de mine répartis sur une longueur de cent mètres.
Le second, attentif à cette évolution, constate que tout le monde est à son poste et transmet un ordre au mécanicien par le télégraphe de la machine.
Pour la seconde fois, le sifflet se met à mugir. Les hommes, disséminés sur la glace, prévenus par ce signal, allument, avec un ensemble parfait, et tout en courant, chacun dix bouts de cordon.
Dix minutes après, les plus éloignés ont rallié le navire agité de sourdes trépidations.
Puis, tous ces braves matelots un peu essoufflés de cette course succédant à un travail auquel ils ne sont pas habitués, savourent le nectar versé par M. Dumas, et comptent les minutes.
Bien que nul ne doute parmi eux du succès, ils sont anxieux, énervés. Les loustics eux-mêmes ne songent guère à plaisanter. On sent, du reste, qu'en pareil moment, une facétie raterait comme un pétard mouillé.
Un quart d'heure s'écoule, et l'on n'entend d'autre bruit que celui de la vapeur fusant sous les soupapes.
On compte presque les secondes! et quinze paires d'yeux rivés sur la surface bleuâtre s'hypnotisent dans une fixité inquiète.
Soudain, à un kilomètre de la Gallia, surgit un long jet de vapeur blanchâtre qui s'élève à plus de dix mètres, et brusquement s'arrondit en coupole au sommet. Bien avant que le bruit de la détonation soit parvenu à la goélette, un second faisceau de fumée jaillit de la lourde carapace qui recouvre les eaux, puis un troisième, et tout à coup, l'explosion simultanée de toutes les mines.
Un coup sourd, étouffé, pas très intense retentit avec un tel ensemble, que l'on dirait un feu de peloton exécuté par des soldats d'élite.
Puis, sous le nuage qui flotte à cinq ou six mètres, on perçoit l'irrésistible poussée de débris informes, arrachés, broyés, effondrés. Tout craque, tout gémit, tout se disloque aussi loin que la vue peut s'étendre. Des pans entiers, soulevés par une de leurs extrémités, se dressent à pic, oscillent et retombent au milieu de cascades qui roulent, grossissent, et accourent vers le navire.
Encore une fois vainqueurs de l'inerte résistance des forces de la nature, les matelots poussent un long cri d'enthousiasme auquel succède un ronflement bien connu.
Au commandement du chef, l'hélice, captive depuis plus de trente-six heures, se met à tourbillonner avec rage, et la Gallia, mettant le cap sur la déchirure, s'élance au milieu des eaux libres, balayant comme des fétus, sous sa puissante étrave, les glaçons en dérive.
Très fiers de leur exploit, heureux de cette victoire sur la banquise, l'ennemi qu'ils détestaient déjà, les marins n'en peuvent croire leurs yeux, à mesure qu'ils avancent, tant le spectacle de cette destruction est complet, effrayant.
Eh quoi! un semblable anéantissement est l'œuvre de trente livres de dynamite!
Mais ce n'est pas tout. Le capitaine comptait sur une passe de dix ou douze mètres; et par endroits, elle en mesure cinquante. En outre, ce choc effroyable, cette poussée qui, à l'inverse de celle produite par la poudre, s'opère de haut en bas, s'est fait sentir on ne sait à quelle profondeur.
La preuve, c'est qu'on aperçoit, à droite et à gauche, des phoques assommés, foudroyés, immobiles, le ventre en l'air, avec une infinité de poissons de toute grosseur, de toute espèce.
Ne craignant plus d'être emprisonnés, confiant d'ailleurs dans les ressources de son arsenal, le capitaine ordonne de stopper un moment, afin de faire hisser à bord quelques-unes des victimes, et procurer à ses hommes des vivres frais.
Dix minutes suffisent à une pêche réellement miraculeuse, puis la goélette reprend son envolée vers les eaux libres, et accompagnée des craquements retentissant de la glace disloquée jusqu'à une distance qu'on ne peut apprécier.
C'est au point que, le choc se répercutant ainsi de proche en proche, on voit parfois les glaciers de la côte osciller, puis s'effondrer et détacher d'immenses glaçons qui se mettent à dériver en tournoyant.
Déjà le chenal improvisé par la seule volonté de l'intrépide officier était franchi. Quelques heures encore de navigation sans entraves, et la baie de Melville serait traversée.