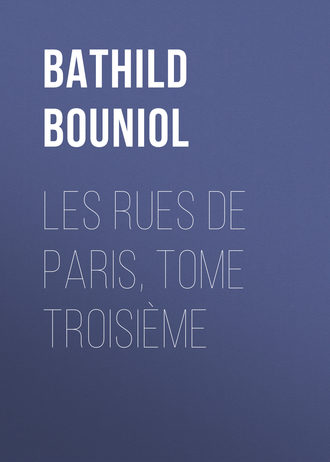
Полная версия
Les Rues de Paris, tome troisième
Les éloges les plus passionnés font difficilement contrepoids à de pareils aveux.
III
Michel-Ange au reste était plus sculpteur que peintre et les immortelles figures de Moyse, de la Nuit, du Pensiero ne laissent pas de doute à cet égard. Ce qui ne paraît pas moins certain, malgré les écarts signalés plus haut, c'est qu'il avait sur l'art en général, sur son but, sa mission, les idées les plus sublimes. Un document d'une haute importance puisqu'il émane d'un témoin oculaire, document découvert récemment, confirme de la façon la plus explicite cette opinion qui résulte pour tout judicieux critique de l'œuvre de Buonarroti pris dans son ensemble. Un contemporain de Michel-Ange, maître François de Hollande, architecte et enlumineur, avait été envoyé en Italie par le gouvernement portugais pour y étudier l'état des arts. À son retour, il écrivit la relation de son voyage ayant pour titre: Dialogue de la Peinture dans la ville de Rome. Cet ouvrage dont l'authenticité ne paraît point douteuse, quoiqu'il soit resté manuscrit jusqu'à ces derniers temps16, fut écrit vers 1549. Il renferme, dans sa narration un peu diffuse, quelques pages relatives à Michel-Ange d'un intérêt singulier et qui donnent un caractère tout nouveau, admirable et puissamment sympathique à cette étonnante figure qui nous apparaissait, dans son lointain, non pas seulement austère, mais rébarbative et farouche. La narration si naïvement sincère de maître François de Hollande nous la montre sous un jour tout différent.
«Dans le nombre de jours que je passai ainsi dans cette capitale, il y en eut un, ce fut un dimanche, où j'allai voir, selon mon habitude, messire Lactance Tolomée qui m'avait procuré l'amitié de Michel-Ange par l'entremise de messire Blosio, secrétaire du pape. Ce messire Lactance était un grave personnage, respectable autant par la noblesse de ses sentiments et de sa naissance que par son âge et par ses mœurs. On me dit chez lui qu'il avait laissé commission de me faire savoir qu'il se trouvait à Monte-Cavallo, dans l'église Saint-Silvestre, avec madame la marquise de Pescara, pour entendre une lecture des épîtres de saint Paul; je me transportai donc à Monte-Cavallo. Or, madame Vittoria Colonna, marquise de Pescara, sœur du Seigneur Ascanio Colonna, est une des plus illustres et des plus célèbres dames qu'il y ait en Italie et en Europe, c'est-à-dire dans le monde. Chaste et belle, instruite en latinité et spirituelle, elle possède toutes les qualités qu'on peut louer chez une femme. Depuis la mort de son illustre mari17, elle mène une vie modeste et retirée; rassasiée de l'éclat et de la grandeur de son passé, elle ne chérit maintenant que Jésus-Christ et les bonnes études, faisant beaucoup de bien à des femmes pauvres et donnant l'exemple d'une véritable piété.
«… M'ayant fait asseoir, et la lecture se trouvant terminée, elle se tourna vers moi et dit: «Il faut savoir donner à qui sait être reconnaissant, d'autant plus que j'aurai une part aussi grande après avoir donné que François de Hollande après avoir reçu. Holà! un Tel, va chez Michel-Ange, dis-lui que messire Lactance et moi nous sommes dans cette salle bien fraîche, qui est fermée et agréable, demande-lui s'il veut bien venir perdre une partie de la journée avec nous, pour que nous ayons l'avantage de la gagner avec lui.»
Quelques instants après, on frappait à la porte qui fut ouverte, et Michel-Ange, que le serviteur par fortune avait rencontré à peu de distance, entra. La marquise se leva pour le recevoir, puis le fit asseoir entre elle et messire Lactance. «Après un court silence, la marquise, suivant sa coutume d'ennoblir toujours ceux à qui elle parlait ainsi que les lieux où elle se trouvait, commença avec un art que je ne pourrais imiter ni décrire, et parla de choses et d'autres avec beaucoup d'esprit et de grâce sans jamais toucher le sujet de la peinture, pour mieux s'assurer du grand artiste. On voyait la marquise se conduire comme celui qui veut s'emparer d'une place inexpugnable par ruse et par tactique, et le peintre se tenir sur ses gardes, vigilant comme s'il eût été l'assiégé.
«Vous avez, dit-elle entre autres choses à Michel-Ange, vous avez le mérite de vous montrer libéral avec sagesse, et non pas prodigue avec ignorance; c'est pourquoi vos amis placent votre caractère au-dessus de vos ouvrages, et les personnes qui ne vous connaissent pas estiment de vous ce qu'il y a de moins parfait, c'est-à-dire les ouvrages de vos mains. Pour moi certes, je ne vous considère pas comme moins digne d'éloges pour la manière dont vous savez vous isoler, fuir nos inutiles conversations, et refuser de peindre pour tous les princes qui vous le demandent.
« – Madame, dit Michel-Ange, peut-être m'accordez-vous plus que je ne mérite… mais les oisifs ont tort d'exiger qu'un artiste, absorbé par ses travaux, se mette en frais de compliments pour leur être agréable, car bien peu de gens s'occupent de leur métier en conscience, et certes ceux-là ne font pas leur devoir qui accusent l'honnête homme désireux de remplir soigneusement le sien… Je puis assurer à Votre Excellence que même Sa Sainteté me cause quelquefois ennui et chagrin en me demandant pourquoi je ne me laisse pas voir plus souvent… Alors je réponds à Sa Sainteté que j'aime mieux travailler pour elle à ma façon que de rester un jour entier en sa présence, comme tant d'autres.
« – Heureux Michel-Ange! m'écriai-je à ces mots, parmi tous les princes il n'y a que les papes qui sachent pardonner un tel péché.»
La conversation continua très intéressante sur ce sujet, mais la rapporter nous entraînerait trop loin. La marquise cependant ne perdait point de vue son but qui était d'amener la peintre à parler de son art: «Demanderai-je à Michel-Ange, dit-elle enfin à Lactance, qu'il éclaircisse mes doutes sur la peinture?
» – Que Votre Excellence, répondit Michel-Ange, me demande quelque chose qui soit digne de lui être offert, elle sera obéie.
» – Je désire beaucoup savoir, reprit en souriant la marquise, ce que vous pensez de la peinture de Flandre?
» – Cette peinture, reprit Michel-Ange, semblera belle surtout à ceux qui sont sourds à la véritable harmonie. En Flandre, on peint de préférence, pour tromper la vue extérieure, soit des objets qui vous charment, soit des objets dont vous ne puissiez dire du mal, tels que des saints et des prophètes. D'ordinaire, ce sont des chiffons, des masures, des champs très verts ombragés d'arbres, des rivières et des ponts, ce que l'on appelle paysages et beaucoup de figures par-ci par-là; quoique cela fasse bon effet à certains yeux, en vérité, il n'y a là ni raison ni art, point de symétrie, point de proportions, nul soin dans le choix, nulle grandeur; enfin cette peinture est sans corps et sans vigueur, et pourtant on peint plus mal ailleurs qu'en Flandre. Si je dis tant de mal de la peinture flamande (celle de l'époque) ce n'est pas qu'elle soit entièrement mauvaise, mais elle veut rendre avec perfection tant de choses, dont une seule suffirait par son importance, qu'elle n'en fait aucune d'une manière satisfaisante. C'est seulement aux ouvrages qui se font en Italie que l'on peut donner le nom de vraie peinture. Et c'est pour cela que la bonne peinture est appelée italienne. La bonne peinture est noble et dévote par elle-même, car chez les sages rien n'élève plus l'âme et ne la porte davantage à la dévotion que la difficulté de la perfection qui s'approche de Dieu et qui s'unit à lui: Or, la bonne peinture n'est qu'une copie de ses perfections, une ombre de son pinceau, enfin une musique, une mélodie, et il n'y a qu'une intelligence très vive qui en puisse sentir la grande difficulté; c'est pourquoi elle est si rare que peu de gens y peuvent atteindre et savent le produire.»
À ces paroles si vraies, les dernières surtout, de Michel-Ange, on ne peut qu'applaudir, comme firent ses auditeurs, maître François de Hollande et le docte Lactance qui dit entre autres choses: «Sachez, maître François, que celui qui ne comprend et qui n'estime pas la très noble peinture, agit ainsi par son propre défaut: la faute n'en est pas à l'art si illustre et si grand. Il agit ainsi parce qu'il est barbare et privé du jugement de la plus noble partie de l'intelligence humaine.»
« – Quel homme vertueux et sage en effet, ajouta la marquise, n'accordera toute sa vénération aux contemplations spirituelles et dévotes de la sainte peinture? Le temps manquerait, je crois, plutôt que la matière pour les louanges de cette vertu. Elle rappelle la gaîté chez le mélancolique, la connaissance de la misère humaine chez le dissipé et l'exalté; elle réveille la componction chez l'obstiné, guide le mondain à la pénitence, le contemplatif à la méditation, à la crainte et au repentir. Elle nous représente les tourments et les dangers de l'enfer, et autant qu'il est possible, la gloire et la paix des bienheureux et l'incompréhensible image du Seigneur Dieu. Elle nous fait voir bien mieux que de toute autre manière la modestie des saints, la constance des martyrs, la pureté des vierges, la beauté des anges et l'amour de charité dont brûlent les séraphins. Elle élève et transporte notre esprit et notre âme au-delà des étoiles et nous fait contempler l'éternel empire. Elle nous rend présents les hommes célèbres qui depuis longtemps n'existent plus et dont les ossements même ont disparu de la face de la terre. Elle nous invite à les imiter dans leurs hauts faits en même temps qu'elle offre à la vue leurs pensées, leurs plaisirs et leurs dangers dans les batailles, ainsi que leur piété, leurs mœurs et leurs grandes actions… La peinture ne s'arrête point là: si nous désirons voir et connaître l'homme que ses actions ont rendu célèbre, elle nous en montre l'image. Elle nous présente celle de la beauté dont un grand nombre de lieues nous séparent, chose que Pline tient pour très-grande. La veuve affligée retrouve des consolations dans la vue journalière de l'image de son mari; les jeunes orphelins sont satisfaits, une fois devenus hommes, de connaître les traits d'un père chéri et son image leur inspire le respect et les bons sentiments.»
La marquise se tut alors émue jusqu'aux larmes, et Michel-Ange s'inclina en signe d'assentiment, car ce langage d'une femme pour laquelle sa vénération était profonde, exprimait admirablement sa propre pensée. Dans le troisième entretien, Michel-Ange dit entre autres choses: «La gravité et la décence sont d'une grande importance dans la peinture. Bien peu de peintres s'efforcent de s'approprier ces qualités; aussi parmi eux y en a-t-il beaucoup qui n'ont d'artiste que le nom. Ceux qui estiment ces qualités sont seuls vraiment grands.»
Parlant ensuite des sujets religieux, il dit: «Cette entreprise est si grande qu'il ne suffit pas pour imiter en quelque partie l'image vénérable de Notre-Seigneur qu'un maître soit grand et habile, je soutiens qu'il lui est nécessaire d'avoir de bonnes mœurs ou même, s'il était possible, d'être saint afin que le Saint-Esprit puisse inspirer son entendement… Si Dieu voulut que l'arche de la sainte loi fût bien décorée et bien peinte, avec combien plus de réflexion et d'étude doit-on chercher à imiter sa divine figure et celle de son fils Notre-Seigneur, ou la résignation, la chasteté, la beauté de la glorieuse Vierge-Marie retracée par saint Luc l'Évangéliste… Souvent les images mal peintes causent de la distraction et font perdre la dévotion. Celles au contraire qui sont peintes parfaitement excitent à la contemplation et aux larmes jusqu'aux moins dévots en leur inspirant la vénération et la crainte par la gravité de leur aspect.»
IV
Après avoir lu ces admirables pages, on s'étonnera davantage sans doute des étrangetés du jugement dernier, mais bien plus encore que Michel-Ange ait pu peindre cette Léda, destinée d'abord au duc de Ferrare, mais qui, donnée par l'artiste à son élève Memmi, passa en France et fut achetée par François Ier. «Elle fut transportée à Fontainebleau sous Louis XIII, dit d'Argenville; M. du Noyer, ministre d'état, fit brûler dans la suite cette peinture à cause de son caractère trop libre. Un cardinal en a fait autant en jetant au feu des peintures un peu lascives: «Pereant tabulæ, dit-il, ne pereant animæ! Périssent les tableaux plutôt que les âmes.» D'une note de Mariette il résulterait que cette œuvre n'avait point été détruite, mais qu'elle subit des retranchements.
Quoique d'ailleurs prétendent messieurs les biographes et les critiques, prompts à railler M. du Noyer de ses scrupules, il est impossible qu'avec un tel sujet Michel-Ange pût faire un tableau exempt de tout blâme au point de vue de la morale, et dont plus tard l'artiste, éclairé par la réflexion, n'ait pas ressenti quelques remords. Quand plusieurs années après l'époque dont nous parlions plus haut (celle des entretiens avec Maître François de Hollande), il fut éprouvé par de si cruelles douleurs, ne dut-il pas voir là une expiation?
Vittoria Colonna, «si belle et honnête dame, dit Brantôme dans la vie du marquis de Pescara, qu'elle fut de son temps estimée une perle en toutes vertus et beautés», n'était pas moins remarquable par la distinction de son esprit dont témoignent ses poésies. Michel-Ange, quoiqu'il l'eût connue tardivement, l'aima d'une affection profonde, qui s'exaltait par le respect même et la vénération.
L'illustre artiste, comme on l'a vu, avait toujours vécu «seul comme le bourreau», disait un peu durement Raphaël. Déjà presque sexagénaire, célèbre entre tous et rassasié de gloire pour ainsi dire, il n'était plus autant tourmenté de cette fièvre de produire qui le dévorait autrefois. Il semble même qu'à cette époque il ait jeté un regard mélancolique sur la carrière parcourue, et que la solitude pour lui perdit de son attrait. Peut-être souffrit-il un peu tardivement de ce regret si fatal de nos jours à l'infortuné Léopold Robert? Peut-être, par cette illusion ordinaire qui abuse les plus expérimentés dans la science de la vie, en leur faisant croire que le bonheur, en ce monde, se trouve précisément dans ce qui leur manque, peut-être Michel-Ange, un beau jour, se dit que l'homme ne vit pas seulement par l'intelligence et qu'à son cœur aussi il faut un aliment? Qui sait si, dupe de ce mirage, il ne rêva pas ou mieux ne regretta pas la douceur du foyer domestique dont il ne voyait que les côtés riants, n'ayant pu connaître ses épreuves ou ses chagrins, et ne sentit pas son âme se remplir d'une morne tristesse et des larmes monter à ses yeux par la pensée qu'il avait sacrifié toutes ces joies à la jalouse Muse qui maintenant, dans sa vieillesse, le délaissait?
C'est alors qu'il se rencontra avec la marquise de Pescara, cette autre Béatrice, qui réalisait merveilleusement son idéal et «dont l'esprit divin l'avait séduit» selon l'expression de Condivi. Michel-Ange eut tout-à-coup, dans sa vie, un intérêt nouveau, puissant, d'autant plus que l'illustre veuve témoignait pour lui de la plus haute estime et d'une amitié sincère. D'après certains sonnets de Michel-Ange (car l'artiste était poète aussi), on peut croire qu'il espéra davantage et que la marquise, libre d'elle-même, ne refuserait pas sa main à celui qui l'aimait d'une affection si sérieuse et dont le front, s'il s'ombrageait de cheveux gris, rayonnait pour tous de cette magnifique auréole du génie et de la gloire.
S'il se berça de cet espoir (chose probable), Michel-Ange se vit cruellement déçu; la marquise voulut rester fidèle à la mémoire de son premier mari, à cette chère ombre qui semblait l'appeler de loin, et qu'elle ne devait pas tarder, malgré les nobles amitiés qui voulaient la retenir sur la terre, à rejoindre dans la tombe. Buonarroti connaissait, admirait, vénérait cette illustre amie depuis quatre années à peine quand il eut la douleur de la perdre.
Vittoria Colonna, dont la santé avait toujours été délicate, au commencement de l'année 1547, tomba malade. Se sentant gravement atteinte, elle se fit transporter dans la maison de sa parente, Guilia Colonna, qui lui était tendrement dévouée et se montra pour elle garde-malade des plus zélées.
Michel-Ange, prévenu, accourut au chevet de la malade qu'il ne quitta pas jusqu'à ce qu'elle eût rendu le dernier soupir. Quand Vittoria Colonna ne fut plus qu'un cadavre, il prit dans ses mains tremblantes sa main déjà glacée qu'il approcha respectueusement de ses lèvres, puis il s'éloigna et «sa douleur fut si violente, Condivi nous l'atteste, qu'elle le rendait comme privé de sens.»
On n'en doute pas quand on lit ces vers où le regret de l'artiste se trahit si poignant: «Ô sort fatal à mes désirs, ô esprit pur, où es-tu maintenant? La terre couvre ton corps et le ciel a reçu ton âme divine.
«… Je reste glacé comme un corps défaillant qu'un reste de vie abandonne.
«Ah! mort cruelle! combien tes coups auraient été doux si, quand tu as frappé l'un de nous deux, l'autre eût été atteint de la même blessure.
«Je ne traînerais point maintenant ma vie dans les larmes et, libre de la douleur qui me tourmente, je ne remplirais pas l'air de tant de soupirs18.»
On ne peut douter, d'après tous ces témoignages, que Michel-Ange éprouva de cette mort un grand vide et que le travail, pour lequel il n'avait plus d'autre aiguillon que le devoir, ne suffit pas toujours à le combler. Dans les seize années qu'il vécut encore, il eut des jours d'amère tristesse, alors surtout qu'un nouveau deuil fût venu attrister son logis déjà si solitaire. Vers 1556, il perdit Urbino, son fidèle serviteur, qu'après tant d'années de vie commune et de dévouement, il regardait plus comme un ami que comme un domestique, et qui jeune encore semblait, selon le cours de la nature, devoir lui fermer les yeux. Une anecdote racontée par Condivi prouve, avec la générosité de l'artiste, sa vive affection pour Urbino.
«Si je venais à mourir, que ferais-tu? dit un jour Michel-Ange à son serviteur.
– Je serais obligé de servir un autre maître.
– Oh! mon pauvre Urbino, je ne veux pas que tu sois malheureux après moi! et il lui donna à l'instant 2,000 écus.
Durant toute la maladie d'Urbino, il ne le quitta pas, le soigna comme il eût fait d'un parent et le pleura comme un frère. Mais si douloureuse qui lui fût cette mort, on est heureux de voir que, par une grâce spéciale de la Providence, il y vit un motif pour raviver sa foi plutôt que pour se décourager, témoin cette lettre en réponse à Vasari qui lui avait écrit pour le consoler:
«Messer Giorgio, mon cher ami, j'écrirai mal; cependant il faut que je vous dise quelque chose en réponse à votre lettre. Vous savez comment Urbino est mort; ça été pour moi une très-grande faveur de Dieu et un chagrin bien cruel. Je dis que ce fut une faveur de Dieu, parce que Urbino, après avoir été le soutien de ma vie, m'a appris non-seulement à mourir sans regret, mais même à désirer la mort. Je l'ai gardé vingt-six ans avec moi et je l'ai toujours trouvé parfait et fidèle. Je l'avais enrichi, je le regardais comme le bâton et l'appui de ma vieillesse, et il m'échappe en ne me laissant que l'espérance de le revoir en paradis. J'ai un gage de son bonheur dans la manière dont il est mort. Il ne regrettait pas la vie, il s'affligeait seulement en pensant qu'il me laissait accablé de maux, au milieu de ce monde trompeur et méchant. Il est vrai que la majeure partie de moi-même l'a suivi et tout ce qui me reste n'est plus que misères et que peines. Je me recommande à vous.»
Je ne sais rien de plus admirablement touchant que cette lettre qui atteste tout à la fois une sensibilité si vraie et une résignation si courageuse. Michel-Ange survécut six années à Urbino. Pendant l'année 1562, à plusieurs reprises, il souffrit de graves indispositions. Puis, au commencement de l'année 1563, sa santé s'altéra de plus en plus; la fièvre le força de s'aliter et, le 17 février, il expira, à l'âge de 89 ans, après avoir dicté ce testament où l'homme tout entier se retrouve: «Je laisse mon âme à Dieu, mon corps à la terre, et mes biens à mes plus proches parents.»
Le poète, d'ailleurs si vraiment poète d'Il Pianto, a-t-il donc tout à fait raison quand il dit, dans son sonnet sur Michel-Ange?
Hélas! d'un lait trop fort la Muse t'a nourri,L'art fut ton seul amour et prit ta vie entière;Soixante ans tu courus une triple carrière,Sans reposer ton cœur sur un cœur attendri.Pauvre Buonarroti! ton seul bonheur au mondeFut d'imprimer au marbre une grandeur profonde,Et, puissant comme Dieu, d'effrayer comme lui.Aussi, quand tu parvins à ta saison dernière,Vieux lion fatigué, sous ta blanche crinière,Tu mourus longuement plein de gloire et d'ennui.Dieu ne veut effrayer que les méchants et même pour eux, dès qu'ils se repentent, il a dans sa miséricorde des trésors de bouté. Michel-Ange mourut plein de gloire sans doute, mais non pas plein d'ennui, témoin cet admirable sonnet qu'il écrivait trois ans avant sa mort, et qu'on lit avec plusieurs autres dans une lettre adressée à Vasari:
«Porté sur une barque fragile, au milieu d'une mer orageuse, j'arrive au port commun où tout homme vient rendre compte du bien et du mal qu'il a faits.
«Maintenant je reconnais combien mon âme fut sujette à l'erreur en faisant de l'art son idole et son souverain maître.
«Pensers amoureux, imaginations vaines et douces, que deviendrez-vous maintenant que j'approche de deux morts, l'une certaine, l'autre menaçante?
«Ni la peinture ni la sculpture ne peuvent suffire pour calmer une âme qui s'est tournée vers toi, ô mon Dieu, qui as ouvert pour nous tes bras sur la croix.»
Ne sent-on pas ici le calme d'une grande âme battue naguère par les orages, mais pour laquelle la lumière s'est faite de plus en plus, et qui, dans la sérénité de sa foi, dans la certitude de son espérance, n'aspire qu'à dire à la terre son dernier adieu attirée qu'elle est vers la céleste patrie?
Michel-Ange étant mort à Rome, par l'ordre du pape, son corps fut déposé dans l'église de Santo-Apostolo, en attendant le tombeau qu'on devait lui élever à Saint-Pierre. Mais Léonardo, le neveu de Buonarroti, instruit, par des amis présents à ses derniers moments, que son oncle avait témoigné de son désir d'être enterré à Florence, fit, pendant la nuit, en grand secret, par crainte de la jalousie des Romains, enlever le corps transporté rapidement à Florence. Dans cette ville, dès que la nouvelle s'en répandit, il y eut une émotion profonde mêlée de joie et de tristesse qui mit toute la population en rumeur. Après des funérailles magnifiques, dont les préparatifs avaient duré plusieurs mois, le corps fut déposé dans l'église de Santa-Croce, où se voit encore aujourd'hui le tombeau de Michel-Ange. Il fut exécuté par Lorenzo d'après les dessins de Vasari empressé de donner ce dernier témoignage d'affection à son maître, «le plus grand artiste qui eût jamais été», suivant ses expressions excessives sans doute, mais qui dans sa bouche ne peuvent étonner.
TOUSTAIN
Il y eut en France deux personnages de ce nom tous deux distingués dans des carrières fort différentes encore que leur mérite ne fût point tel qu'il pût donner à leur nom la grande célébrité. Le premier de ces deux hommes éminents, bénédictin de la congrégation de saint Maur (Toustain, dom Charles François), était né au Repos, diocèse de Séez, le 13 octobre 17.. d'une ancienne famille du pays de Caux. Ses études terminées au collége de l'abbaye de Jumièges, il fit profession dans cette même abbaye. Avec la vocation religieuse, il avait celle de la science. Sachant le grec et l'hébreu, il voulut avoir aussi des notions sur les langues orientales, et en même temps, il étudiait les langues modernes, l'italien, l'anglais, l'allemand et le hollandais. Mais sa passion pour la science et son amour de l'étude ne refroidirent jamais sa piété. Ordonné prêtre en 1729, il ne disait jamais la messe sans un tremblement causé par le respect et l'amour, et son action de grâces, d'après ce qu'on raconte, était souvent accompagnée de larmes abondantes. En 1747, le général de son ordre l'appela dans le couvent de St-Germain d'où il passa dans celui des Blancs-Manteaux. Les austérités du régime en même temps que les excès de travail avaient fort affaibli sa santé; pourtant il ne pouvait se résigner à quitter ses livres et ses pieuses pratiques. Ce ne fut que dans l'année 1754 que, par obéissance, il consentit à se rendre à St-Denis pour y prendre le laitage. Il mourut dans cette résidence, la même année, laissant plusieurs savants ouvrages imprimés ou manuscrits. Le plus important a pour titre La Nouvelle Diplomatique.

