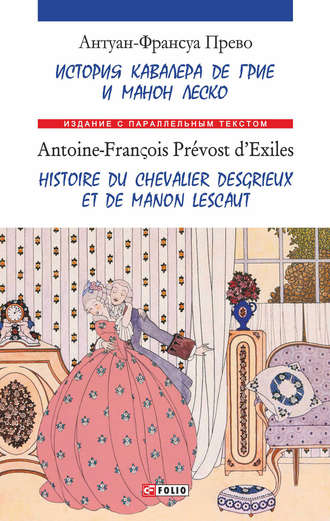
Полная версия
История кавалера де Грие и Манон Леско = Ніstoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut
Il me raconta que Manon, ne pouvant soutenir la crainte de la misère, et surtout l’idée d’être obligée tout d’un coup à la réforme de notre équipage, l’avait prié de lui procurer la connaissance de M. de G*** M***, qui passait pour un homme généreux. Il n’eut garde de me dire que le conseil était venu de lui, ni qu’il eût préparé les voies avant que de l’y conduire. « Je l’y ai menée ce matin, continua-t-il, et cet honnête homme a été si charmé de son mérite, qu’il l’a invitée d’abord à lui tenir compagnie à sa maison de campagne, où il est allé passer quelques jours. Moi, ajouta Lescaut, qui ai pénétré tout d’un coup de quel avantage cela pouvait être pour vous, je lui ai fait entendre adroitement que Manon avait essuyé des pertes considérables ; et j’ai tellement piqué sa générosité, qu’il a commencé par lui faire un présent de deux cents pistoles. Je lui ai dit que cela était honnête pour le présent, mais que l’avenir amènerait à ma sœur de grands besoins ; qu’elle s’était chargée d’ailleurs du soin d’un jeune frère qui nous était resté sur les bras après la mort de nos père et mère, et que s’il la croyait digne de son estime, il ne la laisserait pas souffrir dans ce pauvre enfant qu’elle regardait comme la moitié d’elle-même. Ce récit n’a pas manqué de l’attendrir. Il s’est engagé à louer une maison commode pour vous et pour Manon ; car c’est vous-même qui êtes ce pauvre petit frère orphelin. Il a promis de vous meubler proprement et de vous fournir tous les mois quatre cents bonnes livres, qui en feront, si je compte bien, quatre mille huit cents à la fin de chaque année. Il a laissé ordre à son intendant, avant que de partir pour sa campagne, de chercher une maison et de la tenir prête pour son retour. Vous reverrez alors Manon, qui m’a chargé de vous embrasser mille fois pour elle, et de vous assurer qu’elle vous aime plus que jamais. »
Revers funeste ! Quel est l’infâme personnage qu’on vient ici me proposer ? Quoi ! j’irai partager… Mais y a-t-il à balancer, si c’est Manon qui l’a réglé et si je la perds sans cette complaisance ? « Monsieur Lescaut, m’écriai-je en fermant les yeux, comme pour écarter de si chagrinantes réflexions, si vous avez eu dessein de me servir, je vous en rends grâces. Vous auriez pu prendre une voie plus honnête ; mais c’est une chose finie, n’est-ce pas ? ne pensons donc plus qu’à profiter de vos soins et à remplir votre promesse. »
Lescaut, à qui ma colère suivie d’un fort long silence avait causé de l’embarras, fut ravi de me voir prendre un parti tout différent de celui qu’il avait appréhendé sans doute ; il n’était rien moins que brave, et j’en eus de meilleures preuves dans la suite. « Oui, oui, se hâta-t-il de me répondre, c’est un fort bon service que je vous ai rendu, et vous verrez que nous en tirerons plus d’avantage que vous ne vous y attendiez. » Nous concertâmes de quelle manière nous pourrions prévenir les défiances que M. de G*** M*** pouvait concevoir de notre fraternité en me voyant plus grand et un peu plus âgé peut-être qu’il ne se l’imaginait. Nous ne trouvâmes point d’autre moyen que de prendre devant lui un air simple et provincial, et de lui faire croire que j’étais dans le dessein d’entrer dans l’état ecclésiastique, et que j’allais pour cela tous les jours au collège. Nous résolûmes aussi que je me mettrais fort mal la première fois que je serais admis à l’honneur de le saluer.
Il revint à la ville trois ou quatre jours après. Il conduisit lui-même Manon dans la maison que son intendant avait eu soin de préparer. Elle fit avertir aussitôt Lescaut de son retour, et celui-ci m’en ayant donné avis, nous nous rendîmes tous deux chez elle. Le vieil amant en était déjà sorti.
Malgré la résignation avec laquelle je m’étais soumis à ses volontés, je ne pus réprimer le murmure de mon cœur en la revoyant. Je lui parus triste et languissant. La joie de la retrouver ne l’emportait pas tout à fait sur le chagrin de son infidélité ; elle, au contraire, paraissait transportée du plaisir de me revoir. Elle me fit des reproches de ma froideur. Je ne pus m’empêcher de laisser échapper les noms de perfide et d’infidèle, que j’accompagnai d’autant de soupirs.
Elle me railla d’abord de ma simplicité ; mais lorsqu’elle vit mes regards s’attacher toujours tristement sur elle, et la peine que j’avais à digérer un changement si contraire à mon humeur et à mes désirs, elle passa seule dans son cabinet. Je la suivis un moment après. Je l’y trouvai tout en pleurs. Je lui demandai ce qui les causait. « Il t’est bien aisé de le voir, me dit-elle : comment veux-tu que je vive, si ma vue n’est plus propre qu’à te causer un air sombre et chagrin ? Tu ne m’as pas fait une seule caresse depuis une heure que tu es ici, et tu as reçu les miennes avec la majesté du Grand Turc au sérail.
« Écoutez, Manon, lui répondis-je en l’embrassant, je ne puis vous cacher que j’ai le cœur mortellement affligé. Je ne parle point à présent des alarmes où votre fuite imprévue m’a jeté, ni de la cruauté que vous avez eue de m’abandonner sans un mot de consolation, après avoir passé la nuit dans un autre lit que moi ; le charme de votre présence m’en ferait bien oublier davantage. Mais croyez-vous que je puisse penser sans soupirs et même sans verser des larmes, continuai-je en en versant quelques unes, à la triste et malheureuse vie que vous voulez que je mène dans cette maison ? Laissons ma naissance et mon honneur à part ; ce ne sont plus des raisons si faibles qui doivent entrer en concurrence avec un amour tel que le mien ; mais cet amour même, ne vous imaginez-vous pas qu’il gémit de se voir si mal récompensé ou plutôt traité si cruellement par une ingrate et dure maîtresse ?… »
Elle m’interrompit : « Tenez, dit-elle, mon chevalier, il est inutile de me tourmenter par des reproches qui me percent le cœur lorsqu’ils viennent de vous. Je vois ce qui vous blesse. J’avais espéré que vous consentiriez au projet que j’avais fait pour rétablir un peu notre fortune, et c’était pour ménager votre délicatesse que j’avais commencé à l’exécuter sans votre participation ; mais j’y renonce, puisque vous ne l’approuvez pas. » Elle ajouta qu’elle ne me demandait qu’un peu de complaisance pour le reste du jour ; qu’elle avait déjà reçu deux cents pistoles de son vieil amant, et qu’il lui avait promis de lui apporter le soir un beau collier de perles avec d’autres bijoux, et par-dessus cela la moitié de la pension annuelle qu’il lui avait promise.
L’heure du souper étant venue, monsieur de G*** M*** ne se fit pas attendre longtemps. Lescaut était avec sa sœur dans la salle. Le premier compliment du vieillard fut d’offrir à sa belle un collier, des bracelets et des pendants de perles qui valaient au moins mille écus. Il lui compta ensuite en beaux louis d’or la somme de deux mille quatre cents livres, qui faisait la moitié de la pension. Il assaisonna son présent de quantité de douceurs dans le goût de la vieille cour. Manon ne put lui refuser quelques baisers ; c’était autant de droits qu’elle acquérait sur l’argent qu’il lui mettait entre les mains. J’étais à la porte, où je prêtais l’oreille en attendant que Lescaut m’avertît d’entrer.
Il vint me prendre par la main, lorsque Manon eut serré l’argent et les bijoux ; et me conduisant vers monsieur de G*** M***, il m’ordonna de lui faire la révérence. J’en fis deux ou trois des plus profondes. « Excusez, monsieur, lui dit Lescaut, c’est un enfant fort neuf. Il est bien éloigné, comme vous le voyez, d’avoir les airs de Paris ; mais nous espérons qu’un peu d’usage le façonnera. Vous aurez l’honneur de voir ici souvent monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers moi ; faites bien votre profit d’un si bon modèle. »
Le vieil amant parut prendre plaisir à me voir. Il me donna deux ou trois petits coups sur la joue, en me disant que j’étais un joli garçon, mais qu’il fallait être sur mes gardes à Paris, où les jeunes gens se laissent aller facilement à la débauche. Lescaut l’assura que j’étais naturellement si sage, que je ne parlais que de me faire prêtre, et que tout mon plaisir était à faire des petites chapelles. « Je lui trouve l’air de Manon, » reprit le vieillard en me haussant le menton avec la main. Je répondis d’un air niais : « Monsieur, c’est que nos deux chairs se touchent de bien proche ; aussi j’aime ma sœur comme un autre moi-même. – L’entendez-vous ? dit-il à Lescaut ; il a de l’esprit. C’est dommage que cet enfant-là n’ait pas un peu plus de monde. – Ho ! monsieur, repris-je, j’en ai vu beaucoup chez nous dans les églises, et je crois bien que j’en trouverai à Paris de plus sots que moi. – Voyez, ajouta-t-il, cela est admirable pour un enfant de province. »
Toute notre conversation fut à peu près du même goût pendant le souper. Manon, qui était badine, fut plusieurs fois sur le point de gâter tout par ses éclats de rire. Je trouvai l’occasion, en soupant, de lui raconter sa propre histoire et le mauvais sort qui le menaçait. Lescaut et Manon tremblaient pendant mon récit, surtout lorsque je faisais son portrait au naturel ; mais l’amour-propre l’empêcha de s’y reconnaître, et je l’achevai si adroitement qu’il fut le premier à le trouver fort risible. Vous verrez que ce n’est pas sans raison que je me suis étendu sur cette ridicule scène.
Enfin, l’heure du sommeil étant arrivée, il parla d’amour et d’impatience. Nous nous retirâmes, Lescaut et moi. On le conduisit à sa chambre ; et Manon, étant sortie sous prétexte d’un besoin, nous vint rejoindre à la porte. Le carrosse, qui nous attendait trois ou quatre maisons plus bas, s’avança pour nous recevoir. Nous nous éloignâmes en un instant du quartier.
Quoiqu’à mes propres yeux cette action fût une véritable friponnerie, ce n’était pas la plus injuste que je crusse avoir à me reprocher. J’avais plus de scrupule sur l’argent que j’avais acquis au jeu. Cependant nous profitâmes aussi peu de l’un que de l’autre, et le ciel permit que la plus légère de ces deux injustices fût la plus rigoureusement punie.
Monsieur de G*** M*** ne tarda pas longtemps à s’apercevoir qu’il était dupé. Je ne sais s’il fit dès le soir même quelques démarches pour nous découvrir ; mais il eut assez de crédit pour n’en pas faire longtemps d’inutiles, et nous assez d’imprudence pour compter trop sur la grandeur de Paris et sur l’éloignement qu’il y avait de notre quartier au sien. Non seulement il fut informé de notre demeure et de nos affaires présentes, mais il apprit aussi qui j’étais, la vie que j’avais menée à Paris, l’ancienne liaison de Manon avec de B***, la tromperie qu’elle lui avait faite ; en un mot, toutes les parties scandaleuses de notre histoire. Il prit là-dessus la résolution de nous faire arrêter, et de nous traiter moins comme des criminels que comme de fieffés libertins. Nous étions encore au lit lorsqu’un exempt de police entra dans notre chambre avec une demi-douzaine de gardes. Ils se saisirent d’abord de notre argent, ou plutôt de celui de monsieur de G*** M*** ; et, nous ayant fait lever brusquement, il nous conduisirent à la porte, où nous trouvâmes deux carrosses, dans l’un desquels la pauvre Manon fut enlevée sans explication, et moi traîné dans l’autre à Saint-Lazare.
Mes gardes ne m’ayant point averti non plus du lieu où ils avaient ordre de me conduire, je ne connus mon destin qu’à la porte de Saint-Lazare. J’aurais préféré la mort, dans ce moment, à l’état où je me crus près de tomber ; j’avais de terribles idées de cette maison. Ma frayeur augmenta lorsqu’en entrant les gardes visitèrent une seconde fois mes poches, pour s’assurer qu’il ne me restait ni armes ni moyens de défense.
Le supérieur parut à l’instant ; il était prévenu sur mon arrivée. Il me salua avec beaucoup de douceur. « Mon père, lui dis-je, point d’indignités ; je perdrai mille vies avant que d’en souffrir une. – Non, non, monsieur, me répondit-il ; vous prendrez une conduite sage, et nous serons contents l’un de l’autre. » Il me pria de monter dans une chambre haute. Je le suivis sans résistance. Les archers nous accompagnèrent jusqu’à la porte, et le supérieur, y étant entré, leur fit signe de se retirer.
« Je suis donc votre prisonnier ? lui dis-je. Eh bien, mon père, que prétendez-vous faire de moi ? » Il me dit qu’il était charmé de me voir prendre un ton raisonnable ; que son devoir serait de travailler à m’inspirer le goût de la vertu et de la religion, et le mien de profiter de ses exhortations et de ses conseils ; que pour peu que je voulusse repondre aux attentions qu’il aurait pour moi, je ne trouverais que du plaisir dans ma solitude. « Ah ! du plaisir ! repris-je ; vous ne savez pas, mon père , l’unique chose qui est capable de m’en faire goûter, » – Je le sais, reprit-il ; mais j’espère que votre inclination changera. » Sa réponse me lit comprendre qu’il était instruit de mes aventures, et peut-être de mon nom. Je le priai de m’éclaircir. Il me dit naturellement qu’on l’avait informé de tout.
Cette connaissance fut le plus rude de tous mes châtiments. Je me mis à verser un ruisseau de larmes, avec toutes les marques d’un affreux désespoir. Je ne pouvais me consoler d’une humiliation qui allait me rendre la fable de toutes les personnes de ma connaissance et la honte de ma famille. Je passai ainsi huit jours dans le plus profond abattement, sans être capable de rien entendre, ni de m’occuper d’autre chose que de mon opprobre. Le souvenir même de Manon n’ajoutait rien à ma douleur. Il n’y entrait du moins que comme un sentiment qui avait précédé cette nouvelle peine , et la passion dominante de mon âme était la honte et la confusion.
Il y a peu de personnes qui connaissent la force de ces mouvements particuliers du cœur. Le commun des hommes n’est sensible qu’à cinq ou six passions dans le cercle desquelles leur vie se passe et où toutes leurs agitations se réduisent. Otez-leur l’amour et la haine, le plaisir et la douleur, l’espérance et la crainte, ils ne sentent plus rien. Mais les personnes d’un caractère plus noble peuvent être remuées de mille façons différentes : il semble qu’elles aient plus de cinq sens, et qu’elles puissent recevoir des idées et des sensations qui passent les bornes ordinaires de la nature. Et comme elles ont un sentiment de cette grandeur qui les élève au-dessus du vulgaire, il n’y a rien dont elles soient plus jalouses. De là vient qu’elles souffrent si impatiemment le mépris et la risée, et que la honte est une de leurs plus violentes passions.
J’avais ce triste avantage à Saint-Lazare. Ma tristesse parut si excessive au supérieur, qu’en appréhendant les suites, il crut devoir me traiter avec beaucoup de douceur et d’indulgence. Il me visitait deux ou trois fois le jour. Il me prenait souvent avec lui pour faire un tour de jardin, et son zèle s’épuisait en exhortations et en avis salutaires. Je les recevais avec douceur, je lui marquais même de la reconnaissance : il en tirait l’espoir de ma conversion.
Je pris un jour la hardiesse de lui demander si c’était de lui que mon élargissement dépendait. Il me dit qu’il n’en était pas absolument le maître, mais que, sur son témoignage, il espérait que monsieur de G*** M***, à la sollicitation duquel monsieur le lieutenant général de police m’avait fait renfermer, consentirait à me rendre la liberté. « Puis-je me flatter, repris-je doucement, que deux mois de prison que j’ai déjà essuyés lui paraîtront une expiation suffisante ? » Il me promit de lui en parler si je le souhaitais. Je le priai instamment de me rendre ce bon office.
Il m’apprit, deux jours après, que monsieur de G*** M*** avait été si touché du bien qu’il avait entendu dire de moi, que non seulement il paraissait être dans le dessein de me laisser voir le jour, mais qu’il avait même marqué beaucoup d’envie de me connaître plus particulièrement, et qu’il se proposait de me rendre une visite dans ma prison. Quoique sa présence ne pût m’être agréable, je la regardai comme un acheminement prochain à ma liberté.
Il vint effectivement à Saint-Lazare. Je lui trouvai l’air plus grave et moins sot qu’il ne l’avait eu dans la maison de Manon. Il me tint quelques discours de bon sens sur ma mauvaise conduite. Il ajouta, pour justifier apparemment ses propres désordres, qu’il était permis à la faiblesse des hommes de se procurer certains plaisirs que la nature exige, mais que la friponnerie et les artifices honteux méritaient d’être punis.
Je l’écoutai avec un air de soumission dont il parut satisfait. Je ne m’offensai pas même de lui entendre lâcher quelques railleries sur ma fraternité avec Lescaut et Manon, et sur les petites chapelles dont il supposait, me dit-il, que j’avais dû faire un grand nombre à Saint-Lazare, puisque je trouvais tant de plaisir à cette pieuse occupation. Mais il lui échappa, malheureusement pour lui et pour moi-même, de me dire que Manon en aurait fait aussi sans doute de fort jolies à l’hôpital. Malgré le frémissement que le nom d’hôpital me causa, j’eus encore le pouvoir de le prier avec douceur de s’expliquer : « Hé oui ! reprit-il, il y a deux mois qu’elle apprend la sagesse à l’Hôpital Général, et je souhaite qu’elle en ait tiré autant de profit que vous à Saint-Lazare. »
Quand j’aurais eu une prison éternelle ou la mort même présente à mes yeux, je n’aurais pas été le maître de mon transport à cette furieuse nouvelle. Je me jetai sur lui avec une si affreuse rage, que j’en perdis la moitié de mes forces. J’en eus assez néanmoins pour le renverser par terre et pour le prendre à la gorge. Je l’étranglais, lorsque le bruit de sa chute et quelques cris aigus que je lui laissais à peine la liberté de pousser attirèrent le supérieur et plusieurs religieux dans ma chambre. On le délivra de mes mains.
Le supérieur, ayant ordonné à ses religieux de le conduire, demeura seul avec moi. Il me conjura de lui apprendre promptement d’où venait ce désordre. « O mon père ! lui dis-je, en continuant de pleurer comme un enfant, figurez-vous la plus horrible cruauté, imaginez-vous la plus détestable de toutes les barbaries, c’est l’action que l’indigne G*** M*** a eu la lâcheté de commettre. Oh ! il m’a percé le cœur. Je n’en reviendrai jamais. Je veux vous raconter tout, ajoutai-je en sanglatant. Vous êtes bon, vous aurez pitié de moi. »
Je lui fis un récit abrégé de la longue et insurmontable passion que j’avais pour Manon, de la situation florissante de notre fortune avant que nous eussions été dépouillés par nos propres domestiques, des offres que G*** M*** avait faites à ma maîtresse, de lа conclusion de leur marché, et de la manière dont il avait été rompu. Je lui représentai les choses, à la vérité, du côté le plus favorable pour nous. « Voilà, continuai-je, de quelle source est venu le zèle de M. de G*** M*** pour ma conversion. Il a eu le crédit de me faire renfermer ici par un pur motif de vengeance. Je le lui pardonne ; mais, mon père, ce n’est pas tout : il a fait enlever cruellement la plus chère moitié de moi-même ; il l’a fait mettre honteusement à l’hôpital ; il a eu l’impudence de me l’annoncer aujourd’hui de sa propre bouche. A l’hôpital, mon père ! O ciel ! ma charmante maîtresse, ma chère reine à l’hôpital, comme la plus infâme de toutes les créatures ! Où trouverai-je assez de force pour ne pas mourir de douleur et de honte ? »
Le bon père, me voyant dans cet excès d’affliction, entreprit de me consoler. Il me dit qu’il n’avait jamais compris mon aventure de la manière dont je la racontais ; qu’il avait su, à la vérité, que je vivais dans le désordre, mais qu’il s’était figuré que ce qui avait obligé monsieur de G*** M*** d’y prendre intérêt était quelque liaison d’estime et d’amitié avec ma famille ; qu’il ne s’en était expliqué à lui-même que sur ce pied ; que ce que je venais de lui apprendre mettrait beaucoup de changement dans mes affaires, et qu’il ne doutait pas que le récit fidèle qu’il avait dessein d’en faire à monsieur le lieutenant général de police ne pût contribuer à ma liberté.
Il me demanda ensuite pourquoi je n’avais pas encore pensé à donner de mes nouvelles à ma famille, puisqu’elle n’avait point eu de part à ma captivité. Je satisfis à cette objection par quelques raisons prises de la douleur que j’avais appréhendé de causer à mon père et de la honte que j’en aurais ressentie moi-même. Enfin il me promit d’aller de ce pas chez le lieutenant général de police : « Ne fût-ce, ajouta-t-il, que pour prévenir quelque chose de pis de la part de M. de G*** M***, qui est sorti de cette maison fort mal satisfait, et qui est assez considéré pour se faire redouter. »
J’attendis le retour du père avec toutes les agitations d’un malheureux qui touche au moment de sa sentence. Il ne tarda point à revenir. Je ne vis pas sur son visage les marques de joie qui accompagnent une bonne nouvelle. « J’ai parlé, me dit-il, à monsieur le lieutenant général de police, mais je lui ai parlé trop tard. Monsieur de G*** M*** l’est allé voir en sortant d’ici, et l’a si fort prévenu contre vous, qu’il était sur le point de m’envoyer de nouveaux ordres pour vous resserrer davantage.
Cependant, lorsque je lui ai appris le fond de vos affaires, il a paru s’adoucir beaucoup ; et, riant un peu de l’incontinence du vieux monsieur de G*** M***, il m’a dit qu’il fallait vous laisser ici six mois pour le satisfaire : d’autant mieux, a-t-il dit, que cette demeure ne saurait vous être inutile. Il m’a recommandé de vous traiter honnêtement, et je vous réponds que vous ne vous plaindrez point de mes manières. »
Cette explication du bon supérieur fut assez longue pour me donner le temps de faire une sage réflexion. Je conçus que je m’exposerais à renverser mes desseins, si je lui marquais trop d’empressement, pour ma liberté. Je lui témoignai, au contraire, que, dans la nécessité de demeurer, c’était une douce consolation pour moi d’avoir quelque part à son estime. Je le priai ensuite, sans affectation, de m’accorder une grâce qui n’était de nulle importance pour personne, et qui servirait beaucoup à ma tranquillité : c’était de faire avertir un de mes amis, un saint ecclésiastique qui demeurait à Saint-Sulpice, que j’étais à Saint-Lazare, et de permettre que je reçusse quelquefois sa visite. Cette faveur me fut accordée sans délibérer.
C’était mon ami Tiberge dont il était question, non que j’espérasse de lui des secours nécessaires pour ma liberté, mais je voulais l’y faire servir comme un instrument éloigné, sans qu’il en eût même connaissance. En un mot, voici mon projet : je voulais écrire à Lescaut, et le charger, lui et nos amis communs, du soin de me délivrer. La première difficulté était de lui faire tenir ma lettre ; ce devait être l’office de Tiberge. Cependant, comme il le connaissait pour le frère de ma maîtresse, je craignais qu’il n’eût peine à se charger de cette commission. Mon dessein était de renfermer ma lettre à Lescaut dans une autre lettre que je devais adressera un honnête homme de ma connaissance, en le priant de rendre promptement la première à son adresse ; et comme il était nécessaire que je visse Lescaut pour nous accorder dans nos mesures, je voulais lui marquer de venir à Saint-Lazare, et de demander à me voir sous le nom de mon frère aîné, qui était venu exprès à Paris pour prendre connaissance de mes affaires. Je remettais à convenir avec lui des moyens qui nous paraîtraient les plus expéditifs et les plus sûrs. Le père supérieur fit avertir Tiberge du désir que j’avais de l’entretenir. Ce fidèle ami ne m’avait pas tellement perdu de vue qu’il ignorât mon aventure ; il savait que j’étais à Saint-Lazare, et peut-être n’avait-il pas été fâché de cette disgrâce, qu’il croyait capable de me ramener au devoir. Il accourut aussitôt à ma chambre.
Notre entretien fut plein d’amitié. Il voulut être informé de mes dispositions. Je lui ouvris mon cœur sans réserve, excepté sur le dessein de ma fuite. « Ce n’est pas à vos yeux, cher ami, lui-dis-je, que je veux paraître ce que je ne suis point. Si vous avez cru trouver ici un ami sage et réglé dans ses désirs, un libertin réveillé par les châtiments du ciel, en un mot, un cœur dégagé de l’amour et revenu des charmes de Manon, vous avez jugé trop favorablement de moi. Vous me revoyez tel que vous me laissâtes il y a quatre mois, toujours tendre et toujours malheureux par cette fatale tendresse dans laquelle je ne me lasse point de chercher mon bonheur. »
Cette conversation servit du moins à renouveler la pitié de mon ami. Il comprit qu’il y avait plus de faiblesse que de malignité dans mes désordres. Son amitié en fut plus disposée, dans la suite, à me donner des secours, sans lesquels j’aurais péri infailliblement de misère. Cependant, je ne lui fis pas la moindre ouverture du dessein que j’avais de m’échapper de Saint-Lazare. Je le priai seulement de se charger de ma lettre. Je l’avais préparée, avant qu’il fût venu, et je ne manquai point de prétextes pour colorer la nécessité où j’étais d’écrire. Il eut la fidélité de la porter exactement, et Lescaut reçut, avant la fin du jour, celle qui était pour lui.











