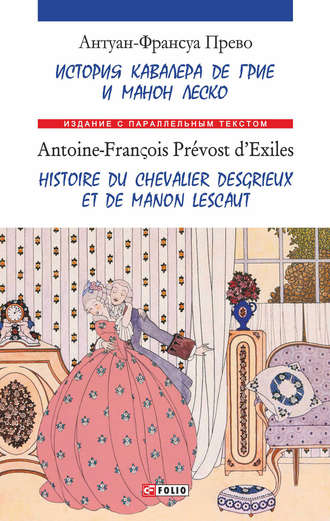
Полная версия
История кавалера де Грие и Манон Леско = Ніstoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut
A la fin, je crus avoir trouvé le dénoûment de ce mystère. Monsieur de B***, dis-je en moi-même, est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations ; les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent. Elle en a peut-être déjà reçu de lui ; il est venu aujourd’hui lui en apporter encore. Elle s’est fait sans doute un jeu de me le cacher, pour me surprendre agréablement. Peut-être m’en aurait-elle parlé si j’étais rentré à l’ordinaire, au lieu de venir ici m’affliger ; elle ne me le cachera pas du moins lorsque je lui en parlerai moi-même.
Je me remplis si fortement de cette opinion, qu’elle eut la force de diminuer beaucoup ma tristesse. Je retournai sur-le-champ au logis. J’embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire. Elle me reçut fort bien. J’étais tenté d’abord de lui découvrir mes conjectures, que je regardais plus que jamais comme certaines ; je me retins, dans l’espérance qu’il lui arriverait peut-être de me prévenir en m’apprenant tout ce qui s’était passé.
On nous servit à souper. Je me mis à table d’un air fort gai ; mais, à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Cette pensée m’en inspira aussi. Je remarquai que ses regards s’attachaient sur moi d’une autre façon qu’ils n’avaient accoutumé. Je ne pouvais démêler si c’était de l’amour ou de la compassion, quoiqu’il me parût que c’était un sentiment doux et languissant. Je la regardai avec la même attention ; et peut-être n’avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon coeur par mes regards. Nous ne pensions ni à parler, ni à manger. Enfin je vis tomber des larmes de ses beaux yeux : perfides larmes !
« Ah ! Dieu, m’écriai-je, vous pleurez, ma chère Manon vous êtes affligée jusqu’à pleurer, et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines ! Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levai en tremblant, je la conjurai avec tous les empressements de l’amour de me découvrir le sujet de ses pleurs ; j’en versai moi-même en essuyant les siens ; j’étais plus mort que vif. Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte.
Dans le temps que j’étais ainsi tout occupé d’elle, j’entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l’escalier. On frappa doucement à la porte. Manon me donna un baiser ; et, s’échappant de mes bras, elle entra rapidement dans le cabinet, qu’elle ferma aussitôt sur elle. Je me figurais qu’étant un peu en désordre, elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé. J’allai leur ouvrir moi-même.
A peine avais-je ouvert, que je me vis saisir par trois hommes que je reconnus pour les laquais de mon père. Ils ne me firent point de violence ; mais deux d’entre eux m’ayant pris par les bras, le troisième visita mes poches, dont il tira un petit couteau qui était le seul fer que j’eusse sur moi. Ils me demandèrent pardon de la nécessité où ils étaient de me manquer de respect ; ils me dirent naturellement qu’ils agissaient par l’ordre de mon père, et que mon frère aîné m’attendait en bas dans un carrosse. J’étais si troublé, que je me laissai conduire sans résister et sans répondre. Mon frère était effectivement à m’attendre. On me mit dans le carrosse auprès de lui ; et le cocher, qui avait ses ordres, nous conduisit à grand train jusqu’à Saint-Dénis. Mon frère m’embrassa tendrement, mais il ne me parla point, de sorte que j’eus tout le loisir dont j’avais besoin pour rêver à mon infortune.
J’y trouvai d’abord tant d’obscurité, que je ne voyais pas de jour à la moindre conjecture. J’étais trahi cruellement ; mais par qui ? Accuser Manon, c’est de quoi mon cœur n’osait se rendre coupable. Cette tristesse extraordinaire dont je l’avais vue comme accablée, ses larmes, le tendre baiser qu’elle m’avait donné en se retirant, me paraissaient bien une énigme ; mais je me sentais porté à l’expliquer comme un pressentiment de notre malheur commun ; et dans le temps que je me désespérais de l’accident qui m’arrachait à elle, j’avais la crédulité de m’imaginer qu’elle était encore plus à plaindre que moi.
Le résultat de ma méditation fut de me persuader que j’avais été aperçu dans les rues de Paris par quelques personnes de connaissance qui en avaient donné avis à mon père.
Mon frère avait à Saint-Denis une chàise à deux dans laquelle nous partîmes de grand matin, et nous arrivâmes chez nous le lendemain au soir. Il vit mon père avant moi, pour le prévenir en ma faveur en lui apprenant avec quelle douceur je m’étais laissé conduire ; de sorte que j’en fus reçu moins durement que je ne m’y étais attendu. Il se contenta de me faire quelques reproches généraux sur la faute que j’avais commise en m’absentant sans sa permission. Pour ce qui regardait ma maîtresse, il me dit que j’avais bien mérité ce qui venait de m’arriver, en me livrant à une inconnue ; qu’il avait eu meilleure opinion de ma prudence ; mais qu’il espérait que cette petite aventure me rendrait plus sage. Je ne pris ce discours que dans le sens qui s’accordait avec mes idées. Je remerciai mon père de la bonté qu’il avait de me pardonner, et je lui promis de prendre une conduite plus soumise et plus réglée. Je triomphais au fond du cœur ; car, de la manière dont les choses s’arrangeaient, je ne doutais point que je n’eusse la liberté de me dérober de la maison même avant la fin de la nuit.
On se mit à table pour souper ; on me railla sur ma conquête d’Amiens et sur ma fuite avec cette fidèle maîtresse. Je reçus les coups de bonne grâce ; j’étais même charmé qu’il me fût permis de m’entretenir de ce qui m’occupait continuellement l’esprit ; mais quelques mots lâchés par mon père me firent prêter l’oreille avec la dernière attention. Il parla de perfidie et de service intéressé rendu par M. de B***. Je demeurai interdit en lui entendant prononcer ce nom, et je le priai humblement de s’expliquer davantage. Il se tourna vers mon frère, pour lui demander s’il ne m’avait pas raconté toute l‘histoire. Mon frère lui répondit que je lui avais paru si tranquille sur la route, qu’il n’avait pas cru que j’eusse besoin de ce remède pour me guérir de ma folie. Je remarquai que mon père balançait s’il achèverait de s’expliquer. Je l’en suppliai si instamment, qu’il me satisfit, ou plutôt qu’il m’assassina cruellement par le plus horrible de tous les récits.
Il me demanda d’abord si j’avais toujours eu la simplicité de croire que je fusse aimé de ma maîtresse. Je lui dis hardiment que j’en étais si sûr, que rien ne pouvait m’en donner la moindre défiance. « Ha ! ha ! ha ! s’écria-t-il en riant de toute sa force, cela est excellent ! Tu es une jolie dupe, et j’aime à te voir dans ces sentiments-là. C’est grand dommage, mon pauvre chevalier, de te faire entrer dans l’ordre de Malte, puisque tu as tant de disposition à faire un mari patient et commode. » Il ajouta mille railleries de cette force sur ce qu’il appelait ma sottise et ma crédulité.
Enfin, comme je demeurais dans le silence, il continua de me dire que, suivant le calcul qu’il pouvait faire du temps depuis mon départ d’Amiens, Manon m’avait aimé environ douze jours : « Car, ajouta-t-il, je sais que tu partis d’Amiens le 28 de l’autre mois ; nous sommes au 29 du présent ; il y en a onze que monsieur de B*** m’a écrit ; je suppose qu’il lui en ait fallu huit pour lier une parfaite connaissance avec ta maîtresse ; ainsi, qui ôte onze et huit de trente-un jours qu’il y a depuis le 28 d’un mois jusqu’au 29 de l’autre, reste douze, un peu plus ou moins. » Là-dessus les éclats de rire recommencèrent.
Je n’eus pas la force de soutenir plus longtemps un discours dont chaque mot m’avait percé le cœur. Je me levai de table, et je n’avais pas fait quatre pas pour sortir de la salle que je tombai sur le plancher, privé de sentiment et de connaissance. On me les rappela par de prompts secours. J’ouvris les yeux pour verser un torrent de pleurs, et la bouche pour proférer les plaintes les plus tristes et les plus touchantes. Mon père, qui m’a toujours aimé tendrement, s’employa avec toute son affection pour me consoler. Je l’écoutais, mais sans l’entendre. Je me jetai à ses genoux ; je le conjurai, en joignant les mains, de me laisser retourner à Paris, pour aller poignarder de B***. « Non, disais-je, il n’a pas gagné le cœur de Manon ; il lui a fait violence, il l’a séduite par un charme ou par un poison ; il l’a peut-être forcée brutalement. Manon m’aime. Ne le sais-je pas bien ? Il l’aura menacée, le poignard à la main, pour la contraindre de m’abandonner. Que n’aura-t-il pas fait pour me ravir une si charmante maîtresse ! Ô dieux ! dieux ! serait-il possible que Manon m’eût trahi et qu’elle eût cessé de m’aimer ? »
Comme je parlais toujours de retourner promptement à Paris, et que je me levais même à tous moments pour cela, mon père vit bien que, dans le transport où j’étais, rien ne serait capable de m’arrêter. Il me conduisit dans une chambre haute, où il laissa deux domestiques avec moi, pour me garder à vue. Je ne me possédais point ; j’aurais donné mille vies pour être seulement un quart d’heure à Paris. Je compris que, m’étant déclaré si ouvertement, on ne me permettrait pas aisément de sortir de ma chambre. Je mesurai des yeux la hauteur des fenêtres. Ne voyant nulle possibilité de m’échapper par cette voie, je m’adressai doucement à mes deux domestiques. Je m’engageai, par mille serments, à faire un jour leur fortune, s’ils voulaient consentir à mon évasion. Je les pressai, je les caressai, je les menaçai ; mais cette tentative fut encore inutile. Je perdis alors toute espérance ; je résolus de mourir, et je me jetai sur un lit avec le dessein de ne le quitter qu’avec la vie. Je passai la nuit et le jour suivant dans cette situation. Je refusai la nourriture qu’on m’apporta le lendemain.
Mon père vint me voir l’après-midi. Il eut la bonté de flatter mes peines par les plus douces consolations. Il m’ordonna si absolument de manger quelque chose, que je le fis par respect pour ses ordres. Quelques jours se passèrent, pendant lesquels je ne pris rien qu’en sa présence et pour lui obéir. Il continuait toujours de m’apporter les raisons qui pouvaient me ramener au bon sens et m’inspirer du mépris pour l’infidèle Manon.
Je reconnaissais trop clairement qu’il avait raison. C’était un mouvement involontaire qui me faisait prendre ainsi le parti de mon infidèle. « Hélas ! repris-je après un moment de silence, il n’est que trop vrai que je suis le malheureux objet de la plus lâche de toutes les perfidies. Oui, continuai-je en versant des larmes de dépit, je vois bien que je ne suis qu’un enfant. Ma crédulité ne leur soûtait guère à tromper. Mais je sais bien ce que J’ai à faire pour me venger. » Mon père voulut savoir quel était mon dessein : « J’irai à Paris, lui dis-je, je mettrai le feu à la maison de B***, et je le brûlerai tout vif avec la perfide Manon. « Cet emportement fit rire mon père, et ne servit qu’à me faire garder plus étroitement dans ma prison.
J’y passai six mois entiers, pendant le premier desquels il y eut peu de changement dans mes dispositions. Tous mes sentiments n’étaient qu’une alternative perpétuelle de haine et d’amour, d’espérance ou de désespoir, selon l’idée sous laquelle Manon s’offrait à mon esprit. Tantôt je ne considérais en elle que la plus aimable de toutes les filles, et je languissais du désir de la revoir ; tantôt je n’y apercevais qu’une lâche et perfide maîtresse, et je faisais mille serments de ne la chercher que pour la punir.
Tiberge vint me voir un jour dans ma prison. Je fus surpris du transport avec lequel il m’embrassa. Je n’avais point encore eu de preuves de son affection, qui pussent me la faire regarder autrement que comme une simple amitié de collège, telle qu’elle se forme entre des jeunes gens qui sont à peu près du même âge. Je le trouvai si changé et si formé depuis cinq ou six mois que j’avais passés sans le voir, que sa figure et le ton de son discours m’inspirèrent du respect. Il me parla en conseiller sage plutôt qu’en ami d’école. Il plaignit l’égarement où j’étais tombé. Il me félicita de ma guérison, qu’il croyait avancée ; enfin il m’exhorta à profiter de cette erreur de jeunesse pour ouvrir les yeux sur la vanité des plaisirs. Je le regardai avec étonnement. Il s’en aperçut.
Il me raconta qu’après s’être aperçu que je l’avais trompé et que j’étais parti avec ma maîtresse, il était monté à cheval pour me suivre ; mais qu’ayant sur lui quatre ou cinq heures d’avance, il lui avait été impossible de me joindre ; qu’il était arrivé néanmoins à Saint-Denis une demi-heure après mon départ ; qu’étant bien certain que je me serais arrêté à Paris, il y avait passé six semaines à me chercher inutilement ; qu’il allait dans tous les lieux où il se flattait de pouvoir me trouver, et qu’un jour enfin il avait reconnu ma maîtresse à la Comédie ; qu’elle y était dans une parure si éclatante, qu’il s’était imaginé qu’elle devait cette fortune à un nouvel amant ; qu’il avait suivi son carrosse jusqu’à sa maison, et qu’il avait appris d’un domestique qu’elle était entretenue par les libéralités de M. de B***. « Je ne m’arrêtai point là, continua-t-il ; j’y retournai le lendemain pour apprendre d’elle-même ce que vous étiez devenu. Elle me quitta brusquement, lorsqu’elle m’entendit parler de vous, et je fus obligé de revenir en province sans aucun autre éclaircissement. J’y appris votre aventure et la consternation extrême qu’elle vous a causée ; mais je n’ai pas voulu vous voir sans être assuré de vous trouver plus tranquille.
– Vous avez donc vu Manon ? lui répondis-je en soupirant. Hélas ! vous êtes plus heureux que moi, qui suis condamné à ne la revoir jamais ! Il me fit des reproches de ce soupir qui marquait encore de la faiblesse pour elle. Il me flatta si adroitement sur la bonté de mon caractère et sur mes inclinations, qu’il me fit naître, dès cette première visite, une forte envie de renoncer comme lui à tous les plaisirs du siècle pour entrer dans l’état ecclésiastique.
Je goûtai tellement cette idée, que, lorsque je me trouvai seul, je ne m’occupai plus d’autre chose. Je me rappelai les discours de M. l’Évêque d’Amiens, qui m’avait donné le même conseil, et les présages heureux qu’il avait formés en ma faveur, s’il m’arrivait d’embrasser ce parti. La piété se mêla aussi dans mes considérations. Je mènerai une vie sage et chrétienne, disais-je ; je m’occuperai de l’étude et de la religion, qui ne me permettront point de penser aux dangereux plaisirs de l’amour. Je mépriserai ce que le commun des hommes admire ; et comme je sens assez que mon cœur ne désirera que ce qu’il estime, j’aurai aussi peu d’inquiétudes que de désirs.
Je formai là-dessus, d’avance, un système de vie paisible et solitaire. J’y faisais entrer une maison écartée, avec un petit bois et un ruisseau d’eau douce au bout du jardin, une bibliothèque composée de livres choisis, un petit nombre d’amis vertueux et de bon sens, une table propre, mais frugale et modérée. J’y joignais un commerce de lettres avec un ami qui ferait son séjour à Paris, et qui m’informerait des nouvelles publiques, moins pour satisfaire ma curiosité que pour me faire un divertissement des folles agitations des hommes. Ne serai-je pas heureux ? ajoutais-je ; toutes mes prétentions ne seront-elles point remplies ? Il est certain que ce projet flattait extrêmement mes inclinations. Mais à la fin d’un si sage arrangement, je sentais que mon cœur attendait encore quelque chose, et que pour n’avoir rien à désirer dans la plus charmante solitude, il fallait y être avec Manon.
Cependant, Tiberge continuant de me rendre de fréquentes visites pour me fortifier dans le dessein qu’il m’avait inspiré, je pris l’occasion d’en faire l’ouverture à mon père. Il me déclara que son intention était de laisser ses enfants libres dans le choix de leur condition, et que, de quelque manière que je voulusse disposer de moi, il ne se réservait que le droit de m’aider de ses conseils. Il m’en donna de fort sages, qui tendaient moins à me dégoûter de mon projet qu’à me le faire embrasser avec connaissance.
Le renouvellement de l’année scolastique approchait. Je convins avec Tiberge de nous mettre ensemble au séminaire de Saint-Sulpice, lui pour achever ses études de théologie, et moi pour commencer les miennes. Son mérite, qui était connu de l’évêque du diocèse, lui fit obtenir de ce prélat un bénéfice considérable avant notre départ.
Mon père, me croyant tout à fait revenu de ma passion, ne fit aucune difficulté de me laisser partir. Nous arrivâmes à Paris ; l’habit ecclésiastique prit la place de la croix de Malte, et le nom d’abbé des Grieux celle de chevalier.
J’avais passé près d’un an à Paris sans m’informer des affaires de Manon. Il m’en avait d’abord coûté beaucoup pour me faire cette violence ; mais les conseils toujours présents de Tiberge et mes propres réflexions m’avaient fait obtenir la victoire. Les derniers mois s’étaient écoulés si tranquillement, que je me croyais sur le point d’oublier éternellement cette charmante et perfide créature. Le temps arriva auquel je devais soutenir un exercice public devant l’école de théologie ; je fis prier plusieurs personnes de considération de m’honorer de leur présence. Mon nom fut ainsi répandu dans tous les quartiers de Paris ; il alla jusqu’aux oreilles de mon infidèle. Elle ne le reconnut pas avec certitude sous le titre d’abbé ; mais un reste de curiosité, ou peut-être quelque repentir de m’avoir trahi (je n’ai jamais pu démêler lequel de ces deux sentiments), lui fit prendre intérêt à un nom si semblable au mien ; elle vint en Sorbonne avec quelques autres dames. Elle fut présente à mon exercice, et sans doute qu’elle eut peu de peine à me remettre.
Je n’eus pas la moindre connaissance de cette visite. On sait qu’il y a dans ces lieux des cabinets particuliers pour les dames, où elles sont cachées derrière une jalousie. Je retournai à Saint-Sulpice, couvert de gloire et chargé de compliments. Il était six heures du soir. On vint m’avertir, un moment après mon retour, qu’une dame demandait à me voir. J’allai au parloir sur-le-champ. Dieux ! quelle apparition surprenante ! j’y trouvai Manon. C’était elle, mais plus aimable et plus brillante que je ne l’avais jamais vue. Elle était dans sa dix-huitième année. Ses charmes surpassaient tout ce qu’on peut décrire : c’était un air si fin, si doux, si engageant ; l’air de l’Amour même ! Toute sa figure me parut un enchantement.
Je demeurai interdit à sa vue ; et, ne pouvant conjecturer quel était le dessein de cette visite, j’attendais les yeux baissés et avec tremblement, qu’elle s’expliquât. Son embarras fut pendant quelque temps égal au mien ; mais voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes. Elle me dit d’un ton timide qu’elle confessait que son infidélité méritait ma haine ; mais que, s’il était vrai que j’eusse jamais eu quelque tendresse pour elle, il y avait eu aussi bien de la dureté à laisser passer deux ans sans prendre soin de l’informer de mon sort, et qu’il y en avait beaucoup encore à la voir dans l’état où elle était en ma présence, sans lui dire une parole. Le désordre de mon âme en l’écoutant ne saurait être exprimé.
Elle s’assit. Je demeurai debout, le corps à demi tourné, n’osant l’envisager directement. Je commençai plusieurs fois une réponse que je n’eus pas la force d’achever. Enfin je fis un effort pour m’écrier douloureusement : « Perfide Manon ! Ah ! perfide ! perfide ! » Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu’elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc ? m’écriai-je encore. Je prétends mourir, répondit-elle, si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. – Demande donc ma vie, infidèle ! repris-je en versant moi-même des pleurs que je m’efforçai en vain de retenir ; demande ma vie, qui est l’unique chose qui me reste à te sacrifier ; car mon cœur n’a jamais cessé d’être à toi. »
À peine eus-je achevé ces derniers mots, qu’elle se leva avec transport pour venir m’embrasser. Elle m’accabla de mille caresses passionnées. Elle m’appela par tous les noms que l’amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n’y répondais encore qu’avec langueur. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j’avais été, aux mouvements tumultueux que je sentais renaître ! J’en étais épouvanté. Je frémissais, comme il arrive lorsqu’on se trouve la nuit dans une campagne écartée : on se croit transporté dans un nouvel ordre de choses ; on y est saisi d’une horreur secrète, dont on ne se remet qu’après avoir considéré longtemps tous les environs.
Nous nous assîmes l’un près de l’autre. Je pris ses mains dans les miennes. « Ah ! Manon, lui dis-je en la regardant d’un œil triste, je ne m’étais pas attendu à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper un coeur dont vous etiez la souveraine absolue, et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d’aussi tendres et d’aussi soumis. Non, non, la nature n’en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi du moins si vous l’avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd’hui pour le consoler ? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais ; mais, au nom de toutes les peines que j’ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. »
Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir, et elle s’engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments, qu’elle m’attendrit à un degré inexprimable.
Où trouver un barbare qu’un repentir si vif et si tendre n’eût pas touché ? Pour moi, je sentis dans ce moment que j’aurais sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde chrétien. Je lui demandai quel nouvel ordre elle jugeait à propos de mettre dans nos affaires. Elle me dit qu’il fallait sur-le-champ sortir du séminaire et remettre à nous arranger dans un lieu plus sûr. Je consentis à toutes ses volontés sans réplique. Elle entra dans son carrosse pour aller m’attendre au coin de la rue. Je m’échappai un moment après sans être aperçu du portier. Je montai avec elle. Nous passâmes à la friperie ; je repris les galons et l’épée. Manon fournit aux frais ; car j’étais sans un sou, et, dans la crainte que je ne trouvasse de l’obstacle à ma sortie de Saint-Sulpice, elle n’avait pas voulu que je retournasse un moment à ma chambre pour y prendre mon argent. Mon trésor d’ailleurs était médiocre, et elle assez riche des libéralités de B*** pour mépriser ce qu’elle me faisait abandonner. Nous conférâmes chez le fripier même sur le parti que nous allions prendre ?
Pour me faire valoir davantage le sacrifice qu’elle me faisait de B***, elle résolut de ne pas garder avec lui le moindre ménagement. « Je veux lui laisser ses meubles, me dit-elle, ils sont à lui ; mais j’emporterai, comme de justice, les bijoux et près de soixante mille francs que j’ai tirés de lui depuis deux ans. Je ne lui ai donné nul pouvoir sur moi, ajouta-t-elle : ainsi, nous pouvons demeurer sans crainte à Paris, en prenant une maison commode où nous vivrons heureusement. »
Je lui représentai que, s’il n’y avait point de péril pour elle, il y en avait beaucoup pour moi, qui ne manquerais point tôt ou tard d’être reconnu, et qui serais continuellement exposé au malheur que j’avais déjà essuyé. Elle me fit entendre qu’elle aurait du regret à quitter Paris. Je craignais tant de la chagriner, qu’il n’y avait point de hasard que je ne méprisasse pour lui plaire ; cependant nous trouvâmes un tempérament raisonnable, qui fut de louer une maison dans quelque village voisin de Paris, d’où il nous serait aisé d’aller à la ville lorsque le plaisir ou le besoin nous y appellerait. Nous choisîmes Chaillot, qui n’en est pas éloigné. Manon retourna sur-le-champ chez elle. J’allai l’attendre à la petite porte du jardin des Tuileries.
Elle revint, une heure après, dans un carrosse de louage, avec une fille qui la servait et quelques malles où ses habits et tout ce qu’elle avait de précieux étaient renfermés.
Nous ne tardâmes point à regagner Chaillot. Nous logeâmes la première nuit à l’auberge, pour nous donner le temps de chercher une maison, ou du moins un appartement commode. Nous en trouvâmes, dès le lendemain, un de notre goût.
Mon bonheur me parut d’abord établi d’une manière inébranlable. Manon était la douceur et la complaisance même. Elle avait pour moi des attentions si délicates, que je me crus trop parfaitement dédommagé de toutes mes peines. Comme nous avions acquis tous deux un peu d’expérience, nous raisonnâmes sur la solidité de notre fortune. Soixante mille francs, qui faisaient le fonds de nos richesses, n’étaient point une somme qui pût s’étendre autant que le cours d’une longue vie. Nous n’étions pas disposés d’ailleurs à resserrer trop notre dépense. La première vertu de Manon, non plus que la mienne, n’était pas l’économie. Voici le plan que je lui proposai : « Soixante mille francs, lui dis-je, peuvent nous soutenir pendant dix ans. Deux mille écus nous suffiront chaque année, si nous continuons de vivre à Chaillot. Nous y mènerons une vie honnête, mais simple. Notre unique dépense sera pour l’entretien d’un carrosse et pour les spectacles. Nous nous réglerons. Vous aimez l’Opéra, nous irons deux fois la semaine. Pour le jeu, nous nous bornerons tellement, que nos pertes ne passeront jamais deux pistoles. Il est impossible que dans l’espace de dix ans il n’arrive point de changement dans ma famille ; mon père est âgé, il peut mourir ; je me trouverai du bien, et nous serons alors au-dessus de toutes nos autres craintes. »











