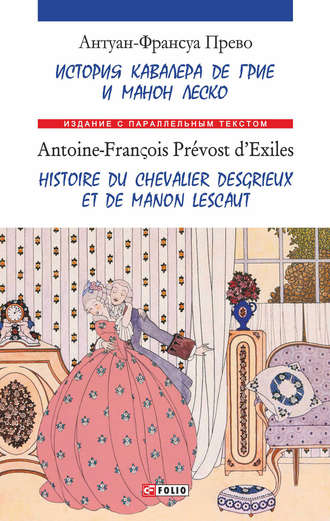
Полная версия
История кавалера де Грие и Манон Леско = Ніstoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut
Cet arrangement n’eût pas été la plus folle action de ma vie, si nous eussions été assez sages pour nous y assujettir constamment ; mais nos résolutions ne durèrent guère plus d’un mois. Manon était passionnée pour le plaisir ; je l’étais pour elle : il nous naissait à tous moments de nouvelles occasions de dépense ; et, loin de regretter les sommes qu’elle employait quelquefois avec profusion, je fus le premier à lui procurer tout ce que je croyais propre à lui plaire. Notre demeure de Chaillot commença même à lui devenir à charge.
L’hiver approchait, tout le monde retournait à la ville, et la campagne devenait déserte. Elle me proposa de reprendre une maison à Paris. Je n’y consentis point ; mais, pour la satisfaire en quelque chose, je lui dis que nous pouvions y louer un appartement meublé, et que nous y passerions la nuit lorsqu’il nous arriverait de quitter trop tard l’assemblée où nous allions plusieurs fois la semaine ; car l’incommodité de revenir si tard à Chaillot était le prétexte qu’elle apportait pour le vouloir quitter. Nous nous donnâmes ainsi deux logements, l’un à la ville et l’autre à la campagne. Ce changement mit bientôt le dernier désordre dans nos affaires, en faisant naître deux aventures qui causèrent notre ruine.
Manon avait un frère qui était garde du corps. Il se trouva malheureusement logé, à Paris, dans la même rue que nous. Il reconnut sa sœur en la voyant le matin à sa fenêtre. Il accourut aussitôt chez nous. C’était un homme brutal et sans principes d’honneur. Il entra dans notre chambre en jurant horriblement ; et comme il savait une partie des aventures de sa sœur, il l’accabla d’injures et de reproches.
J’étais sorti un moment auparavant, ce qui fut sans doute un bonheur pour lui ou pour moi, qui n’étais rien moins que disposé à souffrir une insulte. Je ne retournai au logis qu’après son départ. La tristesse de Manon me fit juger qu’il s’était passé quelque chose d’extraordinaire. Elle me raconta la scène fâcheuse qu’elle venait d’essuyer et les menaces brutales de son frère. J’en eus tant de ressentiment, que j’eusse couru sur-le-champ à la vengeance, si elle ne m’eût arrêté par ses larmes.
Pendant que je m’entretenais avec elle de cette aventure, le garde du corps rentra dans la chambre où nous étions, sans s’être fait annoncer. Je ne l’aurais pas reçu aussi civilement que je le fis, si je l’eusse connu ; mais, nous ayant salués d’un air riant, il eut le temps de dire à Manon qu’il venait lui faire des excuses de son emportement ; qu’il l’avait crue dans le désordre, et que cette opinion avait allumé sa colère ; mais que s’étant informé qui j’étais d’un de nos domestiques, il avait appris de moi des choses si avantageuses, qu’elles lui faisaient désirer de bien vivre avec nous.
Quoique cette information qui lui venait d’un de mes laquais, eût quelque chose de bizarre et de choquant, je reçus son compliment avec honnêteté ; je crus faire plaisir à Manon ; elle paraissait charmée de le voir porté à se réconcilier. Nous le retînmes à dîner.
Il se rendit en peu de moments si familier que, nous ayant entendus parler de notre retour à Chaillot, il voulut absolument nous tenir compagnie. Il fallut lui donner une place dans notre carrosse. Ce fut une prise de possession ; car il s’accoutuma bientôt à nous voir avec tant de plaisir qu’il fit sa maison de la nôtre, et qu’il se rendit le maître, en quelque sorte, de tout ce qui nous appartenait. Il m’appelait son frère, et, sous prétexte de la liberté fraternelle, il se mit sur le pied d’amener tous ses amis dans notre maison de Chaillot et de les y traiter à nos dépens. Il se fit habiller magnifiquement à nos frais, il nous engagea même à payer toutes ses dettes. Je fermais les yeux sur cette tyrannie, pour ne pas déplaire à Manon, jusqu’à feindre de ne pas m’apercevoir qu’il tirait d’elle, de temps en temps, des sommes considérables. Il est vrai qu’étant grand joueur, il avait la fidélité de lui en remettre une partie lorsque la fortune le favorisait ; mais la nôtre était trop médiocre pour fournir longtemps à des dépenses si peu modérées.
J’étais sur le point de m’expliquer fortement avec lui, pour nous délivrer de ses importunités, lorsqu’un funeste accident m’épargna cette peine, en nous en causant une autre qui nous abîma sans ressource.
Nous étions demeurés un jour à Paris pour y coucher, comme il nous arrivait fort souvent. La servante, qui restait seule à Chaillot dans ces occasions, vint m’avertir le matin que le feu avait pris pendant la nuit dans ma maison et qu’on avait eu beaucoup de difficulté à l’éteindre. Je lui demandai si nos meubles avaient souffert quelque dommage : elle me répondit qu’il y avait eu une si grande confusion, causée par la multitude d’étrangers qui étaient venus au secours, qu’elle ne pouvait être assurée de rien. Je tremblai pour notre argent qui était renfermé dans une petite caisse. Je me rendis promptement à Chaillot. Diligence inutile ; la caisse avait déjà disparu.
J’éprouvai alors qu’on peut aimer l’argent sans être avare. Cette perte me pénétra d’une si vive douleur, que j’en pensai perdre la raison. Je compris tout d’un coup à quels nouveaux malheurs j’allais me trouver exposé : l’indigence était le moindre. Je connaissais Manon ; je n’avais déjà que trop éprouvé que, quelque fidèle et quelque attachée qu’elle me fût dans la bonne fortune, il ne fallait pas compter sur elle dans la misère : elle aimait trop l’abondance et les plaisirs pour me les sacrifier. Je la perdrai ! m’écriai-je. Malheureux chevalier ! tu vas donc perdre encore tout ce que tu aimes ! Cette pensée me jeta dans un trouble si affreux, que je balançai pendant quelques moments, si je ne ferais pas mieux de finir tous mes maux par la mort.
Cependant je conservai assez de présence d’esprit pour vouloir examiner auparavant s’il ne me restait nulle ressource. Le ciel me fit naître une idée qui arrêta mon désespoir ; je crus qu’il ne me serait pas impossible de cacher notre perte à Manon, et que, par industrie ou par quelque faveur du hasard, je pourrais fournir assez honnêtement à son entretien pour l’empêcher de sentir la nécessité.
Je résolus d’abord d’aller consulter M. Lescaut, frère de Manon. Il connaissait parfaitement Paris, et je n’avais eu que trop d’occasions de reconnaître que ce n’était ni de son bien, ni de la paye du roi qu’il tirait son plus clair revenu. Il me restait à peine vingt pistoles, qui s’étaient trouvées heureusement dans ma poche. Je lui montrai ma bourse, en lui expliquant mon malheur et mes craintes, et je lui demandai s’il y avait pour moi un parti à choisir entre celui de mourir de faim ou de me casser la tête de désespoir. Il me répondit que se casser la tête était la ressource des sots ; pour mourir de faim, qu’il y avait quantité de gens d’esprit qui s’y voyaient réduits, quand ils ne voulaient pas faire usage de leurs talents ; que c’était à moi d’examiner de quoi j’étais capable ; qu’il m’assurait de son secours et de ses conseils dans toutes mes entreprises.
« Cela est bien vague, monsieur Lescaut, lui dis-je ; mes besoins demanderaient un remède plus présent, car que voulez-vous que je dise à Manon ? – A propos de Manon, reprit-il, qu’est-ce qui vous embarrasse ? N’avez-vous pas toujours, avec elle, de quoi finir vos inquiétudes quand vous le voudrez ? Une fille comme elle devrait nous entretenir, vous, elle et moi. » Il me coupa la réponse que cette impertinence méritait, pour continuer de me dire qu’il me garantissait avant le soir mille écus à partager entre nous, si je voulais suivre son conseil ; qu’il connaissait un seigneur si libéral sur le chapitre des plaisirs, qu’il était sûr que mille écus ne lui coûteraient rien pour obtenir les faveurs d’une fille telle que Manon.
Je l’arrêtai. « J’avais meilleure opinion de vous, lui répondis-je ; je m’étais figuré que le motif que vous aviez eu pour m’accorder votre amitié était un sentiment tout opposé à celui où vous êtes maintenant. » Il me confessa impudemment qu’il avait toujours pensé de même, et que sa sœur ayant une fois violé les lois de son sexe, quoique en faveur de l’homme qu’il aimait le plus, il ne s’était réconcilié avec elle que dans l’espérance de tirer parti de sa mauvaise conduite.
Il me fut aisé de juger que jusqu’alors nous avions été ses dupes. Quelque émotion, néanmoins, que ce discours m’eût causée, le besoin que j’avais de lui m’obligea de répondre en riant que son conseil était une dernière ressource qu’il fallait remettre à l’extrémité. Je le priai de m’ouvrir quelque autre voie.
Il me proposa de profiter de ma jeunesse et de la figure avantageuse que j’avais reçue de la nature pour me mettre en liaison avec quelque dame vieille et libérale. Je ne goûtai pas non plus ce parti, qui m’aurait rendu infidèle à Manon.
Je lui parlai du jeu comme du moyen le plus facile et le plus convenable à ma situation. Il me dit que le jeu, à la vérité, était une ressource, mais que cela demandait d’être expliqué qu’entreprendre de jouer simplement avec les espérances communes, c’était le vrai moyen d’achever ma perte que de prétendre exercer seul, et sans être soutenu, les petits moyens qu’un habile homme emploie pour corriger la fortune, était un métier trop dangereux ; qu’il y avait une troisième voie, qui était celle de l’association ; mais que ma jeunesse lui faisait craindre que messieurs les confédérés ne me jugeassent point encore les qualités propres à la ligue. Il me promit néanmoins ses bons offices auprès d’eux ; et, de que je n’aurais pas attendu de lui, il m’offrit quelque argent lorsque je me trouverais pressé du besoin. L’unique grâce que je lui demandai, dans les circonstances, fut de ne rien apprendre à Manon de la perte que j’avais faite et du sujet de notre conversation.
Je sortis de chez lui moins satisfait encore que je n’y étais entré ; je me repentis même de lui avoir confié mon secret.
Enfin cette confusion de pensées en produisit une qui remit le calme tout d’un coup dans mon esprit, et que je m’étonnai de n’avoir pas eue plus tôt : ce fut de recourir à mon ami Tiberge, dans lequel j’étais bien certain de retrouver toujours le même fonds de zèle et d’amitié.
Je regardai comme un effet de la protection du ciel de m’être souvenu si à propos de Tiberge, et je résolus de chercher les moyens de le voir avant la fin du jour. Je retournai sur-le-champ au logis, pour lui écrire un mot et lui marquer un lieu propre à notre entretien. Je lui recommandai le silence et la discrétion comme un des plus importants services qu’il pût me rendre dans la situation de mes affaires.
Une heure après, je reçus la réponse de Tiberge, qui me promettait de se rendre au lieu de l’assignation. J’y courus avec impatience. Je sentais néanmoins quelque honte d’aller paraître aux yeux d’un ami dont la seule présence devait être un reproche de mes désordres : mais l’opinion que j’avais de la bonté de son cœur et l’intérêt de Manon soutinrent ma hardiesse.
Je l’avais prié de se trouver au jardin du Palais-Royal. Il y était avant moi. Il vint m’embrasser aussitôt qu’il m’eut aperçu.
Nous nous assîmes sur un banc. Il me demanda, comme une marque d’amitié, de lui raconter sans déguisement ce qui m’était arrivé depuis mon départ de Saint-Sulpice. Je le satisfis ; et, loin d’altérer quelque chose à la vérité, ou de diminuer mes fautes pour les faire trouver plus excusables, je lui parlai de ma passion avec toute la force qu’elle m’inspirait. Je la lui représentai comme un de ces coups particuliers du destin qui s’attache à la ruine d’un misérable, et dont il est aussi impossible à la vertu de se défendre qu’il l’a été à la sagesse de les prévoir. Je lui fis une vive peinture de mes agitations, de mes craintes, du désespoir où j’étais deux heures avant que de le voir, et de celui dans lequel j’allais retomber, si j’étais abandonné par mes amis aussi impitoyablement que par la fortune ; enfin j’attendris tellement le bon Tiberge, que je le vis aussi affligé par la compassion que je l’étais par le sentiment de mes peines.
Il ne se lassait point de m’embrasser et de m’exhorter à prendre du courage et de la consolation ; mais comme il supposait toujours qu’il fallait me séparer de Manon, je lui fis entendre nettement que c’était cette séparation même que je regardais comme la plus grande de mes infortunes, et que j’étais disposé à souffrir non seulement le dernier excès de la misère, mais la mort la plus cruelle, avant que de recevoir un remède plus insupportable que tous mes maux ensemble.
« Expliquez-vous donc, me dit-il ; quelle espèce de secours suis-je capable de vous donner, si vous vous révoltez contre toutes mes propositions ? » Je n’osais lui déclarer que c’était de sa bourse que j’avais besoin. Il le comprit pourtant à la fin ; et, m’ayant confessé qu’il croyait m’entendre, il demeura quelque temps suspendu, avec l’air d’une personne qui balance. « Ne croyez pas, reprit-il bientôt, que ma rêverie vienne d’un refroidissement de zèle et d’amitié ; mais à quelle alternative me réduisez-vous, s’il faut que je vous refuse le seul secours que vous voulez accepter, ou que je blesse mon devoir en vous l’accordant ? car n’est-ce pas prendre part à votre désordre que de vous y faire persévérer ?
« Cependant, continua-t-il après avoir réfléchi un moment, je m’imagine que c’est peut-être l’état violent où l’indigence vous jette qui ne vous laisse pas assez de liberté pour choisir le meilleur parti. Il faut un esprit tranquille pour goûter la sagesse et la vérité. Je trouverai le moyen de vous faire avoir quelque argent. Permettez-moi, mon cher chevalier, ajouta-t-il en m’embrassant, d’y mettre seulement une condition : c’est que vous m’apprendrez le lieu de votre demeure, et que vous souffrirez que je fasse du moins mes efforts pour vous ramener à la vertu, que je sais que vous aimez, et dont il n’y a que la violence de vos passions qui vous écarte. »
Je lui accordai sincèrement tout ce qu’il souhaitait, et je le priai de plaindre la malignité de mon sort, qui me faisait profiter si mal des conseils d’un ami si vertueux. Il me mena aussitôt chez un banquier de sa connaissance, qui m’avança cent pistoles sur son billet ; car il n’était rien moins qu’en argent comptant. J’ai déjà dit qu’il n’était pas riche : son bénéfice valait mille écus ; mais, comme c’était la première année qu’il le possédait, il n’avait encore rien touché du revenu ; c’était sur les fruits futurs qu’il me faisait cette avance.
Je sentis tout le prix de sa générosité : j’en fus touché jusqu’au point de déplorer l’aveuglement d’un amour fatal qui me faisait violer tous les devoirs ; la vertu eut assez de force pendant quelques moments pour s’élever dans mon cœur contre ma passion, et j’aperçus, du moins dans cet instant de lumière, la honte et l’indignité de mes chaînes. Mais ce combat fut léger et dura peu. La vue de Manon m’aurait fait précipiter du ciel ; et je m’étonnai, en me retrouvant près d’elle, que j’eusse pu traiter un moment de honteuse une tendresse si juste pour un objet si charmant.
Manon était une créature d’un caractère extraordinaire. Jamais fille n’eut moins d’attachement qu’elle pour l’argent ; mais elle ne pouvait être tranquille un moment avec la crainte d’en manquer. C’était du plaisir et des passe-temps qu’il lui fallait. Elle n’eût jamais voulu toucher un sou, si l’on pouvait se divertir sans qu’il en coûte ; elle ne s’informait pas même quel était le fonds de nos richesses, pourvu qu’elle pût passer agréablement la journée ; de sorte que, n’étant ni excessivement livrée au jeu, ni capable d’être éblouie par le faste des grandes dépenses, rien n’était plus facile que de la satisfaire, en lui faisant naître tous les jours des amusements de son goût. Mais c’était une chose si nécessaire pour elle d’être ainsi occupée par le plaisir, qu’il n’y avait pas le moindre fond à faire sans cela sur son humeur et sur ses inclinations. Quoiqu’elle m’aimât tendrement, et que je fusse le seul, comme elle en convenait volontiers, qui pût lui faire goûter parfaitement les douceurs de l’amour, j’étais presque certain que sa tendresse ne tiendrait point contre de certaines craintes. Elle m’aurait préféré à toute la terre avec une fortune médiocre, mais je ne doutais nullement qu’elle ne m’abandonnât pour quelque nouveau de B***, lorsqu’il ne me resterait que de la constance et de la fidélité à lui offrir.
Je résolus donc de régler si bien ma dépense particulière, que je fusse toujours en état de fournir aux siennes, et de me priver plutôt de mille choses nécessaires que de la borner même pour le superflu. Le carrosse m’effrayait plus que tout le reste ; car il n’y avait point d’apparence de pouvoir entretenir des chevaux et un cocher.
Je découvris ma peine à M. Lescaut. Je ne lui avais point caché que j’eusse reçu cent pistoles d’un ami. Il me répéta que si je voulais tenter le hasard du jeu, il ne désespérait point qu’en sacrifiant de bonne grâce une centaine de francs pour traiter ses associés, je ne pusse être admis, à sa recommandation, dans la ligue de l’industrie. Quelque répugnance que j’eusse à tromper, je me laissai entraîner par une cruelle nécessité.
M. Lescaut me présenta, le soir même, comme un de ses parents. Il ajouta que j’étais d’autant mieux disposé à réussir, que j’avais besoin de plus grandes faveurs de la fortune. Cependant pour faire connaître que ma misère n’était pas celle d’un homme de néant, il leur dit que j’étais dans le dessein de leur donner à souper. L’offre fut acceptée. Je les traitai magnifiquement. On s’entretînt longtemps de la gentillesse de ma figure et de mes heureuses dispositions ; on prétendit qu’il y avait beaucoup à espérer de moi, parce qu’ayant quelque chose dans la physionomie qui sentait l’honnête homme, personne ne se défierait de mes artifices ; enfin on rendit grâce à M. Lescaut d’avoir procuré à l’ordre un novice de mon mérite, et l’on chargea un des chevaliers de me donner, pendant quelques jours, les instructions nécessaires.
Le principal théâtre de mes exploits devait être l’hôtel de Transylvanie, où il y avait une table de pharaon dans une salle, et divers autres jeux de cartes et de dés dans la galerie. Cette académie se tenait au profit de monsieur le prince de R***, qui demeurait alors à Clagny, et la plupart de ses officiers étaient de notre société. Le dirai-je à ma honte ? Je profitai en peu de temps des leçons de mon maître ; j’acquis surtout beaucoup d’habileté à faire une volte-face, a filer la carte ; et m’aidant fort bien d’une longue paire de manchettes, j’escamotais assez légèrement pour tromper les yeux des plus habiles et ruiner sans affectation quantité d’honnêtes joueurs. Cette adresse extraordinaire hâta si fort les progrès de ma fortune, que je me trouvai en peu de semaines des sommes considérables, outre celles que je partageais de bonne foi avec mes associés.
J’avais fait au jeu des gains si considérables, que je pensais à placer une partie de mon argent. Mes domestiques n’ignoraient pas mes succès, surtout mon valet de chambre et la suivante de Manon, devant lesquels nous nous entretenions souvent sans défiance. Cette fille était jolie ; mon valet en était amoureux. Ils avaient affaire à des maîtres jeunes et faciles, qu’ils s’imaginèrent pouvoir tromper aisément. Ils en conçurent le dessein, et ils l’exécutèrent si malheureusement pour nous, qu’ils nous mirent dans un état dont il ne nous a jamais été possible de nous relever.
M. Lescaut nous ayant un jour donné à souper, il était environ minuit lorsque nous retournâmes au logis. J’appelai mon valet, et Manon sa femme de chambre ; ni l’un ni l’autre ne parurent. On nous dit qu’ils n’avaient point été vus dans la maison depuis huit heures, et qu’ils étaient partis après avoir fait transporter quelques caisses, suivant les ordres qu’ils disaient avoir reçus de moi. Je pressentis une partie de la vérité ; mais je ne formai point de soupçons qui ne fussent surpassés par ce que j’aperçus en entrant dans ma chambre. La serrure de mon cabinet avait été forcée et mon argent enlevé avec tous mes habits. Dans le temps que je réfléchissais seul sur cet accident, Manon vint, tout effrayée, m’apprendre qu’on avait fait le même ravage dans son appartement.
Je pris le parti d’envoyer chercher sur-le-champ monsieur Lescaut. Il me conseilla d’aller à l’heure même chez monsieur le lieutenant de police et monsieur le grand prévôt de Paris. J’y allai, mais ce fut pour mon plus grand malheur ; car, outre que cette démarche et celles que je fis faire à ces deux officiers de justice ne produisirent rien, je donnai le temps à Lescaut d’entretenir sa sœur et de lui inspirer, pendant mon absence, une horrible résolution. Il lui parla de monsieur de G*** M***, vieux voluptueux qui payait prodigalement ses plaisirs, et lui fit envisager tant d’avantages à se mettre à sa solde, que, troublée comme elle était par notre disgrâce, elle entra dans tout ce qu’il entreprit de lui persuader. Cet honorable marché fut conclu avant mon retour, et l’exécution remise au lendemain, après que Lescaut aurait prévenu monsieur de G*** M***.
Je le trouvai qui m’attendait au logis ; mais Manon s’était couchée dans son appartement, et elle avait donné ordre à son laquais de me dire qu’ayant besoin d’un peu de repos, elle me priait de la laisser seule pendant cette nuit. Lescaut me quitta après m’avoir offert quelques pistoles que j’acceptai.
Il était près de quatre heures quand je me mis au lit ; et m’y étant encore occupé longtemps des moyens de rétablir ma fortune, je m’endormis si tard, que je ne pus me réveiller que vers les onze heures ou midi. Je me levai promptement pour aller m’informer de la santé de Manon : on me dit qu’elle était sortie une heure auparavant avec son frère, qui l’était venu prendre dans un carrosse de louage. Quoiqu’une telle partie faite avec Lescaut me parût mystérieuse, je me fis violence pour suspendre mes soupçons. Je laissai couler quelques heures que je passai à lire. Enfin, n’étant plus le maître de mon inquiétude, je me promenai à grands pas dans nos appartements. J’aperçus dans celui de Manon une lettre cachetée qui était sur la table. L’adresse était à moi, et l’écriture de sa main. Je l’ouvris avec un frisson mortel ; elle était dans ces termes :
« Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l’idole de mon cœur, et qu’il n’y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t’aime ; mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l’état où nous sommes réduits, c’est une sotte vertu que la fidélité ? Crois-tu qu’on puisse être bien tendre lorsqu’on manque de pain ? La faim me causerait quelque méprise fatale ; je rendrais quelque jour le dernier soupir en croyant en pousser un d’amour. Je t’adore, compte là-dessus ; mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune. Malheur à qui va tomber dans mes filets ! Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. Mon frère l’apprendra des nou-velles de ta Manon ; il te dira qu’elle a pleuré de la nécessité de te quitter. »
Elle m’aime, je le veux croire ; mais ne faudrait-il pas, m’écriai-je, qu’elle fût un monstre pour me haïr ? Quels droits eut-on jamais sur un cœur que je n’aie pas sur le sien ? Que me reste-t-il à faire pour elle, après tout ce que je lui ai sacrifié ? Cependant elle m’abandonne ! et l’ingrate se croit à couvert de mes reproches en me disant qu’elle ne cesse pas de m’aimer ! Elle appréhende la faim ! Dieu d’amour ! quelle grossièreté de sentiments, et que c’est répondre mal à ma délicatesse ! Je ne l’ai pas appréhendée, moi qui m’y expose si volontiers pour elle en renonçant à ma fortune et aux douceurs de la maison de mon père ; moi qui me suis retranché jusqu’au nécessaire pour satisfaire ses petites humeurs et ses caprices ! Elle m’adore, dit-elle. Si tu m’adorais, ingrate, je sais bien de qui tu aurais pris des conseils ; tu ne m’aurais pas quitté, du moins, sans me dire adieu. C’est à moi qu’il faut demander quelles peines cruelles on sent de se séparer de ce qu’on adore. Il faudrait avoir perdu l’esprit pour s’y exposer volontairement.
Mes plaintes furent interrompues par une visite à laquelle je ne m’attendais pas ; ce fut celle de Lescaut. « Bourreau ! lui dis-je en mettant l’épée à la main, où est Manon ? qu’en as-tu fait ? Ce mouvement l’effraya. Il me répondit que si c’était ainsi que je le recevais, lorsqu’il venait me rendre compte du service le plus considérable qu’il eût pu me rendre, il allait se retirer et ne remettrait jamais le pied chez moi. Je courus à la porte de la chambre, que je fermai soigneusement. « Ne t’imagine pas, lui dis-je en me tournant vers lui, que tu puisses me prendre encore une fois pour dupe et me tromper par des fables. Il faut défendre ta vie ou me faire retrouver Manon. – Là, que vous êtes vif ! repartit-il ; c’est l’unique sujet qui m’amène. Je viens vous annoncer un bonheur auquel vous ne pensez pas, et pour lequel vous reconnaîtrez peut-être que vous m’avez quelque obligation. » Je voulus être éclairci sur-le-champ.











