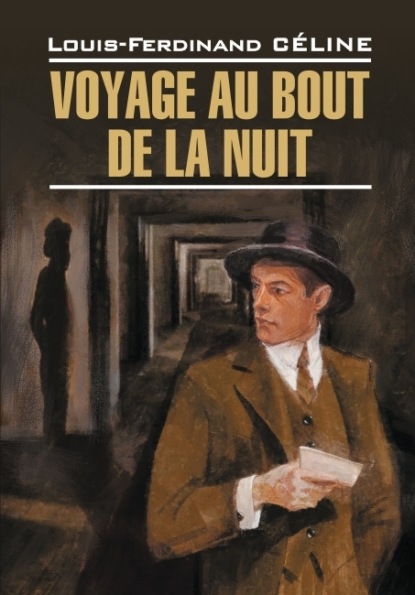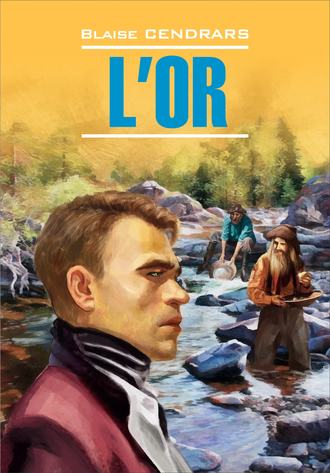
Полная версия
L’Or / Золото. Книга для чтения на французском языке

Blaise Cendrars / Блез Сандрар
L’Or / Золото. Книга для чтения на французском языке
© Каро, 2019
Chapitre I
1
La journée venait de finir. Les bonnes gens rentraient des champs, qui une bine sur l’épaule ou un panier au bras. En tête venaient les jeunes filles en corselet blanc et la cotte haut-plissée. Elles se tenaient par la taille et chantaient :
Wenn ich ein Vöglein wärUnd auch zwei Flüglein hättFlög ich zu dir…Sur le pas de leur porte, les vieux fumaient leur pipe en porcelaine et les vieilles tricotaient de longs bas blancs. Devant l’auberge « Zum Wilden Mann » on vidait des cruchons du petit vin blanc du pays, des cruchons curieusement armoriés d’une crosse d’évêque entourée de sept points rouges. Dans les groupes on parlait posément, sans cris et sans gestes inutiles. Le sujet de toutes les conversations était la chaleur précoce et extraordinaire pour la saison et la sécheresse qui menaçait déjà la tendre moisson.
C’était le 6 mai 1834.
Les vauriens du pays entouraient un petit Savoyard qui tournait la manivelle de son orgue de Sainte-Croix, et les mioches avaient peur de la marmotte émoustillée qui venait de mordre l’un d’eux. Un chien noir pissait contre l’une des quatre bornes qui encadraient la fontaine polychrome. Les derniers rayons du jour éclairaient la façade historiée des maisons. Les fumées montaient tout droit dans l’air pur du soir. Une carriole grinçait au loin dans la plaine.
Ces paisibles campagnards bâlois furent tout à coup mis en émoi par l’arrivée d’un étranger. Même en plein jour, un étranger est quelque chose de rare dans ce petit village de Rünenberg ; mais que dire d’un étranger qui s’amène à une heure indue, le soir, si tard, juste avant le coucher du soleil ? Le chien noir resta la patte en l’air et les vieilles femmes laissèrent choir leur ouvrage. L’étranger venait de déboucher par la route de Soleure. Les enfants s’étaient d’abord portés à sa rencontre, puis ils s’étaient arrêtés, indécis. Quant au groupe des buveurs, « Au Sauvage », ils avaient cessé de boire et observaient l’étranger par en dessous. Celui-ci s’était arrêté à la première maison du pays et avait demandé qu’on veuille bien lui indiquer l’habitation du syndic de la commune. Le vieux Buser, à qui il s’adressait, lui tourna le dos et, tirant son petit-fils Hans par l’oreille, lui dit de conduire l’étranger chez le syndic. Puis il se remit à bourrer sa pipe, tout en suivant du coin de l’œil l’étranger qui s’éloignait à longues enjambées derrière l’enfant trottinant.
On vit l’étranger pénétrer chez le syndic.
Les villageois avaient eu le temps de le détailler au passage. C’était un homme grand, maigre, au visage prématurément flétri. D’étranges cheveux d’un jaune filasse sortaient de dessous un chapeau à boucle d’argent. Ses souliers étaient cloutés. Il avait une grosse épine à la main.
Et les commentaires d’aller bon train. « Ces étrangers, ils ne saluent personne », disait Buhri, l’aubergiste, les deux mains croisées sur son énorme bedaine. « Moi, je vous dis qu’il vient de la ville », disait le vieux Siebenhaar qui autrefois avait été soldat en France ; et il se mit à conter une fois de plus les choses curieuses et les gens extravagants qu’il avait vus chez les Welches. Les jeunes filles avaient surtout remarqué la coupe raide de la redingote et le faux col à hautes pointes qui sciait le bas des oreilles ; elles potinaient à voix basse, rougissantes, émues. Les gars, eux, faisaient un groupe menaçant auprès de la fontaine ; ils attendaient les événements, prêts à intervenir.
Bientôt, on vit l’étranger réapparaître sur le seuil. Il semblait très las et avait son chapeau à la main. Il s’épongea le front avec un de ces grands foulards jaunes que l’on tisse en Alsace. Du coup, le bambin qui l’attendait sur le perron, se leva, raide. L’étranger lui tapota les joues, puis il lui donna un thaler, foula de ses longues enjambées la place du village, cracha dans la fontaine en passant. Tout le village le contemplait maintenant. Les buveurs étaient debout. Mais l’étranger ne leur jeta même pas un regard, il regrimpa dans la carriole qui l’avait amené et disparut bientôt en prenant la route plantée de sorbiers qui mène au chef-lieu du canton.
Cette brusque apparition et ce départ précipité bouleversaient ces paisibles villageois. L’enfant s’était mis à pleurer. La pièce d’argent que l’étranger lui avait donnée circulait de main en main. Des discussions s’élevaient. L’aubergiste était parmi les plus violents. Il était outré que l’étranger n’ait même point daigné s’arrêter un moment chez lui pour vider un cruchon. Il parlait de faire sonner le tocsin pour prévenir les villages circonvoisins et d’organiser une chasse à l’homme.
Le bruit se répandit bientôt que l’étranger se réclamait de la commune, qu’il venait demander un certificat d’origine et un passeport pour entreprendre un long voyage à l’étranger, qu’il n’avait pas pu faire preuve de sa bourgeoisie et que le syndic, qui ne le connaissait pas et qui ne l’avait jamais vu, lui avait refusé et certificat et passeport.
Tout le monde loua fort la prudence du syndic.
Voici le dialogue qui avait lieu le lendemain matin dans le cabinet du secrétaire de police, à Liesthal, chef-lieu du canton. Il était à peine onze heures.
LE VIEUX GREFFIER : Voulez-vous établir un passeport pour la France au nom de Johann August Suter, natif de Rünenberg ?
LE SECRÉTAIRE DE POLICE KLOSS : A-t-il un certificat d’origine établi par le syndic de sa commune ?
LE VIEUX GREFFIER : Non, il n’en a pas ; mais son père était un ami à moi et je me porte garant.
LE SECRÉTAIRE DE POLICE KLOSS : Alors je n’établis pas de passeport. Le patron est absent. Lui peut faire ce qu’il veut. Malheureusement il est à Aarau, et moi je n’établis pas de passeport dans ces conditions.
LE VIEUX GREFFIER : Voyons, mon cher, vous exagérez. Je vous dis que son père était un vieil ami à moi. Qu’est-ce qu’il vous faut de plus ?
LE SECRÉTAIRE DE POLICE KLOSS : Mon cher Gäbis, je fais mon devoir. Tout le reste ne me regarde pas. Je ne fais pas de passeport sans certificat d’origine.
Tard dans la soirée, une lettre de cachet arrivait de Berne ; mais l’étranger avait déjà franchi la frontière suisse.
2
Johann August Suter venait d’abandonner sa femme et ses quatre enfants.
Il traversa la frontière suisse au-dessous de Mariastein ; puis, en suivant l’orée des bois, il gagna les montagnes d’en face. Le temps continuait à être très chaud et le soleil était brûlant. Le soir même, Suter avait atteint Férette, et comme un violent orage éclatait, il passa la nuit dans une grange abandonnée.
Le lendemain, il se remettait en marche avant l’aube. Il se rabattit vers le sud, évita Delle, franchit le Lomont et pénétra dans le pays du Doubs.
Il venait de faire plus de vingt-cinq lieues d’une traite. La faim le tiraillait. Il n’avait pas un fifrelin en poche. Le thaler, qu’il avait donné au bambin de Rünenberg, était son dernier argent.
Il erra encore deux jours dans les hauts pâturages désertiques des Franches-Montagnes, rôdant le soir autour des fermes, mais l’aboiement des chiens le faisait rentrer sous bois. Un soir pourtant il parvint à traire une vache dans son chapeau et but goulûment ce chaud lait écumeux. Jusque-là, il n’avait fait que brouter des touffes d’oseille sauvage et sucer des tiges de gentianes en fleur. Il avait trouvé la première fraise de l’année et devait s’en souvenir longtemps.
Des paquets de neige durcissaient à l’ombre des sapins.
3
Johann August Suter avait à cette époque trente et un ans.
Il était né le 15 février 1803, à Kandern, Grand-Duché de Bade.
Son grand-père, Jakob Suter, le fondateur de la dynastie des « Suter, papetiers », ainsi qu’ils figurent sur les registres de l’église de Kilchberg à Bâle, avait quitté la petite commune de Rünenberg à l’âge de quinze ans pour aller en apprentissage en ville. Quelque dix ans plus tard, il était devenu le plus gros fabricant de papier de Bâle et ses affaires avec les petites villes universitaires de l’Allemagne du Sud prenaient un tel développement, qu’il créait à Kandern de nouvelles fabriques de papier. C’est le père de Johann August, Hans Suter, qui dirigeait cette dernière manufacture.
C’était alors le bon vieux temps des corporations ; le maître papetier signait encore avec ses commis et ses employés des contrats et des engagements de cent un ans, et sa femme, la patronne, faisait bouillir tous les printemps, pour sa famille et celle de ses ouvriers, la tisane dépurative que l’on prenait en commun. Les secrets de fabrication passaient de père en fils, et avec l’extension des affaires, de nouvelles branches, se rattachant toutes à l’industrie et au commerce du papier – l’impression, la dominoterie, le livre, la librairie, l’édition – devenaient l’apanage de nouveaux membres de la famille. Chaque nouvelle génération, en se spécialisant, donnait un nouvel essor à « la papeterie » de l’ancêtre, déjà fameuse et bientôt de renommée européenne.
(Ainsi un oncle de Johann August Suter, Friederich Suter, avait fait la contrebande des pamphlets et des brochures révolutionnaires, passant d’énormes ballots d’imprimés de Suisse en Alsace et les distribuant dans le pays entre Altkirch et Strasbourg, ce qui lui avait valu de pouvoir assister à Paris, à titre de « fameux colporteur », aux journées de la Terreur de 1793 et de 1794, dont il a laissé un mémorial plein de détails inédits. – Aujourd’hui encore, un des derniers descendants du grand papetier, Gottlieb Suter, est établi relieur à Bâle, sur cette vieille et paisible place où les petites filles des écoles font des rondes et chantent autour de la statue du poète-paysan cantonal :
Johann Peter Hebel
Hat zwischen den Bein’ ein Knebel
Und dass man ihn besser fassen kann
Hat er zwei grossen Knollen drann
C’est une toute petite échoppe. Gottlieb, un peu fou, court les sectes, les assemblées religieuses et évangélise les prisonniers dans les prisons. Il change de religion plus souvent que de chemise et bat ses enfants dru comme plâtre. Souvent aussi, il ne sort pas du cabaret où il soliloque dans son verre. Depuis le général, tous les Suter sont comme ça.)
4
À une lieue de Besançon, Johann August Suter trempe ses pieds meurtris dans un ruisseau. Il est assis au milieu des renoncules, à trente mètres de la grand-route.
Passent sur la route, sortant d’un petit bois mauve, une dizaine de jeunes Allemands. Ce sont de gais compagnons qui vont faire leur tour de France. L’un est orfèvre, l’autre ferronnier d’art, le troisième est garçon boucher, un autre laquais. Tous se présentent et entourent bientôt Johann. Ce sont de bons bougres, toujours prêts à trousser un jupon et à boire sans soif. Ils sont en bras de chemise et portent un balluchon au bout d’un bâton. Johann se joint à leur groupe se faisant passer pour ouvrier imprimeur.
C’est en cette compagnie que Suter arrive en Bourgogne. Une nuit, à Autun, alors que ses camarades dorment, pris de vin, il en dévalise deux ou trois et en déshabille un complètement.
Le lendemain, Suter court la poste sur la route de Paris.
Arrivé à Paris, il est de nouveau sans le sou. Il n’hésite pas. Il se rend directement chez un marchand de papier en gros du Marais, un des meilleurs clients de son père, et lui présente une fausse lettre de crédit. Une demi-heure après avoir empoché la somme, il est dans la cour des Messageries du Nord. Il roule sur Beauvais et de là, par Amiens, sur Abbeville. Le patron d’une barque de pêche veut bien l’embarquer et le mener au Havre. Trois jours après, le canon tonne, les cloches sonnent, toute la population du Havre est sur les quais : l’Espérance, pyroscaphe à aubes et à voilures carrées, sort fièrement du port et double l’estacade. Premier voyage, New York.
À bord, il y a Johann August Suter, banqueroutier, fuyard, rôdeur, vagabond, voleur, escroc.
Il a la tête haute et débouche une bouteille de vin.
C’est là qu’il disparaît dans les brouillards de la Manche par temps qui crachote et mer qui roule sec. Au pays on n’entend plus parler de lui et sa femme reste quatorze ans sans avoir de ses nouvelles. Et tout à coup son nom est prononcé avec étonnement dans le monde entier.
C’est ici que commence la merveilleuse histoire du général Johann August Suter.
C’est un dimanche.
Chapitre II
5
Le port.
Le port de New York.
1834.
C’est là que débarquent tous les naufragés du vieux monde. Les naufragés, les malheureux, les mécontents. Les hommes libres, les insoumis. Ceux qui ont eu des revers de fortune ; ceux qui ont tout risqué sur une seule carte ; ceux qu’une passion romantique a bouleversés. Les premiers socialistes allemands, les premiers mystiques russes. Les idéologues que les polices d’Europe traquent ; ceux que la réaction chasse. Les petits artisans, premières victimes de la grosse industrie en formation. Les phalanstériens français, les carbonari, les derniers disciples de Saint-Martin, le philosophe inconnu, et des Écossais. Des esprits généreux, des têtes fêlées. Des brigands de Calabre, des patriotes hellènes. Les paysans d’Irlande et de Scandinavie. Des individus et des peuples victimes des guerres napoléoniennes et sacrifiés par les congrès diplomatiques. Les carlistes, les Polonais, les partisans de Hongrie. Les illuminés de toutes les révolutions de 1830 et les derniers libéraux qui quittent leur patrie pour rallier la grande République, ouvriers, soldats, marchands, banquiers de tous les pays, même sud-américains, complices de Bolivar. Depuis la Révolution française, depuis la déclaration de l’Indépendance (vingt-sept ans avant l’élection de Lincoln à la présidence), en pleine croissance, en plein épanouissement, jamais New York n’a vu ses quais aussi continuellement envahis. Les émigrants débarquent jour et nuit, et dans chaque bateau, dans chaque cargaison humaine, il y a au moins un représentant de la forte race des aventuriers.
Johann August Suter débarque le 7 juillet, un mardi. Il a fait un vœu. À quai, il saute sur le sol, bouscule les soldats de la milice, embrasse d’un seul coup d’œil l’immense horizon maritime, débouche et vide d’un trait une bouteille de vin du Rhin, lance la bouteille vide parmi l’équipage nègre d’un bermudien. Puis il éclate de rire et entre en courant dans la grande ville inconnue, comme quelqu’un de pressé et que l’on attend.
6
– Vois-tu, mon vieux, disait Paul Haberposch à Johann August Suter, moi, je t’offre une sinécure et tu seras nourri, logé, blanchi. Même que je t’habillerai. J’ai là un vieux garrick à sept collets qui éblouira les émigrants irlandais. Nulle part tu ne trouveras une situation aussi bonne que chez moi ; surtout, entre nous, que tu ne sais pas la langue ; et c’est là que le garrick fera merveille, car avec les Irlandais qui sont de sacrés bons bougres, tous fils du diable tombés tout nus du paradis, tu n’auras qu’à laisser ouvertes tes oreilles pour qu’ils y entrent tous avec leur bon dieu de langue de fils à putain qui ne savent jamais se taire. Je te jure qu’avant huit jours, tu en entendras tant que tu me demanderas à entrer dans les ordres. Un Irlandais ne peut pas se taire, mais pendant qu’il raconte ce qu’il a dans le ventre, moi, je te demande de palper un peu son balluchon, histoire de voir s’il n’a pas un double estomac comme les singes rouges ou s’il n’est pas constipé comme une vieille femme. Je te donne donc mon garrick, un gallon de Bay-Rhum (car il faut toujours trinquer avec un Irlandais qui débarque, c’est une façon de se souhaiter la bienvenue entre compatriotes) et un petit couteau de mon invention, long comme le coude, à lame flexible comme le membre d’un eunuque. Tu vois ce ressort, presse dessus, na, tu vois, il y a trois petites griffes qui sortent du bout de la lame. C’est bien comme ça, oui. Pendant que tu lui parles d’O’Connor ou de l’acte de l’Union voté par le Parlement, mon petit outil te dira si ton client a le fondement percé ou s’il est bouché à l’émeri. Tu n’auras qu’à mordre dessus pour savoir si elle est en or ou en plomb, sa rondelle. Tu as compris ? oui, eh bien, tant mieux, ça n’est pas trop tôt ! Certes, c’est de mon invention ; quand je naviguais sur les Échelles, il y avait un diable de chirurgien français à bord qui appelait ça un thermomètre. Alors je te confie le thermomètre et pas de blagues, hein ? car tu me plais, fiston, votre mère n’a pas dû s’embêter en vous fabriquant. Écoutez. Surtout n’oublie pas de bien astiquer les boutons de ton garrick, il faut qu’ils brillent comme l’enseigne d’une bonne auberge, puis tu montres le flacon de rhum, car, comme dit le proverbe : bon sang ne saurait mentir, et avec tes cheveux de radis noir, mon garrick, les boutons astiqués comme des dollars gagnés aux dés, ils te prendront pour le cocher de l’archevêque de Dublin un jour de Grand pardon, et avec leurs idées d’Europe, ils te suivront tous jusqu’ici. Fais attention, hein, ne fais pas dead-heat, ne te laisse pas souffler tes clients par le satané Hollandais d’en face ; sinon gare ! Encore un mot. Quand tu m’auras amené ici un de tes Irlandais de malheur, tâche de ne jamais plus le rencontrer dans ta vie, même pas dans cent ans ! C’est tout ce que je te souhaite. Maintenant, fous le camp, on est paré.
– Il y a des tuyaux qui sont bons ; il y a des tuyaux qui sont crevés. Moi, je vais t’apprendre comment on fait du lard avec du cochon.
C’est Hagelstroem qui parle, l’inventeur des allumettes suédoises. Johann August Suter est garçon livreur, empaqueteur et comptable chez lui. Trois mois se sont écoulés. Johann August Suter a quitté les abords immédiats du port et pénétré plus avant dans la ville. Comme toute la civilisation américaine, il se déplace lentement vers l’ouest. Depuis sa rencontre avec ce vieux corsaire d’Haberposch, il a déjà fait deux, trois métiers différents. Il s’enfonce de plus en plus en ville. Il travaille chez un drapier, chez un droguiste, dans une charcuterie. Il s’associe avec un Roumain et fait du colportage. Il est palefrenier dans un cirque. Puis maréchal-ferrant, dentiste, empailleur, vend la rose de Jéricho dans une voiture dorée, s’établit tailleur pour dames, travaille dans une scierie, boxe un nègre géant et gagne un esclave et une bourse de cent guinées, remange de la vache enragée, enseigne les mathématiques chez les Pères de la Mission, apprend l’anglais, le français, le hongrois, le portugais, le petit nègre de la Louisiane, le sioux, le comanche, le slang, l’espagnol, s’avance encore plus dans l’ouest, traverse la ville, franchit l’eau, sort en banlieue, ouvre un mastroquet dans un faubourg. À Fordham, parmi sa clientèle de rudes rouliers qui s’attardent à boire en se communiquant les mille nouvelles de l’intérieur, apparaît de temps à autre un buveur solitaire et taciturne, Edgar Allan Poe.
Deux ans se sont écoulés. Tout ce que Suter a ouï, vu, appris, entendu dire, s’est gravé dans sa mémoire. Il connaît New York, les vieilles petites rues aux noms hollandais et les grandes artères nouvelles qui se dessinent et que l’on va numéroter ; il sait quel genre d’affaires on y traite, sur quoi s’édifie la prodigieuse fortune de cette ville ; comment on s’y tient au courant de la progression des lentes caravanes de chariots dans les grandes plaines herbeuses du Middle West ; dans quels milieux se préparent des plans de conquête et des expéditions encore ignorées du Gouvernement. Il a tellement bu de whisky, de brand, de gin, d’eau-de-vie, de rhum, de caninha, de pulque, d’aguardiente avec tous les enfants perdus retour de l’intérieur, qu’il est un des hommes les mieux renseignés sur les territoires légendaires de l’ouest. Il a plus d’un itinéraire en tête, a vent de plusieurs mines d’or, est le seul à connaître certaines pistes perdues. Deux, trois fois, il risque de l’argent dans des expéditions lointaines ou mise sur la tête de tel chef de bande. Il connaît les Juifs qui financent, qui sont comme les armateurs de ces sortes d’entreprises. Il connaît aussi les fonctionnaires qu’on peut acheter.
Et il agit.
D’abord prudemment.
Il s’associe, pour le voyage seulement, à des marchands allemands et part pour Saint-Louis, capitale du Missouri.
7
L’État du Missouri est grand comme la moitié de la France. La seule voie de communication est le gigantesque Mississippi. Il y reçoit ses principaux affluents, d’abord les eaux formidables du Missouri, que les grands bacs à vapeur et à roue transversale arrière remontent durant dix-huit cents lieues, et dont les eaux sont si pures que dix-huit lieues après leur jonction on les distingue encore des eaux vaseuses, troubles, terreuses, jaunies du Mississippi ; puis, ce second fleuve, vraisemblablement aussi important et dont les eaux sont aussi pures, « la belle rivière », l’Ohio. Entre des rives basses, recouvertes de forêts, ces trois fleuves coulent majestueusement à leur rencontre.
Les populations grandissantes et fiévreusement agitées des États de l’est et du sud sont mises par ces artères géantes en communication avec les territoires inconnus qui s’étendent sans fin au nord et à l’ouest. Plus de huit cents bateaux à vapeur accostent annuellement à Saint-Louis.
C’est un peu au-dessus de la capitale, dans l’angle fertile formé par la jonction du Missouri et du Mississippi, exactement à Saint-Charles, que Johann August Suter achète des terres et s’établit fermier.
Le pays est beau et fertile. Le maïs, le coton et le tabac y poussent et surtout, plus au nord, le blé. Tous ces produits descendent le fleuve, vers les États plus chauds, pour être mesurés hebdomadairement aux Nègres qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. Cela est d’un bon rapport.
Mais ce qui intéresse avant tout Suter dans ce trafic, c’est la parole vivante des voyageurs qui montent et descendent les rivières. Sa maison est ouverte à tous et sa table toujours mise. Une barque armée, montée d’esclaves noirs, arraisonne les bateaux qui passent et les mène à l’estacade. L’accueil est tel que la maison ne désemplit pas ; aventuriers, colons, trappeurs qui descendent chargés de butins ou misérables, tous également heureux de se refaire là et de se remettre des fatigues de la brousse et des prairies ; chercheurs de fortune, casse-cou, têtes brûlées qui remontent, la fièvre aux yeux, mystérieux, secrets.
Suter est infatigable, il les régale tous, passe des nuits à boire, interroge insatiablement son monde.
Mentalement il confronte tous ces récits, les classe, les compare. Il se souvient de tout et n’oublie pas un nom propre, de col, rivière, montagne ou lieux-dits : l’Arbre Sec, les Trois Cornes, le Gué Mauvais.
Un jour, il a une illumination. Tous, tous les voyageurs qui ont défilé chez lui, les menteurs, les bavards, les vantards, les hâbleurs, et même les plus taciturnes, tous ont employé un mot immense qui donne toute sa grandeur à leurs récits. Ceux qui en disent trop comme ceux qui n’en disent pas assez, les fanfarons, les peureux, les chasseurs, les outlaws, les trafiquants, les colons, les trappeurs, tous, tous, tous, tous parlent de l’Ouest, ne parlent en somme que de l’Ouest.
L’Ouest.
Mot mystérieux.
Qu’est-ce que l’Ouest ?
Voici la notion qu’il en a.
De la vallée du Mississippi jusqu’au-delà des montagnes géantes, bien loin, bien loin, bien avant dans l’ouest, s’étendent des territoires immenses, des terres fertiles à l’infini, des steppes arides à l’infini. La prairie. La patrie des innombrables tribus peaux rouges et des grands troupeaux de bisons qui vont et viennent comme le flux de la mer.
Mais après, mais derrière ?
Il y a des récits d’Indiens qui parlent d’un pays enchanté, de villes d’or, de femmes qui n’ont qu’un sein. Même les trappeurs qui descendent du nord avec leur chargement de fourrures ont entendu parler sous leur haute latitude, de ces pays merveilleux de l’ouest, où, disent-ils, les fruits sont d’or et d’argent.
L’Ouest ? Qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi y a-t-il tant d’hommes qui s’y rendent et qui n’en reviennent jamais ? Ils sont tués par les Peaux Rouges ; mais celui qui passe outre ? Il meurt de soif ; mais celui qui traverse les déserts ? Il est arrêté par les montagnes ; mais celui qui franchit le col ? Où est-il ? qu’a-t-il vu ? Pourquoi y en a-t-il tant parmi ceux qui passent chez moi qui piquent directement au nord et qui, à peine dans la solitude, obliquent brusquement à l’ouest ?