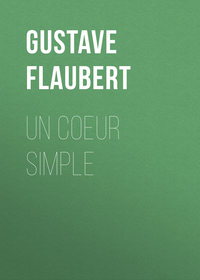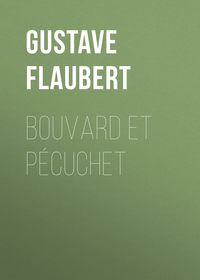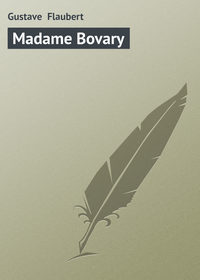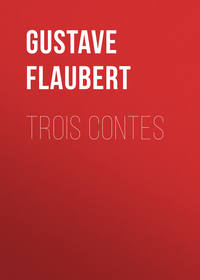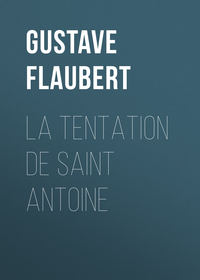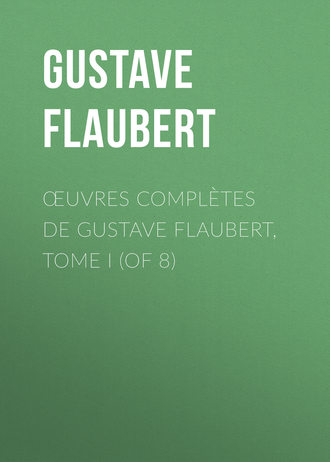
Полная версия
?uvres compl?tes de Gustave Flaubert, tome I (of 8)
L'après-midi, quelquefois, elle allait causer en face avec les postillons. Madame se tenait en haut, dans son appartement.
Elle portait une robe de chambre tout ouverte, qui laissait voir, entre les revers à châle du corsage, une chemisette plissée avec trois boutons d'or. Sa ceinture était une cordelière à gros glands, et ses petites pantoufles de couleur grenat avaient une touffe de rubans larges, qui s'étalait sur le cou-de-pied. Elle s'était acheté un buvard, une papeterie, un porte-plume et des enveloppes, quoiqu'elle n'eût personne à qui écrire; elle époussetait son étagère, se regardait dans la glace, prenait un livre, puis, rêvant entre les lignes, le laissait tomber sur ses genoux. Elle avait envie de faire des voyages, ou de retourner vivre à son couvent. Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris.
Charles, à la neige et à la pluie, chevauchait par les chemins de traverse. Il mangeait des omelettes sur la table des fermes, entrait son bras dans des lits humides, recevait au visage le jet tiède des saignées, écoutait les râles, examinait des cuvettes, retroussait bien du linge sale; mais il trouvait tous les soirs un feu flambant, la table servie, des meubles souples, et une femme en toilette fine, charmante et sentant frais, à ne savoir même d'où venait cette odeur, ou si ce n'était pas sa peau qui parfumait sa chemise.
Elle le charmait par quantité de délicatesses; c'était tantôt une manière nouvelle de façonner pour les bougies des bobèches de papier, un volant qu'elle changeait à sa robe ou le nom extraordinaire d'un mets bien simple, et que la bonne avait manqué, mais que Charles jusqu'au bout avalait avec plaisir. Elle vit, à Rouen, des dames qui portaient à leur montre un paquet de breloques; elle acheta des breloques. Elle voulut sur sa cheminée deux grands vases de verre bleu, et quelque temps après un nécessaire d'ivoire, avec un dé de vermeil. Moins Charles comprenait ces élégances, plus il en subissait la séduction. Elles ajoutaient quelque chose au plaisir de ses sens et à la douceur de son foyer. C'était comme une poussière d'or qui sablait tout du long le petit sentier de sa vie.
Il se portait bien, il avait bonne mine; sa réputation était établie tout à fait. Les campagnards le chérissaient parce qu'il n'était pas fier. Il caressait les enfants, n'entrait jamais au cabaret, et d'ailleurs inspirait la confiance par sa moralité. Il réussissait particulièrement dans les catarrhes et les maladies de poitrine. Craignant beaucoup de tuer son monde, Charles, en effet, n'ordonnait que des potions calmantes, de temps à autre de l'émétique, un bain de pieds ou des sangsues. Ce n'était pas que la chirurgie lui fît peur; il vous saignait les gens largement, comme des chevaux, et il avait pour l'extraction des dents une poigne d'enfer.
Enfin, pour se tenir au courant, il prit un abonnement à la Ruche médicale, journal nouveau dont il avait reçu le prospectus. Il en lisait un peu après son dîner; mais la chaleur de l'appartement, jointe à la digestion, faisait qu'au bout de cinq minutes, il s'endormait; et il restait là, le menton sur ses deux mains, et les cheveux étalés comme une crinière jusqu'au pied de la lampe. Emma le regardait en haussant les épaules. Que n'avait-elle au moins pour mari un de ces hommes d'ardeurs taciturnes qui travaillent la nuit dans les livres, et portent enfin à soixante ans, quand vient l'âge des rhumatismes, une brochette de croix sur leur habit noir, mal fait. Elle aurait voulu que ce nom de Bovary, qui était le sien, fût illustre, le voir étalé chez les libraires, répété dans les journaux, connu par toute la France. Mais Charles n'avait point d'ambition! Un médecin d'Yvetot, avec qui dernièrement il s'était trouvé en consultation, l'avait humilié quelque peu, au lit même du malade, devant les parents assemblés. Quand Charles lui raconta le soir cette anecdote, Emma s'emporta bien haut contre le confrère. Charles en fut attendri. Il la baisa au front avec une larme. Mais elle était exaspérée de honte; elle avait envie de le battre, elle alla dans le corridor ouvrir la fenêtre et huma l'air frais pour se calmer. «Quel pauvre homme! quel pauvre homme!» disait-elle tout bas en se mordant les lèvres.
Elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui. Il prenait avec l'âge des allures épaisses; il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides; il se passait, après manger, la langue sur les dents; il faisait, en avalant la soupe, un gloussement à chaque gorgée; et, comme il commençait à engraisser, ses yeux, déjà petits, semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes.
Emma, quelquefois, lui rentrait dans son gilet la bordure rouge de ses tricots, rajustait sa cravate, ou jetait à l'écart les gants déteints qu'il se disposait à passer; et ce n'était pas, comme il le croyait, pour lui, mais pour elle-même, par expansion d'égoïsme, agacement nerveux. Quelquefois aussi, elle lui parlait des choses qu'elle avait lues, comme d'un passage de roman, d'une pièce nouvelle, ou de l'anecdote du grand monde que l'on racontait dans le feuilleton; car, enfin, Charles était quelqu'un, une oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête. Elle faisait bien des confidences à sa levrette! Elle en eût fait aux bûches de la cheminée et au balancier de la pendule.
Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelque voile blanche dans les brumes de l'horizon. Elle ne savait pas quel serait ce hasard, le vent qui le pousserait jusqu'à elle, vers quel rivage il la mènerait, s'il était chaloupe ou vaisseau à trois ponts, chargé d'angoisses ou plein de félicités jusqu'aux sabords. Mais chaque matin, à son réveil, elle l'espérait pour la journée, et elle écoutait tous les bruits, se levant en sursaut, s'étonnait qu'il ne vînt pas, puis au coucher du soleil, toujours plus triste, désirait être au lendemain.
Le printemps reparut. Elle eut des étouffements aux premières chaleurs, quand les poiriers fleurirent.
Dès le commencement de juillet, elle compta sur ses doigts combien de semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre, pensant que le marquis d'Andervilliers, peut-être, donnerait encore un bal à la Vaubyessard. Mais tout septembre s'écoula sans lettre ni visite.
Après l'ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide, et alors la série des mêmes journées recommença.
Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi, à la file, toujours pareilles, innombrables, et n'apportant rien! Les autres existences, si plates qu'elles fussent, avaient du moins la chance d'un événement. Une aventure amenait parfois des péripéties à l'infini, et le décor changeait. Mais pour elle, rien n'arriverait, Dieu l'avait voulu! L'avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée.
Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer? qui l'entendrait? Puisqu'elle ne pourrait jamais, en robe de velours à manches courtes, sur un piano d'Érard, dans un concert, battant de ses doigts légers les touches d'ivoire, sentir comme une brise circuler autour d'elle un murmure d'extase, ce n'était pas la peine de s'ennuyer à étudier. Elle laissa dans l'armoire ses cartons à dessin et la tapisserie. A quoi bon! à quoi bon! La couture l'irritait. «J'ai tout lu», se disait-elle, et elle restait à faire rougir les pincettes, ou regardant la pluie tomber.
Comme elle était triste, le dimanche, quand on sonnait les vêpres! Elle écoutait, dans un hébétement attentif, tinter un à un les coups fêlés de la cloche. Quelque chat sur les toits, marchant lentement, bombait son dos aux rayons pâles du soleil. Le vent, sur la grande route, soufflait des traînées de poussière. Au loin, parfois, un chien hurlait; et la cloche, à temps égaux, continuait sa sonnerie monotone qui se perdait dans la campagne.
Cependant on sortait de l'église, les femmes en sabots cirés, les paysans en blouse neuve, les petits enfants qui sautillaient nu-tête devant eux, tout rentrait chez soi. Et jusqu'à la nuit, cinq à six hommes, toujours les mêmes, restaient à jouer au bouchon, devant la grande porte de l'auberge.
L'hiver fut froid. Les carreaux chaque matin étaient chargés de givre, et la lumière, blanchâtre à travers eux, comme par des verres dépolis, quelquefois ne variait pas de la journée. Dès quatre heures du soir, il fallait allumer la lampe.
Les jours qu'il faisait beau, elle descendait dans le jardin. La rosée avait laissé sur les choux des guipures d'argent avec de longs fils clairs qui s'étendaient de l'un à l'autre. On n'entendait pas d'oiseaux; tout semblait dormir, l'espalier couvert de paille et la vigne comme un grand serpent malade sous le chaperon du mur, où l'on voyait, en s'approchant, se traîner des cloportes à pattes nombreuses. Dans les sapinettes, près de la haie, le curé en tricorne qui lisait son bréviaire avait perdu le pied droit, et même le plâtre, s'écaillant à la gelée, avait fait des gales blanches sur sa figure.
Puis elle remontait, fermait la porte, étalait les charbons, et, défaillant à la chaleur du foyer, sentait l'ennui plus lourd qui retombait sur elle. Elle serait bien descendue causer avec la bonne, mais une pudeur la retenait.
Tous les jours, à la même heure, le maître d'école, en bonnet de soie noire, ouvrait les auvents de sa maison, et le garde champêtre passait, portant son sabre sur sa blouse. Soir et matin, les chevaux de la poste, trois par trois, traversaient la rue, pour aller boire à la mare. De temps à autre, la porte d'un cabaret faisait tinter sa sonnette; et, quand il y avait du vent, l'on entendait grincer sur leurs deux tringles les petites cuvettes en cuivre du perruquier qui servaient d'enseigne à sa boutique. Elle avait pour décoration une vieille gravure de modes collée contre un carreau et un buste de femme en cire, dont les cheveux étaient jaunes. Lui aussi, le perruquier, il se lamentait de sa vocation arrêtée, de son avenir perdu, et rêvant quelque boutique dans une grande ville, comme à Rouen par exemple, sur le port, près du théâtre, il restait toute la journée à se promener en long depuis la mairie jusqu'à l'église, sombre, et attendant la clientèle. Lorsque Mme Bovary levait les yeux, elle le voyait toujours là, comme une sentinelle en faction, avec son bonnet grec sur l'oreille et sa veste de lasting.
Dans l'après-midi quelquefois, une tête d'homme apparaissait derrière les vitres de la salle, tête hâlée, à favoris noirs, et qui souriait lentement, d'un large sourire doux à dents blanches. Une valse aussitôt commençait, et sur l'orgue, dans un petit salon, des danseurs hauts comme le doigt, femmes en turbans roses, tyroliens en jaquette, singes en habit noir, messieurs en culotte courte, tournaient, tournaient entre les fauteuils, les canapés, les consoles, se répétant dans les morceaux de miroir que raccordait à leurs angles un filet de papier doré. L'homme faisait aller sa manivelle, regardant à droite, à gauche, et vers les fenêtres. De temps à autre, tout en lançant contre la borne un long jet de salive brune, il soulevait du genou son instrument, dont la bretelle dure lui fatiguait l'épaule; et tantôt dolente et traînarde, ou joyeuse et précipitée, la musique de la boîte s'échappait en bourdonnant à travers un rideau de taffetas rose, sous une grille de cuivre en arabesques. C'étaient des airs que l'on jouait ailleurs sur les théâtres, que l'on chantait dans les salons, que l'on dansait le soir sous des lustres éclairés, échos du monde, qui arrivaient jusqu'à Emma. Des sarabandes à n'en plus finir se déroulaient dans sa tête, et, comme une bayadère sur les fleurs d'un tapis, sa pensée, bondissant avec les notes, se balançait de rêve en rêve et de tristesse en tristesse. Quand l'homme avait reçu l'aumône dans sa casquette, il rabattait une vieille couverture de laine bleue, passait son orgue sur son dos et s'éloignait d'un pas lourd. Elle le regardait partir.
Mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus, dans cette petite salle au rez-de-chaussée, avec le poêle qui fumait, la porte criant, les murs qui suintaient, les pavés humides! Toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette, et, à la fumée du bouilli, il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement. Charles était long à manger; elle grignotait quelques noisettes, ou bien, appuyée du coude, s'amusait, avec la pointe de son couteau, à faire des raies sur la toile cirée.
Elle laissait maintenant tout aller dans son ménage; et Mme Bovary mère, lorsqu'elle vint passer à Tostes une partie du carême, s'étonna fort de ce changement. Elle, en effet, si soigneuse autrefois et délicate, elle restait à présent des journées entières sans s'habiller, portait des bas de coton gris, s'éclairait à la chandelle. Elle répétait qu'il fallait économiser puisqu'ils n'étaient pas riches, ajoutant qu'elle était très contente, très heureuse, que Tostes lui plaisait beaucoup, et autres discours nouveaux qui fermaient la bouche à la belle-mère. Du reste, Emma ne semblait plus disposée à suivre ses conseils; une fois même, Mme Bovary s'étant avisée de prétendre que les maîtres devaient surveiller la religion de leurs domestiques, elle lui avait répondu d'un œil si plein de colère et avec un sourire tellement froid que la bonne femme ne s'y refrotta plus.
Emma devenait difficile, capricieuse. Elle se commandait des plats pour elle, n'y touchait point, un jour ne buvait que du lait pur et le lendemain des tasses de thé à la douzaine. Souvent elle s'obstinait à ne pas sortir, puis elle suffoquait, ouvrait les fenêtres, s'habillait en robe légère. Lorsqu'elle avait bien rudoyé sa servante, elle lui faisait des cadeaux ou l'envoyait se promener chez les voisines, de même qu'elle jetait parfois aux pauvres toutes les pièces blanches de sa bourse, – quoiqu'elle ne fût guère tendre cependant, ni facilement accessible à l'émotion d'autrui, comme la plupart des gens issus de campagnards, qui gardent toujours sur l'âme quelque chose de la callosité des mains paternelles.
Vers la fin de février, le père Rouault, en souvenir de sa guérison, apporta lui-même à son gendre une dinde superbe, et il resta trois jours à Tostes. Charles étant à ses malades, Emma lui tint compagnie. Il fuma dans la chambre, cracha sur les chenets, causa culture, veaux, vaches, volailles et conseil municipal, si bien qu'elle referma la porte, quand il fut parti, avec un sentiment de satisfaction qui la surprit elle-même. D'ailleurs, elle ne cachait plus son mépris pour rien ni pour personne; et elle se mettait quelquefois à exprimer des opinions singulières, blâmant ce que l'on approuvait, et approuvant des choses perverses ou immorales, ce qui faisait ouvrir de grands yeux à son mari.
Est-ce que cette misère durerait toujours? Est-ce qu'elle n'en sortirait pas? Elle valait bien cependant toutes celles qui vivaient heureuses! Elle avait vu des duchesses à la Vaubyessard qui avaient la taille plus lourde et les façons plus communes; et elle exécrait l'injustice de Dieu; elle s'appuyait la tête aux murs pour pleurer; elle enviait les existences tumultueuses, les nuits masquées, les insolents plaisirs avec tous les éperduments qu'elle ne connaissait pas et qu'ils devaient donner.
Elle pâlissait et avait des battements de cœur. Charles lui administra de la valériane et des bains de camphre. Tout ce que l'on essayait semblait l'irriter davantage.
En de certains jours, elle bavardait avec une abondance fébrile; à ces exaltations succédaient tout à coup des torpeurs où elle restait sans parler, sans bouger. Ce qui la ranimait alors, c'était de se répandre sur les bras un flacon d'eau de Cologne.
Comme elle se plaignait de Tostes continuellement, Charles imagina que la cause de sa maladie était dans quelque influence locale, et, s'arrêtant à cette idée, il songea sérieusement à aller s'établir ailleurs.
Dès lors elle but du vinaigre pour se faire maigrir, contracta une petite toux sèche et perdit complètement l'appétit.
Il en coûtait à Charles d'abandonner Tostes après quatre ans de séjour et au moment où il commençait à s'y poser. S'il le fallait, cependant! Il la conduisit à Rouen voir son ancien maître. C'était une maladie nerveuse. On devait la changer d'air.
Après s'être tourné de côté et d'autre, Charles apprit qu'il y avait dans l'arrondissement de Neufchâtel un fort bourg nommé Yonville-l'Abbaye, dont le médecin, qui était un réfugié polonais, venait de décamper la semaine précédente. Alors il écrivit au pharmacien de l'endroit pour savoir quel était le chiffre de la population, la distance où se trouvait le confrère le plus voisin, combien par année gagnait son prédécesseur, etc.; et les réponses ayant été satisfaisantes, il se résolut à déménager vers le printemps, si la santé d'Emma ne s'améliorait pas.
Un jour qu'en prévision de son départ elle faisait des rangements dans un tiroir, elle se piqua les doigts à quelque chose. C'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière, et les rubans de satin, à liséré d'argent, s'effiloquaient par le bord. Elle le jeta dans le feu. Il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche. Puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres, et qui se rongeait lentement. Elle le regarda brûler. Les petites baies de carton éclataient, les fils d'archal se tordaient, le galon se fondait; et les corolles de papier, raccornies, se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs, enfin s'envolèrent par la cheminée.
Quand on partit de Tostes, au mois de mars, Mme Bovary était enceinte.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIEDEUXIÈME PARTIE
I
Yonville-l'Abbaye (ainsi nommé à cause d'une ancienne abbaye de capucins dont les ruines n'existent même plus) est un bourg à huit lieues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beauvais, au fond d'une vallée qu'arrose la Rieule, petite rivière qui se jette dans l'Andelle après avoir fait tourner trois moulins vers son embouchure, et où il y a quelques truites, que les garçons, le dimanche, s'amusent à pêcher à la ligne.
On quitte la grande route à la Boissière et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte des Leux, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme deux régions de physionomie distincte. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière aux pâturages du pays de Bray, tandis que du côté de l'est la plaine montant doucement va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche sinueuse la couleur des prés et celle des sillons, et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert bordé d'un galon d'argent.
Au bout de l'horizon, lorsqu'on arrive, on a devant soi les chênes de la forêt d'Argueil, avec les escarpements de la côte Saint-Jean rayés du haut en bas par de longues traînées rouges, inégales; ce sont les traces des pluies; et ces tons de brique, tranchant en filets minces sur la couleur grise de la montagne, viennent de la quantité de sources ferrugineuses qui coulent au delà, dans le pays d'alentour.
On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Ile-de-France, contrée bâtarde où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neufchâtel de tout l'arrondissement, et d'autre part la culture y est coûteuse, parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser ces terres friables, pleines de sable et de cailloux.
Jusqu'en 1835, il n'y avait point de route praticable pour arriver à Yonville, mais on a établi vers cette époque un chemin de grande vicinalité, qui relie la route d'Abbeville à celle d'Amiens et sert quelquefois aux rouliers allant de Rouen dans les Flandres. Cependant Yonville-l'Abbaye est demeuré stationnaire, malgré ses débouchés nouveaux. Au lieu d'améliorer les cultures, on s'y obstine encore aux herbages, quelque dépréciés qu'ils soient; et le bourg paresseux, s'écartant de la plaine, a continué naturellement à s'agrandir vers la rivière. On l'aperçoit de loin, tout couché en long sur la rive, comme un gardeur de vaches qui fait la sieste au bord de l'eau.
Au bas de la côte, après le pont, commence une chaussée plantée de jeunes trembles, qui vous mène en droite ligne jusqu'aux premières maisons du pays. Elles sont encloses de haies, au milieu de cours pleines de bâtiments épars, pressoirs, charretteries et bouilleries, disséminés sous les arbres touffus portant des échelles, des gaules ou des faux accrochées dans leur branchage. Les toits de chaume, comme des bonnets de fourrure rabattus sur des yeux, descendent jusqu'au tiers à peu près des fenêtres basses, dont les gros verres bombés sont garnis d'un nœud dans le milieu, à la façon des culs de bouteille. Sur le mur de plâtre, que traversent en diagonale des lambourdes noires, s'accroche parfois quelque maigre poirier, et les rez-de-chaussée ont à leur porte une petite barrière tournante pour les défendre des poussins, qui viennent picorer, sur le seuil, des miettes de pain bis trempé de cidre. Cependant les cours se font plus étroites, les habitations se rapprochent, les haies disparaissent; un fagot de fougères se balance sous une fenêtre au bout d'un manche à balai; il y a la forge d'un maréchal et ensuite un charron avec deux ou trois charrettes neuves, en dehors, qui empiètent sur la route. Puis, à travers une claire-voie, apparaît une maison blanche au delà d'un rond de gazon que décore un Amour, le doigt posé sur la bouche; deux vases en fonte sont à chaque bout du perron; des panonceaux brillent à la porte; c'est la maison du notaire et la plus belle du pays.
L'église est de l'autre côté de la rue, vingt pas plus loin, à l'entrée de la place. Le petit cimetière qui l'entoure, clos d'un mur à hauteur d'appui, est si bien rempli de tombeaux que les vieilles pierres à ras du sol font un dallage continu, où l'herbe a dessiné de soi-même des carrés verts réguliers. L'église a été rebâtie à neuf dans les dernières années du règne de Charles X. La voûte en bois commence à se pourrir par le haut, et, de place en place, a des enfonçures noires dans sa couleur bleue. Au-dessus de la porte, où seraient les orgues, se tient un jubé pour les hommes, avec un escalier tournant qui retentit sous les sabots.
Le grand jour, arrivant par les vitraux tout unis, éclaire obliquement les bancs rangés en travers de la muraille, que tapisse çà et là quelque paillasson cloué, ayant au-dessous de lui ces mots en grosses lettres: «Banc de M. un tel.» Plus loin, à l'endroit où le vaisseau se rétrécit, le confessionnal fait pendant à une statuette de la Vierge, vêtue d'une robe de satin, coiffée d'un voile de tulle semé d'étoiles d'argent, et tout empourprée aux pommettes comme une idole des îles Sandwich; enfin une copie de la Sainte Famille, envoi du ministre de l'intérieur, dominant le maître autel entre quatre chandeliers, termine au fond la perspective. Les stalles du chœur, en bois de sapin, sont restées sans être peintes.
Les halles, c'est-à-dire un toit de tuiles supporté par une vingtaine de poteaux, occupent à elles seules la moitié environ de la grande place d'Yonville. La mairie, construite sur les dessins d'un architecte de Paris, est une manière de temple grec qui fait l'angle, à côté de la maison du pharmacien. Elle a au rez-de-chaussée trois colonnes ioniques, et au premier étage une galerie à plein cintre, tandis que le tympan qui la termine est rempli par un coq gaulois, appuyé d'une patte sur la charte et tenant, de l'autre, les balances de la justice.
Mais, ce qui attire le plus les yeux, c'est, en face de l'auberge du Lion d'or, la pharmacie de M. Homais! le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs deux clartés de couleur; alors, à travers elles, comme dans des feux du Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien, accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée: «Eaux de Vichy, de Seltz et de Barèges, robs dépuratifs, médecine Raspail, racahout des Arabes, pastilles Darcet, pâte Regnault, bandages, bains, chocolats de santé, etc.» Et l'enseigne, qui tient toute la largeur de la boutique, porte en lettres d'or: Homais, pharmacien. Puis, au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois Homais, en lettres d'or, sur un fond noir.