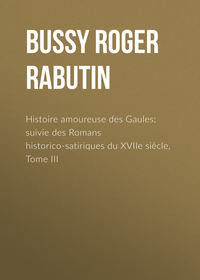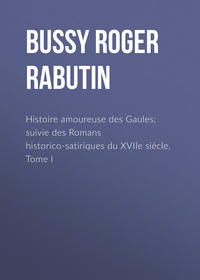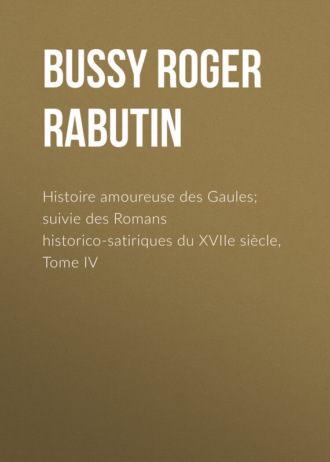
Полная версия
Histoire amoureuse des Gaules; suivie des Romans historico-satiriques du XVIIe siècle, Tome IV
26
Le Journal de la Santé du Roi ne parle pas de cette malencontreuse verrue; mais bien qu'en 1672 «Sa Majesté ait joui d'une santé digne d'elle», il avoit eu cependant, à plusieurs reprises, soit sur la poitrine, soit sur d'autres parties du corps de nombreuses tumeurs et duretés squirreuses.
27
La tempe. Cette forme s'est conservée dans le patois normand (voy. le glossaire de Du Bois); le glossaire genevois de Gaudy l'a également relevée. Furetière, Richelet n'admettent pas la forme tempe, aujourd'hui en usage. – Chapelain a dit, en parlant d'Agnès Sorel:
Les glaces lui font voir un front grand et modesteSur qui vers chaque temple, à bouillons séparés,Tombent les riches flots de ses cheveux dorés.Le Richelet de 1719 n'admet encore que temple; mais le dictionnaire de Trévoux de 1732 dit: «tempe, voyez temple.»
28
«Happelourde, faux diamant, ou toute pierre précieuse contrefaite, ou qui n'est pas arrivée à la perfection», dit Furetière. Le mot est pris ici dans son sens propre; on connoît son sens figuré.
29
On assure que le roi Louis XIV, voulant sauver les apparences, ne passa jamais une nuit sans aller coucher dans la chambre de la reine.
30
Voyez ci-dessus, p. 25, note 14.
31
C'est la pensée de Pascal, sur le nez de Cléopâtre et le grain de sable de Cromwell.
32
Remora. Furetière conteste déjà l'opinion de Pline et de tous les anciens qui, après lui, attribuaient au remora la force d'arrêter un vaisseau dans sa course: «mais les modernes tiennent que c'est une fable.»
33
La 1re édition de ce petit roman, reproduite par M. Paul Lacroix, remplace le passage qui suit par un texte tout différent, que nous reproduisons ci-dessous:
« – Je suis bien aise, répliqua le duc, que Votre Majesté soit en humeur de railler sur cette aventure, et si vous n'étiez pas mon roi, je dirois encore une plaisanterie qui m'est venue dans l'esprit sur le malheur qui vient de vous arriver.
«Le Roi lui permit de dire tout ce qu'il voudroit, ne cherchant qu'à dissiper son chagrin. – Je ne puis penser à la fatalité de votre aventure, dit alors le duc, qu'il ne me souvienne de ce que j'ai ouï dire autrefois d'un certain Martin qui, ayant un âne noir, voulut faire une gageure qu'on n'y trouveroit pas un seul poil d'une autre couleur. Aussi étoit-il noir depuis les pieds jusques à la tête. Cependant il y eut un homme qui se présenta pour faire cette gageure. Il offrit de payer le prix de l'âne s'il n'y remarquoit aucun poil qui ne fût noir, et le maître de la bête s'engagea à la lui livrer s'il trouvoit un seul poil d'une autre couleur. La chose étant ainsi arrêtée entr'eux, il se trouva que la bête avoit un poil qui étoit grisâtre, mais si menu qu'il ne paroissoit que comme un point; ce qui fut cause que son maître la perdit, et de là est venu ce proverbe: pour un point, Martin perdit son âne. Et vous, Sire, pour quelque chose de semblable, vous avez perdu la comtesse, qui, sans cela, ne pouvoir pas vous échapper.
«Le Roi ne fit que rire de cette plaisanterie, et dit qu'effectivement il ne s'étoit jamais aperçu de cette marque sur son corps. Cependant, ajouta-t-il, c'est ce qui m'a fait perdre la bête que je tenois sans cela. Voilà la deuxième fois… etc.»
34
Voy. t. I, p. 272, et passim, à la table.
35
Voy. t. I, préface.
36
Nous dirions prendre le mors aux dents.
37
A partir de cette réplique du Roi, les deux textes se confondent. – Voy. p. 88, note 33.
38
Erreur. Voir ci-dessus, page 31, note 16.
39
Nous sommes en 1672. Il s'agit évidemment des divertissements donnés à Versailles par le Roi à toute sa cour à cette époque. La relation qui en a été publiée répartit ces fêtes en six journées.
40
Furetière définit un parterre: «la partie d'un jardin découverte où on entre en sortant de la maison.»
41
Qui s'ajoutoit à plus de…
42
Voir sur ces costumes l'intéressant ouvrage de M. Ludovic Celler: Les décors, les costumes et la mise en scène au xviie siècle, 1 vol. in-12. Paris, Liepmannsohn et Dufour, 1869.
43
Du temps où les loups de velours noir étaient en usage, ils devaient tomber devant le Roi ou la Reine; à plus forte raison les masques.