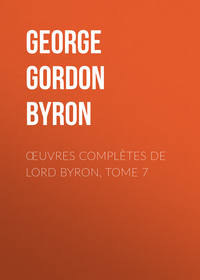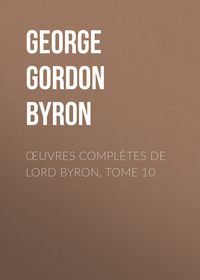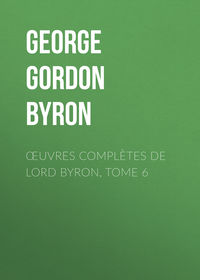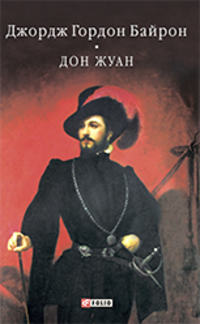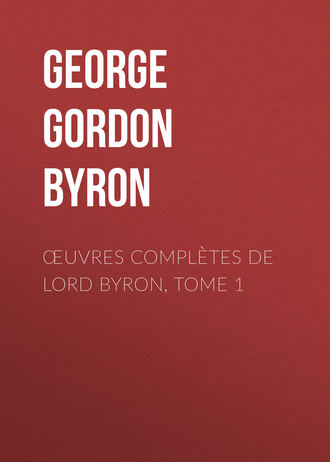
Полная версия
Œuvres complètes de lord Byron, Tome 1
Quoi qu'il en soit, la séparation de Lord et de lady Byron fit revivre tous les anciens contes dont les précieuses de Londres (les bas bleus) avaient les premières répandu le bruit: tous les écrits périodiques, à l'exception d'un seul (l'Examinateur), les répétèrent à l'envi: une mistress Lee composa un roman dont le héros (Lord Byron) était, sous le nom de Glenarvon, accusé de plusieurs assassinats. On alla jusqu'à imprimer qu'étranger à tous les sentimens de bienveillance et d'humanité il n'était pas même susceptible d'être captivé par les attraits ou les vertus d'une femme; et les stances ravissantes qu'il avait adressées à Thirza, à Maria, à Janthé, ne lui avaient été inspirées que par son attachement pour un ours et le chien de Terre-Neuve dont il avait composé l'épitaphe. Il ne paraissait plus à Drury-Lane sans être accueilli par des huées; les dames le désignaient du doigt, les enfans poursuivaient sa voiture quand il se rendait à la chambre des pairs, et sa vertueuse femme écoutait avec une merveilleuse sérénité le récit des calomnies dont il était abreuvé.
Cependant, cet homme était Lord Byron, le chantre de Childe Harold et du Giaour! celui qui avait défendu de toutes ses forces les catholiques d'Irlande et les chrétiens de l'Orient! Ah! si, pour l'honneur de la France, un aussi puissant génie, une aussi grande ame, eût reçu le jour dans son sein, lui eût-on décerné les mêmes récompenses? Les clameurs de misérables et ridicules coteries auraient-elles ainsi aveuglé l'opinion publique? Nous avons l'orgueil d'en douter.
Il ne faut pas s'étonner si, depuis ce moment, Byron conserva contre l'Angleterre une haine profonde: elle n'était plus digne de ses hommages. Pour comble de disgrâces, il se vit obligé de vendre l'abbaye de Newstead, demeure de ses ancêtres, afin de restituer aux Milbank la dot de lady Byron. Newstead seule le retenait en Angleterre; quand il s'en fut dépouillé, il s'éloigna une seconde fois d'une ingrate patrie, avec la résolution de n'y jamais revenir.
Quelques jours avant son départ, une jeune dame, que ses talens n'avaient pu tirer de la misère, se présente chez lui, et le prie d'honorer de sa protection un recueil de vers qui formait son unique ressource. Elle était belle, ses parens étaient éloignés, et ceux qui d'abord l'avaient encouragée à se dévouer au culte des muses lui avaient retiré leur protection, avant d'avoir pu apprécier si réellement elle en était digne. Byron l'écouta avec attention. Quand elle eut fini de parler: «Puissiez-vous, madame, répondit-il en lui présentant un billet plié, être plus heureuse que moi; puissent vos talens, vos vertus et votre beauté désarmer l'envie! Voici ma souscription. Mais tous deux nous sommes jeunes, et le monde est pervers; je ne veux donc pas avoir l'air de m'intéresser à vos succès: ce serait vous faire plus de tort que de bien.» La jeune dame prit alors congé de lui, et sa surprise fut grande, en rentrant chez elle, de voir que le poète lui avait remis un bon de cinquante louis sur son banquier. Avant qu'elle songeât à publier ce trait de générosité, Byron touchait au rivage de la France.
C'était au printems de 1816. Il emmenait avec lui une bibliothèque composée de poètes grecs, latins et italiens; l'assortiment d'animaux dont nous avons déjà parlé, et le bon et fidèle Fletcher, dont la destinée, assez conforme à celle de son maître, était d'abandonner, de maudire et de regretter sans cesse sa patrie, sa femme et ses enfans. Lord Byron traversa rapidement la France: sa première halte fut le champ de Waterloo. Il parcourut plusieurs fois cette plaine désormais célèbre, et qui lui rendait les impressions de Salamine et de Marathon. Après avoir visité successivement Bruxelles, Coblentz et Bâle, il s'arrêta, pendant l'été, à la campagne Diodati, sur les bords du lac de Genève.
Depuis son départ d'Angleterre, la violence des tourmens intérieurs avait influé sur sa santé: mais Clarence et les rochers de Meillerie, en rappelant à son cœur les sublimes rêveries de Rousseau; les montagnes du Jura, en l'attendrissant à la pensée de sa chère Écosse; l'aspect du lac de Genève enfin, tout contribuait à calmer ses ennuis et à ranimer ses forces physiques. Tous les soirs, comme si le lac eût pu verser dans son ame la tranquillité de sa limpide surface, il aimait à voguer sur les flots, dans un frêle bateau. Ces courses n'étaient pas sans danger: quelquefois l'onde s'agitait subitement avec violence, et notre poète, un jour, fut sur le point de périr à l'endroit même où Saint-Preux avait caressé l'idée de précipiter dans les flots madame de Volmar. C'est ainsi que, dans la nature, tout, jusqu'aux élémens, semblait destiné à nourrir son ame de grandes et poétiques inspirations.
Il retrouva, dans les environs de Genève, ses anciens amis; Cam Hobhouse, Monk Lewis, auteur du plus fantastique des romans, et Shelley, dont les habitudes austères et les opinions indépendantes lui plaisaient, jusque dans leur exagération. Mais, de toutes les personnes dont il cultiva la société, nulle ne l'intéressa plus que madame de Staël, alors retirée à Coppet: c'était, en effet, deux ames dignes de s'entendre. On se rappelle la prédilection de Corinne pour la littérature, les opinions et les lois de l'Angleterre; elle semblait remercier chaque citoyen de Londres de la naissance de Shakspeare et de la chute de Napoléon. En ce moment, comme elle avait au nombre de ses hôtes plusieurs Anglaises, de celles dont Byron avait flétri les doctes prétentions, il était naturel qu'elle fût encore la dupe des calomnies débitées contre l'auteur de Childe Harold. Quand on annonçait la visite de Byron, ces dames quittaient le salon, et frémissaient à l'idée de regarder en face un semblable monstre. Pour madame de Staël, à peine l'eut-elle entendu, qu'elle déposa ses anciens préjugés. Un jour, après avoir lu les stances que Byron avait adressées à sa femme en quittant l'Angleterre, elle s'écria: «Mesdames, je ne sais quel est le coupable, mais je me consolerais d'avoir été malheureuse comme lady Byron, si j'avais inspiré à mon époux de semblables adieux.» En effet, pour ceux qui ne sont pas dépourvus de sensibilité, ces vers seront toujours, à défaut d'autres Mémoires, la condamnation de lady Byron.
C'est à la campagne Diodati qu'il composa Manfred, la première et la plus grande de ses compositions dramatiques, et le Prisonnier de Chillon, dans lequel il semble, comme en se jouant, avoir réuni à l'imagination de Dante celle de Châteaubriand. De la Suisse il descendit en Italie, accompagné de Shelley et du docteur Polidori, son secrétaire, le même qui publia quelques mois plus tard, à Londres, la fameuse histoire du Vampire. Arrivés à Montanvers, le prieur des bénédictins les pria de mettre leurs noms sur l'album du couvent. Shelley répondit à cette invitation en y inscrivant le mot Αθεος. Mais Byron, jetant à son tour un regard sur le livret, se hâta de passer un trait sur le mot que Shelley avait eu la ridicule hardiesse de tracer. Telle fut pourtant la seule preuve qu'osa plus tard donner le poète Southey de l'athéisme de Lord Byron. Les ouvrages de l'illustre poète se chargent à l'envi de démentir cette odieuse imputation: Byron fut, au contraire, et toute sa vie, tourmenté de ces doutes métaphysiques, nobles et sûrs indices d'une ame profondément religieuse; et quant à Shelley lui-même, auteur d'un poème satirique, la Reine mob, dans lequel les opinions dogmatiques sont peu respectées, il est certain qu'il avait sur l'immortalité de l'ame, et sur l'indépendante dignité de son essence, les idées les plus respectables. Nous ajouterons toutefois qu'elles offraient quelques rapports visibles avec celles de Spinosa, si souvent accusées, si rarement approfondies.
La première résidence de Lord Byron, en Italie, fut Milan. Il y passa l'automne et une partie de l'hiver de 1816; il allait, presque tous les soirs, entendre, à l'opéra de la Scala, ces belles partitions dont la France commence à préférer la large mélodie aux ariettes de sa lourde, maigre, et vieille musique. Des premiers jours de l'année 1817 aux derniers de 1819, il vécut à Venise: il y composa Mazeppa, les deux drames de Marino Faliero et des Deux Foscari et le quatrième chant de son cher Childe Harold. Dans les derniers vers de cet immortel poème on sent l'influence des impressions du ciel vénitien sur son cœur; les ruines de l'ancienne reine du monde glissent, moins désolantes, devant ses yeux: il sourit même à la vue des danses et de la guitare adriatique, et l'Italie, semblable aux jardins d'Armide, entremêle sans cesse, à ses mélancoliques méditations, de suaves accens de mollesse et d'amour. Au coucher du soleil, qui n'est nulle part aussi magnifique qu'à Venise, il parcourait la ville dans une élégante gondole, tandis que, pour quelques pièces d'argent, deux bateliers reproduisaient, dans leurs chants alternatifs, les octaves d'Arioste et de Tasse. Le jour, il allait sur les sables du Lido exercer ses chevaux ou se baigner dans la mer. Il parcourait les campagnes, et, pénétrant dans les plus humbles cabanes, il prodiguait aux malheureux des secours et des consolations. Le feu prit un jour à la boutique d'un cordonnier: chargé d'une nombreuse famille, ce malheureux se voyait privé de toutes ressources. Byron l'apprend; lui fait passer la valeur de tous les objets que les flammes avaient dévorés, et quelques jours après il l'invite à retourner chez lui. Sa maison était reconstruite, plus commode, plus élégante qu'auparavant. Le hasard fit découvrir aux Vénitiens étonnés plusieurs semblables traits de générosité.
Mais un penchant invincible l'entraînait en même tems au plaisir: gardons-nous de le lui reprocher: cette passion pour les femmes, dont on lui fit un si grand crime dans son immorale patrie, fut sans doute l'une des sources de son génie. À Venise, il fréquenta les brillantes réunions, les bals masqués, les concerts et les théâtres: mais les faciles enchanteresses de Venise entourèrent vainement sa tête de fleurs; les souvenirs de l'injustice de ses compatriotes, de son premier amour et de sa fille, ne cessèrent de l'y poursuivre. Il demandait et recevait fréquemment, par l'entremise de sa sœur, des nouvelles de sa chère Ada; et quand ses lettres éprouvaient quelque retard, il tombait dans de profonds accès de mélancolie.
Tandis que son tems semblait ainsi consacré à de frivoles distractions, il faisait paraître une succession de nouveaux chefs-d'œuvre. Las de ne présenter que les inspirations d'un noble enthousiasme à un monde qu'il avait appris à mépriser en le connaissant mieux, il parut se repentir d'avoir pris au sérieux les malheurs et les turpitudes humaines, et il forma le plan d'un ouvrage dans lequel il reproduirait, sous un nouveau point de vue, la grande scène de la société. Dans ce poème extraordinaire de Don Juan, vers, octaves, chants, conception, tout d'abord paraît improvisé; mais ce désordre apparent est un heureux effet de l'art. L'intention profondément calculée de Byron fut de peindre le monde tel qu'il était, avec ses courtes joies et ses souffrances inénarrables; il voulut fatiguer les ames capables de réfléchir, en les obligeant à considérer à quel degré d'abaissement, de honte, leurs préjugés les faisaient descendre. Jamais projet ne fut mieux exécuté. Vices de l'éducation, malheurs de l'humanité, innocens plaisirs, honteuse débauche, horreurs de la guerre, intrigues et vanités des cours, peinture d'une nation parvenue au dernier degré de corruption, tel est le vaste et instructif tableau que déroule à nos yeux le Don Juan. On pourrait lui appliquer ces vers charmans du second chant:
I can't describe it, though so much is strike;Nor liken it, – I never saw the like.«Je ne puis le décrire, quoiqu'il m'ait fait une vive impression, ni le comparer à quelque chose. – Je n'ai jamais rien vu de pareil.»
On a pourtant comparé Don Juan à la Pucelle; c'était juger d'un arbre d'après son écorce. Voltaire, dans son poème, s'empare de toutes les idées nobles que notre imagination aime à nourrir: il lutte contre elles, il ne les quitte qu'après les avoir imprégnées de ridicule. Du reste, il ne démêle rien avec les turpitudes de la vie: elles sont, au contraire, son point de départ et le niveau auquel il s'efforce de ramener toutes choses. Que s'il s'arrête avec complaisance sur des scènes d'amour, son pinceau ne produit encore qu'un tableau infernal dont, fort heureusement, on chercherait en vain, dans la nature, le modèle. Les deux poèmes ont pourtant cela de commun, qu'ils sont tous deux l'effet d'une débauche d'esprit. Mais la Pucelle fut premièrement destinée à égayer6 les loisirs de Frédéric-le-Grand, tandis que le Don Juan fut composé pour une génération qui avait lu avec enthousiasme Werther, René, Childe Harold et Manfred. La verve de gaîté ne pouvait donc être de la même espèce dans les deux ouvrages. Dans Juan on aperçoit l'ironie, mais jamais cette ironie ne flétrit une ame, une action, une idée, nobles ou grandes. Byron y développe nos sociales misères avec un calme qui est loin de son cœur; à chaque instant il trahit son émotion, et quelquefois, en s'y abandonnant avec franchise, il nous fait fondre en larmes. Enfin, pour me servir des belles expressions de madame Belloc7, son but bien évident est «d'obliger les hommes à se relever à force de mépris. Les saillies de Don Juan ressemblent à des fleurs dont on aurait entouré une couronne d'épines; on devine que le front qui la porte en est ensanglanté.»
Lord Byron quitta Venise en 1819, et vint s'établir à Ravenne. De tous les séjours qu'il essaya, Ravenne fut celui qui lui plut davantage. Dante, son poète favori, y avait passé plusieurs années d'exil: à quelques milles de la ville s'élevait la forêt de pins plusieurs fois mentionnée dans le Décameron de Boccace. C'est là qu'il composa la Prophétie du Dante, les troisième, quatrième et cinquième chants de Don Juan; Sardanapale, Caïn et le Ciel et la Terre. Juan et Caïn offrirent, en Angleterre, un nouvel aliment aux ennemis du noble poète. Lord Byron ne répondit aux injures qu'en citant, pour justifier Caïn, l'exemple péremptoire de Milton. Le parti des hypocrites, s'emparant alors de sa vie privée, lui reprocha une avarice sordide: à les entendre, il ne prodiguait le scandale que pour mieux trouver à vendre ses poèmes. Comme il gardait un dédaigneux silence, ses amis répondirent pour lui que jusqu'alors le noble Lord n'avait rien touché pour ses ouvrages, et qu'il leur en avait constamment abandonné le profit. Cependant le directeur du théâtre de Drury-Lane faisait représenter sa tragédie de Marino Faliero, qui n'avait pas été destinée à être jamais jouée; elle n'eut pas, au théâtre, le même succès qu'à la lecture, et, après trois représentations, le libraire de Lord Byron réclama et obtint, de l'autorité, le droit de la retirer.
Lord Byron fut moins sensible à tous ces désagrémens qu'à la mort du commandant militaire de Ravenne. Cet homme, vétéran de Napoléon, avait fini par s'attacher à la maison d'Autriche; mais, à cette époque où l'Espagne était en feu, où l'Italie préludait à sa passagère révolution, la haute police germanique vint à le soupçonner de carbonarisme. Il fut assassiné, en plein jour, dans la ville de Ravenne, à une portée de fusil de la demeure de Lord Byron. Celui-ci entendant une détonnation, accourt, met vainement ses gens à la recherche des meurtriers, et transporte la victime dans son palais; mais à peine déposé sur les escaliers intérieurs, le pauvre commandant n'existait plus. Cet événement fit sur lui une impression qu'il a fidèlement consignée dans le cinquième chant de Don Juan. Les coupables de ce meurtre ne furent nullement poursuivis.
Quelque tems après éclata l'insurrection du Piémont. Byron ne prit aucune part directe à tous ces mouvemens tumultueux qui s'étendaient jusqu'à Pise; seulement il ouvrit un asile à ceux qui, au moment de la réaction, cherchèrent à se dérober aux vengeances de la police. Il avait réuni dans son palais une centaine d'armures complètes, dont il avait l'intention arrêtée de faire usage si les révoltés voulaient sérieusement se défendre; mais il n'en fut rien. Étouffée aussi facilement qu'elle avait été exécutée, la conspiration carbonarienne échoua en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France; en un mot, sur tous les points de l'Europe.
Dès ce moment il ne fut plus en sûreté à Ravenne: chaque jour il recevait des lettres menaçantes, mais rien ne pouvait le décider à interrompre le cours de ses promenades. Enfin, la voix de l'amour fut plus puissante que celle de la crainte sur cette ame passionnée. Depuis quelques années, il était l'amant heureux de la comtesse Guiccioli: Theresa Gamba, mariée à seize ans au vieux comte Guiccioli, douée d'une beauté merveilleuse et de tous les dons qui peuvent ajouter à celui de la beauté, devint facilement éprise du plus grand poète, et de l'un des plus beaux cavaliers de son tems. Le vieux mari se plaignit, non pas d'avoir un rival, mais d'avoir un rival hérétique et soupçonné de libéralisme. Bientôt, demande en séparation simultanément faite par les deux époux: le pape, juge de l'affaire, consent à rompre des nœuds mal assortis, mais à condition que la jeune comtesse sera reléguée dans un couvent. Byron ne trouva qu'un moyen de rendre vaine la décision du souverain pontife; du consentement du père et du frère de la comtesse, il disparut de Ravenne avec elle, en 1821, au commencement de l'automne, et alla poser sa tente dans la ville de Pise.
Il y loua, pour une année, le vieux et magnifique palais Lanfranchi, au nom duquel se rattachaient plusieurs grands souvenirs poétiques et légendaires. Il semblait trouver des inspirations dans les murs d'un vieux et gothique édifice comme dans l'aspect des montagnes ou de la mer. Les petites ames de sa patrie prétendirent qu'il recherchait le voisinage de ces imposantes ruines pour exciter la curiosité; mais l'auteur de Childe Harold connaissait, par expérience, de plus sûrs moyens de faire naître l'admiration de ses contemporains; et, à vrai dire, ce n'est pas comprendre l'homme de génie que de le supposer, un instant, capable de calculs aussi misérables.
Tandis qu'il était à Pise, il reçut la nouvelle de la mort de lady Noël, mère de sa femme. Il écrivit aussitôt à cette dernière une lettre de condoléance dans laquelle, revenant sur les motifs de leur séparation, il lui témoignait l'ardent désir de la revoir et d'embrasser sa fille. La mort de sa plus ardente ennemie lui faisait espérer que lady Byron consentirait avec joie à ce rapprochement: il se trompa encore. Il ne reçut d'Angleterre aucune réponse.
Quelques jours après le départ de cette lettre, un anonyme lui fit parvenir un médaillon renfermant une boucle des cheveux de sa chère Ada. Rien ne peut donner une idée de la joie qu'il montra dans cette occasion: il baisait ces cheveux, les touchait, les contemplait avec des yeux passionnés. Il pendit le précieux médaillon autour de son cou, et ne s'en sépara plus qu'à la mort.
Les journaux anglais lui apprirent alors que Leight Hunt était persécuté dans sa patrie; c'était l'éditeur de l'Examiner, le seul journal qui eût pris à cœur sa défense, à l'époque de ses démêlés matrimoniaux: Byron lui écrivit pour lui demander en grâce de venir habiter l'Italie, et lui offrit pour asile le palais Lanfranchi. Hunt accepta sans délai, et à peine arrivé à Pise il fit goûter à Lord Byron le plan d'un journal qui, assurait-il, ne pouvait manquer d'intéresser vivement l'Europe. Il parut trois numéros du Libéral: mais les rédacteurs, et Byron le premier, se lassèrent bientôt de coopérer à cette entreprise, pour laquelle ils n'avaient peut-être pas une vocation merveilleuse. Dans le Libéral fut publiée la Vision du jugement, excellente satire d'un poème louangeur du lauréat Southey.
Lord Byron, Shelley et les deux Gamba se promenaient un jour à cheval, à quelques pas de la ville, quand un sous-officier, passant au grand galop au milieu d'eux, renverse l'un des domestiques et continue sa route sans articuler la moindre excuse. Byron s'élance à sa poursuite, lui demande raison d'une pareille insolence et reçoit pour réponse de grossières injures: d'autres soldats viennent alors soutenir leur camarade; une rixe s'engage entre eux et les gens de la suite de Lord Byron, et au nombre des blessés se trouve le sous-officier provocateur. L'affaire s'instruisit devant les tribunaux. Lord Byron ne fut pas compromis dans les débats; mais les juges condamnèrent le comte Gamba, son fils et plusieurs des gens de Byron à s'éloigner de Pise. Comme la belle comtesse suivait le sort de son père, Lord Byron se décida à les accompagner à Livourne. Mais de nouvelles persécutions y attendaient les Gamba: obligés de quitter la Toscane, ils choisirent Gênes pour leur nouvelle résidence, et cependant, la comtesse demandait à Byron un asile et revenait avec lui à Pise, au palais Lanfranchi.
À quelque tems de là mourut son meilleur ami, Bishe Shelley, âgé seulement de vingt-neuf ans. Ce fut un grand malheur pour la littérature; car, après la mort de Byron il eût pu donner au public, sur lui, des détails qui ne se trouvèrent plus que dans les mains craintives de Thomas Moore. Les tristes impressions que cet événement laissa dans l'esprit de Byron le décidèrent à s'éloigner une seconde fois de Pise. Il se retira dans une maison charmante située à une demi-lieue de Gênes, sur une hauteur qui dominait le golfe et le vaste horizon qui s'étend autour de la ville. On remarqua, dès ce moment, qu'il devenait plus sédentaire, qu'il négligeait ses courses à cheval et tous les divertissemens auxquels il se livrait précédemment. Il avait laissé à Pise la belle comtesse Guiccioli; il refusait de voir la société: enfin, il mettait dans ses dépenses une économie qui surprenait tous ceux qui avaient été témoins de ses prodigalités antérieures. On sut bientôt le secret de cette énigme: au mois de juillet 1823, un officier westphalien, nommé Det Striitz, aborda à Gênes à son retour de Grèce, où il avait combattu sous les drapeaux des insurgés, depuis 1821. À peine Lord Byron l'eut-il appris, qu'il descendit à Gênes, et n'ayant pu l'y rencontrer, il lui écrivit pour l'inviter à se rendre à sa maison de campagne. Ici nous laisserons raconter madame Belloc qui entendit tous les détails de l'entrevue, de la bouche même de M. Det Striitz.
«M. Det Striitz y alla le lendemain, et trouva Lord Byron devant une table, examinant une carte de la Grèce. Il se leva et lui fit l'accueil le plus favorable… Il adressa à cet officier plusieurs questions sur la situation des Grecs. «Il parlait avec tant de feu, me dit le colonel, que j'avais quelquefois de la peine à suivre le cours de ses idées; je m'efforçai cependant de le mettre au fait de tout ce qu'il désirait savoir.» Après être entré dans une foule de particularités, il retint à dîner le colonel, et en sortant de table il prit son bras et le conduisit dans le parc qui entourait la maison. «Tout d'un coup, au détour d'une allée, il s'arrête brusquement et me dit: Pensez-vous que ma présence pût être utile aux Grecs? me verraient-ils avec plaisir? Je ne pouvais croire qu'il voulût échanger l'existence agréable qu'il menait pour une vie de privations, d'inquiétudes et de dangers. Je n'hésitai pourtant pas à répondre que sa présence serait pour les Grecs un bienfait, et qu'il était digne de travailler à une régénération que ses écrits avaient en partie commencée. Je le voudrais de grand cœur, répondit-il; mais je crains que mes moyens ne soient en disproportion avec ma tâche. Enfin, je ferai ce que je pourrai. Mon projet d'aller en Grèce ne date pas d'aujourd'hui; je le nourris depuis long-tems. Je ne suis plus indécis sur mon voyage; mais ce qui m'importe, c'est de le rendre utile. Et le lendemain matin, en me revoyant, il me dit encore: «Je n'ai pu dormir cette nuit que d'un sommeil agité. Je me voyais toujours à la tête des braves Souliotes, ou à côté d'un de leurs intrépides chefs, combattant les Turcs sans vouloir leur faire grâce, et il se pourrait que mon rêve se réalisât un jour; car je n'irai pas en Grèce pour y être oisif. Je veux me faire faire des armes avant de partir.»
Deux mois s'étaient à peine écoulés depuis cette entrevue, quand il s'embarqua à Livourne accompagné du comte de Gamba et de ses compatriotes sir Edouard Trelawney, Hamilton Browne, etc. Dans les derniers jours d'août le vaisseau jeta l'ancre dans un des ports de Céphalonie.