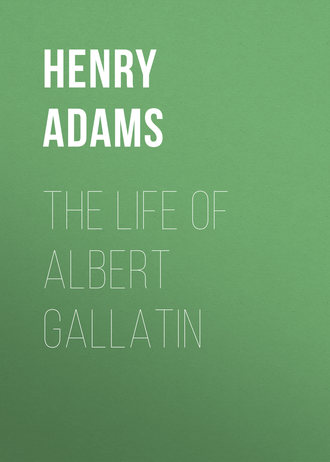 полная версия
полная версияThe Life of Albert Gallatin
Notre voyage jusqu’en Amérique ne fut marqué par aucun évènement remarquable excepté le vol que le second du vaisseau nous fit de la moitié de notre linge et de quelqu’argent. Nous arrivâmes à Boston le 15 juillet, 1780, et nous y restâmes deux mois avant de pouvoir nous défaire de quelques caisses de thé que nous avions achetées avant de nous embarquer. La difficulté de se transporter à Philadelphie et le désir d’augmenter un peu nos fonds avant d’y aller, nous détermina à passer dans le nord de cet état dans le dernier établissement qu’aient les Américains sur les frontières de la Nouvelle-Ecosse. Cette place se nomme Machias et est un port de mer situé sur la baye Funday, ou Française, à cent lieues N. – E. de Boston. Un Genevois nommé Lesdernier, un bon paysan de Russin, qui après avoir fait de fort bons établissements en Nouvelle-Ecosse, les avait perdus en partie par sa faute, en partie par son attachement pour la cause des Américains, et qui allait avec un capucin (destiné à prêcher des sauvages) joindre son fils qui est lieutenant au service américain à Machias, – ce Genevois, dis-je, fut un des motifs qui nous entraîna dans le nord, où notre curiosité ne demandait pas mieux que de nous conduire. Nous partîmes de Boston le 1er octobre, 1780, et après avoir relâché à Newbury et à Casco Bay (deux ports de la Nouvelle-Angleterre, situés le premier à quinze lieues et le second à quarante-cinq nord-est de Boston), et avoir pensé nous perdre dans un brouillard contre un rocher, en grande partie par l’ignorance de nos matelots, nous arrivâmes le 15e octobre dans la rivière de Machias. Te donner une idée de ce pays n’est pas bien difficile; quatre ou cinq maisons ou plutôt cahutes de bois éparses dans l’espace de deux lieues de côte que l’on découvre à la fois, deux ou trois arpens de terre défrichés autour de chaque cahute, et quand je dis défrichés j’entends seulement qu’on a coupé les arbres des alentours et que l’on a planté quelques patates entre les souches, et au delà, de quel côté que l’on se tourne, rien que des bois immenses qui bornent la vue de tous côtés, voilà ce que le premier coup-d’œil présente. Il ne laisse cependant pas que d’y avoir quelques variétés dans cette vue, quelqu’uniforme qu’elle soit naturellement. Le port que la rivière forme à son embouchure, port qui pour le dire en passant est assez beau et très-sûr, est parsemé de quelques petites îles. Les différentes réflexions du soleil sur les arbres de différentes couleurs dont elles sont couvertes, sur les rocs escarpés qui en bordent quelques-unes et sur les vagues qui se brisent à leur pied, forment des contrastes assez agréables. Ajoute à cela quelques bâteaux à voiles ou à rames et quelques petits canots, les uns de bois, les autres d’écorce d’arbre et faits par les sauvages, qui sont menés par un ou deux hommes, souvent par quelques jolies jeunes filles vêtues très-simplement mais proprement, armés chacun d’une pagaye avec laquelle ils font voler leur fragile navire, et tu auras une idée de la vue de toutes les côtes et bayes du nord de la Nouvelle-Angleterre. Cinq milles au-dessus de l’embouchure de la rivière est le principal établissement, car il y a une vingtaine de maisons et un fort de terre et de bois défendu par sept pièces de canon, et par une garnison de 15 à 20 hommes. C’est un colonel nommé Allan qui est le commandeur de cette redoutable place, mais il a un emploi un peu plus important, celui de surintendant de tous les sauvages de cette partie. Je t’ai dit qu’un de nos motifs pour aller à Machias était d’augmenter un peu nos fonds; pour cela nous avions employé les deux mille livres argent de France qui formait notre capital, à acheter du rhum, du sucre et du tabac, que nous comptions vendre aux sauvages ou aux habitans; mais ces derniers n’ayant point d’argent, la saison du poisson salé qu’ils pèchent en assez grande quantité…
The remainder of this letter is lost, and the loss is the more unfortunate because the next movements of the two travellers are somewhat obscure. They appear to have wasted a year at Machias quite aimlessly, with possibly some advantage to their facility of talking, but at a serious cost to their slender resources. In the war, though they were on the frontier, and no doubt quite in the humor for excitement of the kind, they had little opportunity to take part. “I went twice as a volunteer,” says Mr. Gallatin, in a letter written in 1846,5 “to Passamaquoddy Bay, the first time in November, 1780, under Colonel Allen, who commanded at Machias and was superintendent of Indian affairs in that quarter. It was then and at Passamaquoddy that I was for a few days left accidentally in command of some militia, volunteers, and Indians, and of a small temporary work defended by one cannon and soon after abandoned. As I never met the enemy, I have not the slightest claim to military services.” But what was of much more consequence, he advanced four hundred dollars in supplies to the garrison at Machias, for which he was ultimately paid by a Treasury warrant, which, as the Treasury was penniless, he was obliged to sell for what it would bring, namely, one hundred dollars. Nevertheless he found Machias and the Lesderniers so amusing, or perhaps he felt so little desire to throw himself again upon the world, that he remained all the following summer buried in this remote wilderness, cultivating that rude, free life which seems to have been Serre’s ideal even more than his own. They came at length so near the end of their resources that they were forced to seek some new means of support. In October, 1781, therefore, they quitted Machias and returned to Boston, where Gallatin set himself to the task of obtaining pupils in French. None of his letters during this period have been preserved except the fragment already given, and the only light that can now be thrown on his situation at Boston is found in occasional references to his letters by his correspondents at home in their replies.
1781.MLLE. PICTET TO GALLATINNo. 5.
Genève, 5 février, 1782.J’ai reçu, mon cher ami, ta lettre de Boston du 18e décembre, 1781, qui m’a fait grand plaisir. Je suis bien aise que vous ne soyez plus dans l’espèce de désert où vous avez passé l’hiver précédent et où je ne voyais rien à gagner pour vous mais beaucoup à perdre par la mauvaise compagnie à laquelle vous étiez réduit. Je suis content aussi de l’aveu naïf que tu fais de ton ennui; … vous n’êtes peut-être pas beaucoup mieux à Boston, n’y étant connu de personne; mais il n’est pas impossible de faire quelques bonnes connaissances si vous y passez quelque tems. Je t’y adressai une lettre le 6e janvier, 1782, No. 4, sous le couvert de M. le Docteur Samuel Cooper, à laquelle je joignis un mémoire pour lui demander à s’informer de vous à Machias, où je vous croyais encore, de vouloir bien vous protéger soit à Machias soit à Boston. Je lui contais votre histoire … et lui disais que M. Franklin, son ami, devait le charger de te remettre mille livres, … qu’on remettrait ici à M. Marignac, chez lequel M. Johannot son petit-fils est en pension. C’est ce jeune homme, que nous voyons souvent, qui voulut bien envoyer le tout dans une lettre de recommandation pour vous à son grand-père… La lettre par laquelle M. Johannot te recommande à son ami et le charge de te payer mille livres … n’arrivera vraisemblablement qu’en même tems que celle-ci, ce dont je suis très-fâchée, ne doutant pas que tu n’aies grand besoin d’argent. J’ai peine à croire que les leçons de Français que vous donnez suffisent à vos besoins… Si ton oncle le cadet consent, je t’enverrai à Philadelphie les 800 livres, … puisque tu dis que tu veux y aller au printems.
1782.MLLE. PICTET TO GALLATINNo. 8.
14 novembre, 1782.… Enfin le jeune Johannot vient de recevoir une lettre de M. son grand-père qui lui parle de toi; il t’a fait obtenir une place de Professeur en langue française dans l’académie de Boston…
MLLE. PICTET TO GALLATINNo. 9.
30 novembre, 1782.Je reçois, mon cher ami, ta lettre du 5e septembre, 1782, No. 3… Elle m’a fait d’autant plus de plaisir que je l’ai trouvée mieux que les précédentes; elle est sensée et dépouillée d’enthousiasme; il me semble que tu commences à voir les choses sous leur vrai point de vue… Je vois avec grand plaisir que tu ne penses plus au commerce… Je ne puis m’empêcher de te répéter que tu dois te défier de l’imagination et de la tête de Serre; il l’a légère; l’imagination a plus de part à ses projets que le raisonnement…
MLLE. PICTET TO GALLATINNo. 10.
26 décembre, 1782.… Tu me dis que ta santé est bonne; je trouve que tu la mets à de terribles épreuves, et quoique ta vie soit moins pénible que quand tu étais coupeur de bois à Machias, la quantité de leçons que tu es obligé de donner me paraît une chose bien fatigante et bien ennuyeuse. J’espère que tu seras devenu un peu moins difficile et moins sujet à l’ennui…
SERRE TO BADOLLETCambridge, 13 décembre, 1782.Mon cher ami, ma foi! je perds patience et je n’ai pas tout à fait tort. Tu conviendras avec nous qu’après t’avoir écrit une douzaine de lettres sans recevoir aucune réponse, il nous est bien permis d’être un peu en colère. Au nom de Dieu, dis-nous où es-tu, que fais-tu, es-tu mort ou en vie? Comment serait-il possible que tu n’eusses reçu aucune de nos lettres, ou qu’en ayant reçu, tu te fusses si peu embarrassé de nous; toi sur qui nous comptions si fort! Non; j’aime mieux croire que tu te souviens encore de nous, et attribuer ta négligence apparente au mauvais sort de tes lettres.
Je ne vais point te faire ici le détail de toutes nos aventures dans ce pays, qui sont assez curieuses et intéressantes. Nous avons visité toute la côte septentrionale des États-Unis depuis Boston jusqu’à Pasmacadie, quelquefois séparés l’un de l’autre, mais le plus souvent ensemble; nous avons habité parmi les sauvages, voyagé avec eux, par tems dans leurs canots d’écorce, couché dans leurs cabanes et assisté à un de leurs festins; nous nous sommes trouvés rassemblés cinq Genevois à Machias pendant un hiver, au milieu des bois et des Indiens. Combien de fois nous avons pensé à toi alors; combien de fois nous t’avons désiré pour venir avec nous couper du bois le matin et le transporter dans notre chaumière pour nous en chauffer. Mr. Lesdernier avec qui nous demeurions a été fermier à Russin, et quoique depuis trente ans dans ce pays il a conservé en entier cette humeur joviale et franche et cet esprit libre qui caractérisent nos habitans de la campagne. La première fois que je le vis je me sentis ému de joie, j’aurais voulu lui sauter au cou et l’embrasser; je me crus à Genève parmi nos bons bourgeois de la campagne et il me semblait voir en lui un ancien ami.
Partout où nous avons été nous t’avons toujours regretté. De tous les jeunes gens de notre connoissance à qui nous avons pensé, tu es le seul que nous ayons toujours désiré pour compagnon de fortune et dont le caractère se plairoit le plus à notre genre de vie. Si tu pouvais t’imaginer la liberté dont nous jouissons et tous les avantages qui l’accompagnent, tu n’hésiterais pas un instant à venir la partager avec nous. Nous ne courons point après la Fortune. L’expérience nous a appris qu’elle court souvent après l’homme à qui elle crie: Arrête; mais son ardente ambition le rend sourd et la lui représente toujours comme fuyant devant lui. Alors croyant l’atteindre à force de courses et de fatigues, le malheureux s’en éloigne et lui échappe. De quels regrets ne doit-il pas être consumé si après tant de peines et de travaux il vient à connaître son erreur, misérable par sa faute et trop faible pour retourner sur ses pas. Je ne m’étonnerais point que le désespoir de s’être si cruellement trompé, le portât à se délivrer d’un reste d’existence que le souvenir de sa faute et la pensée rongeante de son ambition déçue lui rendrait insupportable. Ignorant donc si la fortune nous suit ou si elle nous précède, nous ne risquerons point notre bonheur pour la joindre, et nous aimons mieux un état qui procure une jouissance modérée mais présente et continue, que celui qui demande des souffrances préliminaires et n’offre en retour qu’un avenir plus séduisant, il est vrai, mais éloigné et incertain. Et même en le supposant certain, le grand avantage pour un homme qui a employé toute sa jeunesse (c’est à dire toute la partie de sa vie susceptible de jouissance) en veilles et en fatigues, de posséder dans un âge avancé des richesses qui lui sont alors inutiles et superflues! Ce n’est pas lorsqu’il est devenu incapable de sentir, qu’il a perdu presque toute la vivacité de ses sens et de ses passions, qu’il a besoin de l’instrument pour les satisfaire; le plaisir le plus vif que ressent un vieillard est le ressouvenir de ceux de la jeunesse, mais celui-ci n’aura que celui de ses peines passées et cette réflexion le rendra triste et mélancolique.
Notre but donc, mon cher ami, est le plus tôt que nous pourrons de nous procurer un fond de terre et de nous mettre fermiers; ayant ainsi une ressource sûre pour vivre agréablement et indépendants, nous pourrons lorsque l’envie nous en prendra, aller de tems en tems faire quelques excursions dans le dehors et courir le pays, ce qui est un de nos plus grands plaisirs; or nous n’attendrons que toi pour accomplir notre projet; fais ton paquet, je t’en prie, et hormis que tu ne sois dans des circonstances bien avantageuses, viens nous joindre tout de suite. Je ne saurais croire avec quel plaisir je m’imagine quelquefois nous voir tous les trois dans notre maison de campagne occupés des différents soins de la campagne, puis de tems en tems pour varier, aller visiter quelque nouvelle partie du monde; si la fortune se trouve en passant, nous mettons la main dessus; si au contraire quelque revers nous abat, nous nous en revenons vite dans notre ferme, où nous en sommes quittes pour couper notre bois nous-mêmes et labourer notre champ; voilà notre pis-aller, et quel pis-aller! un de nos plus grands amusements!
Ah çà, nous t’attendons pour le plus tard le printems prochain. Pourvu que tu aies de quoi payer ton passage, ne t’inquiète pas du reste. Nous ignorons où nous serons positivement dans ce temps, mais dès le moment que tu seras arrivé, si c’est à Boston va loger chez Tahon qui tient une auberge française à l’enseigne de l’alliance dans la rue appelée Fore Street, prononcé Faure Strite. Si tu n’arrives pas à Boston, écris à Tahon, qui t’indiquera où nous sommes. Emporte avec toi tout ce que tu possèdes et tâche de te munir d’un ou deux bons baromètres et thermomètres et de tubes pour en faire, avec une longue vue.
Adieu, mon cher ami; je ne sais point à qui adresser cette lettre pour qu’elle te parvienne, car j’ignore totalement où est ta résidence actuelle. Gallatin t’écrit aussi, ainsi je ne te dis rien de lui.
It was the watchful care and forethought of Mlle. Pictet that enabled Gallatin to tide over the difficulties of these two years, by obtaining the countenance and aid of Dr. Cooper, which opened to him the doors of Harvard College. The following paper shows the position he occupied at the college, which has been sometimes dignified by the name of Professorship:
“At a meeting of the President and Fellows of Harvard College, July 2, 1782: Vote 5. That Mr. Gallatin, who has requested it, be permitted to instruct in the French language such of the students as desire it and who shall obtain permission from their parents or guardians in writing, signified under their hands to the President; which students shall be assessed in their quarter-bills the sums agreed for with Mr. Gallatin for their instruction; and that Mr. Gallatin be allowed the use of the library, a chamber in the college, and commons at the rate paid by the tutors, if he desire it.
“Copy. Attest,“Joseph Willard, President.”The list of students who availed themselves of this privilege is still preserved, and contains a number of names then best known in Boston. The terms offered were: “Provided fifty students engage, the sum will be five dollars per quarter each, and provided sixty (not included Messrs. Oatis, Pyncheon, and Amory) have permits from their relations, the price will be four dollars each. They are under no obligation to engage more than by the quarter.” The “Mr. Oatis” was apparently Harrison Gray Otis. About seventy appear to have taken lessons, which was, for that day, a considerable proportion of the whole number of students. Gallatin’s earnings amounted to something less than three hundred dollars, and he seems to have found difficulty in procuring payment, for he intimates on a memorandum that this was the sum paid.
1783.Of his life while in Boston and Cambridge almost nothing can be said. He was not fond of society, and there is no reason to suppose that he sought the society of Boston. The only American friend he made, of whose friendship any trace remains, was William Bentley, afterwards a clergyman long settled at Salem, then a fellow-tutor at Cambridge. When Gallatin left Cambridge after a year of residence, President Willard, Professor Wigglesworth, and Dr. Cooper, at his request, gave him a certificate that he had “acquitted himself in this department with great reputation. He appears to be well acquainted with letters, and has maintained an unblemished character in the University and in this part of the country.” And Mr. Bentley, in whose bands he left a few small money settlements, wrote to him as follows, enclosing the testimonial:
WILLIAM BENTLEY TO GALLATINHollis Hall, Cambridge, August 20, 1783.Mr. Gallatin, – I profess myself happy in your confidence. Your very reputable conduct in the University has obliged all its friends to afford you the most full testimony of their esteem and obligation, as the within testimonials witness. I should have answered your letter of July 11 sooner had not the call of a dissenting congregation at Salem obliged my absence at that time, and the immediately ensuing vacation prevented my attention to your business… I expect soon to leave Cambridge, as the day appointed for my ordination at Salem is the 24th of September. In every situation of life I shall value your friendship and company, and subscribe myself your devoted and very humble servant.
N.B. – The tutors all expressed a readiness to subscribe to any recommendation or encomium which could serve Mr. Gallatin’s interest in America; but our names would appear oddly on the list with the president, professors, and Dr. Cooper.
If Gallatin gained the esteem of so excellent a man as Bentley, there can be no doubt that he deserved it. In the small collegiate society of that day there was little opportunity to deceive, and Bentley and President Willard only repeat the same account of Gallatin’s character and abilities which comes from all other sources. There is, too, an irresistible accent of truth in the quaint phraseology of Bentley’s letter.
But he had no intention to stop here. In July, 1783, he took advantage of the summer vacation to travel.
GALLATIN TO SERRENew York, 22e juillet, 1783.Mon bon ami, nous voici arrivés heureusement à New York après un passage plus long que nous n’avions compté. Nous laissâmes Providence jeudi passé, 17e courant, et arrivâmes le lendemain à Newport, où nous ne fîmes que dîner, et que j’ai trouvé mieux situé et plus agréable quoique moins bien bâti et moins commerçant que Providence. Apropos de cette dernière ville, j’ai été voir le collége, où il n’y a que 12 écoliers; je ne pus voir le président, mais le tutor, car il n’y en a qu’un, me parla de Poullin; il me dit qu’ils seraient très-charmés d’avoir un maître français; que le collége ni les écoliers ne pourraient lui donner que peu de chose, mais qu’il se trouverait dans la ville un nombre assez considérable d’écoliers pour l’occuper autant qu’il voudrait; qu’en cas qu’il s’en présentât un, le collége le ferait afficher sur la gazette afin qu’on ouvrît pour lui une souscription dans la ville et qu’il sût sur quoi compter. Pour revenir, nous laissâmes Newport vendredi à 2h. après dîner, et ne sommes arrivés ici que hier, lundi, à la nuit. Nous avons eu beau tems mais calme. Les bords de la Longue-Isle près de New-York sont passables, mais ceux de l’île même où est bâtie New-York sont couverts de campagnes charmantes au-dessus de la ville. Le port paraît fort beau et il y a deux fois autant de vaisseaux qu’à Boston. Ce que j’ai vu de la ville est assez bien, mais il y fait horriblement chaud. Il y a comédie et nous comptons y aller demain. Il y a aussi beaucoup de soldats, de marins, et de réfugiés, les derniers très honnêtes et polis à ce qu’on dit, mais les autres fort insolens. Nous comptons partir après-demain pour Philadelphie, où j’espère trouver de tes nouvelles et de celles de N.W. Dans notre passage de Providence nous avions pour compagnon de passage (parmi plusieurs autres) un docteur français ou barbier, plus bavard que La Chapelle, plus impudent que St. Pri et plus bête – ma foi, je ne sais à qui le comparer pour cela; c’était un sot français au superlatif; il a réussi à nous escroquer trois piastres, sans compter ce qu’il a fait aux autres. Les filles ne sont pas si jolies ici qu’à Boston et nous n’avons pas encore eu la moindre aventure galante dans toute notre route. Au reste, comme tu es sans doute à présent un grave maître d’école et que tu dois avoir pris toute la pédanterie inséparable du métier, ce n’est plus à toi que j’oserais faire de telles confidences. J’espère cependant que tu n’auras pas longtems à t’ennuyer à ce sot emploi et je t’écrirai tout ce que nous avons à espérer dès que je serai à Philadelphie. Porte-toi bien. Tout à toi.
Mr. Savary te fait bien des complimens. Notre autre compagnon de voyage n’est pas ici. Aussi je les supposerai en son nom. Il est arrivé hier ici une frégate d’Angleterre qui a, dit-on, apporté le traité définitif … traité de commerce de…
The M. Savary mentioned here as Gallatin’s fellow-traveller from Boston was to have a great influence on his fortunes. M. Savary de Valcoulon was from Lyons. Having claims against the State of Virginia, he had undertaken himself to collect them, and meeting Gallatin at Boston, they had become travelling companions. They went to Philadelphia together, where they remained till November. Serre rejoined them there; but Gallatin’s means were now quite exhausted. Their combined expenses, since quitting Geneva, had been in three years about sixteen hundred dollars, including three hundred dollars lost by the Treasury warrant. Of this sum Gallatin had advanced about thirteen hundred dollars, Serre’s father resolutely refusing to send his son any money at all or to honor his drafts. A settlement was now made. Serre gave to Gallatin his note for half the debt, about six hundred dollars, and, joining a countryman named Mussard, went to Jamaica, where he died, in 1784, of the West India fever. Fifty-three years afterwards his sister by will repaid the principal to Mr. Gallatin, who had, with great delicacy, declined to ask for payment. But when this separation between Gallatin and Serre took place, it was intended to be temporary only; Serre was to return and to rejoin his friend, who meanwhile was to carry out their scheme of retreat by a new emigration. The sea-coast was not yet far enough removed from civilization; they were bent upon putting another month’s journey between themselves and Europe; the Ohio was now their aim. There may be a doubt whether they drew Savary in this direction, or whether Savary pointed out the path to them. In any case, Serre sailed for Jamaica in the middle of September, before the new plans were entirely settled, and nothing was ever heard from him again until repeated inquiries produced, in the autumn of 1786, a brief but apparently authentic report of his death two years before. Gallatin accepted Savary’s offers, and went with him to Richmond to assist him in the settlement of his claims. But before they left Philadelphia a larger scheme was projected. Savary and Gallatin were to become partners in a purchase of one hundred and twenty thousand acres of land in Western Virginia, Gallatin’s interest being one-fourth of the whole, and his share to be paid, until his majority, in the form of personal superintendence.
Meanwhile, a premonitory symptom of revolution had occurred in Geneva. The two parties had come to blows; blood was shed; the adjoining governments of Switzerland, France, and Savoy had interposed, and held the city in armed occupation. The Liberals were deeply disgusted at this treatment, and to those who had already left their country the temptation to return became smaller than ever.
GALLATIN TO BADOLLETPhiladelphie, ce 1er octobre, 1783.Mon bon ami, je viens de recevoir ta lettre du 20 mars qui à quelques égards m’a fait le plus grand plaisir, mais qui en m’apprenant toutes les circonstances des troubles de notre malheureuse patrie a achevé de m’ôter toute espérance de jamais pouvoir m’y fixer. Non, mon ami, il est impossible à un homme de sens et vertueux, né citoyen d’un état libre, et qui est venu sucer encore l’amour de l’indépendance dans le pays le plus libre de l’univers; il est impossible, dis-je, à cet homme, quelques puissent avoir été les préjugés de son enfance, d’aller jouer nulle part le rôle de tyran ou d’esclave, et comme je ne vois pas qu’il y ait d’autre situation à choisir à Genève, je me vois forcé de renoncer pour toujours à ces murs chéris qui m’ont vu naître, à ma famille, à mes amis; à moins qu’une nouvelle révolution ne change beaucoup la situation des affaires. Tu vois par ce que je viens de te dire que la façon de penser de mes parens n’influe point sur la mienne et que j’en ai changé depuis mon départ d’Europe. Il est tout simple qu’étant entouré des gens qui pensent tous de la même manière, on s’habitue à penser comme eux; dès que l’on commence à être de leur parti, le préjugé a déjà pris possession de vous et à moins que par un heureux hasard la raison et le bon droit ne soient du côté que vous avez embrassé, vous tomberez d’écarts en écarts, de torts en torts, et vous ne verrez les excès auxquels vous vous serez abandonné que lorsque quelqu’évènement d’éclat vous aura ouvert les yeux. En voilà je crois assez pour me justifier d’avoir été Négatif à 19 ans lorsque j’abandonnai Genève. Mais à 1200 lieues de distance on juge bien plus sainement; le jugement n’étant plus embarrassé par les petites raisons, les petits préjugés, les petites vues et les petits intérêts de vos alentours, ne voit plus que le fond de la question, et peut décider hardiment. Si l’on se laisse gagner par un peu d’enthousiasme il y a mille à gager contre un que ce sera en faveur de la bonne cause. Voilà ce qui peu à peu produisit un grand changement dans mon opinion après mon arrivée en Amérique. Je fus bientôt convaincu par la comparaison des gouvernemens américains avec celui de Genève que ce dernier était fondé sur de mauvais principes; que le pouvoir judicatif tant au civil qu’au criminel, le pouvoir exécutif en entier, et ⅔ du pouvoir législatif appartenant à deux corps qui se créaient presqu’entièrement eux-mêmes, et dont les membres étaient élus à vie, il était presqu’impossible que cette formidable aristocratie ne rompît tôt ou tard l’équilibre que l’on s’imaginait pouvoir subsister à Genève. Je compris que le droit d’élire la moitié des membres de l’un de ces conseils sans avoir celui de les déplacer et le droit de déplacer annuellement la 6me partie des membres de l’autre n’étaient que de faibles barrières contre des hommes qui avaient la fortune et la vie des citoyens entre les mains, le soin de la police de la manière la plus étendue, deux négatifs sur toutes les volontés du peuple, et dont les charges étaient à vie, pour ne pas dire héréditaires. Quelle différence entre un tel gouvernement et celui d’un pays où les différents conseils à qui sont confiés les pouvoirs législatifs et exécutifs ne sont élus que pour une année, où les juges, qui ne font qu’expliquer la loi, une fois élus ne sont plus sous l’influence du souverain et ne peuvent être déplacés que juridiquement, où enfin l’on est jugé non pas même par ces juges de nom, mais par 12 citoyens pris parmi les honnêtes gens et que les parties peuvent récuser. (Tu ne seras pas étonné, mon ami, après une telle comparaison, que je me sois décidé à me fixer ici.) En voyant les défauts du gouvernement genevois, je sentis qu’il était de l’intérêt des partisans de la liberté de veiller de près les aristocrates, mais non pas de vouloir les combattre. Le parti violent qu’ont embrassé les représentans ne peut être justifié qu’en disant que les circonstances les ont entraînés, car il était impossible de n’en pas prévoir les conséquences et que la politique artificieuse des négatifs en tireroit tout le parti possible; je n’ai rien à ajouter à ce que tu dis sur la bassesse de ces derniers, et la faute des citoyens produite par l’enthousiasme de liberté n’est que trop sévèrement punie.

