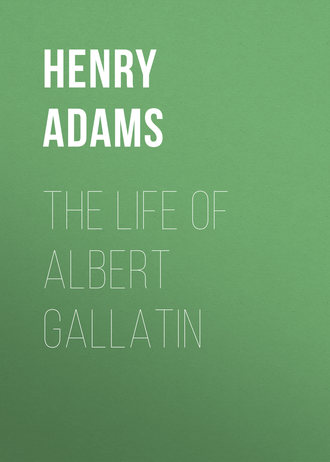 полная версия
полная версияThe Life of Albert Gallatin
Serre te fait ses complimens; il dort pour le moment.
The entire sum of money which the two young men brought with them from Geneva was one hundred and sixty-six and two-thirds louis-d’or, equal to four thousand livres tournois, reckoning twenty-four livres to the louis. One-half of this sum was expended in posting across France and paying their passage to Boston. Their capital for trading purposes was therefore about four hundred dollars, which, however, belonged entirely to Gallatin, as Serre had no means and paid no part of the expenses. For a long time to come they could expect no more supplies.
Meanwhile, the family at Geneva had moved heaven and earth to smooth their path, and had written or applied for letters of introduction in their behalf to every person who could be supposed to have influence. One of these persons was the Duc de la Rochefoucauld d’Enville, who wrote to Franklin a letter which may be found in Franklin’s printed correspondence.4 The letter tells no more than we know; but Franklin’s reply is characteristic. It runs thus:
BENJ. FRANKLIN TO THE DUC DE LA ROCHEFOUCAULD D’ENVILLEPassy, May 24, 1780.Dear Sir, – I enclose the letter you desired for the two young gentlemen of Geneva. But their friends would do well to prevent their voyage.
With sincere and great esteem, I am, dear sir, your most obedient and most humble servant,
B. Franklin.The letter enclosed was as follows:
Passy, May 24, 1780.Dear Son, – Messrs. Gallatin and Serres, two young gentlemen of Geneva, of good families and very good characters, having an inclination to see America, if they should arrive in your city I recommend them to your civilities, counsel, and countenance.
I am ever your affectionate father,B. Franklin.To Richard Bache, Postmaster-General, PhiladelphiaLady Juliana Penn, also, wrote to John Penn at Philadelphia in their favor. Mlle. Pictet wrote herself to Colonel Kinloch, then a member of the Continental Congress from South Carolina. Her description of the young men is probably more accurate than any other: “Quoique je n’ai pas l’avantage d’être connue de vous, j’ai trop entendu parler de l’honnêteté et de la sensibilité de votre âme pour hésiter à vous demander un service absolument essentiel au bonheur de ma vie. Deux jeunes gens de ce pays, nommé Gallatin et Serre, n’étant pas contents de leur fortune, qui est effectivement médiocre, et s’étant échauffé l’imagination du désir de s’en faire une eux-mêmes, aidés d’un peu d’enthousiasme pour les Américains, prennent le parti de passer à Philadelphie. Ils sont tous deux pleins d’honneur, de bons sentiments, fort sages, et n’ont jamais donné le moindre sujet de plainte à leurs familles, qui out le plus grand regret de leur départ… Ils out tous deux des talents et des connaissances; mais je crois qu’ils n’entendent rien au commerce et à la culture des terres qui sont les moyens de fortune qu’ils ont imaginés.” …
With such introductions and such advantages, aided by the little fortune which Gallatin would inherit on coming of age in 1786, in his twenty-fifth year, the path was open to him. He had but to walk in it. Success, more or less brilliant, was as certain as anything in this world can be.
He preferred a different course. Instead of embracing his opportunities, he repelled them. Like many other brilliant men, he would not, and never did, learn to overcome some youthful prejudices; he disliked great cities and the strife of crowded social life; he never could quite bring himself to believe in their advantages and in the necessity of modern society to agglomerate in masses and either to solve the difficulties inherent in close organization or to perish under them. He preferred a wilderness in his youth, and, as will be seen, continued in theory to prefer it in his age. It was the instinct of his time and his associations; the atmosphere of Rousseau and Jefferson; pure theory, combined with shy pride. He seems never to have made use of his introductions unless when compelled by necessity, and refused to owe anything to his family. Not that even in this early stage of his career he ever assumed an exterior that was harsh or extravagant, or manners that were repulsive; but he chose to take the world from the side that least touched his pride, and, after cutting loose so roughly from the ties of home and family, he could not with self-respect return to follow their paths. His friends could do no more. He disappeared from their sight, and poor Mlle. Pictet could only fold her hands and wait. Adoring her with a warmth of regard which he never failed to express at every mention of her name, he almost broke her heart by the manner of his desertion, and, largely from unwillingness to tell his troubles, largely too, it must be acknowledged, from mere indolence, he left her sometimes for years without a letter or a sign of life. Like many another woman, she suffered acutely; and her letters are beyond words pathetic in their effort to conceal her suffering. Mr. Gallatin always bitterly regretted his fault: it was the only one in his domestic life.
His story must be told as far as possible in his own words; but there remain only his letters to Badollet to throw light on his manner of thinking and his motives of action at this time. In these there are serious gaps. He evidently did not care to tell all he had to endure; but with what shall be given it will be easy for the reader to divine the rest.
The two young men landed on Cape Ann on the 14th July, 1780. The war was still raging, and the result still uncertain. General Gates was beaten at Camden on the 16th August, and all the country south of Virginia lost. More than a year passed before the decisive success at Yorktown opened a prospect of peace. The travellers had no plans, and, if one may judge from their tone and behavior, were as helpless as two boys of nineteen would commonly be in a strange country, talking a language of which they could only stammer a few words, and trying to carry on mercantile operations without a market and with a currency at its last gasp. They had brought tea from Nantes as a speculation, and could only dispose of it by taking rum and miscellaneous articles in exchange. Their troubles were many, and it is clear that they were soon extremely homesick; for, after riding on horseback from Gloucester to Boston, they took refuge at a French coffee-house kept by a certain Tahon, and finding there a Genevan, whom chance threw in their way, they clang to him with an almost pathetic persistence. On September 4 they bought a horse and yellow chaise for eight thousand three hundred and thirty-three dollars. Perhaps it was in this chaise that they made an excursion to Wachusett Hill, which they climbed. But their own letters will describe them best.
GALLATIN TO BADOLLETNo. 2.
Boston, 14 septembre, 1780.Mon cher ami, je t’ai déjà écrit une lettre il y a quatre jours, mais elle a bien des hazards à courir, ainsi je vais t’en récrire une seconde par une autre occasion, et je vais commencer par un résumé de ce que je te disais dans ma première.
Nous partîmes le 27e mai de Lorient, après avoir payé 60 louis pour notre voyage, les provisions comprises. Notre coquin de capitaine, aussi frippon que bête et superstitieux, nous tint à peu près tout le tems à viande salée et à eau pourrie. Le second du vaisseau, plus frippon et plus hypocrite que le premier, nous vola 6 guinées dans notre poche, plus la moitié de notre linge, plus le 3½ pour 100 de fret de notre thé. (Il avait demandé 5 pr. cent. de fret pour du thé que nous embarquions, et il a exigé 8½.) Au reste, point de tempête pour orner notre récit, peu malades, beaucoup d’ennui, et souvent effrayés par des corsaires qui nous ont poursuivis. Enfin nous arrivâmes le 14e juillet au Cap Anne à huit lieues de Boston où nous nous rendîmes le lendemain à cheval.
—Ce qui suit n’étoit pas dans [ma première lettre].
Boston est une ville d’environ 18 mille âmes, bâtie sur une presqu’île plus longue que large. Je la crois plus grande que Genève, mais il y a des jardins, des prairies, des vergers au milieu de la ville et chaque famille a ordinairement sa maison. Ces maisons out rarement plus d’un étage ou deux. Elles sont de briques ou de bois, couvertes de planches et d’ardoises, avec des terrasses sur les toits et dans beaucoup d’endroits avec des conducteurs qui ont presque tous trois pointes. Une ou deux rues tirées au cordeau, point d’édifices publics remarquables, un hâvre très-vaste et défendu par des îles qui ne laissent que deux entrées très-étroites, une situation qui rendrait la ville imprenable si elle était fortifiée, voilà tout ce que j’ai à te dire de Boston. Les habitans n’ont ni délicatesse ni honneur ni instruction, et il n’y a rien de trop à l’égard de leur probité, non plus qu’à l’égard de celles des Français qui sont établis ici et qui sont fort haïs des naturels du pays. On s’ennuye fort à Boston. Il n’y a aucun amusement public et beaucoup de superstition, en sorte que l’on ne peut pas le dimanche chanter, jouer du violon, aux cartes, aux boules, &c. Je t’assure que nous avons grand besoin de toi pour venir augmenter nos plaisirs. En attendant, donne-nous de tes nouvelles et fais-nous un peu part de la politique de Genève. Je vais te payer en te disant quelque chose de ce pays…
Then follow four close pages of statistical information about the thirteen colonies, of the ordinary school-book type, which may be omitted without injury to the reader; at the end of which the letter proceeds:
On m’a dit beaucoup de mal de tous les habitans de la Nouvelle-Angleterre; du bien de ceux de la Pensilvanie, de la Virginie, du Maryland, et de la Caroline Septentrionale; et rien des autres.
J’en viens à l’Etat de Massachusetts, que je connais le mieux et que j’ai gardé pour le dernier.
Il est divisé en huit comtés et chaque comté en plusieurs villes. Car il n’y a point de bourgs. Dès qu’un certain nombre de familles veulent s’aller établir dans un terrain en friche et qu’elles consentent à entretenir un ministre et deux maîtres d’école, on leur donne un espace de deux lieues en quarré nommé township et l’établissement obtient le nom de ville et en a tous les privilèges. Les habitans de toutes les villes au-dessus de vingt-et-un ans et qui possèdent en Amérique un bien excédant trois livres sterling de revenu, s’assemblent une fois l’an pour élire un gouverneur et un sénat de la province, composé de six membres, dont on remplace deux membres par an. On compte les suffrages dans chaque ville et ceux qui out la pluralité des villes sont élus. Car les suffrages de chaque ville sont égaux. Boston n’a pas plus de droit qu’un village de deux cents hommes. Le sénat élit un conseil au gouverneur et chaque ville envoye le nombre de députés à Boston qu’elle veut. Cela forme la chambre des représentans et l’on prend toujours les suffrages par ville. Environ deux cents villes envoient des députés et plus de cent ne sont pas assez riches pour en entretenir. Il faut le consentement de ces trois corps pour faire une loi, repartir les impôts (car c’est le Congrès Général qui les fixe sur chaque province, qui décide la paix ou la guerre, &c.), &c. Chaque ville élit les magistrats de police. Tout homme croyant un Dieu rémunérateur et une autre vie est toléré chez lui; et nombre de sectes ont des églises. Il y a cent ans qu’on y persécutait les Anglicans. Tel est le nouveau plan de gouvernement qui a eu l’approbation des villes après que deux autres ont été rejetés et qui sera en vigueur dans trois mois. Cette province est la plus commerçante de toutes et une des plus peuplées. Elle ne produit guère que du maïs, des patates, du poisson, du bois et des bestiaux. Ce sont actuellement ses corsaires qui la soutiennent. On fait ici d’excellent voiliers. Mais il n’y a aucune fabrique (excepté des toiles grossières). Il y a un collége et une académie et une bibliothèque à Cambridge, petite ville à une lieue de Boston. Je n’ai pas encore pu voir cela. Il n’y a aucune ville considérable excepté Boston dans cet état. A l’égard du comté de Main, les Anglais y ont un fort nommé Penobscot où les Américains se sont fait brûler 18 vaisseaux l’année dernière en voulant l’attaquer. Il est à peu près au milieu du comté. Au nord sont des tribus de sauvages; au nord-est, l’Acadie ou Nouvelle-Ecosse; et au nord-ouest, le Canada. Je te dirai plus de choses de ce pays dans peu de tems, car nous y allons faire un petit voyage pour commercer en pelleteries. Nous allons à Machias (on prononce Maitchais) qui est la dernière place au nord. Aye la bonté de t’informer de toutes les particularités que tu pourras apprendre sur les manufactures des environs de Bordeaux, sur la difficulté qu’il y aurait à en transporter des ouvriers ici, de même que des agriculteurs, sur le prix des marchandises qui doivent y être à bon compte tant parcequ’on les y fabrique que parcequ’elles y arrivent aisément, sur ce que coûtent les pendules de bois en particulier, &c. J’espère que nous te verrons dans peu auprès de nous. Cela se fera sur un vaisseau que nous pourrons t’indiquer. Nous aurons fait marché avec le capitaine et j’espère que tu pourras faire la traversée plus agréablement et économiquement que nous. Adieu, mon bon ami. Pense aussi souvent à nous que nous à toi et écris-nous longuement et très-souvent, car il y a bien des vaisseaux de pris.
“A Monsieur Badollet, Etudiant en Théologie.”
Whoever gave the writer his information in regard to the Massachusetts constitution was remarkably ill informed. But this is a trifle. The next letter soon follows:
GALLATIN TO BADOLLETNo. 3.
Machias, 29 8re, 1780.Mon cher ami, tu ne t’attendais sans doute pas à recevoir des lettres datées d’un nom aussi baroque, mais c’est celui que les sauvages y ont mis, et comme ils sont les premiers possesseurs du pays, il est juste de l’appeler comme eux. (On prononce Maitchais.) C’est ici que nous allons passer l’hiver. Nous avons préféré les glaces du nord au climat tempéré qu’habitent les Quakers, et si nous t’avions avec nous pour célébrer l’Escalade et pour vivre avec nous, je t’assure que nous serions fort contens de notre sort actuel. Car jusqu’à présent notre santé et nos affaires pécuniaires vont fort bien; quand je dis fort bien, c’est qu’à l’égard du dernier article nous ne sommes pas trop ambitieux. Je vais te détailler tout l’état de nos affaires. Dans la maison où nous demeurions à Boston nous rencontrâmes une Suissesse qui avait épousé un Genevois nommé de Lesdernier de Russin et dont je crois t’avoir dit deux mots dans une de mes lettres précédentes. Il y avait trente ans qu’il était venu s’établir dans la Nouvelle-Ecosse. Tu sais que cette province et le Canada sont les seules qui soient restées sous le joug anglais. Une partie des habitons de la première essaya cependant de se révolter il y a deux ou trois ans. Mais n’ayant pas été soutenus ils furent obligés de s’enfuir dans la Nouvelle-Angleterre. Parmi eux était un des fils de de Lesdernier. Il vint dans cette place où il fut fait lieutenant. Il fut ensuite fait prisonnier et mené à Halifax (la capitale de la Nouvelle-Ecosse). Son père l’alla voir en prison et la lui fit adoucir jusqu’à ce qu’il fut échangé. Mais il essuya beaucoup de désagrémens de la part de ses amis qui lui reprochaient d’avoir un fils parmi les rebelles. Il eut ensuite une partie de ses effets pris par les Américains tandis qu’il les faisait transporter sur mer d’une place à une autre où il allait s’établir. L’espérance de les recouvrer s’il venait à Boston jointe au souvenir de l’affaire de son fils l’engagea à quitter la Nouvelle-Ecosse avec un autre de ses fils (trois autres sont au service du roi d’Angleterre) et sa femme. Quand nous vinmes à Boston, n’ayant rien pu recouvrer, il était allé jusqu’à Baltimore dans le Maryland voir s’il ne trouverait rien à faire; et à l’arrivée de la flotte française à Rhode Island, il y alla et y prit un Capucin pour servir de missionnaire parmi les sauvages dans cette place. Car ils sont tous catholiques et du parti des Français. Dans ce même temps ayant de la peine à vendre notre thé et voyant beaucoup de difficultés pour le commerce du côté de la Pensilvanie, nous échangeâmes notre thé contre des marchandises des îles, et nous résolûmes de venir ici acheter du poisson et faire la traite de la pelleterie avec les sauvages. Machias est la dernière place au nord-est de la Nouvelle-Angleterre, à environ cent lieues de Boston, dans le comté de Main qui est annexé à l’état de Massachusetts Bay. Il n’y a que quinze ans qu’on y a formé un établissement qui est fort pauvre à cause de la guerre et qui ne consiste qu’en 150 familles dispersées dans un espace de 3 à 4 lieues. Nous sommes dans le chef-lieu, où est un fort, le colonel Allan commandant de la place et surintendant de tous les sauvages qui sont entre le Canada, la Nouvelle-Ecosse et la Nouvelle-Angleterre, et tous les officiers. Lesdernier le fils, chez qui nous logeons, est un très-joli garçon. Nous y passerons l’hiver et probablement nous prendrons des terres le printems prochain, non pas ici mais un peu plus au nord ou au sud où elles sont meilleures. On les a pour rien, mais elles sont en friche et assez difficiles à travailler. Ajoute à cela le manque d’hommes. C’est pourquoi je te le répète, informe-toi des conditions auxquelles des paysans voudraient venir ici. Celles que nous pourrions accorder à peu près seraient de les faire transporter gratis, de les entretenir la première année, après quoi la moitié du revenu des terres qu’ils défricheraient en cas que ce fussent des bleds, ou le quart si c’étaient des pâturages, leur resteraient pendant dix, quinze ou vingt ans suivant les arrangemens (le plus longtems serait le mieux), et au bout de ce tems la moitié ou le quart des terres leur appartiendrait à perpétuité sans qu’ils fussent obligés de cultiver davantage l’autre moitié ou les autres trois quarts. En cas que tu en trouvasses, écris-nous le avec les conditions, le nombre, &c.
Nous avons déjà vu plusieurs sauvages, tous presqu’aussi noirs que des nègres, habillés presqu’à l’Européenne excepté les femmes qui – Mais je veux te laisser un peu de curiosité sans la satisfaire, afin que tu ayes autant de motifs que possible pour venir nous joindre au plus tôt. Mais ne pars que quand nous te le dirons, parcequ’en cas que tu ayes de l’argent, nous t’indiquerons quelles marchandises tu dois acheter, et parceque nous tâcherons de te procurer un embarquement agréable. Dans notre passage de Boston ici nous avons couru plus de risque qu’en venant d’Europe. Le second jour de notre voyage nous relâchâmes à Newbury, jolie ville à dix lieues de Boston et nous y fûmes retenus 5 à 6 jours par les vents contraires. L’entrée du hâvre est très-étroite et il y a un grand nombre de brisans, de manière que quand les vents ont soufflé depuis le dehors pendant quelque tems il y a des vagues prodigieuses qui pouvaient briser ou renverser le vaisseau quand nous voulûmes sortir. Nous fûmes donc obligés de rester encore quelques jours jusqu’à ce que la mer fût calmée. Enfin nous partîmes après nous être échoué 2 fois dans le hâvre. Après deux jours de navigation les vents contraires et très-forts nous obligèrent d’entrer à Casco Bay, où est la ville de Falmouth, une des premières victimes de cette guerre, car elle a été presqu’entièrement brûlée par les Anglais en ‘79. Le lendemain nous en partîmes. Bon vent tout le jour, la nuit et le lendemain, mais un brouillard épais. Le lendemain un coup de vent déchira notre grande voile. On la raccommoda tant bien que mal, et à peine était-elle replacée que le vent augmenta et un quart d’heure après on découvrit tout à coup la terre à une portée-de-fusil à gauche. Nous allions nord-est et le vent était ouest, c’est à dire qu’il portait droit contre terre, et la marée montait. L’on ne pouvait plus virer de bord et l’on fut obligé d’aller autant contre le vent qu’on le pouvait (par un angle de 80 degrés); malgré cela on approchait toujours de terre, mais on en voyait le bout et heureusement elle tournait moyennant quoi nous échappâmes, mais nous n’étions pas à deux toises d’un roc qui était à l’avant de la terre quand nous la dépassâmes. Nous gagnâmes le large au plus vîte, et après avoir été battus par la tempête toute la nuit, nous arrivâmes le lendemain ici.
Je n’ai pas besoin de te dire que ceci est écrit au nom de tous les deux, et comme tu le vois le papier ne me permet pas de causer plus longtems avec toi. Adieu, mon bon ami. Cette lettre est achevée le 7e novembre. Je numérote mes lettres. Fais-en autant et dis-moi quels numéros tu as reçus.
Tu ne recevras point de lettres de nous d’ici au printems, la communication étant fermée.
En relisant ma lettre je vois que je ne t’ai rien dit de la manière de vivre de ce pays. Le commerce consiste en poisson, planches, mâtures, pelleteries, et il est fort avantageux. Avant la guerre on ne faisait que couper des planches, depuis on a défriché les terres; il n’y a encore que fort peu de bleds, mais des patates et des racines de toute espèce en abondance, point de fruits, et du bétail mais peu. Nous avons déjà une vache. C’est un commencement de métairie, comme tu vois. Trois rivières se jettent dans le hâvre et c’est à deux lieues au-dessus de leur embouchure que nous sommes à la jonction de deux d’entr’elles. Nous allons en bâteaux de toute espèce et entr’autres sur des canots d’écorce, dont tu seras enchanté, quelques fragiles qu’ils soient. Tout cela gèle tout l’hyver et on peut faire dix lieues en patins. On va sur la neige avec une sorte de machine qui s’attache aux pieds, nommée raquettes, et avec laquelle on n’enfonce point, quelque tendre qu’elle soit. On fait trente, quarante lieues à travers les bois, les lacs, les rivières, en raquettes, en patins, en canots d’écorce. Car on les porte sur son dos quand on arrive à un endroit où il n’y a plus d’eau jusqu’au premier ruisseau, où l’on se rembarque.
Dis-nous quelque chose de Genève; des affaires politiques, du procès Rilliet, de ta manière de passer ton tems à présent, &c. Adresse-nous tes lettres à Boston.
Monsieur Jean Badollet,
Chez Monsieur le Chevalier de Vivens, à Clérac.
A letter from Serre, which was enclosed with the above long despatch from Gallatin, throws some light on Serre’s imaginative and poetical character and his probable influence on the more practical mind of his companion, although, to say the truth, his idea of life and its responsibilities was simply that of the runaway school-boy.
SERRE TO BADOLLETMon cher ami Badollet, nous sommes ici dans un pays où je crois que tu te plairais bien; nous demeurons au milieu d’une forêt sur le bord d’une rivière; nous pouvons chasser, pêcher, nous baigner, aller en patins quand bon nous semble. A présent nous nous chauffons gaillardement devant un bon feu, et ce qu’il y a de mieux c’est que c’est nous-mêmes qui allons couper le bois dans la forêt. Tu sais comme nous nous amusions à Genève à nous promener en bâteau. Eh bien! je m’amuse encore mieux ici à naviguer dans des canots de sauvages. Ils sont construits avec de l’écorce de bouleau et sont charmants pour aller un ou deux dedans; on peut s’y coucher comme dans un lit, et ramer tout à son aise; il n’y a pas de petit ruisseau qui n’ait assez d’eau pour ces jolies voitures. Il y a quelque tems que je descendis une petite rivière fort étroite; le tems était superbe; je voyais des prairies à deux pas de moi; j’étais couché tout le long du canot sur une couverture, et il y avait si peu d’eau qu’il me semblait glisser sur les près et les gazons. Je tourne, je charpente, je dessine, je joue du violon; il n’y a pas diablerie que je ne fasse pour m’amuser. Note avec cela que nous sommes ici en compagnie de cinq bourgeois et bourgeoises de Genève. Il est bien vrai qu’il y en a trois de nés en Amérique, mais ils n’en ont pas moins conservé le sang républicain de leurs ancêtres, et M. Lesdernier le fils, né dans ce continent d’un père genevois, est celui de tous les Américains que j’ai vu encore le plus zélé et le plus plein d’enthousiasme pour la liberté de son pays.
Adieu, mon cher ami. J’espère que l’été prochain tu viendras m’aider à pagailler (signifie ramer) dans un canot de sauvage. Nous irons remonter la rivière St. Jean ou le fleuve St. Laurent, visiter le Canada. Si tu pouvais trouver moyen de m’envoyer une demi-douzaine de bouts de tubes capillaires pour thermomètre, tu obligerais beaucoup ton affectionné ami.
P.S. – Nous allons bientôt faire un petit voyage pour voir une habitation de sauvages.
A little more information is given by the fragment of another letter, written nearly two years afterwards, but covering the same ground.
GALLATIN TO BADOLLETCambridge, 15 septembre, 1782.Mon bon ami, je t’écris sans savoir où tu es, et sans savoir si mes lettres te parviendront, ou si même tu te soucies d’en recevoir; car si je ne comptais pas autant sur ton amitié que je le fais, je serais presque porté à croire que tu n’as répondu à aucune des lettres que nous t’avons écrites, Serre et moi, depuis plus de deux ans. Cependant te jugeant par moi-même et surtout te connaissant comme je fais, j’aime mieux penser que toutes nos lettres ont été perdues, ou que toutes les tiennes ont subi ce sort. Ainsi commençant par la deuxième supposition, je vais te faire un court narré de nos aventures.

