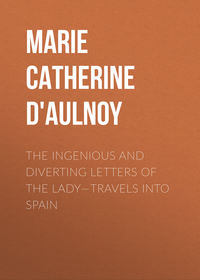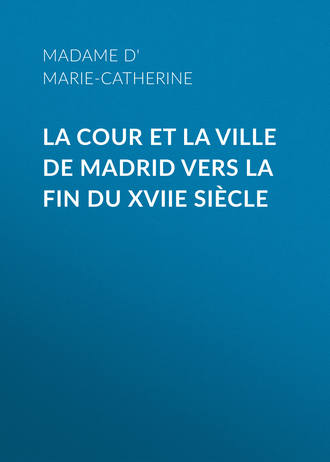
Полная версия
La cour et la ville de Madrid vers la fin du XVIIe siècle
»La plus grande partie de sa charge est perdue; mais j'y serais bien moins sensible, quelque intérêt que j'y aie, si je n'envisageais pas la suite des malheurs que cette perte me prépare. Votre présence aura rendu la santé au marquis de Los-Rios; l'on sait dans votre famille ses sentiments pour vous: il est riche et grand seigneur; je deviens misérable, et si vous m'abandonnez, ma chère Marianne, je n'aurai plus d'espoir que dans une prompte mort.» Je fus pénétrée de douleur à des nouvelles si affligeantes; je pris une de ses mains, et la serrant dans les miennes, je lui dis: «Mon cher Mendez, ne croyez point que je sois capable de vous aimer et de changer par les effets de votre bonne ou de votre mauvaise fortune. Si vous êtes capable de faire un effort pour lui résister, croyez aussi que j'en serai capable. J'en atteste le ciel, continuai-je, et pourvu que vous m'aimiez et que vous me soyez fidèle, je veux bien qu'il me punisse si jamais je change.»
»Il me témoigna toute la sensibilité qu'il devait à des assurances si touchantes, et nous résolûmes de ne pas divulguer cet accident.
»Je me retirai fort triste, et m'enfermai dans mon cabinet, rêvant aux suites que pourrait avoir la perte de tant de biens. J'y étais encore, lorsque j'entendis frapper doucement contre les jalousies qui fermaient ma fenêtre (car j'étais logée dans un appartement bas); je m'approchai, et je vis Mendez au clair de la lune. «Que faites-vous ici à l'heure qu'il est, lui dis-je? – Hélas! me dit-il, je veux essayer de vous parler avant que de m'en aller.
»Mon père vient encore de recevoir des nouvelles du galion; il veut que je parte tout à l'heure, et que j'aille où il est échoué, pour tâcher d'en sauver quelque chose; il y a fort loin d'ici et je vais être un temps considérable sans vous voir. Ah! ma chère Marianne, pendant tout ce temps, me tiendrez-vous ce que vous m'avez promis? Puis-je espérer que ma chère maîtresse me sera fidèle? – Si vous le pouvez espérer, dis-je en l'interrompant. Mendez, que vous ai-je fait pour le mettre en doute? Oui, continuai-je, je vous aimerai, fussiez-vous le plus infortuné de tous les hommes.»
»Ce serait abuser de votre patience, Madame, que de vous raconter tout ce que nous nous dîmes dans cette douloureuse séparation; et bien qu'il n'y parût aucun danger, nos cœurs se saisirent à tel point, que nous avions déjà un pressentiment des disgrâces qui nous devaient arriver. Le jour approchait, et il fallut enfin nous dire adieu; je lui vis répandre des larmes, et j'étais toute mouillée des miennes.
»Je me jetai sur mon lit, roulant dans mon esprit mille tristes pensées, et je parus le lendemain si abattue, que mon père et ma mère eurent peur que je ne tombasse dangereusement malade.
»Le père de Mendez les vint voir, pour excuser son fils de ce qu'il était parti sans prendre congé d'eux. Il ajouta qu'il s'agissait d'une affaire si pressée, qu'elle ne lui avait pas laissé un moment à sa disposition. A mon égard, Madame, je n'avais plus de joie, je n'étais sensible à rien, et si quelque chose pouvait me soulager, c'était la conversation de ma chère Henriette, avec qui je me plaignais en liberté de la longue absence de Mendez.
»Cependant le marquis de Los-Rios était hors de danger, et mon père l'allait voir souvent. Je remarquai un jour beaucoup d'altération sur le visage de ma mère: elle et mon père furent longtemps enfermés avec des religieux qui les étaient venus trouver, et après avoir conféré ensemble, ils me firent appeler, sans que je pusse en deviner la cause.
»J'entrai dans leur cabinet si émue, que je ne me connaissais pas moi-même. Un de ces bons pères, vénérable par son âge et par son habit, me dit plusieurs choses sur la résignation que nous devons aux ordres de Dieu, sur sa providence dans tout ce qui nous regarde, et la fin de son discours fut que Mendez avait été pris par les Algériens, qu'il était esclave, et que par malheur ces corsaires avaient su qu'il était fils d'un riche marchand, ce qui avait été cause qu'ils l'avaient mis à une furieuse rançon; qu'ils étaient à Alger dans le temps qu'il y arriva; qu'ils auraient bien voulu le ramener, mais que l'argent qu'ils avaient porté pour tous n'aurait pas suffi pour lui seul: qu'à leur retour, ils étaient allés chez son père pour lui apprendre ces fâcheuses nouvelles, mais qu'ils avaient su qu'il s'était absenté, et que la perte d'un galion sur lequel il avait tous ses effets, sans en avoir pu rien sauver, l'avait réduit à fuir des créanciers qui le cherchaient pour le faire mettre en prison; que les choses étant en cet état, ils ne voyaient guère de remède aux maux du pauvre Mendez; qu'il était entre les mains de Meluza, le plus renommé et le plus intéressé de tous les corsaires, et que, si je suivais leur conseil et celui de mes parents, je songerais à prendre un autre parti. J'avais écouté jusque-là ces funestes nouvelles si transie, que je n'avais pu les interrompre que par de profonds soupirs; mais quand il m'eut dit qu'il fallait penser à un autre parti, j'éclatai et fis des cris et des regrets si pitoyables, que je touchai de compassion mon père, ma mère et ces bons religieux.
»L'on m'emporta dans ma chambre, comme une fille plus près de la mort que de la vie; l'on envoya quérir Doña Henriette, et ce ne fut pas sans douleur qu'elle me vit si malheureuse et si affligée. Je tombai dans une mélancolie inconcevable; je me tourmentais nuit et jour, rien n'était capable de m'ôter le souvenir de mon cher Mendez.
»Le marquis de Los-Rios ayant appris ce qui se passait, conçut de si fortes espérances, qu'il se trouva bientôt en état de venir demander à mon père, de même à moi, l'effet des paroles que nous lui avions données. Je voulus lui faire entendre que la mienne n'était point dégagée à l'égard de Mendez, qu'il était malheureux, mais que je ne lui étais pas moins promise. Il m'écouta sans se laisser persuader, et me dit que j'avais autant d'envie de me perdre que les autres en ont de se sauver; que c'était moins son intérêt que le mien qui le faisait agir. Et ravi d'avoir un prétexte qui lui semblait plausible, il pressa mon père avec tant de chaleur, qu'il consentit à tout ce qu'il souhaitait.
»Je ne puis vous représenter, Madame, dans quelle douleur j'étais abîmée. Qu'est devenue, Seigneur, disais-je au marquis, cette scrupuleuse délicatesse qui vous empêchait de vouloir mon cœur d'une autre main que de la mienne? Si vous me laissiez au moins le loisir d'oublier Mendez, peut-être que son absence et ses disgrâces me le rendraient indifférent; mais dans le temps où je suis, tout occupée du cruel accident qui me l'arrache, vous ajoutez de nouvelles peines à celles que j'ai déjà, et vous croyez qu'avec ma main je pourrais vous donner ma tendresse!
«Je ne sais ce que je crois, me disait-il, ni ce que j'espère, je sais bien que ma complaisance a pensé me coûter la vie; que si vous n'êtes point destinée pour moi, un autre vous possédera; que Mendez, par l'état de sa fortune, n'y doit plus prétendre, et qu'enfin, puisque l'on veut vous rétablir, vous avez bien de la dureté de refuser que ce soit avec moi. Vous n'ignorez pas ce que j'ai fait jusqu'ici pour vous plaire, mon procédé vous doit être caution de mes sentiments; et qui vous répondra d'un autre cœur fait comme le mien?»
»Les jours se passaient ainsi dans les disputes, dans les prières et dans une affliction continuelle.
»Le marquis faisait bien plus de progrès sur l'esprit de mon père que sur le mien. Enfin, ma mère m'ayant envoyé quérir un jour, elle me dit qu'il n'y avait plus à balancer, et que mon père voulait absolument que j'obéisse à ses ordres. Ce que je pus dire pour m'en dispenser, mes larmes, mes remontrances, ma douleur, mes peines, tout cela fut inutile et ne m'attira que des duretés.
»L'on prépara toutes les choses nécessaires à mon mariage, le marquis voulut que tout eût un air de magnificence convenable à sa qualité; il m'envoya une cassette pleine de bijoux et pour cent mille livres de pierreries. Le jour fatal pour notre hymen fut arrêté. Me voyant réduite dans cette extrémité, je pris une résolution qui vous surprendra, Madame, et qui marque une grande passion. J'allai chez Doña Henriette, cette amie m'avait toujours été fidèle, et je me jetai à ses pieds; je la surpris par une action si extraordinaire. «Ma chère Henriette, lui dis-je, fondant en larmes, il n'y a plus de remèdes à mes maux, si vous n'avez pitié de moi; ne m'abandonnez pas, je vous en conjure, dans le triste état où je suis; c'est demain que l'on veut que j'épouse le marquis de Los-Rios. Il n'est plus possible que je l'évite. Si l'amitié que vous m'avez promise est à toute épreuve et vous rend capable d'une résolution généreuse, vous ne me refuserez point de suivre ma fortune et de venir avec moi à Alger payer la rançon de Mendez, et le tirer du cruel esclavage où il est. Vous me voyez à vos genoux, continuai-je en les embrassant (car quelques efforts qu'elle eût pu faire, je n'avais pas voulu me lever), je ne les quitterai point que vous ne m'ayez donné votre parole de faire ce que je souhaite.» Elle me témoigna tant de peine de me voir à ses pieds, que je me levai pour l'obliger à me répondre. Aussitôt, elle m'embrassa avec de grands témoignages de tendresse. «Je ne vous refuserai jamais rien, ma chère Marianne, me dit-elle, fût-ce ma propre vie; mais vous allez vous perdre et me perdre avec vous. Comment deux filles pourront-elles exécuter ce que vous projetez? Votre âge, notre sexe et votre beauté nous exposeront à des aventures dont la seule imagination me fait frémir. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que nous allons combler nos familles de honte; or si vous y aviez fait de sérieuses réflexions, il n'est pas possible que vous pussiez vous y résoudre. – Ah! barbare, m'écriai-je, plus barbare que celui qui retient mon amant, vous m'abandonnez; mais bien que je sois seule, je ne laisserai pas de prendre mon parti; aussi bien, le secours que vous pourriez me donner ne me pourrait être fort utile: restez, restez, j'y consens, il est juste que j'aille sans aucune consolation affronter tout le péril; j'avoue même qu'une telle démarche ne convient qu'à une fille désespérée.»
»Mes reproches et mes larmes émurent Henriette; elle me dit que mon intérêt l'avait obligée, autant que le sien propre, de me parler comme elle avait fait; mais qu'enfin, puisque je persistais dans mon premier sentiment et que rien ne pouvait m'en détourner, elle était résolue de ne me point abandonner; que si je l'en voulais croire, nous nous travestirions, qu'elle se chargeait d'avoir deux habits d'homme, et que c'était à moi de pourvoir à tout le reste. Je l'embrassai avec mille témoignages de reconnaissance et de tendresse.
»Je lui demandai ensuite si elle avait vu les pierreries que le marquis m'avait envoyées; je les porterai, lui dis-je, pour en payer la rançon de Mendez. Nous résolûmes de profiter de tous les moments, parce qu'il n'y en avait aucun à perdre, et nous ne manquâmes, ni l'une ni l'autre, à rien de ce que nous avions projeté.
»Jamais deux filles n'ont été mieux déguisées que nous le fûmes, sous l'habit de deux cavaliers. Nous partîmes cette même nuit et nous nous embarquâmes sans avoir trouvé le moindre obstacle; mais après quelques jours de navigation, nous fûmes surprises d'une tempête si violente, que nous crûmes qu'il n'y avait point de salut pour nous. Dans tout ce désordre et ce péril, je sentais bien moins de crainte pour moi que de douleur de n'avoir pu mettre mon cher Mendez en liberté, et d'avoir engagé Henriette dans ma mauvaise fortune. C'est moi, lui disais-je en l'embrassant, c'est moi, ma chère compagne, qui excite cet orage; si je n'étais pas sur la mer elle serait calme; mon malheur me suit en quelque lieu que j'aille, j'y entraîne tout ce que j'aime. Enfin, après avoir été un jour et deux nuits dans des alarmes continuelles, le temps changea et nous arrivâmes à Alger.
«J'étais si aise de me voir en état de délivrer Mendez, que je ne comptais pour rien tous les dangers que j'avais courus. Mais, ô Dieu! que devins-je en débarquant, lorsqu'après toute la perquisition que l'on put faire, je connus qu'il n'y avait point d'espérance de retrouver la cassette où j'avais mis tout ce que j'avais de plus précieux; je me sentis pressée d'une si violente douleur que je pensai expirer avant de sortir du vaisseau. Sans doute cette cassette, qui était petite et dont je pris peu de soin pendant la tempête, tomba dans la mer ou fut volée; lequel que ce soit des deux, je fis une perte considérable, et il ne me restait plus que deux mille pistoles de pierreries que j'avais gardées à tout événement et que je portais sur moi.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Ce nom n'est pas inconnu dans l'histoire. Un sieur de Saint-Pé était agent politique du cardinal de Richelieu en Portugal. (Flassan, Histoire de la diplomatie, t. III, p. 62.)
2
Le paysan espagnol trouve inutile de graisser les moyeux des roues de sa charrette. Il en résulte des grincements qui s'entendent à des distances réellement extraordinaires. Les correspondances des armées, au temps de Napoléon, mentionnent cet inconvénient, qui n'était pas sans gravité lorsqu'il s'agissait de dérober une marche à l'ennemi.
3
C'était là un privilége particulier à ces provinces, et il était fondé sur l'extrême pauvreté du pays. «Si le commerce avec la France, l'Angleterre, l'Aragon, la Navarre et le duché de Bretagne, n'était pas libre, nul n'y pourrait subsister, dit l'ordonnance de 1479.» (Llorente, Provincias vascongadas, p. 323, 332.)
4
La langue basque, on le sait, est une langue primitive qui n'a d'analogie avec aucune autre langue connue. Elle était néanmoins infiniment plus usitée que le castillan dans cette partie de l'Espagne. Aussi, lors de la réunion des juntes, les affaires étaient-elles exposées en castillan et discutées en langue basque. (Weiss, t. 1er, p. 207.)
5
Ce personnage se conformait aux usages de son temps, ainsi que nous le verrons par la suite. En pareille circonstance, les Espagnols vous adressent encore ce compliment: «A la disposition de Votre Seigneurie.» Mais il serait indiscret de les prendre au mot.
6
Le conseiller Bertault, qui accompagna la maréchal de Gramont lorsqu'il alla demander pour le roi la main de l'infante Anne d'Autriche, fait également mention de ces jeunes et modestes batelières. Il est vrai de dire qu'un de ses contemporains, le Hollandais Van Aarsens de Sommerdyck, est loin d'être aussi édifié des façons des dames du pays. Il raconte, avec un juste sentiment de pudeur alarmée, que ces femmes s'abritent du soleil en relevant leurs jupes sur leurs têtes, sans se préoccuper le moins du monde des bienséances. (Voyage d'Espagne, p. 5.)
7
Madame d'Aulnoy fait mention de patagons, de ducats, de piastres, de pièces de huit réaux. Ces pièces avaient la même valeur, seulement les patagons étaient monnayés en Flandre et en Franche-Comté à l'effigie de l'archiduc Albert et de l'archiduchesse Isabelle. Les ducats étaient monnayés dans le duché de Milan; les pièces de huit réaux, de même que les réaux d'argent et de cuivre, en Espagne. Les rapports des pièces de huit réaux avec les monnaies de France varièrent légèrement pendant le cours du dix-septième siècle. Elles se rapprochaient généralement de la valeur de l'écu d'or de Henri III, soit trois livres ou soixante sols. Les rapports de ces pièces d'argent avec les pièces de cuivre nommées réaux de vellon, au contraire, varièrent énormément, par la raison que la monnaie d'argent sortait de l'Espagne avec une rapidité telle, que les paiements dans l'intérieur du pays ne se faisaient qu'en monnaie de cuivre. Nous trouvons à cet égard un renseignement précieux dans le Journal du conseiller Bertault: «Un ducat, dit-il, est un peu moins qu'une pièce de cinquante-huit sols, qui vaut huit réaux de plata (argent), mais on n'en trouve pas. Tout se compte par quartos et ochavos qui sont de cuivre et qu'ils appellent de vellon. Ainsi, un réal de huit, qui est une pièce de cinquante-huit sols, vaut de douze et demi à treize réaux de vellon (au lieu de huit réaux d'argent). Un ducat n'est que de dix à onze (réaux de vellon), quarante à quarante-cinq sols de France.» Cette proportion se rapporte à l'année 1660. Il est bon d'observer aussi que les piastres frappées au Mexique étaient d'une valeur beaucoup plus considérable que les piastres d'Espagne, mais nous n'avons pas à nous en occuper.
8
Le roi d'Espagne n'avait droit de tenir garnison que dans ces deux villes. Le désarroi des finances était tel, que des places comme Pampelune tombaient en ruine et étaient à peine gardées. Le Hollandais Van Aarsens en fit l'observation lorsqu'il alla visiter cette place: «Afin que nous ne la trouvassions pas si dépourvue de monde, dit-il, on y avait fait entrer bon nombre de paysans qu'on mêla parmi les soldats. Mais il nous fut aisé de les reconnaître, parce que, outre qu'ils n'avaient pas la mine de traîneurs d'épée, la plupart n'en portaient pas et faisaient la parade avec un simple mousquet ou quelque vieille pique.» (Voyage d'Espagne, p. 339.)
9
Nous ne saurions dire si ce personnage est de fantaisie. Il n'était point assurément le neveu du duc d'Albe; mais le généalogiste Imhof, qui cite souvent madame d'Aulnoy, pense que Don Fernand de Toledo appartenait à une branche cadette éloignée des Toledo, ducs d'Albe. En effet, madame d'Aulnoy dit plus loin qu'il était beau-fils du marquis de Palacios. Or, Don Pedro Ruiz de Alarco Ledezma y Guzman, second marquis de Palacios, avait épousé Dona Blanca de Toledo, huitième dame de Las Higuarez. Imhof pense que cette Dona Blanca de Toledo avait pu avoir d'un premier mariage ce fils qui, suivant l'usage assez général des cadets en Espagne, aurait pris le nom de sa mère. En ce qui touche les trois autres cavaliers qui vinrent rejoindre madame d'Aulnoy, nous ne saurions rien affirmer. (Imhof, Généalogie de vingt familles illustres d'Espagne.)
10
Il nous semble à propos de donner quelques explications à ce sujet. Lors de leur réunion à la couronne de Castille, les provinces basques, Alava, Viscaya et Guipuscoa, avaient expressément stipulé le maintien de leurs priviléges. Les Basques, n'ayant jamais subi le joug des Maures, étaient considérés comme hidalgos. En conséquence, ils ne payaient pas d'impôts au roi, ils ne pouvaient être jugés que par les tribunaux de leur pays, avaient seuls droit aux emplois et jouissaient d'une liberté de commerce illimitée avec leurs voisins. Chaque province était gouvernée par une junte, dont l'organisation était à peu près partout la même. La junte était élue par tous les habitants indistinctement, pourvu qu'ils fussent d'origine basque et chrétienne. Elle votait les lois, les règlements de police, fixait la quotité des impôts et du don gratuit qu'elle accordait au roi. Lorsqu'elle se séparait, elle déléguait les pouvoirs à une commission, qui se partageait les diverses attributions du gouvernement, nommait aux emplois, administrait les fonds provinciaux, rendait la justice, pourvoyait à la défense du pays, et veillait surtout à ce que le roi n'empiétât pas sur ses priviléges et n'amenât pas de troupes étrangères dans la province. Le roi, à son avénement, se rendait en Biscaye sous l'antique chêne de Guernica, jurait de respecter les fueros. Les délégués de la junte prêtaient le même serment en prononçant, la main étendue sur le machete vittoriano: «Je veux que ce couteau me coupe la gorge si je ne défends pas les fueros.» (Llhorente, Provincias Vascongadas, t. II; passim., Weiss, t. I, p. 210.)
11
Les vivres, en effet, étaient si rares, que Gourville, se rendant à Madrid, se vit dans la nécessité de faire faire du biscuit pour son voyage. (Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France, t. XXIX, p. 552.)
12
Madame d'Aulnoy ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était dans l'erreur.
13
Les mystères du moyen âge, on le voit, s'étaient perpétués en Espagne. Ils étaient fort plats, parfois même grotesques, si nous devons en croire madame d'Aulnoy; mais nous n'acceptons pas son jugement d'une façon absolue. Pour apprécier avec équité ce genre de représentations, il faut lire les autos sacramentales du dix-septième siècle. La valeur littéraire en est incontestable. Nous n'essayerons pas de le démontrer. Nous nous bornerons à dire que les grands auteurs de cette époque se faisaient tous honneur d'écrire des autos. Calderon, entre autres, du jour où il entra dans les ordres, consacra sa plume à la scène religieuse, et l'éleva à la hauteur de son génie. Les autos qu'il nous a laissés peuvent être considérés comme les modèles du genre. Ils reflètent dans toute leur énergie les sentiments ardents et mystiques de la chevalerie espagnole, les qualités et les défauts de ses contemporains, leur emphase, leur morgue, leur foi et leur superstition. Le langage qu'il prête à ses héros est brillant à l'excès. Les situations qu'il imagine, sont souvent invraisemblables, mais toujours essentiellement dramatiques. Le lecteur en pourra juger par une esquisse du plus célèbre de ses autos: La Dévotion à la Croix; nous la donnerons plus loin, appendice A.
14
Il s'agit ici des saynètes, intermèdes comiques fort connus maintenant en France par d'heureuses imitations dues à la plume de Prosper Mérimée.
15
Il en était encore ainsi en 1823. Acteurs et spectateurs s'agenouillaient, s'il leur arrivait d'entendre la sonnette qui annonçait aux fidèles le passage du Saint-Sacrement. Les officiers de la garnison française de Barcelone s'égayèrent de cet usage, et, comme on jouait à cette époque le Barbier de Séville, ils se procurèrent la sonnette de l'église voisine et la firent tinter juste au moment où Figaro savonne le menton de son patron. Il en résulta une scène ridicule qui fit quelque scandale dans la ville.
16
Arrivée à la frontière de la Castille, madame d'Aulnoy rencontra pour la première fois une ligne de douane. Ce n'est pas là une des moindres singularités de son voyage. Les marchandises qui venaient de France en Biscaye n'acquittaient pas de droits; mais celles qui s'échangeaient entre la Biscaye, la Castille et la Navarre, ne jouissaient pas de cette franchise. Les deux grands royaumes de Castille et d'Aragon se trouvaient enfermés dans leurs lignes de douanes respectives et s'efforçaient de protéger leur industrie à l'aide de tarifs, comme s'ils eussent été des pays rivaux. De plus, chaque ville avait ses péages et ses octrois. Les voyageurs, qui se trouvaient ainsi arrêtés à chaque pas, s'en étonnaient, mais à tort. L'Espagne, en effet, n'était qu'une agrégation de petites souverainetés, qui lors de leur réunion à la couronne, avaient toujours eu grand soin de stipuler leurs privilèges. Elles tenaient au maintien des droits qu'elles imposaient aux marchandises étrangères, non-seulement en raison de leurs vieilles rivalités, mais encore en raison de leurs intérêts matériels. Ces péages formaient une partie de leur revenu et étaient affermés. Les fermiers acceptaient naturellement de fort mauvaise grâce les passe-ports qui les frustraient de leurs bénéfices; ils ne cédaient qu'en présence d'une délibération du Conseil d'État, revêtue de la signature du Roi; encore cette délibération devait-elle être confiée à un alcade de la Cour, qui parfois recourait à la force. On en trouvera un exemple curieux, mais trop long à rapporter ici, dans le voyage du Hollandais Van Aarsen de Sommerdyck, pp. 256-292.
17
La licence de la soldatesque fut la cause de ce soulèvement; mais elle ne saurait expliquer à elle seule l'hostilité persistante de la Catalogne, hostilité qu'atteste une longue suite de révoltes. Nous croyons devoir en signaler la cause réelle, car elle ajoute un trait à la physionomie de l'Espagne: