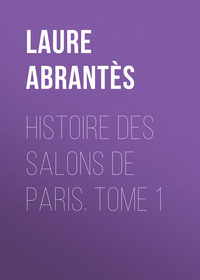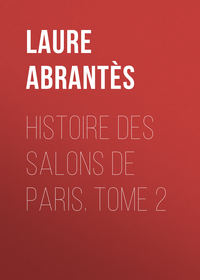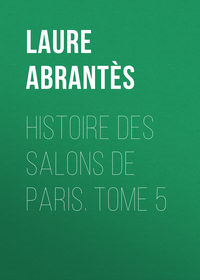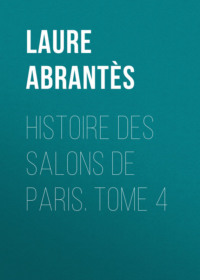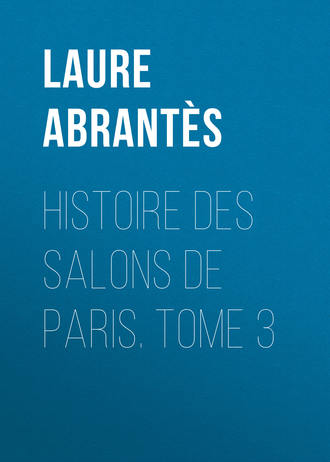
Полная версия
Histoire des salons de Paris. Tome 3
Il était alors arrivé au point de changer enfin de système, car le sien, il le voyait, ne pouvait plus se soutenir. Il fallait enfin ramener un peu d'ordre dans toutes les parties de ce grand État qui croulait de toutes parts malgré les victoires de nos armées; qu'importe l'écorce d'un fruit quand un insecte le pique au cœur!.. Robespierre parla donc à Catherine Théos, la dirigea, et dom Gerle, trompé, se crut le fils de Dieu, et prit pour bon ce que voulut être Robespierre, ce qui ne fut rien moins que le fils de l'Être suprême…
Ce fut alors que des réunions eurent lieu le soir, trois fois par semaine, chez Catherine Théos; il y eut aussi des conférences mystiques auxquelles assista Robespierre. Il voulut organiser le nouveau système religieux qu'il se proposait de donner à la France, après avoir purgé la Convention des hommes qu'il y redoutait, tels que Bourdon (de l'Oise), Tallien, etc… Mais ce fut assez secrètement d'abord et sans beaucoup d'éclat…
Tout fut donc convenu, et la fête de l'Être suprême eut lieu… Mais Robespierre manqua d'adresse ici complètement. Il ne devait présenter des idées religieuses à des hommes qui menacent de tout détruire qu'appuyé d'une force respectable et dans le cas de le défendre ainsi que ses doctrines. Aussi ses auditeurs ouvrirent-ils les yeux, et tout aussitôt des mesures furent-elles prises par une opposition qui se trouva naturellement formée dans une assemblée comme la Convention, où Robespierre était haï et redouté…
En tête de cette faction qui s'élevait lentement, mais formidable dès qu'elle prononcerait une parole accusatrice, était Vadier, membre du comité de Sûreté générale, autrefois le plus grand ami de Robespierre: mais depuis, ils s'étaient séparés et vivaient mal l'un avec l'autre… Il fut averti de ce qui se passait dans le salon de Catherine Théos, et résolut de connaître enfin la conduite de Maximilien. La place qu'occupait Vadier au comité de Sûreté générale mettait à sa discrétion tous les moyens de recherches possibles; il les employa. Un des agents du comité s'introduisit chez Catherine Théos sous le prétexte d'être reçu au nombre de ses adeptes. Il se rendit donc un soir rue de l'Estrapade, dans une assez belle et grande maison où logeait Catherine Théos… Cet agent trompa l'un des initiés, qui le présenta comme je l'ai dit plus haut. Lorsqu'il fut introduit dans l'appartement intérieur, il vit un grand et beau salon au milieu duquel étaient trois magnifiques fauteuils en velours rouge orné de franges d'or: l'un (celui du milieu) était pour la mère Théos; le second, pour le fils de l'Être suprême (Robespierre); et le troisième, pour le fils de Dieu (dom Gerle). À peine fut-il entré, qu'une autre femme presque aussi vieille que la mère du Père Éternel, entra dans la chambre. Cette femme était désignée sous le nom d'Éclaireuse. – À peine fut-elle entrée, qu'elle dit d'un ton nasillard ces paroles:
«Enfants de Dieu, préparez-vous à chanter la gloire de l'Être suprême!..»
Dom Gerle (le fils de Dieu) était assis à la gauche de la mère Théos, Robespierre était absent.
Lorsque l'aspirant eut rempli les formalités requises, Catherine Théos le fit approcher d'elle, et lui ayant ordonné de se mettre à genoux, et là, les mains dans les siennes, elle lui fit réciter la formule de réception des initiés que voici, ou plutôt le serment:
«Je jure de répandre jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour soutenir et défendre, soit l'arme à la main, soit par tous les genres de mort possibles, la cause et la gloire de l'Être suprême.»
Après ce serment, l'Éclaireuse faisait la lecture de l'Apocalypse. Elle disait:
«Les sept sceaux sont mis sur l'Évangile de la vérité; cinq sont levés. Dieu a promis à notre mère de se révéler à elle à la levée du sixième. Quand le septième se lèvera, prenez courage, en quelque lieu que vous soyiez, quelque chose que vous voyiez; la terre sera purifiée, tous les hommes mourront. Les seuls élus de la mère de Dieu ne périront pas… et ceux qui avant ce temps seront frappés d'un accident, quel qu'il soit, renaîtront pour ne plus mourir.»
Alors Catherine reprit les deux mains de l'aspirant dans les siennes, et lui dit en l'embrassant:
– Mon fils, je vous reçois au nombre de mes élus; vous serez immortel, si vous êtes toujours fidèle à votre serment.
L'agent du comité retourna plusieurs fois chez Catherine Théos; chaque réunion offrait un accroissement de néophytes qui devenait alarmant. L'agent suivit cette association dans ses nombreux détours; il vit Robespierre au milieu des initiés, et chaque jour Vadier put juger que son ennemi marchait de lui-même à sa perte. Enfin le moment fut trouvé favorable par lui, et la mère Théos et dom Gerle furent dénoncés et arrêtés… Aussitôt qu'ils furent pris, Robespierre courut pour faire agir son immense pouvoir; mais dès lors il put comprendre combien il avait faibli. Il ne put s'opposer à l'arrestation de la mère Théos ni de dom Gerle!..
De ce moment, Robespierre ne parut plus au comité de Salut public; il s'isola de la société de ses collègues, leur annonçant par cette retraite ce qu'ils avaient à redouter de lui… Cependant son pouvoir était encore bien grand s'il eût su l'employer. Une aventure qui lui arriva à cette époque le prouve; elle trouvera d'autant mieux sa place en ce lieu de l'ouvrage qu'elle est à elle seule l'histoire et même le tableau de ce qu'était la France à cette époque, où quelques meurtres dominaient en la décimant une grande et noble nation.
Une jeune fille, dont le père était papetier, résolut de libérer la France. Elle s'appelait Cécile Renault; elle avait vingt ans, était belle, bien élevée, et n'avait contre les tyrans aucun motif personnel de haine ni de vengeance. Mais chaque jour ses yeux étaient tristement frappés de la vue des familles qui portaient le deuil, ses oreilles douloureusement atteintes par les gémissements des victimes.
– Non, dit-elle, Dieu ne veut pas qu'une faible femme ait au cœur un si ardent désir, si sa volonté ne l'y mettait elle-même… Allons, et que sa sainte mère soit avec moi!
C'était en 1794, le 23 mai au matin; elle se leva, fit sa prière, car elle avait été élevée pieusement par une mère qu'elle avait perdue, puis elle descendit auprès de son père, lui demanda sa bénédiction, et sortit de la maison paternelle, qu'elle ne devait plus revoir.
Arrivée chez Robespierre, elle s'adresse à mademoiselle Duplaix, qui, la regardant avec une curiosité jalouse, lui répond que Robespierre n'était pas chez lui, et que même y fût-il, il n'avait pas de temps à perdre avec la première personne venue.
– S'il est sorti, j'attendrai, répond doucement la jeune fille.
– Avez-vous donc un rendez-vous de lui?
– Un rendez-vous! non. Est-ce que cela est nécessaire? N'est-il pas fonctionnaire public et le chef du Gouvernement? ne se doit-il pas à tout venant? Notre bon roi saint Louis, sous le chêne de Vincennes, rendait justice au premier paysan qui venait la lui demander.
Cette parole imprudente la perdit. Hélas! dans ces temps malheureux, il n'en fallait pas tant pour éveiller les soupçons. Elle fut arrêtée et conduite immédiatement au comité révolutionnaire, où d'abord on l'interrogea.
– Connaissez-vous Robespierre?
– Non.
– Que lui voulez-vous?
– Cela ne vous regarde pas.
– Avez-vous dit que vous regrettiez Capet?
– J'ai dit que je pleurais notre bon roi… oui, je l'ai dit, et je voudrais qu'il vécût encore. N'êtes-vous pas cinq cents rois, et tous plus insolents et despotiques que ne l'était celui que vous avez tué… Vous êtes tous des tyrans… et j'allais chez Robespierre pour voir comment était fait un tyran.
– Que portez-vous dans ce paquet?
Elle avait en effet un petit paquet sous le bras.
– Je m'attendais de toute manière à être arrêtée, et j'avais emporté du linge pour mon usage.
On ouvrit le paquet: il n'y avait, en effet, qu'un peu de linge; mais on la fouilla, et l'on trouva sur elle un grand couteau d'un usage ordinaire… Ce fut suffisant!.. et l'infortunée fut condamnée ce même jour, et mourut le lendemain matin15. Malgré la force de son âme, il y eut un moment où son courage faillit: ce fut en voyant son père, un vieillard âgé de soixante-deux ans, aller avec elle à la mort, comme son complice… Son désespoir fut violent; et lui la consolait en lui disant: Eh quoi! ma fille, tu me plains de mourir! Mais dans un temps aussi cruel, lorsque Dieu a retiré son bras de nous, c'est un bonheur de mourir. Toute la famille de cette jeune fille, deux de ses tantes autrefois religieuses, tous ses parents, au nombre de dix-huit, périrent avec elle!.. Dans ce nombre étaient huit femmes mères et filles; toutes s'embrassaient, s'exhortaient et se donnaient mutuellement de la force…
– Nous sommes heureuses de mourir ensemble! disaient-elles…
– Voyez, disait Fouquier-Tinville, la hardiesse de ces femmes, qui prennent de l'audace pour du courage!.. Il faut que j'aille les voir mourir, pour voir si cette grande force se soutiendra, dussé-je pour cela me passer de dîner!..
Tels étaient les hommes qui formaient la société de Robespierre, et Fouquier-Tinville cependant avait un esprit remarquable hors de cette mer de sang où il se baignait tous les jours… Mais tous en étaient venus à cette extrémité qu'il fallait qu'eux-mêmes fussent toujours montés à ce diapason d'une extrême terreur, pour être compris de ceux à qui ils parlaient, et le délire de cette époque produisit le Père Duchesne!.. Le tutoiement acheva de corrompre le beau langage, dont la tradition se conservait néanmoins encore… Le changement total des noms de chaque chose, même des noms propres, acheva l'ouvrage commencé… Insensiblement la société s'effaça en France… on en perdit jusqu'au souvenir… on ne reçut plus, et lorsque madame de Fontenay, après le 9 thermidor, voulut avoir une maison à Chaillot, à ce qu'on nommait la Chaumière, elle eut une peine extrême à la former.
Une des singularités frappantes de l'époque de la Terreur était ce contraste journalier qu'on allait voir au Tribunal révolutionnaire… Ce langage pur et même presque toujours élégant des victimes, avec les paroles grossièrement meurtrières des bourreaux, frappait vivement ceux qui allaient assister à ces horribles scènes pour surprendre quelquefois un mot ou un regard d'adieu!.. Mais ce que je suis fière d'écrire, c'est que l'honneur de cette époque est tout entier aux femmes: leur courage, et leur bravoure même, je puis dire ce mot, est sans aucune comparaison au-dessus de celui des femmes de l'antiquité, même dans leurs actions les plus vantées. Je vais encore en citer un exemple.
Madame Le Callier, jeune, belle et charmante, est arrêtée et jetée dans une des prisons de Paris les plus renommées pour fournir au charnier populaire… Elle y était avec M. Boyer, qu'elle aimait et devait épouser aussitôt, disait-elle avec crainte, que nous serons hors de cet horrible lieu… Mais M. Boyer est mandé au Tribunal révolutionnaire; c'était aller à la mort: en effet, elle ne le revit plus!
Elle ne dit rien, ne pleura même pas… Mais le même jour elle écrivit à Fouquier-Tinville.
– Vous êtes tous des monstres! vous m'avez fait arrêter parce que j'aimais nos rois, disiez-vous. Eh bien! oui, je les aime, je les pleure, les appelle, et vous maudis.
Un des amis de madame Le Callier intercepta la lettre, qu'il soupçonnait être ce qu'elle était en effet, un titre de mort. Deux jours après, ne recevant pas de réponse, madame Le Callier se douta qu'on voulait la servir comme elle ne voulait pas l'être; et elle écrivit une seconde lettre semblable à la première, en prenant toutefois des mesures pour qu'elle parvînt. Le même jour, elle rassemble toutes les lettres de M. Boyer, les relit encore, y joint tout ce qu'elle tenait de lui, se fait une ceinture de toutes ses reliques, et passe le reste de la nuit en prières. Dès que le jour est venu, elle s'habille avec le plus d'élégance qu'il lui est possible de le faire, et se met à table pour déjeuner avec ses compagnons d'infortune. Au milieu du repas, on entend la cloche sinistre… Tout le monde pâlit… madame Le Callier est seule joyeuse et rassurée; elle se lève, dit adieu à ses amis, leur distribue quelques souvenirs.
– C'est moi qu'on vient chercher, dit-elle avec joie; adieu! je suis heureuse de mourir… Je ne verrai plus mon pays livré à une sanglante anarchie, et je vais rejoindre l'ami qui m'attend.
Elle coupe elle-même ses beaux cheveux, et les distribue autour d'elle à ceux qui peut-être feront le jour suivant le même legs… C'était bien elle, en effet, qu'on venait chercher. Conduite au tribunal, on lui demande si elle est l'auteur de la lettre qu'on lui montre.
– Oui, répondit-elle avec fermeté, cette lettre est de moi… Je regrette peu la vie, car vous avez fait de mon pays un vaste charnier, et vous venez de donner la mort au seul être qui pouvait m'y retenir encore!.. Vive le Roi! s'écria-t-elle avec une sorte d'enthousiasme… vive le Roi! et mort à vous tous!..
Elle mourut le même jour, heureuse, comme elle le disait, de quitter cette France qui n'était plus qu'un vaste cimetière…
J'ai dit en commençant cet ouvrage, et en parlant des salons de Paris, que les femmes en France étaient l'âme de la société, et que sans elles on ne pouvait avoir ce qu'on appelle une maison. Le triste événement que je viens de rapporter me fait dire aussi qu'on devrait reconnaître que pendant cette époque de malheurs elles furent la gloire et l'honneur de cette France que des hommes sans âme déshonoraient avec impudeur… Que d'exemples peu de lignes peuvent fournir!.. À Lyon, mademoiselle Delglace voit emmener son père, des cachots de cette ville, à Paris, pour y être mis à la Conciergerie, c'est-à-dire pour aller à la mort. Mademoiselle Delglace demande à monter sur la même charrette pour soigner son père; on la refuse. Faible et délicate, elle suivit la charrette à pied, ne s'en éloignant un moment que pour aller en avant lui préparer son dîner, et le soir mendier une couverture pour envelopper le vieillard dans le cachot humide où il était enfermé pendant la nuit. Arrivée à Paris, elle espéra vaincre les bourreaux, puisqu'elle avait fléchi des geôliers; en effet, ses sollicitations eurent un succès entier. Elle obtint la grâce de son père, et le reconduisait à Lyon, fière de l'avoir ainsi disputé à la mort, lorsque les fatigues qu'elle avait éprouvées réclamèrent à leur tour leur action désastreuse, et elle mourut dans les bras de celui qu'elle venait de sauver de la mort.
Mademoiselle de Sombreuil est connue et le sera toujours; son nom est celui de la plus digne et de la plus courageuse des femmes.
Voyez mademoiselle de Bérenger, qui ne veut pas demeurer sur une terre que quittent tous les siens; elle veut les suivre. Elle sait qu'il est un mot capable de faire condamner même l'enfance innocente!
– Vive le Roi! s'écrie-t-elle; et la malheureuse enfant suit toute sa famille sur l'échafaud. Elle n'avait que quatorze ans!..
Charlotte Corday, cette noble héroïne qui riva peut-être nos fers en croyant nous sauver, mais dont l'intention était grande et courageuse!.. Et tant d'autres dont les noms mériteraient un panthéon digne d'elles!
Sans doute, sous le régime de la Terreur il n'y avait plus ce que nous appelons société en France; mais les éléments n'en étaient pas perdus, et certainement l'esprit est toujours actif dans un être dont l'âme est aussi noblement grande que ceux que je viens de citer. Aussi est-il une chose digne de remarque; c'est qu'à cette époque, où les hôtels étaient déserts, où les maisons étaient fermées à huit heures du soir, le seul lieu où l'on causait, où l'on riait, c'était dans les prisons du Luxembourg, des Carmes, de Saint-Lazare, là, enfin, où se trouvaient ceux qui, seuls, pouvaient et savaient causer.
SALON DE Mme DE SAINTE-AMARANTHE
Après avoir parlé de madame de Sainte-Amaranthe et de sa fille, il faut donner quelques détails sur ces deux femmes d'autant plus intéressantes à bien connaître qu'on peut regarder leur maison comme le dernier refuge de ce qui s'appelait encore société en France.
Au moment de la Révolution, madame de Sainte-Amaranthe n'était plus une jeune femme, et depuis longtemps Paris connaissait et son nom et ses aventures. En voici un aperçu:
Madame de Sainte-Amaranthe était d'une bonne famille de Franche-Comté16. Élevée par une mère très-sévère qui ne s'occupait cependant pas d'elle, la jeune fille écouta un capitaine de cavalerie, jeune, beau et riche, fut enlevée ou quelque chose de semblable, et Paris vit arriver bientôt M. et madame de Sainte-Amaranthe, dans tout le premier bonheur d'une lune de miel qui ne devait même pas fournir tous ses quartiers… M. de Sainte-Amaranthe était joueur, passablement mauvais sujet, et il s'ennuya bientôt d'une femme, artiste par l'âme, et qui sentait vivement tout ce qui s'offrait à elle avec une apparence de supériorité. La pauvre enfant avait cru voir de cette manière, dans l'atmosphère qui entourait le bel officier de cavalerie; mais l'illusion fut courte et le réveil prompt. Avec la même sincérité qu'elle avait révélé le secret de son amour, elle laissa voir son désenchantement. Le mari trouva mauvais de n'être plus aimé; il s'éloigna. Il était riche17; mais comme il le savait et n'avait aucun jugement, ce fut bientôt comme s'il ne l'était pas, et un jour il se trouva ruiné. Il avait des enfants; mais, avec un tel homme, les liens de famille étaient nuls. Il quitta la France et passa en Espagne, où il mourut dans la misère.
C'était une singulière personne que madame de Sainte-Amaranthe: tout en elle était étrange et difficile à expliquer. Un homme18 que je voyais journellement, et qui fut longtemps lié avec elle, m'en a si souvent parlé, que je la connais comme si moi-même j'avais fait partie de sa société intime. Cet homme racontait à ravir et peignait, surtout en parlant des gens qu'il voulait faire connaître, et les couleurs avec lesquelles il coloriait le portrait d'une femme autrefois bien-aimée avaient une teinte encore plus vive et plus naturelle.
Il est généralement reçu que madame de Sainte-Amaranthe était fort belle; ceux qui le disent ne la connaissaient pas. Elle était aussi bizarre au physique qu'au moral. Elle se levait avec un visage, une heure après elle en avait un autre: ce visage mobile, ou plutôt cette physionomie était aux ordres d'un sentiment ou d'un effet produit au hasard, ce qui rendait la chose encore plus surprenante. Sa tête était mauvaise et sans aucun raisonnement; mais son âme était noble et grande, son cœur excellent; et, à côté de mille défauts, il y avait en elle une foule de qualités qui les éclipsaient, pour ne montrer après tout qu'une femme qu'on pouvait peut-être blâmer, mais qu'il fallait aimer en même temps, et aimer avec dévouement.
Son esprit n'a jamais été constaté d'une façon positive, mais cela était indifférent; elle savait en faire trouver aux autres. C'est déjà un grand esprit que celui-là. Sa physionomie était vive, animée, flexible sous chaque impression qui la venait toucher. David, qui voulut la peindre plusieurs fois, ne put jamais y parvenir.
– Si je le pouvais en une heure! disait-il… mais l'heure d'ensuite ce n'est plus la même femme.
– Cela est si vrai, disait Sainte-Foix, que je l'ai vue quelquefois n'avoir que trente ans, vingt-cinq ans le matin, et le soir en avoir quarante. – Une telle mobilité ne se conçoit pas.
Après la mort de son mari, restant sans une fortune suffisante pour habiter Paris, elle écouta les vœux du prince de Conti. Ce fut ce qui la perdit dans le monde; l'éclat de cette liaison lui fit un tort qu'elle ne put ensuite réparer; et pourtant elle était bien plus estimable peut-être que beaucoup de femmes qui ne daignaient pas lui rendre son salut… Elle avait une fille qu'elle idolâtrait et qui était un ange de beauté et de bonté. Je ne sais si on connaît ce trait d'elle à l'âge de neuf ans: – Un pauvre ouvrier était sans ouvrage dans ce terrible hiver de 83 à 84, et mourait de froid et de faim dans un grenier, à côté de sa femme et de ses enfants. La petite Émilie apprend le fait. Sa mère était absente, et pour quelques jours l'avait confiée à une vieille parente avare qui n'aurait pas donné une obole, et l'enfant n'avait rien… Je me trompe…; elle avait un trésor, les plus beaux cheveux blond-cendré qu'on pût voir; elle l'avait entendu dire fort souvent. Elle fut chez un coiffeur, les lui vendit pour quelques écus, et fut aussitôt porter la joie dans la mansarde où la mort allait entrer sans elle… Ce trait peint à lui seul toute l'âme d'une femme. Une telle âme ne s'altère jamais.
Émilie était adorée de sa mère, et l'adorait aussi… C'était pour elle que, tout en sachant fort bien qu'elle était sa maîtresse et s'appartenait en propre, madame de Sainte-Amaranthe ne faisait usage de sa liberté que d'une manière convenable, à cause de sa fille. À la vérité, son salon était étrangement composé. On y voyait de toutes les classes de la société: diplomates, ecclésiastiques, militaires, noblesse d'épée, noblesse de robe… enfin son salon était une galerie où chacun passait, où beaucoup revenaient, parce qu'on s'y trouvait bien; et si le préjugé du monde, cette loi tyrannique, n'avait retenu beaucoup de femmes, elles y auraient été également. On jouait très-gros jeu chez madame de Sainte-Amaranthe: toutefois cette partie de l'amusement de sa maison qu'on a depuis blâmée avec tant d'acharnement, était alors une chose assez commune que la fortune et le nom pouvaient faire excuser19, mais qui était blâmée dans une femme qui n'avait ni l'une ni l'autre.
Quoi qu'il ait été dit de madame de Sainte-Amaranthe et de madame de Sartines, je crois qu'il faut revenir sur le jugement que le monde avait porté sur elles. Des femmes qui inspirent de l'amour, cela se voit chaque jour en France, et l'on voit aussi que cela ne dure pas. Mais des amitiés saintes et prolongées, qui survivent au temps et à l'absence, voilà ce qui fait l'éloge d'une âme de femme, et madame de Sainte-Amaranthe avait de ces amis-là.
Pour blâmer une femme avec rigueur, il faut bien connaître sa vie… l'origine de ses fautes… leur motif… Madame de Staël disait:
– Je pardonne, parce que je comprends.
Et c'était en vieillissant qu'elle disait cela; parce qu'en effet, en vieillissant, elle apprenait à connaître la valeur des jugements du monde, et surtout leur vérité.
Au moment où la Révolution commença, en 1789, la maison de madame de Sainte-Amaranthe avait reçu un nouvel ornement: c'était sa fille Émilie. La mère était charmante dans sa vivacité, son mouvement, et cette sorte d'inconstance même dans sa personne comme dans sa pensée; elle était attrayante et plaisait plus généralement que sa fille: mais Émilie plaisait plus fortement. Que de passions profondes cette jeune fille inspira aussitôt qu'elle parut dans le monde! Entourée d'une foule admiratrice, elle fut aimée comme on aime et adore les anges…! Simple, naturelle, pensive et mélancolique, elle ne paraissait pas aimer le monde comme sa mère l'aimait… Souvent elle restait dans la partie la plus solitaire du salon, pendant qu'à l'éclat de cent bougies, autour d'une table de jeu, sa mère perdait ou gagnait des sommes énormes, occupée à une douce conversation avec Gossec, le fameux musicien, ou David, ou quelque artiste en premier renom. Jamais un mot amer ne sortit de sa bouche, et, par son rare et doux sourire, on voyait qu'elle était loin de partager cette gaieté folle qui l'entourait et qui même souvent paraissait la fatiguer.
Un mot de Gossec sur la mère et la fille peut contribuer à en donner une idée assez juste: je le trouve spirituel.
– Lorsque je vois madame de Sainte-Amaranthe, disait-il à David et à Sainte-Foix, je me sens disposé à la gaîté, je composerais une gavotte…; mais quand j'aborde Émilie, quand je vois son sourire triste et doux, son regard voilé par de si longues paupières qui semble interroger un objet inconnu… alors je me sens tout saisi de respect… il me semble que j'entends un hymne religieux.
Il paraît, d'après ce que j'ai entendu dire à M. de Sainte-Foix, M. de Narbonne et surtout le comte de Tilly20, que rien ne pouvait être comparé au regard d'Émilie de Sainte-Amaranthe: c'était le ciel ouvert que ses yeux, lorsqu'ils s'arrêtaient sur vous, en y ajoutant une grâce charmante, une angélique douceur, des traits ravissants, une tournure et une taille de nymphe; on peut facilement croire qu'elle fût, en effet, bien aimée!..
Pour en revenir à la mère, qui était l'âme de son salon, c'était surtout le soir qu'elle était adorable, à son tour… Madame de Sainte-Amaranthe était éminemment la femme des heures nocturnes: tant que le jour éclairait Paris, elle dormait ou bien se tenait si bien enfermée qu'elle ne l'apercevait pas; ce n'était qu'au moment où les bougies s'allumaient qu'elle redevenait elle-même: alors sa tête se relevait, son regard, son sourire, s'animaient; elle était gaie, contente de vivre; sa parole montait ses esprits à elle-même en même temps qu'elle agitait les autres; M. de Champcenetz, qui allait chez elle fort souvent, l'avait nommée une machine à salon… Et la grande variété qu'elle laissait voir dans ses manières avait peut-être inspiré ce mot. Elle parlait à une femme qui entrait, disait adieu à une autre qui partait, donnait un coup d'œil gracieux à un homme tandis qu'à un autre elle envoyait un regard de mépris ou de colère, elle faisait une révérence à un duc et pair, adressait un signe à un peintre, et tout cela en même temps… C'était merveille de voir comme elle tenait le sceptre de souveraine dans son salon!.. Elle y maintenait un continuel mouvement; elle aimait qu'on y parlât, mais très-haut. Elle défendait strictement les conversations à voix basse; lorsque la conversation s'établissait ainsi à voix basse, rien n'était plaisant, me racontaient les amis qui étaient toujours chez elle, comme de la voir partir de sa bergère et courir dans tous les sens, parlant à tort et à travers à ceux qui causaient à voix basse, et transformant en un instant son salon en un lieu bruyant et animé: c'était comme une fusée qui mettait le feu à un bouquet d'artifice.