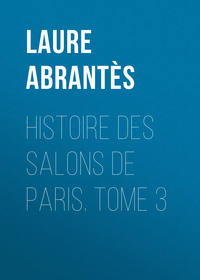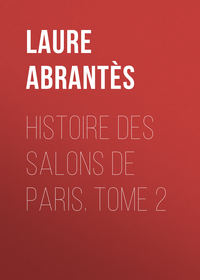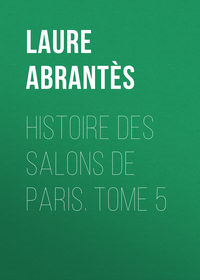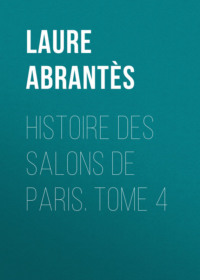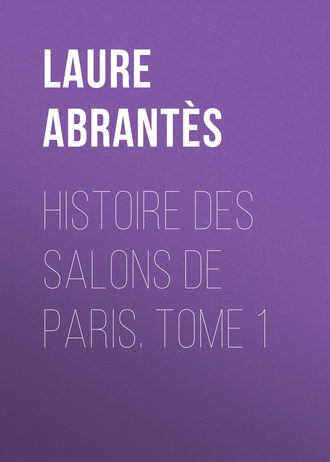
Полная версия
Histoire des salons de Paris. Tome 1
Ces deux partis étaient forts; mais celui dont l'opinion était contraire à celle de la Reine devait lui nuire grandement par la suite, quoique ce parti fût contre les idées philosophiques que le siècle accueillait. Voici la liste des principaux chefs de ces deux partis.
À la tête de celui des parlements exilés par Louis XV, étaient:
La Reine;
Le comte d'Artois;
Le duc d'Orléans;
Le duc de Chartres;
Le prince de Conti;
La majorité des pairs du royaume;
Le duc de Choiseul et sa faction;
Le comte de Maurepas;
La minorité du clergé janséniste et son parti;
Les évêques philosophes;
Une partie des gens de lettres.
Parti des parlements établis par M. de Maupeou.
Monsieur;
Les trois tantes de Louis XVI (madame Adélaïde, madame Victoire, et madame Louise, la religieuse carmélite);
Le duc de Penthièvre;
Le chancelier de France;
La minorité des pairs, spécialement le maréchal de Richelieu et le duc d'Aiguillon;
Tout le reste de l'ancien ministère de Louis XV, et ce qui tenait à lui et au Dauphin, père de Louis XVI;
La majorité du clergé, ayant à sa tête Christophe de Beaumont, archevêque de Paris;
Les jésuites et leur parti;
Les dévotes de la Cour, ayant à leur tête madame de Marsan.
C'était alors qu'il aurait fallu un homme à forte tête comme Napoléon. Ce système de fusion qu'il regardait, justement, comme seul susceptible de sauver la France, c'était dans cette circonstance qu'il le fallait établir; il fallait des deux parlements n'en faire qu'un: car il était évident qu'une dispute entre ces deux corps, voulant ressaisir et conserver le pouvoir, devait amener une catastrophe. Qu'on approfondisse les causes des combats que se livrèrent ces deux partis: c'était la liberté naissante se heurtant contre le despotisme; la religion contre la philosophie; l'autorité absolue contre l'autorité tempérée; mais il n'est pas donné à tous les esprits de comprendre et de connaître le prix des amalgames politiques. Une telle mesure effraie, et souvent elle aurait tout sauvé.
Si l'exemple était jamais de quelque utilité, on pourrait, en regardant autour de soi, juger de la vérité de la bonté du système de fusion, surtout après de longs malheurs dans une nation… lorsqu'elle a été frappée tour à tour et du glaive et du feu par tous les partis: alors elle en arrive d'elle-même à cette fusion nécessaire.
Voyez la Suisse: le résultat de sa guerre de liberté fut de lui donner tous les gouvernements; sa paix intérieure fut la conséquence de cette fusion.
Voyez l'Amérique: après sa lutte avec la mère patrie pour jouir du repos, elle créa un gouvernement mixte, qui tient de l'aristocratie, de la démocratie, et tout à la fois de la royauté et de la république.
Voyez l'Angleterre:… que de querelles ont précédé son système de grande fusion!.. Tour à tour gouvernée par des tyrans, de grands chefs, saccagée, pillée, épuisée par tous ces partis, le corps de la nation réunit ses enfants, et tout fut d'accord: c'est à cette transaction peut-être que l'Angleterre doit sa gloire.
Voyez la France elle-même; voyez Henri IV:… après avoir hésité… il appela dans son conseil des ligueurs et des royalistes, des huguenots et des catholiques; il donna l'édit de Nantes… Que fit Louis XIV en le révoquant?.. Mais à l'époque dont je parle ici, c'est-à-dire dans la première période du règne de Louis XVI, la fusion n'était peut-être possible que pour un homme plus fort que lui. Il fallait donc subir toutes les funestes conséquences du choc journalier de deux partis dont les combattants se trouvaient souvent dans l'intimité l'un de l'autre, quelquefois de la même famille!.. Cette querelle entre les deux partis jette un grand jour sur l'opposition qu'on voyait exister entre la Reine et ses tantes, ainsi que plusieurs autres personnes de la famille royale, et explique, quant à elle, l'inimitié qu'elle portait aux Maurepas et aux Vergennes… qui déjà lui étaient odieux comme ayant cherché à s'opposer à son mariage.
Quant aux conséquences funestes pour la Reine, les voici.
M. de Maupeou, qui était à la tête du parti contraire aux parlements exilés, comprit tout ce qu'il avait à craindre d'une association entre le frère du Roi et les premiers princes du sang: il fit aussitôt jouer une contre-mine. Ses moyens furent infâmes, mais efficaces: il fit circuler dans le monde que les rapports de la Reine avec le duc de Chartres n'étaient pas innocents… et cette infernale calomnie s'étendit jusqu'au comte d'Artois… Ce moyen tenté pour la détacher des deux princes ne servit qu'à la priver de la considération de la France!..
C'était donc avec la haine au cœur et le ressentiment des injures, que ces deux partis vivaient l'un près de l'autre et se voyaient chaque jour. Qu'on juge de l'effet de cette guerre sourde et intestine dans un pays où la société n'avait d'autre lieu de réunion que les salons de cinquante ou soixante maisons qui alors recevaient. Toutefois, on ne s'apercevait jamais d'aucune mésintelligence; le bon goût, les excellentes manières, dominaient encore, et pour longtemps du moins il y avait sécurité pour l'apparence. Par degrés tout s'est effacé; on s'est accoutumé à se dire en face des choses pénibles, et les disputes ont remplacé l'urbanité et la douceur des relations, et surtout cette douce paix, condition la plus positive pour que la vie habituelle puisse être heureuse et légère à porter!
Madame la marquise de Coigny, jeune et charmante femme un peu maligne, riche, ayant tout ce qui plaît et place convenablement dans notre société française, un beau nom, de la fortune et cette beauté sinon régulière, au moins de celle qui plaît, et chez nous cela suffit pour mettre à la mode (c'était le genre de célébrité alors de plusieurs femmes); madame de Sillery9, madame de Simiane, madame de Condorcet, une foule de personnes jeunes, jolies, spirituelles, virent alors le moment de faire revivre ce temps de la Fronde où Anne de Gonzague, madame de Longueville et mesdames de Chevreuse dirigeaient d'un coup d'œil et d'un signe de main les opérations les plus importantes. Madame de Polignac, à la tête de la faction dont la Reine était la protectrice, et soutenue de sa faveur, avait de son côté son salon, qui était le rendez-vous des personnes dévouées à la cause de la Cour et spécialement à la Reine. Ce salon, dans lequel on soupait tous les soirs et que la Reine présidait elle-même, était le rival de celui de madame de Coigny, qui chaque jour était plus à la mode et plus aimée de tout ce que la Cour avait de plus jeune et de plus spirituel, comme M. de Narbonne, MM. de Lameth, l'abbé de Montesquiou, l'abbé de Périgord, et une foule d'hommes et de femmes dont l'esprit et la grâce toute française faisaient de son salon un lieu charmant de causerie, car on tenait encore à l'urbanité des manières et à la grâce du langage10.
J'ai donc commencé ma galerie de la Cour par celui de madame Necker, celui de madame Rolland, et par les deux oppositions si tranchées de madame de Coigny et de madame la duchesse de Polignac. J'ajoute celui de M. de Juigné, parce que l'opposition religieuse fut d'un grand secours à ceux qui mirent le trouble en France, avant que les affaires ne fussent en état de recevoir le changement nécessaire qu'elles devaient éprouver.
Les querelles de M. Necker avec M. Turgot et M. de Calonne furent encore un motif de disputes et de conversations animées. Le parti de M. Necker, défendu par M. de Maurepas, avait surtout dans l'origine un homme plus intelligent peut-être qu'habile, mais habile dans son intrigue et parfaitement secondé par les conseils de sa sœur, ce qui, à une époque où les femmes avaient un crédit et un empire qui leur donnaient encore une sorte de puissance apparente, si elle n'existait pas au fond, était d'une assez grande importance. Madame de Cassini, jadis maîtresse de M. de Maillebois, directeur de la Guerre, et militaire assez distingué, madame de Cassini, dont Louis XV avait rejeté le nom comme intrigante lorsqu'elle avait demandé à être présentée à la Cour, était sœur du marquis de Pezay, dont le nom est presque inconnu à beaucoup de gens aujourd'hui, et qui pourtant fut d'une haute importance dans nos affaires politiques, puisqu'il est positif que ce fut lui qui nous donna M. Necker. Ceci doit être rapporté maintenant pour donner une idée des premières années du règne de Louis XVI, dont je ne parlerai avec détail qu'à la seconde époque de mes Salons.
Louis XVI était le plus honnête homme de sa cour; depuis sa première jeunesse il aimait à s'isoler ou bien à demeurer seul avec la Reine… Il n'aimait pas le monde, il s'en éloignait même, et lorsqu'il devint roi, il aurait cependant voulu parler à chaque personne qu'il rencontrait, mais sans en être connu, pour savoir d'elle l'opinion de chacun sur son règne et prendre son avis. Lorsque Louis XVI monta sur le trône, on afficha sur la statue de Henri IV: Resurrexit! «Quelle belle parole!» dit-il, les yeux pleins de larmes…
Ce désir de s'instruire dans un roi ne peut être que bon, mais cependant il doit avoir des limites. Les avis ne sont pas toujours donnés par une bouche amie, et souvent la haine est le premier motif de l'empressement de ceux qui avertissent, afin de mettre le trouble dans l'âme au lieu de donner la paix.
C'était dans le but de s'instruire et de tout connaître que Louis XVI lisait les journaux étrangers. Il savait parfaitement l'anglais, qu'il avait appris pour lire les journaux écrits dans cette langue, s'étant aperçu qu'on lui faisait une traduction infidèle pour lui dérober une partie des injures qu'écrivaient alors les journalistes anglais sous la direction de M. Pitt; car à cette époque le fameux traité de commerce11 de M. de Vergennes n'était pas encore fait, et M. Pitt ne croyait pas encore autant à notre tendre et constante amitié. Louis XVI voulait régner par lui-même… Ses intentions étaient admirables enfin!.. Que n'avaient-elles plus de force!
Un ami de Dorat, nommé Masson, jeune homme ayant de l'esprit et même au-dessus de la médiocrité des vers qu'il faisait, ce qui me fait croire que les vers étaient en entier de Dorat, tandis qu'on l'accusait de les faire retoucher par lui… ce jeune homme avait une sœur parfaitement belle, appelée madame de Cassini… Elle était belle, galante, spirituelle; elle crut que sa présentation à la Cour de Louis XV ne souffrirait pas de difficultés: elle se trompa… Le Roi répondit, en prenant sur la cheminée de madame Dubarry, chez laquelle il était alors, un crayon pour biffer le nom de madame de Cassini, en écrivant de sa main:
«Il n'y a ici que trop d'intrigantes; madame de Cassini ne sera pas présentée.»
Elle avait été la maîtresse de M. de Maillebois; elle sut le garder pour ami… Elle avait un frère qui était ce Masson, ami de Dorat, qui un jour prit le titre de marquis de Pezay12. Il avait une jolie figure, de bonnes manières qu'il avait prises dans la société de sa sœur, qui, en hommes, voyait ce qu'il y avait de mieux à la Cour; il avait de l'ambition et ne possédait rien. Il y avait bien dans sa vie des circonstances qui pouvaient être par lui mises en œuvre, et le mener à un état heureux: mais son ambition voulait un grand pouvoir; il le rêvait et finit par l'obtenir, chose qui fut longtemps ignorée… Il composait des vers, des héroïdes, des madrigaux, tout cela fort pâle, fort tiède… et pour peu que Dorat se mêlât de corriger, je demande ce que devenait le peu de feu sacré que l'homme ambitieux avait prêté à celui qui voulait être poëte; car l'ambition est un sentiment hardi pour lequel il faut que l'homme sente ses facultés et les mette en activité… L'âme de l'ambitieux ne peut être froide.
Les soirées helvétiques ou helvétiennes furent beaucoup vantées dans la société de madame de Cassini et dans celle d'un ami de M. de Pezay, le résident de Genève, un homme qui depuis devait être fameux, monsieur Necker… Mais la réputation de M. de Pezay ne dépassait pas alors ce cercle assez borné, attendu que les hommes de finance n'étaient connus dans la haute classe que par leurs alliances avec la noblesse… mais ceux qui étaient étrangers à notre patrie comme à nos coutumes nous étaient complètement inconnus… M. Necker de Genève n'était pas tout-à-fait dans ce cas; mais il vivait dans son hôtel assez solitairement, possédant une grande fortune qu'il avait gagnée dans ses spéculations de la compagnie des Indes, et nourrissant une grande ambition qu'il voulait au reste appliquer au bien public… Son caractère était honorable, et rien n'a pu le noircir même à une époque où la plus basse flatterie faisait incliner la tête devant Napoléon, qui avait pris M. Necker dans la plus belle des aversions, sans trop savoir pourquoi, ou plutôt parce que M. Necker réclamait deux millions qu'on lui avait PRIS, c'est le mot.
M. de Pezay avait aussi son ambition: à cette époque, les économistes, les encyclopédistes, avaient un peu tourné les meilleures têtes… d'où il suivait que les médiocres n'allaient guère droit leur chemin. M. de Pezay, n'étant connu de personne, voulut se faire connaître en innovant… Il écrivit à Frédéric, à Catherine II, à Joseph II, à tous les rois de l'Europe… Mais il n'eut aucune bonne chance; Frédéric prit de l'humeur même, et lui répondit:
«Il sied bien à une jeune barbe comme vous de donner des leçons à un vieux roi.»
Frédéric aurait pu ajouter comme moi, car il y avait à cette époque, en Europe, de vieux rois qui auraient pu recevoir des leçons d'un enfant.
M. le marquis de Pezay, repoussé dans ses attaques sur la royauté étrangère, jeta ses filets sur la nôtre… Il aurait bien commencé par elle, mais une circonstance que je dirai tout à l'heure s'y opposait; il voulut enfin dominer son étoile, et voici ce qu'il fit.
Un garçon des petits appartements, nommé Louvain, fut gagné à prix d'or pour déposer une lettre, à l'adresse du Roi, dans l'endroit le plus apparent d'une chambre où le Roi s'occupait ordinairement de ces sortes de lectures.
Cette lettre, écrite d'un fort beau caractère, était de nature à attirer, par cette seule raison, l'attention du Roi… Il écrivait admirablement, et aimait à trouver dans les autres ce qu'il possédait aussi… Mais la lettre elle-même pouvait être considérée par son contenu comme susceptible d'attirer l'attention spéciale du Roi.
Dans cette lettre, qui n'était point signée, on proposait au Roi (alors fort jeune) une correspondance mystérieuse et tout à son avantage; on lui donnerait, disait-on, des détails précieux sur l'esprit public, sur ce qu'on pensait de son administration, enfin sur tout ce qui pouvait stimuler la curiosité et surtout l'intérêt du Roi… Il fut au comble… Louis XVI, enchanté du ton de la lettre, conçut l'espoir d'avoir dans son auteur un véritable ami qui, au milieu de la corruption de cette cour, l'objet de son éloignement et presque de son aversion, serait pour lui un ange sauveur!.. Il relut cette lettre… C'était, lui disait-on, comme le spécimen du reste de la correspondance… Elle contenait des détails sur l'Angleterre, sur l'intérieur de plusieurs familles françaises, depuis la roture jusqu'au prince et au duc et pair… Louis XVI fut ravi et espéra un second numéro, il ne se trompait pas… Le surlendemain, qui était un samedi, le Roi trouva une seconde lettre mieux faite que la première et plus intime dans ses détails. L'auteur disait cette fois qu'il était homme de naissance, qu'il connaissait les Anglais les plus riches et les plus renommés par leur position sociale, qu'il voyait également les personnes les plus remarquables de Paris et de Versailles, qu'il était agréable aux femmes les plus recherchées et les plus à la mode… Il concluait en disant au Roi qu'il l'aimait comme son souverain et puis comme l'homme le plus parfait de sa cour… Il assurait ne vouloir rien pour lui… Il communiquerait ses observations au Roi, et lui n'aurait que le bonheur de se trouver en relation avec le meilleur et le plus digne des maîtres. Tous les samedis comme ce même jour, il ferait parvenir au Roi un numéro de sa correspondance… Si cet arrangement convenait au Roi, l'auteur de la lettre le suppliait humblement de tenir son mouchoir à la main d'une manière qui le lui fît distinguer, pendant le moment de l'élévation, le lendemain à la messe, et de le quitter après l'élévation du calice, pour témoignage que l'auteur de la lettre ne déplairait pas en continuant sa correspondance. Il finissait en assurant Louis XVI qu'il lui donnerait des détails positifs et intimes sur les princes contemporains, les grands du royaume, les parlements, les ministres, les évêques des deux partis, les intendants, les gens de lettres; enfin il assurait au Roi qu'il le ferait assister, comme dans une loge grillée, aux sociétés les plus recherchées de Paris, dont il lui importait surtout de connaître, à cette époque, l'esprit et les sentiments intimes. C'était enfin un ministre de plus qu'avait le Roi, un lieutenant de police, un M. de Sartines, et sans qu'il lui en coûtât rien.
On pense bien que le mouchoir fut tenu à la main et déposé suivant la recommandation faite. Louis XVI était jeune; et bien que rien ne fût moins romanesque que lui, il aimait cet ami mystérieux qui ne donnait qu'à lui seul des communications qui devaient produire un effet d'autant plus étonnant que le Roi paraissait n'avoir aucune connaissance intime. Aussi le conseil fut bien surpris lorsque le Roi annonça des nouvelles qui, au fait, étaient inconnues, même au ministre dont le département était intéressé à les savoir, et qui se trouvèrent exactes.
Bientôt cette correspondance devint si intéressante, que le Roi voulut en connaître l'auteur. Il dit à M. de Sartines de le découvrir, et le lui ordonna comme voulant être obéi.
Le soupçon tomba d'abord sur beaucoup de personnes, qui nièrent à la première enquête, mais qui, voyant que c'était pour une aussi importante raison, eurent l'air de laisser croire qu'elles étaient en effet auteurs de la correspondance; mais les agents de M. de Sartines découvraient bientôt la fausseté de la chose, et on recherchait de nouveau… Cependant la police était trop habilement faite pour ne pas découvrir un homme qui, d'ailleurs, se lassait de l'incognito, et voulait enfin jouir de sa faveur, car il voyait qu'elle n'était plus douteuse: il se laissa donc trouver, et le Roi sut enfin que son correspondant était un homme qu'il pouvait avouer au moins, ce que son mystère prolongé lui faisait mettre en doute.
Le marquis de Pezay, une fois dévoilé, conçut les plus hautes espérances!.. Il avait surtout l'ambition de composer le ministère du Roi et d'y placer M. Necker. Ce qui est certain et en même temps fort curieux, c'est que jamais il n'y songea pour lui-même. Pourquoi cela? C'est une particularité assez remarquable. Quant à M. Necker, c'est ainsi qu'on préluda à son élévation par cette correspondance, qui dura plusieurs années… M. de Pezay ignorait que M. de Vergennes lui en opposait une autre écrite également pour le roi lui seul… Mais elle était, m'a-t-on dit, plus sérieuse, et par cette raison devait moins plaire au Roi. Enfin, le marquis de Pezay reçut du Roi l'affirmation que sa correspondance lui était agréable et l'ordre de la continuer. Alors il voulut établir son crédit, et demanda au Roi de daigner s'arrêter un dimanche, en revenant de la chapelle, devant une travée qu'il désigna et où il devait se trouver. Curieux de connaître enfin son correspondant mystérieux, qui depuis deux ans lui était inconnu, le Roi s'arrêta plusieurs minutes pour causer avec lui, au grand étonnement de toute la cour; mais il redoubla lorsque le Roi, charmé de la bonne tournure, de l'élocution facile, du ton parfait de M. de Pezay, lui ordonna de le suivre dans son cabinet… Là, il causa de confiance avec lui pendant une heure. Au bout de ce temps, il lui dit: «Il faut que je vous fasse connaître à un homme qui lui-même sera ravi de vous voir. Passez un moment derrière ce paravent.» Le marquis obéit, et le Roi fit appeler M. de Maurepas13, qui, alors vieux et presque toujours malade, ne venait que pour satisfaire son ambition en ce qu'il paraissait conserver par là une ombre de grand pouvoir.
«Mon vieil ami, lui dit Louis XVI lorsqu'il entra dans son cabinet, je vais vous présenter l'auteur de ma correspondance mystérieuse.
– Que votre majesté n'a jamais voulu me montrer, grommela le vieux ministre d'un ton grondeur.
– Je ne le pouvais, j'avais engagé ma parole, et vous savez qu'elle est sacrée. Mais je vais vous faire faire connaissance avec l'auteur.»
Et prenant M. de Pezay par la main, il le présenta gracieusement à M. de Maurepas.
«Ah! mon Dieu!» s'écria celui-ci, stupéfait à la vue de M. de Pezay.
Le marquis s'inclina profondément, bien que sa main fût toujours dans celle du Roi.
«Votre majesté me pardonnera de rendre un hommage de respect aussi profond en sa présence à un autre qu'à elle-même. Mais M. de Maurepas est mon parrain.
– Votre parrain! s'écria le Roi à son tour dans un extrême étonnement.
– Son parrain,» répéta M. de Maurepas d'un air si accablé que M. de Pezay et le Roi ne purent retenir un sourire… C'était en effet une chose qui devait surprendre que cet homme, dont la finesse et l'esprit, les manières parfaites, lui donnent une grande ressemblance avec M. de Talleyrand, attrapé, joué par un jeune homme qu'il regardait comme trop enfant pour lui confier la rédaction14 d'un simple rapport. M. de Maurepas dissimula, mais la blessure avait été profonde; il se sentit d'autant plus humilié que M. de Pezay était poëte, et que lui aussi faisait des chansons. Cependant il trouva des sourires et caressa même beaucoup M. de Pezay devant le Roi. Mais lorsque le filleul fut en route avec le parrain pour le remettre chez lui, il s'arrêta tout-à-coup, et regardant le jeune homme ambitieux et favori avec toute la haine impuissante du vieillard ambitieux sans pouvoir, il lui dit: «Vous êtes en relation avec le Roi! vous! vous!»
Et il joignait les mains en regardant au ciel comme s'il avait cru à quelque chose!
M. de Pezay, en prenant le parti qu'il suivait si obstinément depuis deux ans, s'était attendu à l'éclaircissement qui venait d'avoir lieu… et s'y était préparé… Aussi eut-il bientôt ramené à lui M. de Maurepas. Il avait une grâce extrême, de la cajolerie même dans les manières, et ce qui nous paraîtrait aujourd'hui ridicule, et même absurde à n'être pas admis, n'était alors qu'un excès de politesse recherchée, trop affectée peut-être et révélant la province; mais après tout l'inconvénient n'allait pas plus loin.
Ainsi donc, avant d'être au bout de la galerie, M. de Maurepas était ou paraissait apaisé, et le filleul avait persuadé au parrain que tout ce qu'il avait fait depuis deux ans n'était que pour lui-même, M. de Maurepas!.. Mais le vieux renard n'était pas facile à tromper, et une fois sur la voie il devait trouver la trace de la bête lancée. Aussi, quelque temps après, se trouvant chez lui au moment où M. de Pezay discutait un peu plus vivement qu'il n'avait coutume de le faire avec madame de Maurepas, il dit avec aigreur:
«Eh mais! voilà un jeune homme qui nous gouvernerait, ma femme et moi, si nous le lui permettions.»
C'est l'influence positive de M. de Pezay qui fit renvoyer du ministère des Finances l'abbé Terray. Ce fut surtout un compte rendu des conversations de Paris dans les salons les plus influents, qui détermina le Roi à en faire une éclatante justice. Louis XVI ne pouvait supporter patiemment que les actes de son règne fussent l'objet de l'attention aussi spéciale du monde appelé beau monde, non qu'il le blâmât, mais cela lui était pénible; et M. de Pezay, en lui racontant minutieusement toutes les conversations du monde élégant de Versailles et de Paris, l'intéressait davantage qu'en lui donnant d'autres relations.
Ce fut alors que M. le marquis de Pezay commença à recueillir les fruits de son travail. Il fit paraître un ouvrage immense dont la faveur et la protection royale pouvaient seules lui faciliter l'exécution. Il était très-intimement lié avec madame la princesse de Montbarrey, proche parente de M. de Maurepas. M. le prince de Montbarrey, alors au ministère de la Guerre, ouvrit ses portefeuilles, et M. de Pezay fit alors paraître un ouvrage qui est vraiment remarquable par la beauté des cartes et de l'atlas complet, avec le titre de Mémoires de Maillebois. Ce n'est, du reste, qu'une compilation et une traduction de plusieurs ouvrages italiens15, ce qui faisait qu'avant les campagnes d'Italie il pouvait servir, et même utilement; mais depuis ce moment je crois que nous avons fait mieux.