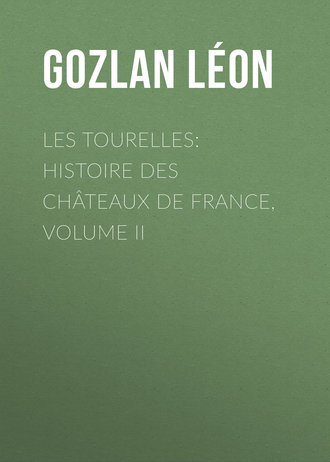
Полная версия
Les Tourelles: Histoire des châteaux de France, volume II
Les vers du prologue de Pélisson passaient pour fort beaux.
– Ah! vous avez fini, monsieur de Pélisson; je vous fais mon compliment. C’est bien! très-bien! J’avais un neveu qui s’amusait aussi à ces bêtises-là; il a réussi. Je l’ai employé aux gabelles.
Gourville se baissa pour ne pas rire, affectant d’arranger les boucles de sa chaussure. Gourville ne faisait pas de vers.
Colbert ne remarqua pas le dépit de Pélisson, qui, oubliant son rôle dans cette comédie, rougit, pâlit, fut sur le point de trahir la ruse et de dire: «Croyez-vous donc, monsieur de Colbert, qu’on vous demande votre avis? Il fallait feindre et vous prendre pour un homme de goût. On ne s’attendait pas à réussir.» Le conjuré l’emporta cependant sur le poète; Pélisson se tut.
Colbert continuait à Fouquet: – Il n’est bruit, monsieur, que de votre retraite du parlement. Au dire de beaucoup, votre charge de procureur-général serait déjà vendue, ce qu’attend le roi pour vous conférer ses Ordres.
– La grâce du roi, répondait Fouquet, n’est pas chose tellement sûre, si je ne dois espérer qu’en mon mérite, que mes intérêts me fassent une nécessité de vendre ma charge. Plus je mettrai de délai à m’en défaire, plus je montrerai à mon maître que je ne vaux que par lui.
– Vous vous jugez trop sévèrement, monsieur de Belle-Isle; et puisque le roi vous laisse espérer cette faveur, c’est qu’il vous en croit digne.
– Je vous remercie de cette manière de voir, monsieur de Colbert; je n’en oublierai pas le témoignage.
Colbert salua et gagna le château.
– S’il n’est fatal, le rapprochement est du moins singulier. Avez-vous remarqué, Gourville, Pélisson? M. de Séguier me demande si j’ai vendu ma charge de procureur-général, M. de Colbert est étonné de m’en trouver encore revêtu. Est-ce du hasard? Le procureur-général les importune donc bien? Mais vous en étiez, Gourville, au moment du feu et de l’enlèvement. Et après que nous serons partis, que se passera-t-il ici?
– L’histoire nous l’apprendra.
– Mais enfin, lorsque le feu sera consumé, qu’on cherchera le… qu’on le cherchera pour partir…
– Alors jaillira le bouquet, détonation terrible qui renversera dans les fossés toutes les voitures de la cour placées au bord. Torelli l’artificier en est sûr. C’est un événement nouveau à travers mille événemens: c’est une heure pour eux, trois lieues pour nous. Au jour ils seront encore ici.
– Mais après?
– Ah! monseigneur, en conspiration, après n’existe pas; on est ou l’on n’est plus!
– Vous avez dit le mot, Gourville, c’est une conspiration, et contre qui? Je frémirais à cette seule pensée, si ma conscience ne me criait que c’est là le seul moyen de convaincre le roi, qui, une fois dans nos mains et dans ma place de Belle-Isle, signera, au nom de l’intérêt de la France plus encore que par la violence de sa captivité, car elle lui sera douce, le renvoi de M. de Colbert, cette affreuse couleuvre, et celui de M. Le Tellier. Avec eux tomberont leurs créatures. Écrasez l’araignée, la toile s’envole au vent. M. de Colbert est mon araignée qui tend sa toile partout où je suis. Depuis Mazarin, il m’enveloppe, m'étouffe; il me tuera si je ne l'écrase. Puissant comme toutes les résistances; hardi, parce qu’il n’a rien à perdre; influent auprès du prince, qui finira par être persuadé que ma chute sera un heureux prétexte pour ne payer aucune dette, car je serai la cause de toutes, si je tombe; chef de parti, ayant su rallier toutes les haines contre ce qu’on appelle ma prodigalité; appuyé des femmes, de celles dont je n’ai pas courtisé la vieillesse ou la laideur; Colbert, laid, triste, avare, obscur, sordide, triompherait de moi! Lui renversé, je n’ai plus que des amis.
En tenant le roi captif, je ne fais, après tout, avec des intentions plus pures que ce qu’exécutèrent, sous la minorité, le cardinal de Retz, Turenne, un prince du sang, le parlement, la France entière, contre Mazarin, la reine et le roi lui-même. Et je n’appelle pas l'étranger! – Voilà de quoi m’absoudre.
Les trois amis se tenaient par la main, et confondaient dans un serment muet le vœu d'être fidèles à leur conjuration.
S'échappant tout-à-coup d’entre Gourville et Pélisson, émus jusqu’aux larmes d’une scène où s'était décidée leur vie, ainsi que l'événement ne le prouva que trop, Fouquet alla galamment offrir son bras à une dame qui accourait vers lui, et se perdit avec elle, en riant aux éclats, dans une contre-allée.
Les deux secrétaires du surintendant, quoique habitués à sa légèreté, se regardèrent stupéfaits. Pélisson ne put s’empêcher de murmurer: C’est trop à la fois, Brutus et Bellegarde!
Ils savaient quelle était cette dame admise dans la plus équivoque familiarité du surintendant.
Fouquet était un sultan. Il était entouré de messagères d’amour, aux mains prodigues de sa fortune, à la bouche éloquente pour lui, qui lui épargnaient la timidité de l’aveu et le dépit du refus.
On publiait, à la gloire de madame de Bellière, dans le monde de la cour, que, sous les enseignes du surintendant, elle n’avait eu que des triomphes et pas une défaite. C'était un bonheur sans exemple. Était-il arrivé à son terme? voilà ce qu’on se demandait depuis que Fouquet avait chargé madame Duplessis-Bellière d’une expédition amoureuse de la plus rare difficulté; c'était la Toison-d’Or à obtenir! Les humbles assistaient à cette audacieuse entreprise comme des bourgeois à une course de chevaux. Que ceci est beau! disaient-ils, et tout bas: Oui, c’est beau! mais quelqu’un se cassera le cou.
C'était pour savoir s’il avait conquis quelques avantages sur le cœur vierge d’une demoiselle d’honneur de Madame que le surintendant s'était caché avec madame de Bellière sous les charmilles, oubliant, comme s’ils n’eussent jamais existé, Pélisson et Gourville. Ce n’est pas qu’il y eût à craindre qu’il dévoilât la conspiration: il n’y pensait plus.
Quand l’heureux Fouquet et sa confidente descendirent vers le château, la joie de leurs visages eût fait pâlir de jalousie celui de Saint-Aignan, ce maître passé dans la carrière officieuse qu’il suivait concurremment avec madame de Bellière.
– Elle viendra donc, disait Fouquet, elle vous l’a promis; mais vous ferez mon bonheur, madame!
– N’oubliez pas, vicomte, que j’ai déjà fait votre bonheur trois cent dix-huit fois.
– Vous tenez donc compte?
– Pourquoi pas? Ce sont mes états de service. M. de Saint-Aignan vient d'être nommé gouverneur.
VAvant l’heure du dîner, Fouquet proposa une promenade aux parterres.
On sortit par la façade opposée à la cour d’honneur.
Les trois grilles de la rotonde s’ouvrirent pour laisser écouler par le pont-levis la cour et la foule de dames et de seigneurs qui la suivait.
A la porte du milieu parurent le roi et madame Henriette d’Angleterre, à qui l'étiquette indiquait cette place en l’absence de la jeune reine, restée à Fontainebleau à cause de sa grossesse; à la porte de droite se présenta Anne d’Autriche, accompagnée de son fils, Monsieur; à la porte de gauche, le prince de Condé et mademoiselle d’Orléans ouvrirent la marche des princes et des pairs.
«On découvre de ce perron, écrivait il y a plus de cent cinquante ans mademoiselle de Scudéry dans sa Clélie, une si grande étendue de différens parterres, tant de fontaines jaillissantes, et tant de beaux objets qui se confondent par leur éloignement, qu’on ne sait presque ce que l’on voit. On a devant soi de grands parterres avec des fontaines, et un rond d’eau au milieu; et à la droite et à la gauche, dans les carrés les plus proches, trois fontaines de chaque côté, qui, par des artifices d’eau divertissent agréablement les yeux.»
Parmi les parterres, celui qu’on nommait le Parterre des fleurs était une œuvre de jardinier et de peintre, de Le Nôtre et de Lebrun. Celui-ci avait tracé le dessin, celui-là l’avait réalisé avec des fleurs. Ils avaient opéré comme les brodeurs orientaux sur les habits de satin: ils avaient brodé la terre. Au lieu de soie rouge, bleue et jaune, ils avaient nuancé des tulipes, des roses et des boutons d’or en guise de soie; et avec mille roses plantées l’une à côté de l’autre, et dont chacune n’avait dans l’ensemble que la valeur d’une feuille, ils en produisaient une mille fois plus grande qu’une rose ordinaire. Cette rose ou toute autre fleur entrait dans l’arabesque d’un carré du parterre pour participer à l’ordonnance d’un bouquet gigantesque. De près c'était un parterre, de loin une broderie; de près un jardin, de loin un pastel: de près on désirait se promener à travers ce champ, ce parterre; de loin on aurait désiré y voir une sultane demi-nue et assise: c'était un tapis.
Venaient ensuite les Saint-Aignan, les Dangeau, les d’Aubusson, les Beauveau, les Lafeuillade, les Langeron, les Créqui, les Tavannes, les Saint-Pol, les Larochefoucauld et les Bouillon, grands noms en faveur auprès du roi et de la reine. Réunis dans la salle des gardes, ils défilèrent en ordre, et, se répandant avec plus de liberté, ils se dirigèrent vers l’espace occupé par les parterres et les pièces d’eau, alors tranquilles, chaudes et empourprées des derniers rayons du jour.
Les pièces d’eau du château étaient nombreuses et belles; leur dessin et leur symétrie excitaient si haut l’admiration qu’elles servirent de modèles à celles de Versailles et de Saint-Cloud. Elles furent, à quelques fausses tentatives près, les premières qu’on vit en France, transportées des villas d’Italie. Fouquet eut la ruineuse gloire de devancer le roi dans l’art merveilleux d’attirer les eaux de cinq lieues à la ronde pour les verser dans des réservoirs de marbre après les avoir laminées et tordues dans des tuyaux de plomb dont les vestiges effraient encore. Arrachés à la terre, cent ans après, par le fils du second possesseur du château, le duc de Villars, et vendus à la livre, ces tuyaux furent payés 480,000 fr.
Ces eaux sont une histoire.
Trois villages furent démolis et rasés, et sur leur emplacement la bêche creusa des bassins qui sont des mers: lacs asphaltites aujourd’hui. La vapeur les étouffe, et le roseau les cache. On dirait que la malédiction du ciel a troublé ces eaux et les a empoisonnées. Qui dort auprès de ces eaux meurt. Tous ces dieux impies de marbre et d’airain, qui respiraient par des poumons de plomb et vomissaient les rivières qu’ils avaient bues, sont restés en place. Mais au printemps les oiseaux déposent leurs nids au fond de la conque muette des tritons; les cascades pétrifiées n'épanchent plus que du lierre; l’eau a verdi en herbe, l’herbe a monté: on fauche ces mers.
Alors le soleil descendait et illuminait en écharpe ces eaux prodigieuses et fières.
Guidée par le roi et la reine-mère, une population d'élite s'étale sur les gradins cintrés qui vont du château aux parterres: des figures belles et sereines, sœurs de têtes royales, se déroulent avec lenteur dans un arc indéfini, s’avancent au milieu de l’air tiède et violet qui les encadre. A ces chairs reposées et blanches, à ces robes de soie émues par des mouvemens amoureux et chastes, à tant de solennité au milieu de tant de jeunesse, on dirait une fête de Zénobie à Palmyre, si jamais Palmyre eut de telles fêtes.
Toute la monarchie de Louis XIV, mais la jeune monarchie, est là.
La Fronde, à qui l’on a pardonné, la Fronde est venue en petit manteau de satin, laissant flotter au vent des pas ses dentelles brodées, ses rubans de moire, ses nœuds de soie. Des plumes blanches s’inclinent sur le chapeau rabattu des héros du faubourg Saint-Antoine: leur chapeau est penché sur l’oreille, et leurs têtes, encore toutes railleuses de dédain pour monsieur le cardinal, suivent l’inclinaison des plumes et du chapeau; leurs moustaches partagent cette inflexible obliquité. Leur cœur s’est rallié au roi; leur chapeau pas.
Si la pente devient rapide, les cavaliers abandonnent le bras de leurs dames, qui, pour assurer leur marche, appuient leurs mains gantées, un peu au-dessous d’elles, sur des épaules officieuses.
Ainsi, à perte de vue, à droite, à gauche, au fond, ce sont des groupes en cascades, penchés l’un sur l’autre dans la plus harmonieuse dégradation. Des sourires montent vers des visages gracieux à mesure que des pieds descendent, et si parfois un vent frais s'élève des pièces d’eau vers le sommet de cet amphithéâtre, toutes ces robes traînantes de femmes enveloppent dans une nuée de mousseline le groupe, tous les groupes, dames et cavaliers, et ce n’est plus alors que quelque chose d’indécis et d’ailé, insaisissables apparitions du crépuscule.
Le roi était vêtu fort simplement: il portait une veste de drap bleu à boutons d’or; l’Ordre passait au-dessus de tout; ses souliers étaient ornés de boucles d'émeraudes; une seule plume blanche flottait à son chapeau.
La fille de Charles Ier, Madame Henriette, cette femme dont la vie ou plutôt la mort a divinisé Bossuet, avait déjà, quoiqu'à peine âgée de dix-sept ans, cette empreinte de douleur si belle et si fatale au front des Stuarts. Henriette était frêle et blanche, d’une délicatesse extrême; son cou était celui de Marie Stuart, d’une transparence si pure qu’on eût pu voir à travers couler le poison du chevalier de Lorraine. Henriette était de ces femmes qui écoutent avec leurs yeux.
Tous ses mouvemens, sans qu’elle s’en aperçût, étaient comptés et renvoyés avec des interprétations à son époux, par sa belle-mère, Anne d’Autriche, qui, à chaque instant, se tournait pour épier l’arrivée de quelqu’un impatiemment attendu par elle. Cette préoccupation de la reine-mère cessa quand elle vit descendre M. de Saint-Aignan conduisant, avec une grâce parfaite, une femme jeune encore, peu connue à la cour: c'était une demoiselle d’honneur de Madame Henriette.
Les mémoires nous ont conservé la parure qu’avait choisie pour cette journée mademoiselle de la Vallière. Sa robe était blanche, étoilée et feuillée d’or, à point de Perse, arrêtée par une ceinture bleu tendre, nouée en touffe épanouie au-dessous du sein. Épars en cascades ondoyantes, sur son cou et ses épaules, ses cheveux blonds étaient mêlés de fleurs et de perles sans confusion. Deux grosses émeraudes rayonnaient à ses oreilles. Ses bras étaient nus; pour en rompre la coupe, trop frêle, ils étaient cernés au-dessus du coude d’un cercle d’or ciselé à jour; les jours étaient des opales. Un peu blanc-jaunes, comme il était riche alors de les porter, ses gants étaient en dentelle de Bruges, mais d’un travail si fin, que sa peau n’en paraissait que plus rose sous la transparence.
Pour s’apercevoir de l’inégalité de sa marche, il aurait fallu pouvoir détacher, – et qui en était capable? – le regard de son buste, le plus délicat qui ait jamais existé à la cour, et c’eût été sans profit pour l’envie, car cette imperfection d’un beau cygne blessé cessait de paraître quand mademoiselle de la Vallière appuyait ses pieds sur un tapis. Elle ne boitait qu’en marchand sur la pierre. Une fois duchesse, elle ne boita plus. Louis XIV le voulut ainsi.
Sa figure est trop connue pour essayer de la reproduire; ce fut celle de la Vénus chrétienne de la France. Ses yeux bleus de vierge martyre, aux paupières de soie, s’ouvraient peu au jour; et, bien qu’ils n’eussent encore réfléchi que des visages jeunes et beaux comme le sien, qu’ils n’eussent vu de bien près qu’un homme, Louis XIV; qu’une femme, si ce fut une femme, ou un ange, Madame Henriette d’Angleterre, ils étaient déjà chargés de cette infortune qui lui arracha tant de larmes aux Carmélites. Mademoiselle de la Vallière vint au monde pour pleurer: elle n’attendait que l’occasion d'être reine.
Elle avait le sourire fermé, quoiqu’elle eût la bouche grande; ceux qui l’aimaient l’aimaient ainsi: mais ses rivales, et Bussy, l'écho de toutes les jalousies, ont attribué à l’irrégularité de ses dents le soin qu’elle eut toute sa vie de ne jamais les montrer. A cette précaution, il faut rapporter sans doute la discrétion de ses paroles. Sa taille était petite, mais élégante et flexible. Elle resta toujours enfant; gracieuse enfant qui aima trop tôt pour vivre. Singulier reproche! et que ne mérita jamais madame de Montespan: on reprocha à mademoiselle de la Vallière d'être complètement privée de formes: comme si les charmes d’une femme étaient ailleurs que dans l’opinion de celui qui l’aime! Et combien ne faut-il pas être plus difficilement belle, ainsi que le fut mademoiselle de la Vallière, pour se faire aimer par des causes qui ne s’altèrent jamais, dût la petite-vérole dans son vol gâter un noble visage! mademoiselle de la Vallière était marquée de petite-vérole.
Elle aima! Quel plus bel éloge peut-on écrire du cœur d’une femme qui s’attacha, non au fils d’Anne d’Autriche, mais à Louis-Dieudonné; non à Louis XIV, vainqueur du Rhin et de la Meuse, mais au jeune homme, tremblant sous la tutelle de sa mère, n’osant demander mille pistoles à son surintendant, humble devant son confesseur; non au roi, chargé de lauriers et de diamans, faisant agenouiller des ambassadeurs du pape, des doges de la sérénissime république, recevant assis et couvert des représentans du roi de Siam, mais au beau cavalier à la bouche rouge, aux cheveux presque noirs, grand, infatigable, courageux, adorant toutes les femmes, mais n’en aimant qu’une, elle!
Louis XIV se peint dans ses maîtresses, et surtout dans les trois qui, plus particulièrement, disputèrent son cœur.
Est-il plein de sève, d’entraînement, de cette galanterie chevaleresque de la fronde, un peu espagnole, très-fière, mettant du point d’honneur dans l’amour? il aime mademoiselle de la Vallière.
La Mancini ne fut qu’une révélation soudaine qui apprit à Louis XIV qu’il y avait des femmes.
A-t-il passé cet âge, qui passe aussi pour les rois, est-il entré dans la vie, cette route pavée et sans ombre, qu’il lui faut des amours faciles et commodes, payés avec rien, avec de l’or: il aime madame de Montespan, une belle femme qui ne boite pas, qui a de gros bras, de fortes épaules, qui perd 500,000 livres au jeu de Marly chaque mois, qui accouche en riant et qui accouche toujours.
Épuisé d’esprit et de corps, capable d’apprendre sans émotion que mademoiselle de la Vallière est morte au monde à trente-un ans dans une cellule des Carmélites, et que madame de Montespan a passé ses épaules et ses bras à quelques ducs, il se tourne enfin vers la religion, il se jette dans le sein de madame de Maintenon, et y meurt. Ainsi Louis XIV pourra dater, en expirant, de son règne le soixante-sixième, et de sa maîtresse la troisième.
Triste parodie de ses maîtresses, ces deux hommes, qui marchent côte à côte du roi, l’accompagneront aussi toute sa vie: à sa table, pour applaudir pendant plus d’un demi-siècle à toutes ses paroles; à l'église, pour déposer qu’il est dévot, ou pour qu’il témoigne qu’eux le sont; à la guerre, assez près de lui pour ne pas craindre d'être blessés, ou assez loin de lui pour laisser croire qu’il court de grands dangers; à son lit, l’un pour en chasser la femme légitime, l’autre pour y introduire la maîtresse en faveur; et presque à son convoi funèbre, celui-ci pour dire: Le roi est mort! celui-là pour crier: Vive le roi!
Ces deux hommes s’abdiqueront dans Louis XIV; ils vivront de ses joies et de ses douleurs. S’il est gai, ils riront; s’il pleure, ils trouveront des larmes. Lui jeune, ils seront jeunes; lui vieux, ils se courberont, ils auront des rides; et si Louis XIV perd ses dents, ils trouveront le secret de n’en plus avoir. L’un n’aura commis qu’une inconvenance, celle de mourir avant le roi; l’autre n’aura pris qu’une liberté, celle de mourir après.
Voyez! Louis XIV sera destiné à survivre à tous ceux qu’il aura élevés ou abattus, ministres ou maréchaux, grands peintres ou célèbres poètes; à ceux qui sont nés avant lui, à ceux qui seront nés depuis lui, à tous ses parens, à son frère, à sa belle-sœur, à ses héritiers, hormis un seul, parce qu’il est passé en chose jugée qu’en France celui-là ne meurt pas; à presque tous ses bâtards, morts jusqu'à trois par trois dans un mois, avec la rapidité qu’il les fit; à toutes ses maîtresses, aux plus vieilles comme aux plus jeunes; même à ses monumens; à Fontainebleau, désert dans sa vieillesse; à Saint-Germain, s'écroulant sous le poids des dorures; à Versailles, où l’eau aura cessé de descendre; à Marly, où elle aura cessé de monter; il sera sur le point de survivre à la monarchie. Seulement deux hermaphrodites lui resteront, deux caricatures de maréchaux et de ministres, deux grimaces éternellement complaisantes, deux rires implacables, deux magots de la Chine remuant et souriant aux deux coins du logis, quoi qu’il arrive; deux squelettes impérissables, deux courtisans embaumés et vivans, deux flambeaux pour toutes ses amours, deux cyprès pour sa tombe: l’un le duc de Saint-Aignan, l’autre le marquis de Dangeau.
Ils sont là tous les deux.
Un coup de canon fut tiré de l’esplanade du château.
A ce signal, les eaux devaient partir.
Elles partent.
Jamais merveille de ce genre n’avait frappé la cour. Pour concevoir cet étonnement, oublions les chefs-d'œuvre de bronze et de fonte des frères Keller des jardins de Versailles et de Saint-Cloud: Saint-Cloud et Versailles n’existaient pas; l’hydraulique était inconnue en France.
Les eaux partent, et ces bassins, tranquilles il n’y a qu’un instant, remuent, montent, bouillonnent. Cent trente-trois jets d’eau jaillissent à perte de vue; ils retombent en brouillard humide nuancé des couleurs du prisme. Autant de figurations mythologiques en fonte déroulent en pages liquides les métamorphoses d’Ovide. Voilà Pan, voilà Syrinx; ici les satyres aux genoux de la nymphe qui les dédaigne et fuit poursuivie par le dieu Pan. Plus loin le fleuve Ladon reçoit Syrinx éplorée et la transforme en roseaux. Du milieu des roseaux des grenouilles de fer soufflent l’eau en menues gerbes. Le poème aquatique finit là. Les trois unités sont respectées sous l’eau comme sur la terre. Neptune reconnaît Aristote.
Autres bassins, autres merveilles.
Admirez Prométhée en perruque limoneuse, qui, avec de l’eau et de la terre, fait un homme. La terre, c’est un morceau de cuivre; l’homme, c’est Louis XIV portant le sceptre. Du sceptre part un vigoureux jet d’eau. Louis XIV a la bonté de se reconnaître et de sourire.
Après la fable, l’allégorie.
Jupiter, emblème de la puissance, enlève Europe dans Ovide; à Vaux, il enlève la Hollande. C’est une grosse femme aux pieds de laquelle on a gravé Batavia. Jupiter, c’est encore Louis XIV.
Laissons dire encore mademoiselle Scudéry: «On voit un abîme d’eau au milieu duquel, par les conseils de Méléandre (Lebrun), on a mis une figure de Galathée avec un cyclope qui joue de la cornemuse et divers tritons tout alentour. Toutes ces figures jettent de l’eau et font un très-bel objet. Mais ce qu’il y a de très-agréable, c’est que toute cette grande étendue d’eau est couverte de petites barques peintes et dorées, et que de là on entre dans le canal.»
Au tour de l’apologue maintenant. Un monstrueux lion de fer qui rugit de l’eau, caresse de l’une de ses pattes un petit écureuil, tandis que de l’autre il presse et retient une couleuvre. L'écureuil, c’est Fouquet, son symbole héraldique; la couleuvre, Colbert; le lion qui rugit, c’est toujours Louis XIV.
Et quand ces eaux, dieux ici, divinités plus loin, païennes et monarchiques, ont fatigué l’air de leurs élancemens, elles coulent dans un canal d’une demi-lieue, auquel la fantaisie a donné, de distance en distance, des formes et des dénominations singulières. La tête du canal s’appelle la Poêle. La queue de la Poêle, c’est le prolongement du canal, qui, cinquante pas au-dessous, s'équarrit en miroir, et en prend le nom. Au-dessus du miroir est la Grotte de Neptune, qui fait face aux cascades de l’autre côté du canal. Sept arcades où s’incrustent sept rochers, et que terminent deux cavernes où se cachent, sous un rideau de pierre dentelée, deux statues de fleuves, forment la Grotte. Tantôt appelée la grotte de Vaux, et tantôt de Neptune, elle déploie soixante-dix marches de chaque côté, conduisant à une spacieuse terrasse au-dessus des arcades. C’est là qu'était la Gerbe-d’Eau, vaste réservoir qui alimentait la Grotte de Neptune, et du centre duquel jaillissait un jet d’eau de toute hauteur.
Placé sur la terrasse de la Grotte, Louis XIV put voir toute la fête et en être vu. C’est le point le plus élevé de la ligne des travaux hydrauliques. Tournez-vous: un monument l’atteste. Hercule, les bras croisés, est derrière la terrasse, au-delà de la Gerbe-d’Eau; il semble dire: Ici finissent mes travaux, allez plus loin.
Ce fut de là aussi que le roi, jaloux de tant de pompe, se dit: J'étendrai ma main sur ce château orgueilleux, et il tombera comme celui qui l’habite; j'épancherai ces eaux, et elles disparaîtront comme celui qui les a ramassées; elles et lui ne se retrouveront plus. Celles-ci seront le désespoir du voyageur, celui-là de l’histoire. J’en donne ma parole de roi.



