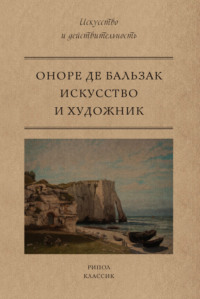Полная версия
La Comédie humaine volume VI
– Tu dois être contente de moi, ma chère mère? lui dit-il vers la fin de janvier, je mène la vie la plus régulière du monde.
Philippe avait dîné cinq fois au restaurant avec d'anciens camarades. Ces vieux soldats s'étaient communiqué l'état de leurs affaires en parlant des espérances que donnait la construction d'un bateau sous-marin pour la délivrance de l'Empereur. Parmi ses anciens camarades retrouvés, Philippe affectionna particulièrement un vieux capitaine des Dragons de la Garde, nommé Giroudeau, dans la compagnie duquel il avait débuté. Cet ancien dragon fut cause que Philippe compléta ce que Rabelais appelait l'équipage du diable, en ajoutant au petit verre, au cigare et au jeu, une quatrième roue. Un soir, au commencement de février, Giroudeau emmena Philippe, après dîner, à la Gaîté, dans une loge donnée à un petit journal de théâtre appartenant à son neveu Finot, où il tenait la caisse, les écritures, pour lequel il faisait et vérifiait les bandes. Vêtus, selon la mode des officiers bonapartistes appartenant à l'opposition constitutionnelle, d'une ample redingote à collet carré, boutonnée jusqu'au menton, tombant sur les talons et décorée de la rosette, armés d'un jonc à pomme plombée qu'ils tenaient par un cordon de cuir tressé, les deux anciens troupiers s'étaient, pour employer une de leurs expressions, donné une culotte, et s'ouvraient mutuellement leurs cœurs en entrant dans la loge. A travers les vapeurs d'un certain nombre de bouteilles et de petits verres de diverses liqueurs, Giroudeau montra sur la scène à Philippe une petite, grasse et agile figurante nommée Florentine dont les bonnes grâces et l'affection lui venaient, ainsi que la loge, par la toute-puissance du journal.
– Mais, dit Philippe, jusqu'où vont ses bonnes grâces pour un vieux troupier gris-pommelé comme toi?
– Dieu merci, répondit Giroudeau, je n'ai pas abandonné les vieilles doctrines de notre glorieux uniforme! Je n'ai jamais dépensé deux liards pour une femme.
– Comment? s'écria Philippe en se mettant un doigt sur l'œil gauche.
– Oui, répondit Giroudeau. Mais, entre nous, le journal y est pour beaucoup. Demain, dans deux lignes, nous conseillerons à l'administration de faire danser un pas à mademoiselle Florentine. Ma foi, mon cher enfant, je suis très-heureux, dit Giroudeau.
– Eh! pensa Philippe, si ce respectable Giroudeau, malgré son crâne poli comme mon genou, ses quarante-huit ans, son gros ventre, sa figure de vigneron et son nez en forme de pomme de terre, est l'ami d'une figurante, je dois être celui de la première actrice de Paris. Où ça se trouve-t-il? dit-il tout haut à Giroudeau.
– Je te ferai voir ce soir le ménage de Florentine. Quoique ma Dulcinée n'ait que cinquante francs par mois au théâtre, grâce à un ancien marchand de soieries nommé Cardot, qui lui offre cinq cents francs par mois, elle est encore assez bien ficelée!
– Eh! mais?.. dit le jaloux Philippe.
– Bah! fit Giroudeau, le véritable amour est aveugle.
Après le spectacle, Giroudeau mena Philippe chez mademoiselle Florentine, qui demeurait à deux pas du Théâtre, rue de Crussol.
– Tenons-nous bien, lui dit Giroudeau. Florentine a sa mère; tu comprends que je n'ai pas les moyens de lui en payer une, et que la bonne femme est sa vraie mère. Cette femme fut portière, mais elle ne manque pas d'intelligence, et se nomme Cabirolle, appelle-la madame, elle y tient.
Florentine avait ce soir-là chez elle une amie, une certaine Marie Godeschal, belle comme un ange, froide comme une danseuse, et d'ailleurs élève de Vestris qui lui prédisait les plus hautes destinées chorégraphiques. Mademoiselle Godeschal, qui voulait alors débuter au Panorama-Dramatique sous le nom de Mariette, comptait sur la protection d'un Premier Gentilhomme de la Chambre, à qui Vestris devait la présenter depuis long-temps. Vestris, encore vert à cette époque, ne trouvait pas son élève encore suffisamment savante. L'ambitieuse Marie Godeschal rendit fameux son pseudonyme de Mariette; mais son ambition fut d'ailleurs très-louable. Elle avait un frère, clerc chez Derville. Orphelins et misérables, mais s'aimant tous deux, le frère et la sœur avaient vu la vie comme elle est à Paris: l'un voulait devenir avoué pour établir sa sœur, et vivait avec dix sous par jour; l'autre avait résolu froidement de devenir danseuse, et de profiter autant de sa beauté que de ses jambes pour acheter une Étude à son frère. En dehors de leurs sentiments l'un pour l'autre, de leurs intérêts et de leur vie commune, tout, pour eux, était, comme autrefois pour les Romains et pour les Hébreux, barbare, étranger, ennemi. Cette amitié si belle, et que rien ne devait altérer, expliquait Mariette à ceux qui la connaissaient intimement. Le frère et la sœur demeuraient alors au huitième étage d'une maison de la Vieille rue du Temple. Mariette s'était mise à l'étude dès l'âge de dix ans, et comptait alors seize printemps. Hélas! faute d'un peu de toilette, sa beauté trotte-menu, cachée sous un cachemire de poil de lapin, montée sur des patins en fer, vêtue d'indienne et mal tenue, ne pouvait être devinée que par les Parisiens adonnés à la chasse des grisettes et à la piste des beautés malheureuses. Philippe devint amoureux de Mariette. Mariette vit en Philippe le commandant aux Dragons de la Garde, l'officier d'ordonnance de l'Empereur, le jeune homme de vingt-sept ans et le plaisir de se montrer supérieure à Florentine par l'évidente supériorité de Philippe sur Giroudeau. Florentine et Giroudeau, lui pour faire le bonheur de son camarade, elle pour donner un protecteur à son amie, poussèrent Mariette et Philippe à faire un mariage en détrempe. Cette expression du langage parisien équivaut à celle de mariage morganatique employée pour les rois et les reines. Philippe, en sortant, confia sa misère à Giroudeau; mais le vieux roué le rassura beaucoup.
– Je parlerai de toi à mon neveu Finot, lui dit Giroudeau. Vois-tu, Philippe, le règne des péquins et des phrases est arrivé, soumettons-nous. Aujourd'hui l'écritoire fait tout. L'encre remplace la poudre, et la parole est substituée à la balle. Après tout, ces petits crapauds de rédacteurs sont très-ingénieux et assez bons enfants. Viens me voir demain au journal, j'aurai dit deux mots de ta position à mon neveu. Dans quelque temps, tu auras une place dans un journal quelconque. Mariette, qui, dans ce moment (ne t'abuse pas), te prend parce qu'elle n'a rien, ni engagement, ni possibilité de débuter, et à qui j'ai dit que tu allais être comme moi dans un journal, Mariette te prouvera qu'elle t'aime pour toi-même et tu le croiras! Fais comme moi, maintiens-la figurante tant que tu pourras! J'étais si amoureux que, dès que Florentine a voulu danser son pas, j'ai prié Finot de demander son début; mais mon neveu m'a dit: – Elle a du talent, n'est-ce pas? Eh! bien, le jour où elle aura dansé son pas elle te fera passer celui de la porte. Oh! mais voilà Finot. Tu verras un gars bien dégourdi.
Le lendemain, sur les quatre heures, Philippe se trouva rue du Sentier, dans un petit entresol où il aperçut Giroudeau encagé comme un animal féroce dans une espèce de poulailler à chatière où se trouvaient un petit poêle, une petite table, deux petites chaises, et de petites bûches. Cet appareil était relevé par ces mots magiques: Bureau d'abonnement, imprimés sur la porte en lettres noires, et par le mot Caisse écrit à la main et attaché au-dessus du grillage. Le long du mur qui faisait face à l'établissement du capitaine s'étendait une banquette où déjeunait alors un invalide amputé d'un bras, appelé par Giroudeau Coloquinte, sans doute à cause de la couleur égyptienne de sa figure.
– Joli! dit Philippe en examinant cette pièce. Que fais-tu là, toi qui as été de la charge du pauvre colonel Chabert à Eylau? Nom de nom! Mille noms de nom, des officiers supérieurs!..
– Eh! bien! oui! – broum! broum! – un officier supérieur faisant des quittances de journal, dit Giroudeau qui raffermit son bonnet de soie noire. Et, de plus, je suis l'éditeur responsable de ces farces-là, dit-il en montrant le journal.
– Et moi qui suis allé en Égypte, je vais maintenant au Timbre, dit l'invalide.
– Silence, Coloquinte, dit Giroudeau, tu es devant un brave qui a porté les ordres de l'Empereur à la bataille de Montmirail.
– Présent! dit Coloquinte, j'y ai perdu le bras qui me manque.
– Coloquinte, garde la boutique, je monte chez mon neveu.
Les deux anciens militaires allèrent au quatrième étage, dans une mansarde, au fond d'un corridor, et trouvèrent un jeune homme à l'œil pâle et froid, couché sur un mauvais canapé. Le péquin ne se dérangea pas, tout en offrant des cigares à son oncle et à l'ami de son oncle.
– Mon ami, lui dit d'un ton doux et humble Giroudeau, voilà ce brave chef d'escadron de la Garde impériale de qui je t'ai parlé.
– Eh! bien? dit Finot en toisant Philippe qui perdit toute son énergie comme Giroudeau devant le diplomate de la presse.
– Mon cher enfant, dit Giroudeau qui tâchait de se poser en oncle, le colonel revient du Texas.
– Ah! vous avez donné dans le Texas, dans le Champ-d'Asile. Vous étiez cependant encore bien jeune pour vous faire Soldat Laboureur.
L'acerbité de cette plaisanterie ne peut être comprise que de ceux qui se souviennent du déluge de gravures, de paravents, de pendules, de bronzes et de plâtres auxquelles donna lieu l'idée du Soldat Laboureur, grande image du sort de Napoléon et de ses braves qui a fini par engendrer plusieurs vaudevilles. Cette idée a produit au moins un million. Vous trouvez encore des Soldats Laboureurs sur des papiers de tenture, au fond des provinces. Si ce jeune homme n'eût pas été le neveu de Giroudeau, Philippe lui aurait appliqué une paire de soufflets.
– Oui, j'ai donné là-dedans, j'y ai perdu douze mille francs et mon temps, reprit Philippe en essayant de grimacer un sourire.
– Et vous aimez toujours l'Empereur? dit Finot.
– Il est mon Dieu, reprit Philippe Bridau.
– Vous êtes libéral?
– Je serai toujours de l'Opposition Constitutionnelle. Oh! Foy! oh! Manuel! oh! Laffitte! voilà des hommes! Ils nous débarrasseront de ces misérables revenus à la suite de l'étranger!
– Eh! bien, reprit froidement Finot, il faut tirer parti de votre malheur, car vous êtes une victime des libéraux, mon cher! Restez libéral si vous tenez à votre opinion; mais menacez les Libéraux de dévoiler les sottises du Texas. Vous n'avez pas eu deux liards de la souscription nationale, n'est-ce pas? Eh! bien, vous êtes dans une belle position, demandez compte de la souscription. Voici ce qui vous arrivera: il se crée un nouveau journal d'Opposition, sous le patronage des Députés de la Gauche; vous en serez le caissier, à mille écus d'appointements, une place éternelle. Il suffit de vous procurer vingt mille francs de cautionnement; trouvez-les, vous serez casé dans huit jours. Je donnerai le conseil de se débarrasser de vous en vous faisant offrir la place; mais criez, et criez fort!
Giroudeau laissa descendre quelques marches à Philippe, qui se confondait en remercîments, et dit à son neveu: – Eh! bien, tu es encore drôle, toi!.. tu me gardes ici à douze cents francs.
– Le journal ne tiendra pas un an, répondit Finot. J'ai mieux que cela pour toi.
– Nom de nom! dit Philippe à Giroudeau, ce n'est pas une ganache, ton neveu! Je n'avais pas songé à tirer, comme il le dit, parti de ma position.
Le soir, au café Lemblin, au café Minerve, le colonel Philippe déblatéra contre le parti libéral qui faisait des souscriptions, qui vous envoyait au Texas, qui parlait hypocritement des Soldats Laboureurs, qui laissait des braves sans secours, dans la misère, après leur avoir mangé des vingt mille francs et les avoir promenés pendant deux ans.
– Je vais demander compte de la souscription pour le Champ-d'Asile, dit-il à l'un des habitués du café Minerve qui le redit à des journalistes de la Gauche.
Philippe ne rentra pas rue Mazarine, il alla chez Mariette lui annoncer la nouvelle de sa coopération future à un journal qui devait avoir dix mille abonnés, et où ses prétentions chorégraphiques seraient chaudement appuyées. Agathe et la Descoings attendirent Philippe en se mourant de peur, car le duc de Berry venait d'être assassiné. Le lendemain, le colonel arriva quelques instants après le déjeuner; quand sa mère lui témoigna les inquiétudes que son absence lui avait causées, il se mit en colère, il demanda s'il était majeur.
– Nom de nom! je vous apporte une bonne nouvelle, et vous avez l'air de catafalques. Le duc de Berry est mort, eh! bien, tant mieux! c'est un de moins. Moi, je vais être caissier d'un journal à mille écus d'appointements, et vous voilà tirées d'embarras pour ce qui me concerne.
– Est-ce possible? dit Agathe.
– Oui, si vous pouvez me faire vingt mille francs de cautionnement; il ne s'agit que de déposer votre inscription de treize cents francs de rente, vous toucherez tout de même vos semestres.
Depuis près de deux mois, les deux veuves, qui se tuaient à chercher ce que faisait Philippe, où et comment le placer, furent si heureuses de cette perspective, qu'elles ne pensèrent plus aux diverses catastrophes du moment. Le soir, le vieux du Bruel, Claparon qui se mourait, et l'inflexible Desroches père, ces sages de la Grèce furent unanimes: ils conseillèrent tous à la veuve de cautionner son fils. Le journal, constitué très-heureusement avant l'assassinat du duc de Berry, évita le coup qui fut alors porté par M. Decaze à la Presse. L'inscription de treize cents francs de la veuve Bridau fut affectée au cautionnement de Philippe, nommé caissier. Ce bon fils promit aussitôt de donner cent francs par mois aux deux veuves pour son logement, pour sa nourriture, et fut proclamé le meilleur des enfants. Ceux qui avaient mal auguré de lui félicitèrent Agathe.
– Nous l'avions mal jugé, dirent-ils.
Le pauvre Joseph, pour ne pas rester en arrière de son frère, essaya de se suffire à lui-même, et y parvint. Trois mois après, le colonel, qui mangeait et buvait comme quatre, qui faisait le difficile et entraînait, sous prétexte de sa pension, les deux veuves à des dépenses de table, n'avait pas encore donné deux liards. Ni sa mère, ni la Descoings ne voulaient, par délicatesse, lui rappeler sa promesse. L'année se passa sans qu'une seule de ces pièces, si énergiquement appelées par Léon Gozlan un tigre à cinq griffes, eût passé de la poche de Philippe dans le ménage. Il est vrai qu'à cet égard le colonel avait calmé les scrupules de sa conscience: il dînait rarement à la maison.
– Enfin il est heureux, dit sa mère, il est tranquille, il a une place!
Par l'influence du feuilleton que rédigeait Vernou, l'un des amis de Bixiou, de Finot et de Giroudeau, Mariette débuta non pas au Panorama-Dramatique, mais à la Porte-Saint-Martin, où elle eut du succès à côté de la Bégrand. Parmi les directeurs de ce théâtre, se trouvait alors un riche et fastueux officier-général amoureux d'une actrice et qui s'était fait impresario pour elle. A Paris, il se rencontre toujours des gens épris d'actrices, de danseuses ou de cantatrices qui se mettent Directeurs de Théâtre par amour. Cet officier-général connaissait Philippe et Giroudeau. Le petit journal de Finot et celui de Philippe y aidant, le début de Mariette fut une affaire d'autant plus promptement arrangée entre les trois officiers, qu'il semble que les passions soient toutes solidaires en fait de folies. Le malicieux Bixiou apprit bientôt à sa grand'mère et à la dévote Agathe que le caissier Philippe le brave des braves, aimait Mariette, la célèbre danseuse de la Porte-Saint-Martin. Cette vieille nouvelle fut comme un coup de foudre pour les deux veuves; d'abord les sentiments religieux d'Agathe lui faisaient regarder les femmes de théâtre comme des tisons d'enfer; puis il leur semblait à toutes deux que ces femmes vivaient d'or, buvaient des perles, et ruinaient les plus grandes fortunes.
– Eh! bien, dit Joseph à sa mère, croyez-vous que mon frère soit assez imbécile pour donner de l'argent à sa Mariette? Ces femmes-là ne ruinent que les riches.
– On parle déjà d'engager Mariette à l'Opéra, dit Bixiou. Mais n'ayez pas peur, madame Bridau, le corps diplomatique se montre à la Porte-Saint-Martin, cette belle fille ne sera pas longtemps avec votre fils. On parle d'un ambassadeur amoureux-fou de Mariette. Autre nouvelle! Le père Claparon est mort, on l'enterre demain, et son fils, devenu banquier, qui roule sur l'or et sur l'argent, a commandé un convoi de dernière classe. Ce garçon manque d'éducation. Ça ne se passe pas ainsi en Chine!
Philippe proposa, dans une pensée cupide, à la danseuse de l'épouser; mais, à la veille d'entrer à l'Opéra, mademoiselle Godeschal le refusa, soit qu'elle eût deviné les intentions du colonel, soit qu'elle eût compris combien son indépendance était nécessaire à sa fortune. Pendant le reste de cette année, Philippe vint tout au plus voir sa mère deux fois par mois. Où était-il? A sa caisse, au théâtre ou chez Mariette. Aucune lumière sur sa conduite ne transpira dans le ménage de la rue Mazarine. Giroudeau, Finot, Bixiou, Vernou, Lousteau lui voyaient mener une vie de plaisirs. Philippe était de toutes les parties de Tullia, l'un des premiers sujets de l'Opéra, de Florentine qui remplaça Mariette à la Porte-Saint-Martin, de Florine et de Matifat, de Coralie et de Camusot. A partir de quatre heures, moment où il quittait sa caisse, il s'amusait jusqu'à minuit; car il y avait toujours une partie de liée la veille, un bon dîner donné par quelqu'un, une soirée de jeu, un souper. Philippe vécut alors comme dans son élément. Ce carnaval, qui dura dix-huit mois, n'alla pas sans soucis. La belle Mariette, lors de son début à l'Opéra, en janvier 1821, soumit à sa loi l'un des ducs les plus brillants de la cour de Louis XVIII. Philippe essaya de lutter contre le duc; mais, malgré quelque bonheur au jeu, au renouvellement du mois d'avril il fut obligé, par sa passion, de puiser dans la caisse du journal. Au mois de mai, il devait onze mille francs. Dans ce mois fatal, Mariette partit pour Londres y exploiter les lords pendant le temps qu'on bâtissait la salle provisoire de l'Opéra, dans l'hôtel Choiseul, rue Lepelletier. Le malheureux Philippe en était arrivé, comme cela se pratique, à aimer Mariette malgré ses patentes infidélités; mais elle n'avait jamais vu dans ce garçon qu'un militaire brutal et sans esprit, un premier échelon sur lequel elle ne voulait pas long-temps rester. Aussi, prévoyant le moment où Philippe n'aurait plus d'argent, la danseuse avait-elle su conquérir des appuis dans le journalisme qui la dispensaient de conserver Philippe; néanmoins, elle eut la reconnaissance particulière à ces sortes de femmes pour celui qui, le premier, leur a pour ainsi dire aplani les difficultés de l'horrible carrière du théâtre.
Forcé de laisser aller sa terrible maîtresse à Londres sans l'y suivre, Philippe reprit ses quartiers d'hiver, pour employer ses expressions, et revint rue Mazarine dans sa mansarde; il y fit de sombres réflexions en se couchant et se levant. Il sentit en lui-même l'impossibilité de vivre autrement qu'il n'avait vécu depuis un an. Le luxe qui régnait chez Mariette, les dîners et les soupers, la soirée dans les coulisses, l'entrain des gens d'esprit et des journalistes, l'espèce de bruit qui se faisait autour de lui, toutes les caresses qui en résultaient pour les sens et pour la vanité; cette vie, qui ne se trouve d'ailleurs qu'à Paris, et qui offre chaque jour quelque chose de neuf, était devenue plus qu'une habitude pour Philippe; elle constituait une nécessité comme son tabac et ses petits verres. Aussi reconnut-il qu'il ne pouvait pas vivre sans ces continuelles jouissances. L'idée du suicide lui passa par la tête, non pas à cause du déficit qu'on allait reconnaître dans sa caisse, mais à cause de l'impossibilité de vivre avec Mariette et dans l'atmosphère de plaisirs où il se chafriolait depuis un an. Plein de ces sombres idées, il vint pour la première fois dans l'atelier de son frère qu'il trouva travaillant, en blouse bleue, à copier un tableau pour un marchand.
– Voici donc comment se font les tableaux? dit Philippe pour entrer en matière.
– Non, répondit Joseph, mais voilà comment ils se copient.
– Combien te paye-t-on cela?
– Hé! jamais assez, deux cent cinquante francs; mais j'étudie la manière des maîtres, j'y gagne de l'instruction, je surprends les secrets du métier. Voilà l'un de mes tableaux, lui dit-il en lui indiquant du bout de sa brosse une esquisse dont les couleurs étaient encore humides.
– Et que mets-tu dans ton sac par année, maintenant?
– Malheureusement je ne suis encore connu que des peintres. Je suis appuyé par Schinner qui doit me procurer des travaux au château de Presles où j'irai vers octobre faire des arabesques, des encadrements, des ornements très-bien payés par le comte de Sérizy. Avec ces brocantes-là, avec les commandes des marchands, je pourrai désormais faire dix-huit cents à deux mille francs, tous frais payés. Bah! à l'Exposition prochaine, je présenterai ce tableau-là; s'il est goûté, mon affaire sera faite: mes amis en sont contents.
– Je ne m'y connais pas, dit Philippe d'une voix douce qui força Joseph à le regarder.
– Qu'as-tu? demanda l'artiste en trouvant son frère pâli.
– Je voudrais savoir en combien de temps tu ferais mon portrait.
– Mais en travaillant toujours, si le temps est clair, en trois ou quatre jours j'aurai fini.
– C'est trop de temps, je n'ai que la journée à te donner. Ma pauvre mère m'aime tant que je voulais lui laisser ma ressemblance. N'en parlons plus.
– Eh! bien, est-ce que tu t'en vas encore?
– Je m'en vais pour ne plus revenir, dit Philippe d'un air faussement gai.
– Ah ça! Philippe, mon ami, qu'as-tu? Si c'est quelque chose de grave, je suis un homme, je ne suis pas un niais; je m'apprête à de rudes combats; et, s'il faut de la discrétion, j'en aurai.
– Est-ce sûr?
– Sur mon honneur.
– Tu ne diras rien à qui que ce soit au monde?
– A personne.
– Eh! bien, je vais me brûler le cervelle.
– Toi! tu vas donc te battre?
– Je vais me tuer.
– Et pourquoi?
– J'ai pris onze mille francs dans ma caisse, et je dois rendre mes comptes demain, mon cautionnement sera diminué de moitié; notre pauvre mère sera réduite à six cents francs de rente. Ça! ce n'est rien, je pourrais lui rendre plus tard une fortune; mais je suis déshonoré! Je ne veux pas vivre dans le déshonneur.
– Tu ne seras pas déshonoré pour avoir restitué, mais tu perdras ta place, il ne te restera plus que les cinq cents francs de ta croix, et avec cinq cents francs on peut vivre.
– Adieu! dit Philippe qui descendit rapidement et ne voulut rien entendre.
Joseph quitta son atelier et descendit chez sa mère pour déjeuner; mais la confidence de Philippe lui avait ôté l'appétit. Il prit la Descoings à part et lui dit l'affreuse nouvelle. La vieille femme fit une épouvantable exclamation, laissa tomber un poêlon de lait qu'elle avait à la main, et se jeta sur une chaise. Agathe accourut. D'exclamations en exclamations, la fatale vérité fut avouée à la mère.
– Lui! manquer à l'honneur! le fils de Bridau prendre dans la caisse qui lui est confiée!
La veuve trembla de tous ses membres, ses yeux s'agrandirent, devinrent fixes, elle s'assit et fondit en larmes.
– Où est-il? s'écria-t-elle au milieu de ses sanglots. Peut-être s'est-il jeté dans la Seine!
– Il ne faut pas vous désespérer, dit la Descoings, parce que le pauvre garçon a rencontré une mauvaise femme, et qu'elle lui a fait faire des folies. Mon Dieu! cela se voit souvent. Philippe a eu jusqu'à son retour tant d'infortunes, et il a eu si peu d'occasions d'être heureux et aimé, qu'il ne faut pas s'étonner de sa passion pour cette créature. Toutes les passions mènent à des excès! J'ai dans ma vie un reproche de ce genre à me faire, et je me crois cependant une honnête femme! Une seule faute ne fait pas le vice! Et puis, après tout, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas!
Le désespoir d'Agathe l'accablait tellement que la Descoings et Joseph furent obligés de diminuer la faute de Philippe en lui disant que dans toutes les familles il arrivait de ces sortes d'affaires.
– Mais il a vingt-huit ans, s'écriait Agathe, et ce n'est plus un enfant.
Mot terrible et qui révèle combien la pauvre femme pensait à la conduite de son fils.
– Ma mère, je t'assure qu'il ne songeait qu'à ta peine et au tort qu'il te fait, lui dit Joseph.
– Oh! mon Dieu, qu'il revienne! qu'il vive, et je lui pardonne tout! s'écria la pauvre mère à l'esprit de laquelle s'offrit l'horrible tableau de Philippe retiré mort de l'eau.