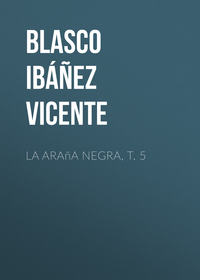Полная версия
Les quatre cavaliers de l'apocalypse
Madariaga était un Espagnol venu jeune en Argentine et qui, s'étant plié aux mœurs du pays et vivant comme un gaucho, avait fini par acquérir d'énormes estancias2. Ses terres étaient aussi vastes que telle ou telle principauté européenne, et son infatigable vigueur de centaure avait beaucoup contribué à la prospérité de ses affaires. Il galopait des journées entières sur les immenses prairies où il avait été l'un des premiers à planter l'alfalfa, et, grâce à l'abondance de ce fourrage, il pouvait, au temps de la sécheresse, acheter presque pour rien le bétail qui mourait de faim chez ses voisins et qui s'engraissait tout de suite chez lui. Il lui suffisait de regarder quelques minutes une bande d'un millier de bêtes pour en savoir au juste le nombre, et, quand il faisait le tour d'un troupeau, il distinguait au premier coup d'œil les animaux malades. Avec un acheteur comme Madariaga, les roueries et les artifices des vendeurs étaient peine perdue.
– Mon garçon, lui avait dit Madariaga, un jour qu'il était de bonne humeur, vous êtes dans la débine. L'impécuniosité se sent de loin. Pourquoi continuez-vous cette chienne de vie? Si vous m'en croyez, restez chez moi. Je me fais vieux et j'ai besoin d'un homme.
Quand l'arrangement fut conclu, les voisins de Madariaga, c'est-à-dire les propriétaires établis à quinze ou vingt lieues de distance, arrêtèrent sur le chemin le nouvel employé pour lui prédire toute sorte de déboires. Cela ne durerait pas longtemps: personne ne pouvait vivre avec Madariaga. On ne se rappelait plus le nombre des intendants qui avaient passé chez lui. Marcel ne tarda pas à constater qu'en effet le caractère de Madariaga était insupportable; mais il constata aussi que son patron, en vertu d'une sympathie spéciale et inexplicable, s'abstenait de le molester.
– Ce garçon est une perle, répétait volontiers Madariaga, comme pour excuser la considération qu'il témoignait au Français. Je l'aime parce qu'il est sérieux. Il n'y a que les gens sérieux qui me plaisent.
Ni Marcel, ni sans doute Madariaga lui-même ne savaient au juste en quoi pouvait bien consister le «sérieux» que ce dernier attribuait à son homme de confiance; mais Marcel n'en était pas moins flatté de voir que l'estanciero, agressif avec tout le monde, même avec les personnes de sa famille, abandonnait pour causer avec lui le ton rude du maître et prenait un accent quasi paternel.
La famille de Madariaga se composait de sa femme, Misiá Petrona, qu'il appelait la Chinoise, et de deux filles adultes, Luisa et Héléna, qui, revenues au domaine après avoir passé quelques années en pension, à Buenos-Aires, avaient bientôt recouvré une bonne partie de leur rusticité primitive.
Misiá Petrona se levait en pleine nuit pour surveiller le déjeuner des ouvriers, la distribution du biscuit, la préparation du café ou du maté; elle gourmandait les servantes bavardes et paresseuses, qui s'attardaient volontiers dans les bosquets voisins de la maison; elle exerçait à la cuisine une autorité souveraine. Mais, dès que la voix de son mari se faisait entendre, elle se recroquevillait sur elle-même dans un silence craintif et respectueux; à table, elle le contemplait de ses yeux ronds et fixes, et lui témoignait une soumission religieuse.
Quant aux filles, le père leur avait richement meublé un salon dont elles prenaient grand soin, mais où, malgré leurs protestations, il apportait à chaque instant le désordre de ses rudes habitudes. Les opulents tapis s'attristaient des vestiges de boue imprimés par les bottes du centaure; la cravache traînait sur une console dorée; les échantillons de maïs éparpillaient leurs grains sur la soie d'un divan où ces demoiselles osaient à peine s'asseoir. Dans le vestibule, près de la porte, il y avait une bascule; et, un jour qu'elles lui avaient demandé de la faire transporter dans les dépendances, il entra presque en fureur. Il serait donc obligé de faire un voyage toutes les fois qu'il voudrait vérifier le poids d'une peau crue?
Luisa, l'aînée, qu'on appelait Chicha, à la mode américaine, était la préférée de son père.
– C'est ma pauvre Chinoise toute crachée, disait-il. Aussi bonne et aussi travailleuse que sa mère, mais beaucoup plus dame.
Marcel n'avait pas la moindre velléité de contredire cet éloge, qu'il aurait plutôt trouvé insuffisant; mais il avait de la peine à admettre que cette belle fille pâle, modeste, aux grands yeux noirs et au sourire d'une malice enfantine, eût la moindre ressemblance physique avec l'estimable matrone qui lui avait donné le jour.
Héléna, la cadette, était d'un tout autre caractère. Elle n'avait aucun goût pour les travaux du ménage et passait au piano des journées entières à tapoter des exercices avec une conscience désespérante.
– Grand Dieu! s'écriait le père exaspéré par cette rafale de notes. Si au moins elle jouait la jota et le pericón3!
Et, à l'heure de la sieste, il s'en allait dormir sur son hamac, au milieu des eucalyptus, pour échapper à ces interminables séries de gammes ascendantes et descendantes. Il l'avait surnommée «la romantique», et elle était continuellement l'objet de ses algarades ou de ses moqueries. Où avait-elle pris des goûts que n'avaient jamais eus son père ni sa mère? Pourquoi encombrait-elle le coin du salon avec cette bibliothèque où il n'y avait que des romans et des poésies? Sa bibliothèque, à lui, était bien plus utile et bien plus instructive: elle se composait des registres où était consignée l'histoire de toutes les bêtes fameuses qu'il avait achetées pour la reproduction ou qui étaient nées chez lui de parents illustres. N'avait-il pas possédé Diamond III, petit-fils de Diamond I qui appartint au roi d'Angleterre, et fils de Diamond II qui fut vainqueur dans tous les concours!
Marcel était depuis cinq ans dans la maison lorsque, un beau matin, il entra brusquement au bureau de Madariaga.
– Don Julio, je m'en vais. Ayez l'obligeance de me régler mon compte.
Madariaga le regarda en dessous.
– Tu t'en vas? Et le motif?
– Oui, je m'en vais… Il faut que je m'en aille…
– Ah! brigand! Je le sais bien, moi, pourquoi tu veux t'en aller! T'imagines-tu que le vieux Madariaga n'a pas surpris les œillades de mouche morte que tu échanges avec sa fille? Tu n'as pas mal réussi, mon garçon! Te voilà maître de la moitié de mes pesos4, et tu peux dire que tu as «refait» l'Amérique.
Tout en parlant, Madariaga avait empoigné sa cravache et en donnait de petits coups dans la poitrine de son intendant, avec une insistance dont celui-ci ne discernait pas encore si elle était bienveillante ou hostile.
– C'est précisément pour cela que je viens prendre congé de vous, répliqua Marcel avec hauteur. Je sais que mon amour est absurde, et je pars.
– Vraiment? hurla le patron. Monsieur part? Monsieur croit qu'il est maître de faire ce qui lui plaît?.. Le seul qui commande ici, c'est le vieux Madariaga, et je t'ordonne de rester… Ah! les femmes! Elles ne servent qu'à mettre la mésintelligence entre les hommes. Quel malheur que nous ne puissions pas vivre sans elles!
Bref, Marcel Desnoyers épousa Chicha, et désormais son beau-père s'occupa beaucoup moins des affaires du domaine. Tout le poids de l'administration retomba sur le gendre.
Madariaga, plein d'attentions délicates pour le mari de sa fille préférée, lui fit un jour une surprise: il lui ramena de Buenos-Aires un jeune Allemand, Karl Hartrott, qui aiderait Marcel pour la comptabilité. Au dire de Madariaga, cet Allemand était un trésor; il savait tout, pouvait s'acquitter de toutes les besognes.
Par le fait, après une courte épreuve, Marcel fut très satisfait de son aide-comptable. Sans doute celui-ci appartenait à une nation ennemie de la France; mais peu importait, en somme: il y a partout d'honnêtes gens, et Karl était un serviteur modèle. Il se tenait à distance de ses égaux et se montrait inflexible avec ses inférieurs. Il paraissait employer toutes ses facultés à bien remplir ses fonctions et à admirer ses maîtres. Dès que Madariaga ouvrait la bouche ou prononçait quelque bon mot, Karl approuvait de la tête, éclatait de rire. Lorsque Marcel entrait au bureau, il se levait de son siège, le saluait avec une raideur militaire. Il causait peu, s'appliquait beaucoup à son travail, faisait sans observation tout ce qu'on lui commandait de faire. En outre, – et cela n'était pas ce qui plaisait le plus à Desnoyers, – il espionnait le personnel pour son propre compte et venait dénoncer toutes les négligences, tous les manquements. Madariaga ne se lassait pas de se féliciter de cette acquisition.
– Ce Karl fait merveilleusement notre affaire, disait-il. Les Allemands sont si souples, si disciplinés! Et puis, ils ont si peu d'amour-propre! A Buenos-Aires, quand ils sont commis, ils balaient le magasin, tiennent la comptabilité, s'occupent de la vente, dactylographient, font la correspondance en quatre ou cinq langues, et par-dessus le marché, le cas échéant, ils accompagnent en ville la maîtresse du patron, comme si c'était une grande dame et qu'ils fussent ses valets de pied. Tout cela, pour vingt-cinq pesos par mois. Pas possible de rivaliser contre de pareilles gens…
Mais, après ce lyrique éloge, le vieux réfléchissait une minute et ajoutait:
– Au fond, peut-être ne sont-ils pas aussi bons qu'ils le paraissent. Lorsqu'ils sourient en recevant un coup de pied au cul, peut-être se disent-ils intérieurement: «Attends que ce soit mon tour et je t'en rendrai vingt.»
Madariaga n'en introduisit pas moins Karl Hartrott, comme autrefois Marcel, dans son intérieur, mais pour une raison très différente. Marcel avait été accueilli par estime; Karl n'entra au salon que pour donner des leçons de piano à Héléna. Aussitôt que l'employé avait terminé son travail de bureau, il venait s'asseoir sur un tabouret à côté de la «romantique», lui faisait jouer des morceaux de musique allemande, puis, avant de se retirer, chantait lui-même, en s'accompagnant, un morceau de Wagner qui endormait tout de suite le patron dans son fauteuil.
Un soir, au dîner, Héléna ne put s'empêcher d'annoncer à ses parents une découverte qu'elle venait de faire.
– Papa, dit-elle en rougissant un peu, j'ai appris quelque chose. Karl est noble: il appartient à une grande famille…
– Allons donc! repartit Madariaga en haussant les épaules. Tous les Allemands qui viennent en Amérique sont des meurt-de-faim. S'il avait des parchemins, il ne serait pas à nos gages. A-t-il donc commis un crime dans son pays, pour être obligé de venir chez nous trimer comme il fait?
Ni le père ni la fille n'avaient tort. Karl Hartrott était réellement fils du général von Hartrott, l'un des héros secondaires de la guerre de 1870, que l'empereur avait récompensé en l'anoblissant; et Karl lui-même avait été officier dans l'armée allemande; mais, n'ayant d'autres ressources que sa solde, vaniteux, libertin et indélicat, il s'était laissé aller à commettre des détournements et des faux. Par considération pour la mémoire du général, il n'avait pas été l'objet de poursuites judiciaires; mais ses camarades l'avaient fait passer devant un jury d'honneur qui l'avait expulsé de l'armée. Ses frères et ses amis avaient alors conseillé à cet homme flétri de se faire sauter la cervelle; mais il aimait trop la vie et il avait préféré fuir en Amérique, avec l'espoir d'y acquérir une fortune qui effacerait les taches de son passé.
Or, un certain jour, Madariaga surprit derrière un bouquet de bois, près de la maison, «la romantique» pâmée dans les bras de son maître de piano. Il y eut une scène terrible, et le père, qui avait déjà son couteau à la main, aurait indubitablement tué Karl, si celui-ci, plus jeune et plus rapide, n'avait pris la fuite. Après cette tragique aventure, Héléna, redoutant la colère paternelle, s'enferma dans une chambre haute et y passa une semaine entière sans se montrer. Puis elle s'enfuit de la maison et alla rejoindre son beau chevalier Tristan.
Madariaga fut au désespoir; mais, contrairement aux prévisions de Marcel, ce désespoir ne se manifesta ni par des violences ni par des vociférations. La robustesse et la vivacité du vieux centaure avaient cédé sous le coup, et souvent, chose extraordinaire, ses yeux se mouillaient de larmes.
– Il me l'a enlevée! Il me l'a enlevée! répétait-il d'un ton désolé.
Grâce à cette faiblesse inattendue, Marcel finit par obtenir un accommodement. Il n'y arriva pas de prime abord, et sept ou huit mois se passèrent avant que Madariaga consentît à entendre raison. Mais, un matin, Marcel dit au vieillard:
– Héléna vient d'accoucher. Elle a un garçon qu'ils ont nommé Julio, comme vous.
– Et toi, grand propre à rien, brailla Madariaga, peut-être pour cacher un attendrissement involontaire, est-ce que tu m'as donné un petit-fils? Paresseux comme un Français! Ce bandit a déjà un enfant, et toi, après quatre ans de mariage, tu n'as rien su faire encore! Ah! les Allemands n'auront pas de peine à venir à bout de vous!
Sur ces entrefaites, la pauvre Misiá Petrona mourut. Héléna, avertie par Marcel, se présenta au domaine pour voir une dernière fois sa mère dans le cercueil; et Marcel, profitant de l'occasion, réussit enfin à vaincre l'obstination du vieux. Après une longue résistance, Madariaga se laissa fléchir.
– Eh bien, je leur pardonne. Je le fais pour la pauvre défunte et pour toi. Qu'Héléna reste à la maison, et que son vilain Allemand la rejoigne.
D'ailleurs le vieux fut intraitable sur la question des arrangements domestiques. Il se refusa absolument à considérer Hartrott comme un membre de la famille: celui-ci ne serait qu'un employé placé sous les ordres de Marcel, et il logerait avec ses enfants dans un des bâtiments de l'administration, comme un étranger. Karl accepta tout cela et beaucoup d'autres choses encore. Madariaga ne lui adressait jamais la parole, et, lorsque Héléna saisissait quelque prétexte pour amener au grand-père le petit Julio:
– Le marmot de ton chanteur! disait-il avec mépris.
Il semblait que le qualificatif de «chanteur» signifiât pour lui le comble de l'ignominie.
Le temps s'écoula sans apporter beaucoup de changement à la situation. Marcel, à qui Madariaga avait entièrement abandonné le soin du domaine, aidait sous main son beau-frère et sa belle-sœur, et Hartrott lui en montrait une humble gratitude. Mais le vieux s'obstinait à affecter vis-à-vis de «la romantique» et de son mari une dédaigneuse indifférence.
Après six ans de mariage, la femme de Marcel mit au monde un garçon qu'on appela Jules. A cette époque, sa sœur Héléna avait déjà trois enfants. Six ans plus tard, Luisa eut encore une fille, qui fut nommée Luisa comme sa mère, mais que l'on surnomma Chichi. Les Hartrott, eux, avaient alors cinq enfants.
Le vieux Madariaga, qui baissait beaucoup, avait étendu à ces deux lignées la partialité qu'il ne perdait aucune occasion de témoigner aux parents. Tandis qu'il gâtait de la façon la plus déraisonnable Jules et Chichi, les emmenait avec lui dans le domaine, leur donnait de l'argent à poignées, il était aussi revêche que possible pour les rejetons de Karl et il les chassait comme des mendiants, dès qu'il les apercevait. Marcel et Luisa prenaient la défense de leurs neveux, accusaient le grand-père d'injustice.
– C'est possible, répondait le vieux; mais comment voulez-vous que je les aime? Ils sont tout le portrait de leur père: blancs comme des chevreaux écorchés, avec des tignasses queue de vache; et le plus grand porte déjà des lunettes!
En 1903, Karl Hartrott fit part d'un projet à Marcel Desnoyers. Il désirait envoyer ses deux aînés dans un gymnase d'Allemagne; mais cela coûterait cher, et, comme Desnoyers tenait les cordons de la bourse, il était nécessaire d'obtenir son assentiment. La requête parut raisonnable à Marcel, qui avait maintenant la disposition absolue de la fortune de Madariaga; il promit donc de demander au vieillard pour Hartrott l'autorisation de conduire ces enfants en Europe, et de sa propre initiative, il se chargea de fournir à son beau-frère les fonds du voyage.
– Qu'il s'en aille à tous les diables, lui et les siens! répondit le vieux. Et puissent-ils ne jamais revenir!
Karl, qui fut absent pendant trois mois, envoya force lettres à sa femme et à Desnoyers, leur parla avec orgueil de ses nobles parents, leur déclara qu'en comparaison de l'Allemagne tous les autres peuples étaient de la gnognote; ce qui n'empêcha point qu'au retour il continua de se montrer aussi humble, aussi soumis, aussi obséquieux qu'auparavant.
Quant à Jules et à Chichi, leurs parents, pour les soustraire aux gâteries séniles de Madariaga, les avaient mis, le premier dans un collège, la seconde dans un pensionnat religieux de Buenos-Aires. Ni l'un ni l'autre n'y travaillèrent beaucoup: habitués à la liberté des espaces immenses, ils s'y ennuyaient comme dans une geôle. Ce n'était pas que Jules manquât d'intelligence ni de curiosité; il lisait quantité de livres, n'importe lesquels, sauf ceux qui lui auraient été utiles pour ses études; et, les jours de congé, avec l'argent que son grand-père lui prodiguait en cachette, il faisait l'apprentissage prématuré de la vie d'étudiant. Chichi, elle non plus, ne s'appliquait guère à ses études; vive et capricieuse, elle s'intéressait beaucoup plus à la toilette et aux élégances citadines qu'aux mystères de la géographie et de l'arithmétique; mais elle avait le meilleur caractère du monde, gai, primesautier, affectueux.
Madariaga, privé de la présence de ces enfants, était comme une âme en peine. Plus qu'octogénaire, ayant l'oreille dure et la vue affaiblie, il s'obstinait encore à chevaucher, malgré les supplications de Luisa et de Marcel qui redoutaient un accident; bien plus, il prétendait faire seul ses tournées, se mettait en fureur si on lui offrait de le faire accompagner par un domestique. Il partait donc sur une jument bien docile, dressée exprès pour lui, et il errait de rancho en rancho5. Lorsqu'il arrivait, une métisse mettait vite sur le feu la bouillotte du maté, une fillette lui offrait la petite calebasse, avec la paille pour boire le liquide amer. Et parfois il restait là tout l'après-midi, immobile et muet, au milieu des gens qui le contemplaient avec une admiration mêlée de crainte.
Un soir, la jument revint sans son cavalier. Aussitôt on se mit en quête du vieillard, qui fut trouvé mort à deux lieues de la maison, sur le bord d'un chemin. Le centaure, terrassé par la congestion, avait encore au poignet cette cravache qu'il avait si souvent brandie sur les bêtes et sur les gens.
Madariaga avait déposé son testament chez un notaire espagnol de Buenos-Aires. Ce testament était si volumineux que Karl Hartrott et sa femme eurent un frisson de peur en le voyant. Quelles dispositions terribles le défunt avait-il pu prendre? Mais la lecture des premières pages suffit à les rassurer. Madariaga, il est vrai, avait beaucoup avantagé sa fille Luisa; mais il n'en restait pas moins une part énorme pour «la romantique» et les siens. Ce qui rendait si long l'instrument testamentaire, c'était une centaine de legs au profit d'une infinité de gens établis sur le domaine. Ces legs représentaient plus d'un million de pesos: car le maître bourru ne laissait pas d'être généreux pour ceux de ses serviteurs qu'il avait pris en amitié. A la fin, un dernier legs, le plus gros, attribuait en propre à Jules Desnoyers une vaste estancia, avec cette mention spéciale: le grand-père faisait don de ce domaine à son petit-fils pour que celui-ci pût en appliquer le revenu à ses dépenses personnelles, dans le cas où sa famille ne lui fournirait pas assez d'argent de poche pour vivre comme il convenait à un jeune homme de sa condition.
– Mais l'estancia vaut des centaines de mille pesos! protesta Karl, devenu plus exigeant depuis qu'il était sûr que sa femme n'avait pas été oubliée.
Marcel, bienveillant et ami de la paix, avait son plan. Expert à l'administration de ces biens énormes, il n'ignorait pas qu'un partage entre héritiers doublerait les frais sans augmenter les profits. En outre, il calculait les complications et les débours qu'amènerait la liquidation d'une succession qui se composait de neuf estancias considérables, de plusieurs centaines de mille têtes de bétail, de gros dépôts placés dans des banques, de maisons sises à la ville et de créances à recouvrer. Ne valait-il pas mieux laisser les choses en l'état et continuer l'exploitation comme auparavant, sans procéder à un partage? Mais, lorsque l'Allemand entendit cette proposition, il se redressa avec orgueil.
– Non, non! A chacun sa part. Quant à moi, j'ai l'intention de rentrer dans ma sphère, c'est-à-dire de regagner l'Europe, et par conséquent je veux disposer de mes biens.
Marcel le regarda en face et vit un Karl qu'il ne connaissait pas encore, un Karl dont il ne soupçonnait pas même l'existence.
– Fort bien, répondit-il. A chacun sa part. Cela me paraît juste.
Karl Hartrott s'empressa de vendre toutes les terres qui lui appartenaient, pour employer ses capitaux en Allemagne; puis, avec sa femme et ses enfants, il repassa l'Atlantique et vint s'établir à Berlin.
Marcel continua quelques années encore à administrer sa propre fortune; mais il le faisait maintenant avec peu de goût. Le rayon de son autorité s'était considérablement rétréci par le partage, et il enrageait d'avoir pour voisins des étrangers, presque tous Allemands, devenus propriétaires des terrains achetés à Karl. D'ailleurs il vieillissait et sa fortune était faite: l'héritage recueilli par sa femme représentait environ vingt millions de pesos. Qu'avait-il besoin d'en amasser davantage?
Bref, il se décida à affermer une partie de ses terres, confia l'administration du reste à quelques-uns des légataires du vieux Madariaga, hommes de confiance qu'il considérait un peu comme de la famille, et se transporta à Buenos-Aires où il voulait surveiller son fils qui, sorti du collège, menait une vie endiablée sous prétexte de se préparer à la profession d'ingénieur. D'ailleurs Chichi, très forte pour son âge, était presque une femme, et sa mère ne trouvait pas à propos de la garder plus longtemps à la campagne: avec la fortune que la jeune fille aurait, il ne fallait pas qu'elle fût élevée en paysanne.
Cependant les nouvelles les plus extraordinaires arrivaient de Berlin. Héléna écrivait à sa sœur d'interminables lettres où il n'était question que de bals, de festins, de chasses, de titres de noblesse et de hauts grades militaires: «notre frère le colonel», «notre cousin le baron», «notre oncle le conseiller intime», «notre cousin germain le conseiller vraiment intime». Toutes les extravagances de l'organisation sociale allemande, qui invente sans cesse des distinctions bizarres pour satisfaire la vanité d'un peuple divisé en castes, étaient énumérées avec délices par «la romantique». Elle parlait même du secrétaire de son mari, secrétaire qui n'était pas le premier venu, puisqu'il avait gagné comme rédacteur dans les bureaux d'une administration publique le titre de Rechnungsrath, conseiller de calcul! Et elle mentionnait avec fierté l'Oberpedell, c'est-à-dire le «concierge supérieur» qu'elle avait dans sa maison. Les nouvelles qu'elle donnait de ses fils n'étaient pas moins flatteuses. L'aîné était le savant de la famille: il se consacrait à la philologie et aux sciences historiques; mais malheureusement il avait les yeux fatigués par les continuelles lectures. Il ne tarderait pas à être docteur, et peut-être réussirait-il à devenir Herr Professer avant sa trentième année. La mère aurait mieux aimé qu'il fût officier; mais elle se consolait en pensant qu'un professeur célèbre peut, avec le temps, acquérir autant de considération sociale qu'un colonel. Quant à ses quatre autres fils, ils se destinaient à l'armée, et leur père préparait déjà le terrain pour les faire entrer dans la garde ou au moins dans quelque régiment aristocratique. Les deux filles, lorsqu'elles seraient en âge de se marier, ne manqueraient pas d'épouser des militaires, autant que possible des officiers de hussards, dont le nom serait précédé de la particule.
Hartrott aussi écrivait quelquefois à Marcel, pour lui expliquer l'emploi qu'il faisait de ses capitaux. Toutefois, ce n'était point qu'il eût l'intention de recourir aux lumières de son beau-frère et de lui demander conseil; c'était uniquement par orgueil et pour faire sentir au chef d'autrefois que désormais l'ancien subordonné n'avait plus besoin de protection. Il avait placé une partie de ses millions dans les entreprises industrielles de la moderne Allemagne; il était actionnaire de fabriques d'armement grandes comme des villes, de compagnies de navigation qui lançaient tous les six mois un nouveau navire. L'empereur s'intéressait à ces affaires et voyait d'un bon œil ceux qui les soutenaient de leur argent. En outre, Karl avait acheté des terrains. A première vue, il semblait que ce fût une sottise d'avoir vendu les fertiles domaines de l'héritage pour acquérir des landes prussiennes qui ne produisaient qu'à force d'engrais; mais Karl, en tant que propriétaire terrien, avait place dans le «parti agraire», dans le groupe aristocratique et conservateur par excellence. Grâce à cette combinaison, il appartenait à deux mondes opposés, quoique également puissants et honorables: à celui des grands industriels, amis de l'empereur, et à celui des junkers, des gentilshommes campagnards, fidèles gardiens de la tradition et fournisseurs d'officiers pour les armées du roi de Prusse.