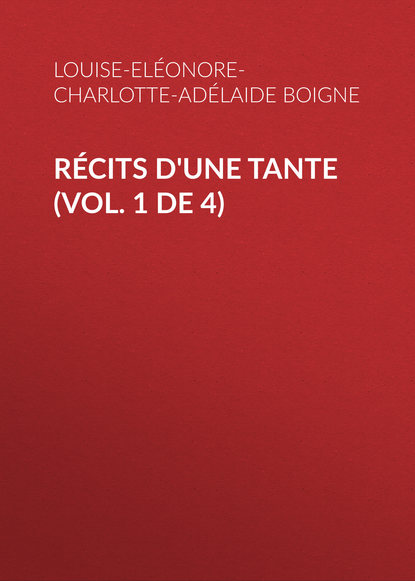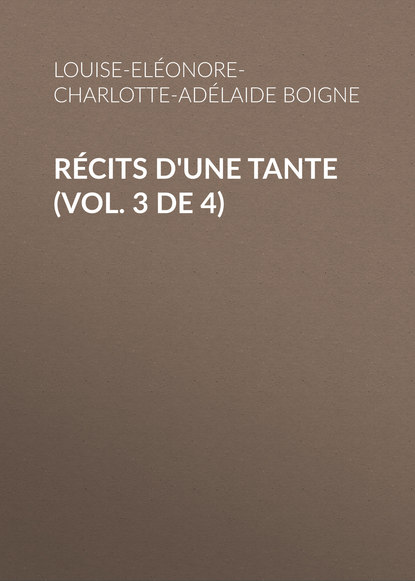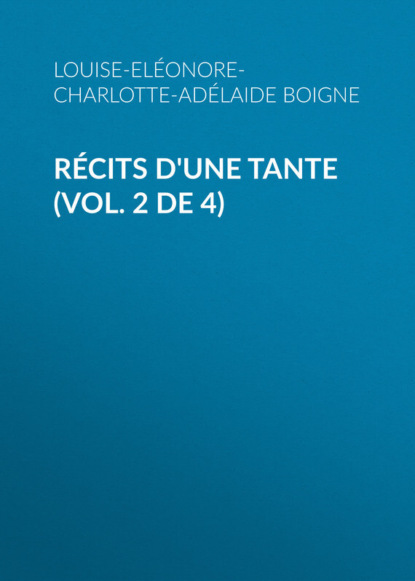Полная версия
Récits d'une tante (Vol. 4 de 4)
Et il portait ses mains sur son front avec désespoir: «Suis-je assez malheureux de me trouver une seconde fois dans une position où les devoirs se combattent si cruellement!»
Au reste, Arago me confirma le rapport de monsieur de La Rue sur l'obsession des gens dont le duc de Raguse était entouré, et sur la difficulté de l'entretenir un moment. Il me raconta l'absurde propos de monsieur de Polignac et l'air niais avec lequel il avait répondu: «Eh bien! on tirerait aussi sur la troupe si elle se réunissait au peuple.»
De mon côté, je lui rapportai le message du maréchal, et je lui appris qu'il n'avait obtenu aucune réponse de Saint-Cloud à la démarche faite la veille par les commissaires.
«Si le maréchal, reprit Arago, n'a pas de nouvelles de Saint-Cloud, je suis moi, en revanche, plus avancé que lui. Monsieur le Dauphin m'a expédié un courrier porteur d'un billet de sa main.
– Vraiment! et que vous dit-il?
– Il me demande le degré exact du thermomètre dans la journée d'hier.»
Les bras tombent à pareille révélation! Pour ne pas la traiter de fable, il faut savoir que, dans leur intérieur, les princes de la famille royale s'occupaient extrêmement de l'état du ciel, non dans l'intérêt de la science, mais dans celui de la chasse. L'usage était établi entre eux de se faire part chaque jour de leurs observations; et le plus ou moins d'exactitude de leur thermomètre et de leur baromètre était devenu une sorte de préoccupation, surtout pour monsieur le Dauphin. Or, dans leur existence si éminemment princière, rien ne dérangeait ces niaiseries habituelles, devenues une sorte d'étiquette.
L'homme que j'avais envoyé le matin à l'état-major s'était muni pour revenir d'une carte à l'aide de laquelle il prétendait pouvoir y retourner. Nous remarquâmes, en effet, qu'elle portait la permission de circuler pour le service de monsieur le maréchal.
Arago se mit à écrire une lettre où il lui disait la ville entière soulevée, la population de toutes les classés en pleine insurrection, les réunions politiques s'organisant. Il avait connaissance de beaucoup de gens y prenant part; on lui avait déjà fait des propositions; il était question d'un gouvernement provisoire; la cocarde tricolore était décidée; le Roi ne conservait de chance qu'en l'adoptant et en proclamant l'abandon du système absolutiste qui allait amener une guerre civile dont il serait incontestablement victime.
Pour lui, duc de Raguse, il y avait encore un beau rôle de médiateur à jouer, mais pas un instant à perdre. La retraite des ministres l'ayant laissé seul maître à Paris, il fallait proclamer l'amnistie sur ce qui s'était passé, faire des conditions au Roi et le sauver malgré lui en mettant les troupes en position de passer du côté où l'on céderait aux véritables besoins du pays.
J'ajoutai quelques mots à cette lettre d'Arago, et je la remis à mon homme en lui recommandant de ne pas s'exposer.
À peine était-il parti que le bruit des fusillades recommença. Il augmenta en se rapprochant. Nous en entendîmes une très vive dans la direction de la place Louis XV. Nous nous précipitâmes à la fenêtre; nous vîmes courir dans la rue du faubourg Saint-Honoré. Un peloton de soldats se présenta devant la barricade, et fut obligé de retourner. La fusillade se fit entendre dans les Champs-Élysées. Il y eut un temps d'arrêt à la hauteur de l'avenue de Marigny; plusieurs décharges consécutives y furent faites. Puis le bruit du feu s'éloigna encore; tout cela ne dura pas dix minutes. Nous ne comprenions rien à cette manœuvre.
Mon messager, dont je commençais à être fort inquiète, revint. Il rapportait notre lettre. Il était parvenu assez facilement à l'état-major. Il avait trouvé les appartements déserts et pénétré jusque dans la chambre du maréchal, toutes les portes étant ouvertes, sans trouver personne à qui parler. S'approchant de la fenêtre, il avait vu les grilles de la cour fermées et les troupes passant en toute hâte sous le pavillon de l'horloge. Le peuple était maître du Carrousel. En redescendant, il avait rencontré monsieur de Glandevès, qu'il connaissait, entrant précipitamment dans un escalier souterrain qui communique sous le guichet avec le palais; il lui avait demandé où il trouverait le maréchal. Monsieur de Glandevès avait l'air fort agité et fort pressé; il lui avait répondu: «Le maréchal doit être dans le jardin des Tuileries; mais il n'y a aucun moyen d'arriver à lui, et je vous conseille de vous en aller le plus vite que vous pourrez.» Profitant de cet avis, il était revenu sans chercher davantage à remplir sa commission; il n'en savait pas plus long.
Nous ne tardâmes pas à apprendre la prise du Louvre, l'abandon des Tuileries, l'évacuation entière de Paris, après un moment d'arrêt à la barrière de l'Étoile, et la marche de toutes les troupes sur Saint-Cloud.
À peine cette nouvelle fut-elle répandue qu'elle fit sur la population l'effet le plus marqué. Il semblait un vase bouillonnant qu'on écarte du feu; tout s'apaisa en un clin d'œil. J'ignore quelles passions s'agitaient dans l'âme de quelques factieux et s'exhalaient peut-être aux environs de l'Hôtel de Ville, mais le reste de la ville reprit une attitude très calme.
La seule autorité reconnue était celle des élèves de l'École polytechnique; ils s'étaient distribué tous les postes. En outre de la bravoure qu'ils avaient montrée dans les combats de la veille et du matin, ils devaient leur importance à ce que seuls ils portaient un uniforme. Les défenseurs des barricades les appelaient: «Mon petit général», et leur obéissaient d'autant plus implicitement que le genre de leurs connaissances était aussi fort utile à la prompte construction de ces barricades. Ils aidaient à les faire et à les défendre.
Au surplus, c'est une circonstance assez remarquable que la considération accordée par le peuple, à cette époque, aux personnes qui semblaient appartenir aux classes plus élevées de la société. Tout homme ayant un habit, et voulant se mêler à un groupe, commandait sans difficulté les gens en veste.
Je me sers mal à propos du mot en vestes; le costume adopté était un pantalon de toile et une chemise avec les manches retroussées. Il faisait, à vrai dire, une chaleur étouffante. Souvent ces légers vêtements et les bras même portaient des traces du combat. Les figures étaient noircies par la poudre et pourtant n'avaient rien d'effrayant; elles annonçaient le calme de la défense et la conscience du bon droit. Une fois la chaleur du combat passée, c'était une ville de frères.
Monsieur Arago me quitta. Je reçus quelques visites. La circulation se rétablissait pour les piétons. Monsieur de Salvandy arrivait d'Essonnes; il y avait été la veille au soir. Sur toute la route, on s'était précipité au-devant de lui pour demander des nouvelles. La population des campagnes partageait les sentiments et la confiance de celle de Paris. On s'adressait à lui (un passant inconnu, ne doutant pas qu'il ne formât des vœux pour le succès des efforts parisiens); partout il avait vu les hommes se préparant à y joindre les leurs.
À Essonnes, la garde nationale, s'étant emparée de la poudrière, au risqué de tous les dangers d'une pareille entreprise avait rempli un grand bateau de poudre et le conduisit sur la rivière, couvert de banderolles tricolores, aux cris de «Vive la Charte» et aux acclamations de toutes les populations riveraines.
Cependant, on ne pouvait se persuader que la Cour tînt la partie pour perdue. Nous pensions que, renforcé par des troupes fraîches, on ferait une nouvelle tentative sur Paris, probablement la nuit suivante.
Je me décidai à sortir sur les trois heures. Monsieur de Salvandy me donna le bras. Il ne doutait pas d'une attaque pour la nuit. J'étais logée dans un des endroits les plus exposés si on rentrait par où on était sorti; je ne voulais pas effrayer chez moi en chargeant mes gens de cette commission, et j'allai moi-même chez madame de Jumilhac, dans la rue Neuve-des-Mathurins, prévenir son portier de m'ouvrir si je venais frapper la nuit.
Au retour, je visitai le boulevard, encombré d'arbres abattus et de tout ce qu'on avait pu se procurer dans le voisinage, pour construire des barricades. Celles-là étaient fort incommodes à franchir: il fallait escalader les unes, ramper sous les autres. Mais partout les gens qui les gardaient offraient une assistance également obligeante et gaie, appelant le plus propre d'entre eux pour ne pas salir les vêtements des dames: pas un propos grossier; jamais la politesse et l'urbanité n'ont mieux régné dans Paris. Un instinct secret semblait avertir que le moindre choc pouvait amener une explosion. Au reste, la pensée d'une opposition aux événements qui se passaient ne venait à personne.
Je parvins à la rue de Rivoli. Il y avait à peine trois heures qu'on s'y battait avec fureur. Les grilles du jardin des Tuileries étaient fermées et gardées par des sentinelles portant le costume que j'ai décrit. Je vis dans la rue une barricade s'élevant très haut et composée des chaises du jardin.
Au moment où je passai, une assez grande quantité de dames avaient en partie dérangé cette barricade. Elles s'étaient emparées de quelques chaises et là, bien mises, bien parées, avec des chapeaux élégants à plumes ou à fleurs, elles étaient tranquillement assises, à l'ombre de leurs ombrelles et de la barricade, comme elles l'auraient été sous les arbres des Tuileries. Au reste, ce spectacle curieux s'est continué jusqu'au dimanche où le jardin a été remis en possession de ses sièges.
J'entrai chez l'ambassadeur de Russie; je ne l'avais pas vu depuis l'avant-veille. Je le trouvai fort troublé; il avait eu sous les yeux la débandade des troupes et me la raconta en détail. Il était aussi surpris qu'indigné de n'avoir reçu aucune communication de monsieur de Polignac dans de telles conjonctures. Il l'était beaucoup aussi des joies de lord Stuart, l'ambassadeur d'Angleterre; elles étaient poussées jusqu'à l'indécence.
Pozzo croyait, lui aussi, à la probabilité d'une attaque sur Paris, et s'inquiétait fort de la position de son hôtel. Du reste, il n'y avait aucun parti pris dans son esprit; il était alarmé, troublé, effrayé, et se disait malade pour expliquer sa contenance.
Je rentrai chez moi. J'envoyai acheter quelques jambons, un sac de riz et un sac de farine. Je m'attendais que ces objets auraient augmenté de prix; ils n'avaient pas varié, tant la sécurité était grande.
J'allai chez madame de Rauzan. Sa belle-sœur, madame de La Bédoyère, y était au désespoir. La pauvre femme pensait peut-être au sang si inutilement versé, il y avait quinze ans, pour arriver à un pareil résultat. Elle se tordait les mains.
C'est la seule personne véritablement affligée que j'aie vue dans ce moment. J'exprimai devant elle l'espèce de sentiment d'enthousiasme pour ce peuple si grand, si brave, si magnanime, que j'avais conçu pendant ma promenade, et je lui fis horreur. Je la consolai un peu en parlant du danger, présumé de tout le monde, que nous courions d'être attaqués pendant la nuit.
Monsieur de Rauzan hocha la tête. À l'état-major, le même matin, il avait entendu le général Vincent répondre à monsieur de Polignac, qui excitait à faire marcher des colonnes dans la ville comme la veille, que cent mille hommes ne seraient pas en possibilité de traverser Paris dans l'état de défense et d'exaltation où il se trouvait.
La pauvre madame de La Bédoyère fut obligée de se contenter de l'espoir, donné par un certain monsieur Denis Benoit, qu'on réussirait du moins à affamer la capitale. Cette pensée augmenta pourtant son très vif désir d'en sortir. Tous ses sentiments se trouvaient assurément bien éloignés des miens, et pourtant ils étaient si profondément vrais, si sincèrement passionnés que, ni dans le moment, ni par le souvenir, ils ne m'ont causé la moindre irritation contre elle.
Madame de Rauzan se tourmentait pour son père, le duc de Duras. Il était de service à Saint-Cloud; elle n'en avait pas entendu parler depuis le lundi où il était venu lui apprendre, avec des transports de joie, les ordonnances et qu'enfin le Roi régnait. C'était l'expression adoptée au château.
Nous convînmes de continuer à nous, communiquer tout ce que nous apprendrions de part et d'autre. En effet, soit chez elle, soit chez moi, nous nous retrouvions dix fois dans la journée.
Placée à ma fenêtre, je vis un vieux chanteur des rues arrivant par la rue de Surène. Il s'arrêta à la barricade de la rue du faubourg Saint-Honoré, où il y avait une cinquantaine d'hommes réunis, et là, tout en ayant l'air de les aider à assujétir les pavés, qui se dérangeaient sans cesse par les passages auxquels personne ne s'opposait, il entonna, avec une très belle voix et une prononciation fort nette, une chanson, en cinq couplets, en l'honneur de Napoléon II, dont le refrain, autant que je puis m'en souvenir, était: «Sans le faire oublier, le fils vaudra le père.»
Cela ne fit pas la plus légère sensation. À peine si on l'écouta. Sa chanson finie, il franchit la barricade, et s'en alla plus loin chercher un autre auditoire que, probablement, il trouva également inattentif.
J'ai déjà beaucoup parlé de cette barricade, et j'en parlerai encore. D'une fenêtre, où je me tenais habituellement, je voyais et j'entendais tout ce qui s'y passait. Ce point était devenu un centre; les voisins s'y réunissaient autour des vingt-cinq ou trente hommes de garde. Ceux-ci n'en ont bougé que lorsqu'ils ont été relevés par un élève de l'École polytechnique et remplacés par d'autres, après vingt-huit heures de faction pendant lesquelles les gens du quartier avaient soin de leur porter à manger et à boire.
J'ai pris simplement l'engagement de dire ce que j'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles; j'entre donc sans scrupule dans tous ces détails. D'ailleurs, ce qui se passait sur ce petit théâtre se renouvelait à l'embranchement de chaque rue dans la ville, et peut donner une idée assez exacte de la situation générale.
J'affirme positivement que, pendant toute cette journée et celles qui l'ont suivie, je n'ai recueilli d'autres cris que celui de: Vive la Charte, et personne ne m'a rapporté en avoir entendu un autre. Il faut faire une grande différence entre l'esprit qui régnait véritablement dans la ville et celui qui pouvait éclater aux entours de l'Hôtel de Ville. Là, des meneurs factieux appelaient une révolution; partout ailleurs on voulait seulement éloigner les gens qui prétendaient établir l'absolutisme. On aurait, ce jeudi-là, traîné le roi Charles X en triomphe s'il avait rappelé ses ordonnances et changé son ministère. Aurait-il pu régner après une telle concession? C'est une question que je ne puis ni discuter, ni résoudre; je prétends seulement conclure que la Charte établie répondait aux vœux de tous en ce moment.
Je reviens à mon récit. J'entendis bientôt de grands cris; ils paraissaient de joie, mais tout effrayait alors. En montant sur une terrasse, je parvins à découvrir un énorme drapeau tricolore arboré sur le sommet de l'église, non encore achevée, de la Madeleine; il remplaçait le drapeau noir qui y flottait la veille.
Depuis, j'ai vu une planche sur laquelle était grossièrement écrit: «Vive Napoléon II». Elle y est restée plusieurs jours et en a été ôtée, comme elle y avait été placée, sans que cela fit aucune sensation.
Il pouvait être sept heures environ lorsque de nouveaux cris, mais poussés dans la rue, me rappelèrent à la fenêtre. Je vis un groupe nombreux occupé à abaisser les barricades devant un homme et son cheval, l'un et l'autre couverts de poussière, haletants de chaud et de fatigue.
«Où loge le général Lafayette? criait-il.
– Ici, ici, répétaient cinquante voix.
– J'arrive de Rouen… je devance mes camarades… Ils vont arriver… voilà la lettre pour le général.
– C'est ici, c'est ici.»
Il apprit à la porte de la maison que le général logeait à l'état-major de la garde nationale, mais qu'il le trouverait plus sûrement à l'Hôtel de Ville.
«À l'Hôtel de Ville!», cria-t-on de toutes parts; et ce courrier en veste, avec sa bruyante escorte, se remit en route traversant toute la ville et racontant sa mission à chaque barricade. Peut-être est-il arrivé plusieurs de ces courriers.
Je ne sais à qui il faut attribuer l'invention de cette jonglerie; elle réussit parfaitement. Au bout de cinq minutes, tout le monde dans le faubourg Saint-Honoré avait la certitude que Rouen s'était insurgé, avait pendu son préfet, expulsé sa garnison et que sa garde nationale et sa population arrivaient immédiatement au secours des parisiens. Il semblait déjà voir les têtes de colonne. De tout cela il n'y avait pas un mot de vrai, mais les gens les mieux informés y ont cru, en partie, pendant vingt-quatre heures.
L'histoire du préfet pendu m'a toujours fait penser que cette ruse avait été inventée, par des gens assez compromis pour désirer voir le peuple se porter à des excès qui le rendissent irréconciliable avec Saint-Cloud.
Un pareil exemple ne s'offre pas par hasard à une multitude qu'on devait supposer bien préparée à toute espèce de cruautés par l'enivrement de la poudre et de la victoire. Si cet horrible plan fut conçu, il échoua; heureusement, elle n'en commit aucune.
Je me sers à dessein de l'expression d'enivrement de la poudre. Celui du vin n'était pas à craindre, car, dans cette semaine héroïque (on ne peut lui refuser ce nom), il n'y a pas eu un verre de vin débité dans aucun cabaret; et l'ivrogne le plus reconnu n'aurait pas voulu s'exposer à en boire. C'était bien assez de la chaleur, du soleil et des événements pour exalter les têtes.
Je vis revenir beaucoup de soldats de la garde. Les uns, soi-disant déguisés, avec une blouse sous laquelle passait leur chaussure militaire et portant encore la moustache, les autres tout bonnement en uniforme, mais sans armes. Tous étaient arrêtés à ma barricade, mais pour y recevoir des poignées de main. Il n'y avait plus la moindre hostilité contre eux; aussi n'en témoignaient-ils aucune de leur côté.
Je me rappelle avoir entendu un défenseur des barricades demander à un de ces soldats:
«Croyez-vous que nous serons attaqués cette nuit?
– Non, je ne crois pas que nous le soyons», répondit-il.
On ne peut faire plus complètement cause commune; et les interlocuteurs de ce singulier colloque n'en semblaient nullement étonnés.
Vers la fin du jour, j'entendis une voix bien connue demander si j'y étais. Je me précipitai sur l'escalier au-devant de monsieur de Glandevès, gouverneur des Tuileries. Mon homme l'avait vu le matin, au moment où le château avait été envahi; j'en étais fort inquiète, et j'éprouvai une grande joie à le voir. Nous nous embrassâmes avec de vrais transports. Il me raconta qu'il avait encore trouvé son appartement libre.
La présence d'esprit de son cuisinier, qui avait adopté bien vite le costume de rigueur et un fusil sur l'épaule, s'était mis en sentinelle devant sa porte et en avait refusé l'entrée avec ces seuls mots: «J'ai ma consigne, on ne passe pas», lui avait laissé le temps d'ôter son uniforme, de prendre son argent et ses papiers. Deux fourriers du palais, en chemise à manches retroussées, en pantalon et le fusil sur l'épaule, l'avaient escorté jusque dans la rue Saint-Honoré, d'où il avait gagné la maison de sa sœur dans la rue Royale. Il comptait s'y tenir caché, mais, voyant tout si tranquille, il avait essayé de venir chez moi. Il y était arrivé à travers les barricades et les politesses de leurs gardiens.
Il me raconta toutes les folies de ce malheureux Polignac pendant ces journées, sa confiance béate et niaise, et, en même temps, sa disposition à la cruauté et à l'arbitraire, son mécontentement contre le maréchal de ce qu'il se refusait à faire retenir, comme otages, les députés venus en députation chez lui, le mercredi matin. Il s'en était expliqué avec une extrême amertume à monsieur de Glandevès, en disant qu'une telle conduite, si elle n'était pas celle d'un traître, était au moins d'une inconcevable faiblesse.
Monsieur de Glandevès ayant répondu qu'il comprenait très bien le scrupule du maréchal, monsieur de Polignac reprit: «Cela n'est pas étonnant quand on vient de serrer la main à monsieur Casimir Perier!
– Oui, monsieur, je lui ai serré la main, je m'en fais honneur, et je serai le premier à le dire au Roi.
– Le premier, non,» répliqua monsieur de Polignac en s'éloignant pour aller raconter à un autre comment le refus du duc de Raguse était d'autant moins justifiable que, l'ordre d'arrêter ces messieurs étant donné d'avance, on devait reconnaître le doigt de Dieu dans leur présence aux Tuileries. Il les y avait amenés tout exprès pour subir leur sort; mais il y avait de certains hommes qui ne voulaient pas reconnaître les voies de la Providence…
Ce discours se tenait à un séide de la veille. Monsieur de Polignac ne savait pas qu'ils sont rarement ceux du lendemain, ou plutôt il ne croyait pas en être au lendemain. Cependant ses paroles furent répétées sur-le-champ avec indignation.
Monsieur de Glandevès me raconta aussi le désespoir de ce pauvre maréchal, et la façon dont il était entouré et dominé par les ministres qui ne lui laissaient aucune initiative, tout en n'ayant rien préparé. À chaque instant, il lui arrivait des officiers:
«Monsieur le maréchal, la troupe manque de pain.
– Monsieur le maréchal, il n'y a pas de marmite pour faire la soupe.
– Monsieur le maréchal, les munitions vont manquer.
– Monsieur le maréchal, les soldats périssent de soif, etc., etc.»
Pour remédier à ce dernier grief, le maréchal supplia qu'on donnât du vin des caves du Roi pour soutenir la troupe, sans pouvoir l'obtenir. Ce fut Glandevès qui fit apporter deux pièces de son vin pour désaltérer et alimenter un peu les soldats qui se trouvaient dans la cour du palais. Notez bien que ces pauvres soldats ne pouvaient rien se procurer par eux-mêmes, car pas une boutique n'aurait été ouverte pour eux.
Voici comment monsieur de Glandevès me raconta l'événement du matin. Après une tournée faite avec le maréchal aux postes environnant les Tuileries, pendant qu'ils attendaient bien anxieusement les réponses aux messages portées à Saint-Cloud par messieurs de Sémonville et d'Argout, ils rentrèrent à l'état-major.
Le maréchal lui dit: «Glandevès, faites-moi donner à manger; je n'ai rien pris depuis hier, je n'en puis plus.
– Venez chez moi, tout y est prêt, ce sera plus vite fait.» Les ministres y avaient déjeuné avant leur départ pour Saint-Cloud. Le maréchal était monté chez lui. À peine assis à table, ils avaient entendu quelques coups de fusil du côté du Louvre, puis davantage. Monsieur de Glandevès s'était écrié:
«Maréchal, qu'est-ce que c'est que cela?
– Oh! de ce côté-là, cela ne peut pas inquiéter… Ah! mon Dieu! cette réponse n'arrivera donc pas!»
Cependant, au bout d'une minute, le maréchal avait repris: «Cela augmente, il faut aller y voir.» Ils étaient redescendus à l'état-major; le maréchal avait saisi son chapeau, et courut rejoindre ses chevaux placés devant les écuries du Roi. Pendant ce court trajet, monsieur de Glandevès lui avait dit:
«Maréchal, si vous vous en allez, vous me ferez donner un cheval de dragon; je ne veux pas rester ici tout seul.
– Êtes-vous fou? Il faut bien attendre ici la réponse de Saint-Cloud.»
En disant ces paroles, le maréchal montait à cheval. À peine en selle, il avait aperçu la colonne des Suisses fuyant à toutes jambes à travers le Carrousel; il n'avait exprimé son sentiment que par un jurement énergique, et était parti au galop pour tâcher vainement d'arrêter les Suisses.
À peine quelques secondes s'étaient écoulées que monsieur de Glandevès avait vu le maréchal, avec une poignée de monde, travaillant à faire fermer les grilles de la cour, et toutes les troupes, y compris l'artillerie, filant au grand galop à travers le palais. Sous le pavillon de l'Horloge, le peuple poursuivant les soldats avait débouché par la rue du Louvre; il occupait déjà les appartements du Roi où il était entré par la galerie des tableaux.
Le pauvre Glandevès, se trouvant seul de sa bande en grand uniforme au milieu du Carrousel, courut de toutes ses forces pour regagner le petit escalier de l'état-major. On tira sur lui, mais sans l'atteindre. C'était dans le moment où il entrait dans le passage souterrain qui conduit de l'état-major au palais que mon valet de chambre l'avait aperçu et lui avait parlé. On comprend, du reste, qu'il eût l'air fort troublé.
Il m'apprit aussi qu'Alexandre de Laborde faisait partie d'un gouvernement provisoire réuni à l'Hôtel de Ville, et me demanda si j'étais en mesure d'obtenir de lui une permission de passer les barricades pour se rendre à Saint-Cloud. Je me mis tout de suite à écrire un billet à monsieur de Laborde que j'envoyai chez lui.