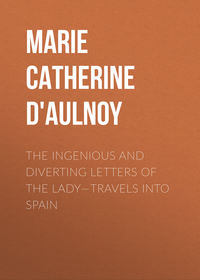Полная версия
La cour et la ville de Madrid vers la fin du XVIIe siècle
Ma fille était si aise qu'il ne tint pas à elle que nous ne retournassions sur nos pas, pour mettre à la porte de la cave quelques perdrix rouges que mes gens venaient d'acheter. Elle comprenait que les mânes de la princesse seraient fort consolées de recevoir ce témoignage de notre bonne volonté; mais pour moi je compris que je serais plus contente qu'elle d'avoir ces perdrix à mon souper. Nous passâmes la rivière d'Urola sur un grand pont de pierre; et, après en avoir traversé un autre à gué assez difficilement, à cause des neiges fondues, nous arrivâmes à Miranda d'Ebro. C'est un gros bourg ou une fort petite ville. Il y a une grande place ornée de fontaines. La rivière de l'Èbre, qui est une des plus considérables de l'Espagne, la traverse; l'on voit sur le haut d'une montagne le château avec plusieurs tours. Il paraît être de quelque défense, et il sort une si grosse fontaine d'un rocher sur lequel il est bâti, que dès sa source elle fait moudre des moulins. Du reste, je n'y remarquai rien qui mérite de vous être écrit. Les trois chevaliers, dont je vous ai déjà parlé, étaient arrivés avant moi et ils avaient donné tous les ordres nécessaires pour le souper. Ainsi nous mangeâmes ensemble, et bien que la nuit parût avancée, parce que les jours sont courts en cette saison, il n'était pas tard. De sorte que ces Messieurs, qui ont beaucoup d'honnêteté et de complaisance pour moi, me demandèrent ce que je voulais faire. Je leur proposai de jouer à l'hombre, et dis que je me mettrais de moitié avec Don Fernand de Tolède. Ils acceptèrent la partie. Don Frédéric de Cardone dit qu'il aimerait mieux m'entretenir que de jouer. Ainsi les trois autres commencèrent, et je m'arrêtai quelque temps à les voir avec beaucoup de plaisir, car leurs manières sont tout à fait différentes des nôtres. Ils ne prononcent jamais un mot, je ne dis pas pour se plaindre (cela serait indigne de la gravité espagnole), mais je dis pour demander un gano, pour couper de plus haut ou pour faire entendre que l'on peut prendre quelque autre avantage. Enfin il semble des statues qui agissent par le moyen d'un ressort, et il est vrai qu'ils se reprocheraient à eux-mêmes le moindre geste.
Après les avoir examinés, je passai vers le brasier et Don Frédéric s'y plaça près de moi; il me demanda en quel état étaient les affaires lorsque j'étais partie de Paris; qu'il m'avouait que les grandes qualités du roi de France faisaient bien souvent le sujet de ses plus agréables réflexions; qu'il avait eu l'honneur de le voir, que son idée lui était toujours présente et que, depuis ce temps-là, il en avait parlé comme d'un monarque digne de l'amour de ses sujets et de la vénération de tout le monde. Je lui répliquai que les sentiments qu'il avait pour le Roi me confirmaient la bonne opinion que j'avais déjà de son esprit et de ses lumières; qu'il était certain que nos ennemis et les étrangers ne pouvaient, sans admiration, entendre parler des grandes actions de ce monarque, de sa conduite, de sa bonté pour ses peuples et de sa clémence. Que, quelque temps avant mon départ, on avait reçu les nouvelles de la ratification de la paix avec la Hollande; qu'il savait assez combien la guerre, qui avait commencé en 1672, avait intéressé de princes; que les Hollandais, mieux conseillés que les autres, avaient fait leur paix, et que le traité qui venait d'être conclu à Nimègue était su de toute l'Europe, et lui rendait la tranquillité qu'elle avait perdue.
J'ajoutai à cela que le roi venait de réduire ses compagnies de cavalerie à trente-sept maîtres et celles de dragons à quarante-cinq; que cette réforme allait à quatre mille chevaux, et que celle qu'il avait encore faite de quinze soldats par compagnie d'infanterie, montait à quarante-cinq mille hommes; qu'il avait aussi retranché dix hommes par chaque compagnie de cavalerie, ce qui allait à douze mille chevaux; que tout cela faisait voir ses dispositions pour entretenir les traités de bonne foi.
Il me répondit que le Roi son maître n'y était pas moins disposé; qu'il l'en avait entendu parler plusieurs fois, et qu'il y avait peu qu'il l'avait quitté; qu'il s'était rendu auprès de lui parce qu'il avait été député par la principauté de Catalogne, avec ceux du royaume de Valence, pour le supplier de faire sortir de leur pays les troupes qui y sont en quartier d'hiver; que bien loin de l'obtenir, ils s'estimaient heureux qu'on ne leur eût pas donné quelques-unes de celles qui étaient venues de Naples et de Sicile; qu'ils avaient paré les coups avec bien de la peine; qu'on les avait envoyées sur les frontières du Portugal et dans les royaumes de Galice et de Léon. Mais, continua-t-il, si on nous avait secondés, ce ne serait pas, à présent, au roi d'Espagne que nous nous adresserions pour être soulagés. Les peuples de Catalogne, accablés de l'oppression et de la violence inouïe des Castillans, cherchèrent, en 1640, les moyens de s'en affranchir. Ils se mirent sous la protection du Roi Très-Chrétien et, pendant l'espace de douze ans, ils s'y trouvèrent fort heureux. Les guerres civiles qui troublèrent le repos dont la France jouissait, lui ôtèrent les moyens de nous secourir contre le roi d'Espagne. Il sut bien profiter de la conjoncture, et il réunit Barcelone, avec la plus grande partie de cette principauté, sous son obéissance17. Je lui demandai s'il retournerait bientôt en ce pays-là; il me dit que la duchesse de Medina-Celi, sa proche parente, venait de gagner un grand procès contre la duchesse de Frias, sa belle-mère, femme du connétable de Castille; qu'il s'agissait du duché de Segorbe, dans le royaume de Valence, et du duché de Cardone, dans la principauté de Catalogne; que madame de Medina-Celi prétendait à ces deux terres, comme fille aînée et héritière du duc de Cardone; que la duchesse de Frias, l'ayant épousé en premières noces, en était en possession par le testament de son mari, qui lui en avait laissé la jouissance sa vie durant; mais qu'enfin madame de Frias avait été condamnée à rendre les terres à la duchesse de Medina-Celi, avec les jouissances de neuf ans, qui montaient à quarante mille écus par an18; qu'elle voulait l'engager d'aller, en son nom, prendre possession du duché de Cardone et qu'il ne pensait pas qu'il pût la refuser.
Il me dit ensuite qu'il y avait deux choses assez singulières dans ce duché, dont l'une est une montagne de sel, en partie blanche comme la neige, et l'autre plus claire et plus transparente que du cristal; qu'il y en a de bleu, de vert, de violet, d'incarnat, d'orangé et de mille couleurs différentes, qui ne laisse pas de perdre sa teinture et de devenir tout blanc quand on le lave; il s'y forme et y croît continuellement, et bien qu'il soit salé, et que d'ordinaire les endroits où l'on trouve le sel soient si stériles que l'on n'y voit pas même de l'herbe, il y a dans ce lieu-là des pins d'une grande hauteur et des vignobles excellents. Lorsque le soleil darde ses rayons sur cette montagne, il semble qu'elle soit composée des plus belles pierreries du monde, et le meilleur, c'est qu'elle est d'un revenu considérable19.
L'autre particularité dont il me parla, c'est d'une fontaine dont l'eau est très-bonne et la couleur pareille à du vin clairet. On ne m'a rien dit de celle-là, interrompis-je; mais un de mes parents, qui a été en Catalogne, m'a assuré qu'il y en a une, près de Balut, dont l'eau est de sa couleur naturelle, et cependant tout ce que l'on y met est comme de l'or. Je l'ai vue, Madame, continua Don Frédéric, et je me souviens qu'un homme fort avare et encore plus fou y allait tous les jours jeter son argent, parce qu'il croyait qu'il se changerait en or; mais il se ruinait, bien loin de s'enrichir, car quelques paysans plus fins et plus habiles que lui, ayant aperçu ce qu'il faisait, attendaient un peu plus bas, et le coulant de l'eau leur conduisait cet argent. Si vous retourniez en France par la Catalogne, ajouta-t-il, vous verriez cette fontaine. Ce ne serait pas elle qui pourrait m'y attirer, lui dis-je, mais l'envie de passer par le Montserrat me ferait faire un plus long voyage. Il est situé, dit-il, proche de Barcelone, et c'est un lieu d'une grande dévotion: il semble que le rocher est scié par la moitié; l'église est un peu plus haut, petite et obscure. A la clarté de quatre-vingt-six lampes d'argent, on aperçoit l'image de la Vierge qui est fort brune, et que l'on tient pour miraculeuse. L'autel a coûté trente mille écus à Philippe second, et l'on y voit chaque jour des pèlerins de toutes les parties du monde. Ce saint lieu est rempli de plusieurs ermitages, habités par des solitaires d'une grande piété.
Ce sont, pour la plupart, des personnes de naissance, qui n'ont quitté le monde qu'après l'avoir bien connu et qui paraissent charmés des douceurs de leur retraite, bien que le séjour en soit affreux et qu'il eût été impossible d'y aborder si l'on n'avait pas taillé un chemin dans les rochers. On ne laisse pas d'y trouver plusieurs beautés, une vue admirable, des sources de fontaine, des jardins très-propres, cultivés de la main de ces bons religieux, et partout un certain air de solitude et de dévotion qui touche ceux qui s'y rendent. Nous avons encore une autre dévotion fort renommée, ajouta-t-il: c'est Nuestra Señora del Pilar. Elle est à Saragosse, dans une chapelle, sur un pilier de marbre; elle tient le petit Jésus entre ses bras. On prétend que la Vierge apparut sur ce même pilier à saint Jacques, et l'on en vénère l'image avec beaucoup de respect. On ne peut la remarquer fort bien, parce qu'elle est élevée et dans un lieu si obscur que, sans les flammes qui l'éclairent, on ne s'y verrait pas. Il y a toujours plus de cinquante lampes allumées; l'or et les pierreries brillent de tous côtés, et les pèlerins y viennent en foule20. Mais, continua-t-il, je puis dire, sans prétention pour Saragosse, que c'est une des plus belles villes qu'on puisse voir. Elle est située le long de l'Èbre, dans une vaste campagne; elle est ornée de grands bâtiments, de riches églises, d'un pont magnifique, de belles places et des plus jolies femmes du monde, agréables, vives, qui aiment la nation française et qui n'oublieraient rien pour vous obliger à dire du bien d'elles, si vous y passiez. Je lui dis que j'en avais déjà entendu parler d'une manière très-avantageuse. Mais, continuai-je, ce pays est fort stérile, et les soldats n'y subsistent qu'avec beaucoup de peine. En effet, répliqua-t-il, soit que l'air n'y soit pas sain, ou qu'il leur manque quelque chose, les Flamands et les Allemands n'y peuvent vivre; et s'ils n'y meurent pas tous, ils tâchent de trouver les moyens de déserter. Les Espagnols et les Napolitains sont encore plus portés qu'eux à cet esprit de désertion. Ces derniers passent par la France et retournent en leur pays; les autres côtoient les Pyrénées, le long du Languedoc et rentrent dans la Castille par la Navarre ou par la Biscaye. C'est une route que les vieux soldats ne manquent guère de tenir; pour les nouveaux, ils périssent dans la Catalogne, parce qu'ils n'y sont pas accoutumés, et l'on peut assurer qu'il n'y a pas de lieu où la guerre embarrasse tant le Roi d'Espagne qu'en celui-là. Il ne s'y soutient qu'avec beaucoup de dépense, et les avantages que les ennemis y remportent sur lui ne peuvent être petits. Je sais aussi que l'on est plus sensible à Madrid sur la moindre perte qui se fait en Catalogne, qu'on ne le serait sur la plus grande qui se ferait en Flandre, à Milan ou ailleurs. Mais à présent, continua-t-il, nous allons être plus tranquilles que nous ne l'avons été; l'on espère, à la Cour, que la paix sera de durée, parce que l'on y parle fort d'un mariage qui ferait une nouvelle alliance; et comme le marquis de Los Balbazes, plénipotentiaire à Nimègue, a reçu ordre de se rendre promptement auprès du Roi Très-Chrétien, pour demander Mademoiselle d'Orléans, l'on ne doute point que le mariage ne se fasse, et l'on pense déjà aux charges de sa maison. Il est vrai que l'on est surpris que don Juan d'Autriche consente à ce mariage. Vous me feriez un plaisir singulier, lui dis-je en l'interrompant, de m'apprendre quelques particularités de ce prince; il est naturel d'avoir de la curiosité pour les personnes de son caractère; et quand on se trouve dans une Cour où l'on n'a jamais été, pour n'y paraître pas trop neuve, on a besoin d'être un peu instruite. Il me témoigna que ce serait avec plaisir qu'il me dirait les choses qui étaient venues à sa connaissance, et il commença ainsi:
Vous ne serez peut-être pas fâchée, Madame, que je prenne les choses dès leur source, et que je vous dise que ce prince était fils d'une des plus belles filles qui fût en Espagne, nommée Maria Calderona. Elle était comédienne, et le duc de Medina-de-las-Torres en devint éperdument amoureux. Ce cavalier avait tant d'avantages au-dessus des autres, que la Calderona ne l'aima pas moins qu'elle en était aimée. Dans la force de cette intrigue, Philippe IV la vit et la préféra à une fille de qualité qui était à la Reine et qui demeura si piquée du changement du Roi, qu'elle aimait de bonne foi et dont elle avait eu un fils, qu'elle se retira à Las Descalzas Reales, où elle prit l'habit de religieuse. Pour la Calderona, comme son inclination se tournait toute du côté du duc de Medina, elle ne voulut point écouter le Roi qu'elle ne sût auparavant si le duc y consentirait. Elle lui en parla et lui offrit de se retirer secrètement en quelque lieu qu'il voudrait; mais le duc craignit d'encourir la disgrâce du Roi, et il lui répondit qu'il était résolu à céder à Sa Majesté un bien qu'il n'était pas en état de lui disputer. Elle lui en fit mille reproches; elle l'appela traître à son amour, ingrat pour sa maîtresse, et elle lui dit encore que s'il était assez heureux pour disposer de son cœur comme il le voulait, elle n'était pas dans les mêmes circonstances, et qu'il fallait absolument qu'il continuât de la voir, ou qu'il se préparât à la voir mourir de désespoir. Le duc, touché d'une si grande passion, lui promit de feindre un voyage en Andalousie et de rester chez elle, caché dans un cabinet. Effectivement, il partit de la Cour et fut ensuite s'enfermer chez elle, comme il en était convenu, quelque risque qu'il y eût à courir par une conduite si imprudente21. Le Roi, cependant, en était fort amoureux et fort satisfait. Elle eut dans ce temps-là don Juan d'Autriche, et la ressemblance qu'il avait avec le duc de Medina-de-las-Torres a persuadé qu'il pouvait être son fils; mais, bien que le Roi eût d'autres enfants, et particulièrement l'évêque de Malaga, la bonne fortune décida en sa faveur, et il a été le seul reconnu.
Les partisans de Don Juan disent que c'était en raison de l'échange qui avait été fait du fils de Calderona avec le fils de la reine Élizabeth, et voici comme ils établissent cet échange, qui est un conte fait exprès pour imposer aux peuples, et qui, je crois, n'a aucun fondement de vérité. Ils prétendent que le Roi était éperdument amoureux de cette comédienne; elle devint grosse en même temps que la Reine, et voyant que la passion du monarque était si forte qu'elle en pouvait tout espérer, elle fit si bien, qu'elle l'engagea de lui promettre que si la Reine avait un fils et qu'elle en eût un aussi, il mettrait le sien à sa place. Que risquez-vous, lui disait-elle, Sire? ne sera-ce pas toujours votre fils qui régnera, avec cette différence que, m'aimant comme vous me le dites, vous l'en aimerez aussi davantage22? Elle avait de l'esprit, et le Roi avait beaucoup de faiblesse pour elle. Il consentit à ce qu'elle voulait; et, en effet, l'affaire fut conduite avec tant d'adresse, que la Reine étant accouchée d'un fils et Calderona d'un autre, l'échange s'en fit; celui qui devait régner et qui portait le nom de Balthazar mourut à l'âge de quatorze ans. L'on dit au Roi que c'était de s'être trop échauffé en jouant à la paume; mais la vérité est qu'on laissait conduire ce prince par de jeunes libertins qui lui procuraient de fort méchantes fortunes. On prétend même que Don Pedro d'Aragon, son gouverneur et premier gentilhomme de sa chambre, y contribua plus qu'aucun autre, lui laissant la liberté de faire venir dans son appartement une fille qu'il aimait. Après cette visite, il fut pris d'une violente fièvre: il n'en dit point le sujet. Les médecins, qui l'ignoraient, crurent le soulager par de fréquentes saignées qui achevèrent de lui ôter le peu de force qui lui restait, et, par ce moyen, ils avancèrent la fin de sa vie. Le Roi sachant, mais trop tard, ce qui s'était passé, exila Don Pedro pour n'avoir pas empêché cet excès, ou pour ne pas l'avoir découvert assez tôt.
Cependant Don Juan d'Autriche, qui était élevé comme fils naturel, ne changea point d'état, bien que cela eût dû être, si effectivement il avait été fils légitime. Malgré cela, ses créatures soutiennent qu'il ressemble si parfaitement à la reine Élisabeth, que c'est son portrait; et cette opinion ne laisse pas de faire impression dans l'esprit du peuple qui court volontiers après les nouveautés, et qui aimait cette grande Reine si passionnément qu'il la regrette encore comme si elle venait de mourir; très-souvent même, l'on prononce son panégyrique, sans autre engagement que celui de la vénération que l'on conserve pour sa mémoire. Il est vrai que si Don Juan d'Autriche avait voulu profiter des favorables dispositions du peuple, il a trouvé bien des temps propres à pousser sa fortune fort loin. Mais son unique but est de servir le Roi et de tenir ses sujets dans les sentiments de fidélité qu'ils lui doivent.
Pour en revenir à la Calderona, le Roi surprit un jour le duc de Medina-de-las-Torres avec elle, et dans l'excès de sa colère il courut à lui, son poignard à la main. Il allait le tuer, lorsque cette fille se mit entre eux deux, lui disant qu'il pouvait la frapper s'il voulait. Comme il avait la dernière faiblesse pour elle, il ne put s'empêcher de lui pardonner, et il se contenta d'exiler son amant. Mais ayant appris qu'elle continuait à l'aimer et à lui écrire, il ne songea plus qu'à faire une nouvelle passion. Quand il en eut une assez forte pour n'appréhender point les charmes de la Calderona, il lui fit dire de se retirer dans un monastère, ainsi que c'est la coutume, lorsque le Roi quitte sa maîtresse. Celle-ci ne différa point; elle écrivit une lettre au duc pour lui dire adieu, et elle reçut le voile de religieuse de la main du nonce apostolique, qui fut depuis Innocent X23. Il y a beaucoup d'apparence que le Roi ne crut pas que Don Juan fût à un autre qu'à lui, puisqu'il l'aima chèrement. Une chose qui vous paraîtra assez singulière, c'est qu'un roi d'Espagne ayant des fils qu'il a reconnus ne peut les laisser entrer dans Madrid tant qu'il vit. Ainsi, Don Juan a été élevé à Ocaña, qui en est éloigné de quelques lieues. Le roi son père s'y rendait souvent, et il le faisait même venir aux portes de la ville, où il l'allait trouver. Cette coutume vient de ce que les grands d'Espagne disputent le rang que ces princes veulent tenir. Celui-ci, avant qu'il allât en Catalogne, demeurait d'ordinaire au Buen-Retiro, qui est une maison royale à l'une des extrémités de Madrid, un peu hors la porte. Il se communiquait si peu, qu'on ne l'a jamais vu à aucune fête publique pendant la vie du feu Roi; mais, depuis, les temps ont changé, et sa fortune est sur un pied fort différent.
Pendant que la reine Marie-Anne d'Autriche, sœur de l'Empereur et mère du Roi, gouvernait l'Espagne, et que son fils n'était pas encore en âge de tenir les rênes de l'État, elle voulut toujours que Don Juan fût éloigné de la cour; et d'ailleurs elle se sentait si capable de gouverner, qu'elle avait aussi fort grande envie de soulager longtemps le Roi du soin de ses affaires. Elle n'était point trop fâchée qu'il ignorât tout ce qui donne le désir, de régner: mais bien qu'elle apportât les dernières précautions pour l'empêcher de sentir qu'il était dans une tutelle un peu gênante, et qu'elle tâchât de ne laisser approcher de lui que les personnes dont elle pouvait s'assurer, cela n'empêcha pas que quelques-uns des fidèles serviteurs du Roi ne hasardassent tout pour lui faire comprendre ce qu'il pouvait faire pour sa liberté. Il voulut suivre les avis qu'on lui donnait, et enfin, ayant pris des mesures justes, il se déroba une nuit et fut au Buen-Retiro. Il envoya aussitôt un ordre à la Reine, sa mère, de ne point sortir du palais.
Don Juan est d'une taille médiocre, bien fait de sa personne; il a tous les traits réguliers, les yeux noirs et vifs, la tête très-belle; il est poli, généreux et fort brave. Il n'ignore rien des choses convenables à sa naissance, et de celles qui regardent toutes les sciences et tous les arts. Il écrit et parle fort bien en cinq sortes de langues, et il en entend encore davantage. Il a étudié longtemps l'astrologie judiciaire. Il sait parfaitement bien l'histoire. Il n'y a pas d'instrument qu'il ne sache et qu'il ne touche comme les meilleurs maîtres; il travaille au tour, il forge des armes, il peint bien. Il prenait fort grand plaisir aux mathématiques, mais, étant chargé du gouvernement de l'État, il a été obligé de se détacher de toutes ses autres occupations.
Il arriva au Buen-Retiro au commencement de l'année 1677, et aussitôt qu'il y fut, il fit envoyer la reine-mère à Tolède, parce qu'elle s'était déclarée contre lui et qu'elle empêchait son retour auprès du Roi. Don Juan eut une joie extrême de recevoir, par le Roi lui-même, l'ordre de pourvoir à tout et de conduire les affaires du royaume; et ce n'était pas sans sujet qu'il s'en déchargeait sur lui, puisqu'il ignorait encore l'art de régner. On apportait pour raison d'une éducation si tardive, que le roi son père était mourant quand il lui donna la vie; que même, lorsqu'il vint au monde, l'on fut obligé de le mettre dans une boîte pleine de coton, car il était si délicat et si petit qu'on ne pouvait l'emmaillotter; qu'il avait été élevé sur les bras et sur les genoux des dames du palais jusqu'à l'âge de dix ans, sans mettre une seule fois les pieds à terre pour marcher24; que dans la suite, la reine sa mère, qui était engagée par toutes sortes de raisons à conserver l'unique héritier de la branche espagnole, appréhendant de le perdre, n'avait osé le faire étudier de peur de lui donner trop d'application et d'altérer sa santé qui, dans la vérité, était fort faible; et l'on a remarqué que ce nombre de femmes avec lesquelles le Roi était toujours et qui le reprenaient trop aigrement des petites fautes qu'il commettait, lui avait inspiré une si grande aversion pour elles que, dès qu'il savait qu'une dame l'attendait en quelque endroit sur son passage, il passait par un degré dérobé, ou se tenait enfermé tout le jour dans sa chambre. La marquise de Los-Velez, qui a été sa gouvernante, m'a dit qu'elle a cherché l'occasion de lui parler six mois de suite fort inutilement. Mais, enfin, quand le hasard faisait qu'elles parvenaient à le joindre, il prenait le placet de leurs mains et tournait la tête, de crainte de les voir. Sa santé s'est si bien affermie, que son mariage avec l'archiduchesse, fille de l'Empereur, ayant été rompu par Don Juan, à cause que c'était l'ouvrage de la reine-mère, il a souhaité d'épouser Mademoiselle d'Orléans. Les circonstances de la paix qui vient d'être conclue à Nimègue lui firent jeter les yeux sur cette princesse, dont les belles qualités, Madame, vous sont encore mieux connues qu'à moi.
Il aurait été difficile de croire qu'ayant des dispositions si éloignées de la galanterie, il fût devenu tout à coup aussi amoureux de la Reine qu'il le devint sur le seul récit qu'on lui fit de ses bonnes qualités, et sur son portrait en miniature qu'on lui apporta. Il ne veut plus le quitter et le met toujours sur son cœur; il lui dit des douceurs qui étonnent tous les courtisans, car il parle un langage qu'il n'a jamais parlé; sa passion pour la princesse lui fournit mille pensées qu'il ne peut confier à personne; il lui semble que l'on n'entre pas assez dans ses impatiences, et dans le désir qu'il a de la voir; il lui écrit sans cesse, et il fait partir presque tous les jours des courriers extraordinaires pour lui porter ses lettres, et lui rapporter de ses nouvelles. Lorsque vous serez à Madrid, ajouta Don Frédéric, vous apprendrez, Madame, plusieurs particularités qui, sans doute, se seront passées depuis que j'en suis parti et qui satisferont peut-être plus votre curiosité que ce que je vous ai dit. Je vous suis très-obligée, répliquai-je, de votre complaisance; mais faites-moi la grâce encore de me dire quel est le véritable caractère des Espagnols. Vous les connaissez, et je suis persuadée que rien n'est échappé à vos lumières; comme vous m'en parlerez sans passion et sans intérêt, je pourrai m'en tenir à ce que vous m'en direz. Pourquoi croyez-vous, Madame, reprit-il en souriant, que je vous en parle plus sincèrement qu'un autre? il y a des raisons qui pourraient me rendre suspect; ils sont mes maîtres, je devrais les ménager, et si je ne suis pas assez politique pour le faire, le chagrin d'être contraint de leur obéir serait propre à me donner sur leur chapitre des idées contraires à la vérité. Quoi qu'il en soit, dis-je en l'interrompant, je vous prie de m'apprendre ce que vous en savez.