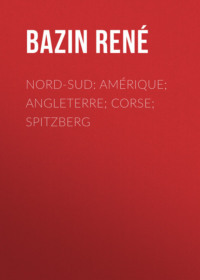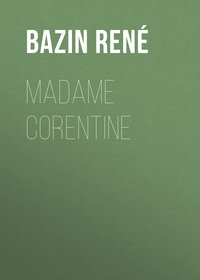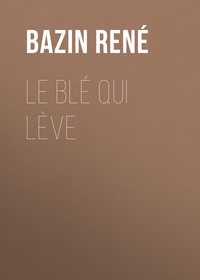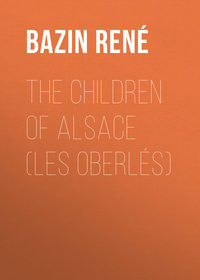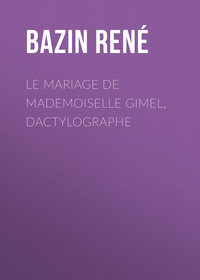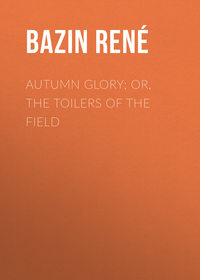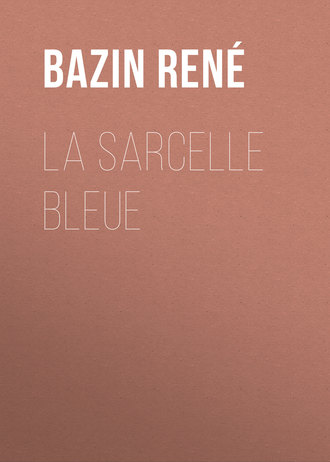
Полная версия
La Sarcelle Bleue
C'est que, pour lui, cette période du milieu de la vie avait été la plus heureuse. Sa jeunesse ne lui offrait rien de semblable, mais une enfance austère et contrainte dans un château des marches de Bretagne, parmi des horizons de landes trempées de longues pluies, entre son père vieux et rude et la seconde femme de celui-ci, créature faible et douce, opprimée, maladive, dont Robert voyait encore dans ses rêves l'éternel sourire triste; aucune gaieté pour répondre à celle de l'enfant, pas d'écho à ses jeux, – si ce n'est une petite fille née de ce second mariage, très gâtée, elle, très adulée, à peine connue de son aîné, – une instruction écourtée, puis le départ, une sorte de fuite hâtive, désirée de part et d'autre, pour l'armée, et alors, sans transition, l'Afrique, le régiment, la discipline avec ses rigueurs et ses relâches brusques, des mois de cruelle monotonie et des mois d'aventure à la suite des tribus arabes. Robert s'accoutuma vite. Il était né soldat. Il se retrouvait chez lui parmi les gens de guerre. Rien qu'à le voir passer, huit jours après son entrée au corps, cambré dans son dolman bleu de chasseur d'Afrique, on devinait le futur officier; on sentait dans ses yeux clairs, dans le pli relevé de sa bouche, toute l'ardeur superbe de la vie mêlée à l'insouciance du danger. Il n'avait, semblait-il, qu'à laisser faire au temps. Et certes, il y eut pour lui d'heureuses fortunes: les jours où l'on se battait d'abord, où l'on rentrait mourant de soif avec des fusils incrustés d'ivoire en travers de sa selle; la rencontre de Guillaume Maldonne, plus âgé que lui, engagé à la suite d'un coup de tête, leur amitié bientôt liée sous la tente, rapidement mûrie par le péril qui les pressait et les relâchait ensemble, et des actions d'éclat, et l'avancement rapide, et presque de la gloire. Ni les hasards, ni la misère, ni l'affection qui font les années inoubliables n'avaient manqué à celles-là. Cependant un voile d'ombre encore avait pesé sur elles. A peine Robert venait-il de gagner ses galons de brigadier, qu'il apprit la mort de son père. M. de Kérédol laissait de grosses dettes. Sans hésiter, sans recourir aux expédients commodes de la loi, son fils accepta la succession, résolu à tout vendre, le château, les terres, les meubles, à s'endetter lui-même, à se réduire au strict nécessaire tout le temps qu'il faudrait pour maintenir intact l'honneur de son vieux nom. Il y parvint, et paya tout. Mais au prix de quels sacrifices et de quelles humiliations! Lui, si fier, si hautain même, traqué par les créanciers, il dut se débattre au milieu d'affaires et de procédures devant lesquelles il était aussi neuf, aussi désarmé qu'un enfant.
L'épreuve dura des années. Il en sortait à peine, quand la guerre de 1870 éclata. Et la guerre, ce fut la fin de ses rêves de gloire et de sa carrière de soldat. Blessé d'un coup de feu à l'épaule, presque au début de la campagne, le lieutenant de Kérédol souffrit de longs jours, guérit à moitié, retomba, et, désespérant de pouvoir reprendre du service, donna sa démission.
Il venait d'avoir vingt-sept ans, et il se trouvait comme abandonné à mi-chemin de la vie. Où aller? Que faire, malade encore, sans carrière, sans métier, sans plus de ressources qu'une modique pension de blessé? Maldonne, qui aurait pu le conseiller, l'aider peut-être, sorti du régiment avant 1870 et retiré en Anjou, semblait avoir oublié son ancien ami. Le temps avait fait son œuvre. Pas une main ne se tendait vers Kérédol, pas un foyer ne s'ouvrait à lui.
Il voulut cependant faire un essai et se rapprocher de l'unique parente qui lui restât, de sa demi-sœur, qu'il avait à peine connue et aussi à peine aimée. Il la revit jeune fille, douce et affectueuse. La mère était morte. Geneviève de Kérédol vivait chez son grand-père maternel. Elle accueillit son frère avec des transports de joie. Mais celui-ci comprit vite qu'il ne pouvait se fixer près d'elle, chez un étranger, dans un domaine qui n'avait jamais appartenu aux siens. Et il ne savait que résoudre, quand une lettre arriva, qui le sauvait.
Oh! la bienheureuse lettre! Comme elle était venue inopinément greffer l'idylle sur ce drame brisé de la vie de soldat! Comme Robert la revoyait nettement et jusque dans les moindres détails de la forme matérielle qu'elle avait, longue, avec son enveloppe maculée de timbres, renvoyée de bureaux en bureaux, ses lignes serrées et bien ordonnées, que terminait un paraphe compliqué, déjà célèbre au régiment! Elle disait:
«Viens, mon ami! Ma maison est assez grande pour deux et de même la tâche que j'ai entreprise. Où peux-tu être? Comment se fait-il que tu n'aies pas pensé à ton vieux camarade, et que tu ne sois pas encore venu te soigner, te consoler et prendre chez lui ta retraite? Accours vite. J'ai le plus joli des métiers à t'offrir dès que tu seras guéri. Tu te souviens de ma passion pour l'histoire naturelle? Elle a décidé de mon sort. J'ai demandé, j'ai obtenu sans lutte un emploi peu envié, peu payé, mais qui me ravit. Me voici conservateur adjoint du musée d'ornithologie de la ville, à la tête d'une collection lamentable, fanée, honteuse, de quelques douzaines de pies et de passereaux auxquels la paille sort par le ventre. Tout est à faire. J'ai résolu de tuer moi-même, de préparer, de monter, d'étiqueter la collection complète de tous les oiseaux du département, de ceux qui passent et de ceux qui demeurent, de ceux qu'on rencontre tous les jours et de ceux qui ne se montrent qu'à de rares intervalles, comme des princes en visite. Déjà je suis à l'œuvre.
»Le préfet m'a délivré un permis de chasse permanent. J'en aurai un second pour toi. Songe, mon ami, quelle belle fin de carrière: la chasse toute l'année, le grand air, la liberté, les bois et l'amitié fidèle de ton compagnon d'armes,
»GUILLAUME MALDONNE,»Ancien marchef au 2e chasseurs d'Afrique.»Robert partit. Il guérit de sa blessure. Il fut bientôt en état de suivre son ami. Et alors commença pour tous deux l'odyssée la plus étonnante et la plus passionnante. Ils y retrouvaient chacun quelque chose de leur ancienne vie: l'aventure, l'émotion des poursuites, des alertes, des coups heureux ou manqués, les courses lointaines, les nuits à la belle étoile. Toutes les propriétés privées, les domaines princiers, les parcs enfermés de murs s'ouvraient devant ces chasseurs d'une nouvelle sorte. Qu'importait, au propriétaire le plus jaloux de ses droits, le meurtre d'un épeiche ou d'une pie-grièche rose? Partout accueillis, partout fêtés, ils couraient d'un bout à l'autre du département, parmi les taillis, les prés, les vignes, les marais. Robert ne chassait pas. Mais il avait un flair extraordinaire pour deviner le passage d'un oiseau, pour découvrir la trace ou le nid du gibier, pour dire, par exemple: «Guillaume, je sens qu'il y a des bécasses dans les marouillers mêlés de bouleaux; la brume est violette; elle embaume la feuille morte.» Ou bien, quand le printemps argenté, au bord de la Loire, met en éveil tout le petit monde des luisettes, il était merveilleux pour apercevoir, immobile à la pointe d'une grève, un combattant aux plumes hérissées, ou encore, posée entre deux chatons de saule, comme une perle enchâssée, l'insaisissable fauvette bleue.
Son compagnon était adroit, et manquait rarement un coup de fusil. Au retour, ils travaillaient tous deux, soit au laboratoire du musée, soit à la maison des Pépinières, triant et classifiant leurs prises, disséquant les plus belles, préparant les peaux avec l'arsenic et la poudre de chaux. Mais Guillaume s'était réservé la pose. Lui seul, il bâtissait la carcasse de fil de fer ténu, la modelait à sa guise, et, avec une adresse, une science, une sincérité d'artiste indéniables, rendait à ces paquets de plumes la vie et le mouvement, la grâce et le lustre des ailes, et le trait, si fugitif, qui marque une humeur d'oiseau.
Presque au début de cette existence nouvelle, un événement s'était produit qui l'avait consacrée, assurée, embellie. Robert, très communicatif en apparence, causeur plein de verve et souvent plein d'esprit, s'était toujours montré d'une extrême réserve sur tout ce qui concernait sa famille. Il n'admettait personne dans les souvenirs, bons ou tristes, du passé, et se bornait à partager le présent, mais le plus volontiers du monde, avec ses amis. Le plus intime de ceux-ci ne savait pas où vivait Geneviève de Kérédol, ni quel parent l'avait recueillie, dans un château ou dans une ville, en France ou même ailleurs. Or, un jour de l'automne finissant de 1871, comme il s'agissait, entre les deux amis, de se procurer une espèce de grimpereau assez peu commun, le tichodrôme échelette, un oiseau charmant, à manteau gris perle avec des crevés rouges au fouet de l'aile, Robert assura qu'il connaissait le rendez-vous de tous les pics du département, qu'il se chargeait de la direction de l'entreprise et de trouver le gîte et le souper.
Ils arrivèrent, le lendemain soir, dans la cour d'un très vieux logis, en plein bois. Les murs et le toit jusqu'à la moitié disparaissaient sous les plantes grimpantes à peine taillées. Au-dessus des arêtes d'ardoises moussues, la futaie, en demi-cercle, étendait ses branches, et enveloppait, enserrait d'ombre l'habitation. En avant seulement, une nappe d'eau de dix hectares, dont les roseaux venaient frôler la grille de la cour, faisait dans ce rideau sombre une trouée de lumière.
Celui qui demeurait là, le grand-père maternel de Geneviève de Kérédol, n'était pas le propriétaire de la forêt. Il n'en possédait, selon son expression, qu'une motte verte. Mais il était hospitalier, veneur comme un roi de France, et mit aussitôt à la disposition des deux amis ses chiens, ses bateaux, ses cabanes d'affût et son garde aussi vieux que lui. Guillaume en profita largement, tandis que Robert demeurait au château. Il chassait du matin au soir, et quelquefois du soir au matin. Le tichodrôme échelette ne se montra nulle part. Mais il y avait toutes les variétés d'oiseaux de proie dans les hautes ramures des futaies et, sur l'étang, des sarcelles, des canards, des hérons, quelques-uns rares et presque introuvables ailleurs.
Et ce fut, pendant une semaine, pour Guillaume Maldonne, une succession de captures heureuses, un ravissement que contribuait à entretenir, au retour, la présence de la jeune fille, assez jolie, avenante et gracieuse surtout, souveraine maîtresse et joie unique du vieux logis. Guillaume l'aima sans l'avouer. Il était timide, il approchait de la quarantaine. Jamais il n'eût osé demander Geneviève, si peu riche et si simple qu'elle fût. Il hâta lui-même le départ. Le soir arrivé, il allait s'éloigner, très malheureux, emportant son secret; déjà, debout derrière le groupe que formaient ses hôtes et son ami causant ensemble à voix basse, autour de la cheminée, il regardait une dernière fois la jeune fille, avec cette douleur muette qui fixe nos regrets, quand Robert se leva, prit la main de Geneviève, et la mit dans celle de Guillaume, en disant: «Eh bien! mon cher ami, on attelle les chevaux: si tu te déclarais?»
Avec Geneviève Maldonne, avec Thérèse bientôt, le bonheur était entré au logis des Pépinières. Madame Maldonne y avait apporté sa gravité douce, son humeur égale, ce charme que certaines femmes possèdent au point que leur seule présence, un mot indifférent tombé de leurs lèvres, éveille comme de la reconnaissance. Thérèse avait été la vie, le mouvement, la gaieté. A peine elle était née, Robert l'avait incroyablement aimée. Il l'avait bercée bien souvent et promenée sur ses bras. Il lui avait appris à marcher et à s'amuser. Pour elle, il avait donné l'essor à son génie d'invention, trouvé des jouets, construit des moulins qu'on allait planter à la cime des vieilles souches, des bateaux avec des roues, des cerfs-volants et des poupées. Pour elle, surtout, il avait fait ce qu'il eût refusé de faire pour lui-même: il s'était remis à étudier. Et, pendant que son beau-frère, retenu au musée, continuait à préparer la plus belle collection ornithologique des provinces de l'ouest, M. de Kérédol apprenait à lire à Thérèse, lui expliquait le catéchisme, la grammaire, l'histoire qu'il avait relue l'instant d'avant, et puis ils jouaient tous deux, pour se reposer de la leçon, leurs deux rires se mêlaient, l'un par l'autre attiré, et l'on eût dit que Robert, parfois, redevenait tout jeune, à force d'aimer l'enfant.
Les moindres détails de ce temps-là lui demeuraient présents. Il se rappelait certaines robes qu'elle avait portées, une blanche toute brodée par la mère, une autre bleue, vers trois ans, et, un peu plus tard, une rose où il y avait un semis de pâquerettes, mais surtout des regards, des sourires pleins de ciel, des mots profonds qui n'en savent rien, des questions si fraîches qu'on les goûte avant d'y répondre. Car, entre elle et lui, c'était l'absolue confiance, la permission, conquise au prix d'un grand amour, de se pencher au-dessus d'une petite âme, et d'y lire. Robert lisait à livre ouvert dans celle de Thérèse, notait tout, gardait tout en lui-même, et, le soir, quand Thérèse dormait là-haut, dans son lit à rideaux blancs, la porte de l'escalier entre-bâillée pour que le moindre cri donnât l'éveil, il partageait son trésor: il racontait à la mère et au père l'histoire de la journée. Aux Pépinières, c'était le sujet habituel des conversations, sujet toujours cher, jamais épuisé, et qui se renouvelait à mesure que grandissait Thérèse. Les oiseaux mêmes ne venaient qu'au second plan.
Le plus extraordinaire, c'est que Thérèse ne fut pas gâtée. Elle demeurait soumise, prévenante, nature délicate qu'un reproche confondait, qu'on ne menait qu'avec de la bonté et de la raison, et qui comprenait à merveille son rôle, faisant sans compter autour d'elle, aux trois amis qui l'entouraient, l'aumône de sa jeunesse en fleur.
O heures délicieuses, heures sans nombre du passé, comme il était doux de vous revivre, et quelle consolation vous apportiez avec vous!
Le vent fraîchissait. Les bignonias, les rames de vigne ou de clématite, fouettés en tous sens, venaient toucher la main de Robert, comme pour dire: «Il est temps, voici la nuit noire et froide, rentrez, vous qui rêvez: vous avez reçu du soir ce que vous attendiez de lui!» Robert ferma la fenêtre, et quand il se retrouva dans le silence de cette chambre tiède, sentant la paix qui régnait au dedans de lui et autour de lui, il poussa un soupir de contentement. Toute impression pénible s'était effacée. Il revoyait Thérèse, sa Thérèse d'autrefois, toute naïve, toute rose, toute petite.
Et cela lui redonnait confiance, grande confiance dans la vie.
II
Le lendemain, quand Robert sortit de sa chambre, le soleil déjà haut chauffait les touffes de réséda semées en cordon le long de la façade, au midi. Par-devant, dans l'allée toute bourdonnante et traversée de rayons d'or par le vol des abeilles, Thérèse se promenait, prête à partir.
Elle avait mis une robe grise de voyage, une voilette blanche, un chapeau rond orné d'un piquet de coquelicots. Elle allait à pas relevés, et, au-dessus de sa tête, l'ombrelle qu'elle tenait ouverte, inclinée, rasant l'épaule, tournait comme un petit moulin. Quand Thérèse entendit M. de Kérédol descendre en se hâtant l'escalier:
– En retard, mon parrain! cria-t-elle. Huit heures et demie! Mon père est déjà rendu au musée. Moi, j'ai eu le temps de cueillir deux corbeilles de roses, que je vais envoyer pour l'adoration. Comment avez-vous dormi?
– Trop bien, comme vous voyez, répondit Robert, en paraissant sur le seuil de la porte.
– Moi, divinement! dit Thérèse.
Mais, presque aussitôt elle poussa un petit cri de surprise.
– Ah! mon parrain, je ne m'étonne plus que vous soyez en retard. Êtes-vous beau!
– Bah! bah! dit en riant M. de Kérédol, immobile sur la margelle d'ardoise étincelante de soleil. Que me trouvez-vous d'extraordinaire?
– Ceci d'abord, fit Thérèse en désignant du doigt l'épingle de cravate, un minuscule cheval arabe, en or ciselé. Elle est très jolie, d'ailleurs. Mais vous ne l'avez jamais portée ici. On ne me trompe pas, vous savez. Et puis ce chapeau neuf! Tout cela pour les loriots du bois de Laurette?
Robert, content d'être si vite découvert, prit la main que Thérèse lui tendait, et, la serrant entre les siennes:
– Non, mon enfant, pas pour les loriots: pour vous!
– Oh!
– Pour vos dix-sept ans, à qui je veux faire honneur! Que dirait-on, si, à côté d'une grande jeune fille comme vous, – car vous voilà grande, ma filleule, – on apercevait un parrain négligé?
Quelque chose d'ému, un frisson de plaisir et de reconnaissance passa sur le visage de Thérèse.
– Eh bien! vous voyez, dit-elle, c'est absolument comme mon dessus de clavier dont vous vous moquiez hier soir, ce que vous venez de faire là: c'est très inutile, car nous ne rencontrerons personne, mais je trouve ça charmant.
Elle se recula de deux pas, considéra un instant M. de Kérédol, son chapeau rond luisant, sa veste à larges boutons de nacre, ses gants, sa canne à pomme d'or, et, avec un petit geste, comme un salut de la main:
– Tout à fait votre air de colonel!
Rien ne flattait davantage l'ancien officier de chasseurs que cette appellation dont le qualifiaient quelquefois les passants ou les conducteurs d'omnibus. Un mot qu'il voulut dire, une exclamation d'amitié, ou l'ordre du départ, resta dans sa moustache. Elle savait trop bien le chemin de son cœur, cette Thérèse! Et Robert était comme beaucoup de soldats: quand le cœur lui battait, il n'avait plus que des gestes. Il leva donc sa canne, et se mit à marcher. La boîte verte lui pendait dans le dos.
– Si vous voulez, dit Thérèse en réglant son pas sur le sien, nous rentrerons par le faubourg?
– Pourquoi faire, mignonne?
– Pour prévenir mon petit commissionnaire habituel. Je vous ai dit que j'avais cueilli…
– Ah oui! Jean Malestroit. Il a grandi, le mioche: je l'ai vu, l'autre jour, sur le seuil de sa porte.
– Si gentil! fit Thérèse.
Tous deux furent bientôt dans la route qui montait à droite, et s'enfonçait dans la campagne. A peine deux ou trois fermes, au milieu des champs d'artichauts ou des plantations de pépinières. Les grillons, toutes sortes d'insectes invisibles, qui chantent à l'entrée de leurs trous, commençaient la longue complainte des jours chauds. On voyait, au bord des fossés, le luisant de l'herbe qui remue. Thérèse causait des détails de la vie quotidienne, de mille petites choses indifférentes pour tous autres qu'elle et Robert. Un passant qui l'aurait entendue se serait demandé pourquoi l'autre riait, pourquoi il s'animait et s'épanouissait, sans raison apparente, sans qu'elle eût rien dit que d'ordinaire, même sans qu'elle parlât, lorsqu'aux barrières des champs elle s'arrêtait un peu, et, toute droite, l'œil aux horizons, les lèvres entr'ouvertes, aspirait à pleine poitrine l'odeur de moisson mûre, qui venait, rasant le sol. Et cependant, que c'était bon, cette promenade avec l'enfant qu'il avait élevée, que c'était doux, ce bavardage sans suite et sans fin, où l'on ne quittait le présent que pour parler du passé, leurs deux domaines communs! Pas un mot inquiétant, pas une note nouvelle dont il pût s'alarmer.
– Vous n'avez pas fini votre légende d'hier? lui dit-elle. J'ai laissé la marquise Gisèle assiégée, et la jument grise bien maigre. Vous disiez: «Alors il arriva…» Je voudrais savoir ce qui est arrivé.
– Non, ma mignonne, répondit gaiement Robert, le temps de mes histoires est passé.
– Vous ne m'en raconterez plus?
– Non, je vous en lirai, des contes des grands auteurs, écrits pour les grandes jeunes filles.
– Oh! que c'est aimable! Je n'aurais pas osé vous le dire…
– Vous le désiriez?
– Sans doute, un peu. Mais comment faites-vous pour deviner ce que je désire?
– Je pense à vous.
– Et moi aussi, mon parrain, je pense à vous, et j'ai le cœur touché de vos attentions, bien touché, je vous assure!
«Comme je la retrouve! songeait Robert, Comme la voilà reconquise! Est-elle charmante, ce matin! Et jeune! Voyez-la!»
Et ils allaient tous deux légèrement.
Bientôt on prit les chemins de traverse. Ils étaient pleins de fleurs, pleins de vie, pleins de fuites d'ailes effarouchées. On se baissait à chaque instant, pour une étoile blanche ou jaune devinée sous le couvert des ronces. La boîte s'emplissait d'herbes. Celles qui n'étaient pas rares étaient au moins jolies. Thérèse avait des goûts qu'il fallait contenter. Ainsi l'avait résolu M. de Kérédol. Il cueillait tout ce qu'elle voulait: «Je n'herborise pas pour moi, songeait-il, je fauche pour elle.» Et, les pieds dans la boue traîtresse des creux des fossés, ou la tête dans les épines, il se mouillait, se piquait, et s'échauffait avec allégresse.
– Je regrette la tenue de colonel, disait Thérèse.
– Moi, je ne regrette rien, si vous êtes contente.
– Ravie!
– Et savez-vous, disait-il, que nous voici tout à l'heure en pleine famille d'orchidées: orchis abeille, orchis mouche, orchis araignée?..
– Où donc, parrain?
– Dans le bois, parbleu!
Chose curieuse, quand ils furent rendus sous la futaie, large et longue tout au plus comme un champ de moyenne taille, vestige d'ancienne forêt, ni l'un ni l'autre ne songeaient plus aux orchidées. Ils étaient las d'avoir tant marché, tant ri, et du soleil qui faisait danser l'air à la hauteur des yeux. Le dôme des feuilles gardait un reste de rosée évaporée, avec le lourd parfum qui monte du sol des bois. A peine eut-il foulé la mousse, et senti sur ses épaules la caresse des premières ombres, M. de Kérédol perdit sa belle ardeur, chercha la place la plus fraîche, sans une moucheture d'or, la trouva au bord d'un fossé d'eau courante, et s'assit en s'épongeant le front. Thérèse tourna un peu, pour ne pas avoir l'air aussi fatiguée que son parrain, affecta de s'intéresser à des fougères, eut une phrase banale sur la douceur de l'ombre, et finalement s'assit à trois pas de lui. Elle arrangea les plis de sa robe, à petits coups songeurs, et se mit à regarder devant elle. Il en faisait autant de son côté, mais, tandis qu'il était seulement silencieux, elle se sentait peu à peu envahie par une mélancolie, un malaise d'âme grandissant, le revers de l'excessive gaieté qu'elle avait eue. Cela vient ainsi, tout jeune qu'on soit. Et Thérèse eut un soupir qui fit se retourner Robert. Il la considéra un instant, et remarqua le changement qui s'était produit en si peu de temps dans la physionomie de sa filleule. Sous la voilette relevée, les yeux de Thérèse grands ouverts, sérieux et comme voilés d'une pensée qu'il ne pouvait lire, fixaient un point de l'horizon. Était-ce le moulin, là-bas, de l'autre côté de la Loire, gros comme un hanneton qui secoue ses élytres, ou les traînées pâles des champs de colza rayant les pentes, ou le nuage roulé, immobile dans l'océan de lumière où pas un souffle ne courait? Non, sans doute. La bouche avait un pli léger, et tout le visage cette lueur égale et comme cette transparence qu'il prend lorsqu'aucun objet du dehors ne l'impressionne plus, et qu'il reflète seulement un songe intime du cœur.
– A quoi rêvez-vous? demanda M. de Kérédol.
– Moi? à rien, répondit-elle sans bouger.
Robert jugea politique d'opérer une diversion, se pencha en avant, au-dessus du courant qui filait, rapide et bleu d'acier, parmi les cressons, les acanthes, toute une végétation réfugiée là contre l'ardeur de l'été, et cueillit une tige couronnée d'un corymbe de fleurs blanches.
– Reine des prés, dit-il, spiræa ulmaria, famille des Rosacées. Voyez, Thérèse, est-elle élégante!
Thérèse fit à la plante l'aumône d'un regard distrait.
– Dites-moi, demanda-t-elle en rabaissant sa voilette, maman s'est bien mariée à dix-huit ans, n'est-ce pas?
– Oui, dix-huit ans, répondit rapidement Robert… Je crois, Thérèse, que vous n'avez jamais étudié la reine des prés. Tenez, la feuille est ailée, duvetée en dessous, à folioles ovales. J'ai lu quelque part qu'en infusant les fleurs dans du vin, on obtient le bouquet du fameux Malvoisie!
Et il observait, sur le visage de la jeune fille, maintenant tournée vers lui, l'effet de cette pointe habile. Elle n'en parut pas touchée.
– Vraiment? dit-elle… Mais, dix-huit ans… mon parrain, savez-vous que je les aurai l'année prochaine? Ce serait très drôle si…
– Qu'est-ce qui serait drôle, mon enfant?
– Non, pas drôle précisément. Je veux dire, reprit-elle, – et son sourire éclatant, toute sa jeunesse enjouée reparut sur ses joues, sur ses lèvres, dans ses yeux qu'animait un éclair de soleil venu on ne sait d'où, – je veux dire que peut-être, vous comprenez bien, peut-être quelqu'un pourrait penser à moi aussi… Eh bien! cela me fait rire malgré moi.